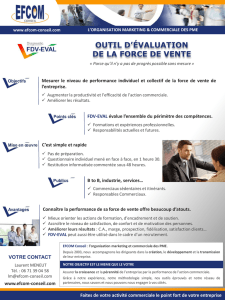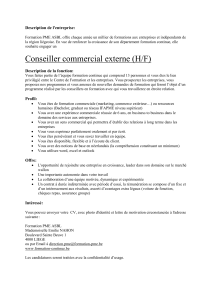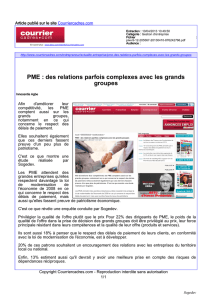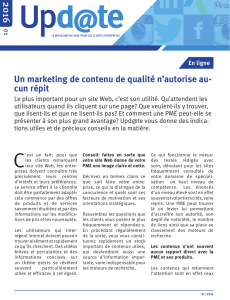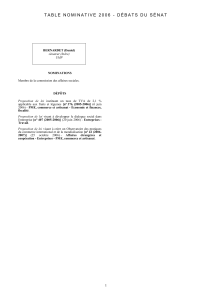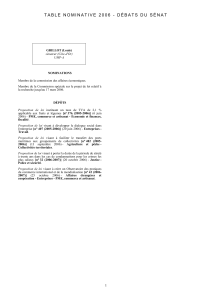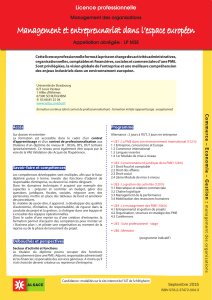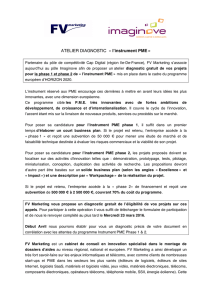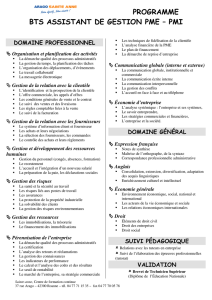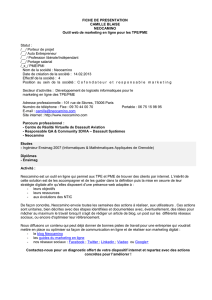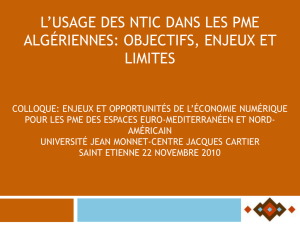TABLE DES MATIÈRES
Introduction
1. Les différentes formes d'investissement et la spécificité des PME camerounaises
1.1. Investissement en capital fixe et investissement en capital circulant
1.2. Investissement de renouvellement et investissement net
1.3. Investissement de capacité et investissement de rationalisation
1.4. La complexité du problème de l'investissement dans l'économie sous-
développée
2. Les déterminants traditionnels de la décisiond'investissement dans les PME
camerounaises
2.1. Les déterminants traditionnels de la décision d'investissement : la primauté
des déterminants financiers
2.1.1. Les anticipations des entrepreneurs
2.1.2. L'importance du coût du capital
2.1.3. Les critères de choix des investissements
2.2. L'importance du problème technologique dans les PME camerounaises
Conclusion
Bibliographie
Introduction
Le rôle moteur de l'investissement dans le processus d'accumulation a constamment été
souligné par l'analyse économique et plus spécialement par KEYNES et les néo-
classiques. Aujourd'hui, ce rôle fait l'objet de nombreux développements et controverses
quant à son rythme, à l'opportunité de certaines de ses formes ou quant à son opportunité
tout simplement.

Si les apports théoriques contemporains sur le sujet 1 permettent de prolonger ou d'élargir
le champ des investigations au cadre spécifique des micro-comportements, ils présentent
surtout, par rapport à l'analyse sur les PME camerounaises un intérêt particulier. L'aspect
majeur de cet intérêt est la démarche que ces différentes analyses suscitent et que l'on
peut situer ici à trois niveaux :
• au niveau de la nature de l'investissement
• au niveau des facteurs déterminants de l'investissement
• au niveau du comportement actif ou passif des entrepreneurs dans la régulation de
l'activité.
La prise en compte de ces préoccupations nous semble de nature à contribuer à l'analyse
de la spécificité de l'investissement dans les PME camerounaises. Elle devra nous
permettre notamment d'en dégager les caractéristiques par rapport à l'analyse théorique,
puis d'en déterminer l'impact sur le processus de développement de ces unités de
production.
En fait, les PME camerounaises possèdent un certain nombre de particularités qui
peuvent expliquer que l'on s'interroge sur les possibilités réelles de développement de
l'investissement dans l'économie camerounaise par le biais de ces entreprises.
D'une manière générale, les PME peuvent être définies comme des unités à l'échelle
humaine ou familiale souvent dirigées par un seul homme propriétaire du capital qui
assume ou cherche à assumer toutes les fonctions essentielles de l'entreprise. Cette
définition, si elle est générale et peut s'appliquer à l'ensemble des PME, elle nous permet
notamment de souligner deux caractéristiques majeures inhérentes à la manière dont
naissent et fonctionnent les PME camerounaises. La première est relative à la propriété
du capital et au mode de financement de l'activité, la deuxième, à l'organisation et à la
structure de l'entreprise qui en découle. Cette caractérisation permet en effet de
comprendre et de poser les principaux problèmes relevés à l'observation des PME
camerounaises 2 , à savoir :
• la faiblesse de leurs ressources propres et l'importance des coûts financiers que les
PME doivent supporter du fait du recours à des ressources d'emprunt dont les
crédits bancaires
• l'importance des coûts technologiques et des consommations intermédiaires
inhérents aux choix sectoriels et à une mauvaise maîtrise d'une technologie
empruntée et appliquée à l'outil de production
• une organisation sommaire de l'activité et de sa gestion qui aggrave, nous semble-
t-il, l'ensemble des coûts et des charges récurrentes de l'entreprise et dont le
caractère évolutif témoigne des limites de l'effet de levier financier de
l'endettement.
Les appréhensions par rapport à ces problèmes des PME camerounaises se justifient pour
au moins deux raisons : celle liéecaractère structurel des difficultés des PME et celle
attachée à la complexité de l'investissement et que ces problèmes laissent entrevoir.

Certaines des questions qu'il convient alors de se poser se rapportent aux conditions de
création d'un investissement efficient dans ces PME puis à la capacité de ces entreprises à
intégrer suffisamment ces contraintes dans leur décision d'investir.
En effet ce qui caractérise l'investissement c'est le temps long et les étapes successives
nécessaires pour créer une richesse. Cette variable s'apprécie alors sur un double plan
économique et financier :
• sur le plan économique il consiste en la création d'un capital physique qui
contribue à l'activité de production sur plusieurs cycles successifs;
• sur le plan financier, il se rapporte à l'immobilisation de capitaux dans une
perspective de profits.
Cette double nature de l'investissement met en lumière, à notre avis, deux aspects
fondamentaux :
• d'abord l'investissement est un arbitrage entre le présent et le futur lequel conduit
à engager une dépense immédiate puis à en attendre les effets dans un futur plus
ou moins lointain;
• ensuite, l'investissement est un pari. Ainsi, que l'on raisonne dans un avenir
certain ou dans un univers incertain, l'entrepreneur qui décide d'investir prend un
risque.
Il peut s'agir aussi bien d'un risque économique que d'un risque financier. Le risque
économique tient à la variabilité possible des résultats due à des modifications pouvant
intervenir dans la concurrence, la technologie, la conjoncture... Quant au risque financier,
il se rapporte au recours à des capitaux d'emprunt pour boucler le financement du projet
ou de l'activité de l'entreprise.
Risque et anticipation semblent donc être des caractéristiques importantes de
l'investissement qui nous amènent au questionnement suivant :
• d'abord quelle est la nature de l'investissement dans l'entreprise en général et dans
la PME camerounaise en particulier ?
• ensuite quels sont les facteurs pris en compte par les entrepreneurs dans les PME
dans leur décision d'investissement?
Quelle signification revêt le comportement actif ou passif des entrepreneurs ? Quel est
son impact dans la régulation de l'activité ? Quel rôle y jouent les anticipations ?
Nous allons, pour répondre à ces différentes questions, procéder en deux temps :
• dans un premier temps nous présenterons les différentes formes de
l'investissement telles qu'elles sont appréhendées par l'analyse théorique; ce sera

alors l'occasion de mettre chacune d'elles en rapport avec le réalité telle qu'elle est
vécue dans les PME camerounaises et d'en souligner l'intérêt et la particularité
• nous pourrons ainsi dans un deuxième temps faire ressortir les facteurs de ces
particularités, c'est-à-dire, les déterminants de la décision d'investissement dans
les PME camerounaises.
Nous ne présentons pas d'étude de cas dans ce document, cela risquerait de rallonger
davantage le texte. Nous l'avons fait dans un travail précédent3 dont nous nous inspirons
ici et qui peut éventuellement compléter de manière avantageuse l'information du lecteur.
1 - LES DIFFERENTES FORMES D'INVESTISSEMENT ET LA SPECIFICITE
DES PME CAMEROUNAISES
Nous nous limiterons ici à l'analyse de l'investissement productif par opposition à
l'investissement financier. Nous précisons que la présentation que nous ferons des
différents types d'investissement 4 n'est nullement restrictive dans la mesure où le même
investissement peut être caractérisé par l'une et l'autre forme à la fois. Nous voulons
surtout souligner dans cette analyse les problèmes majeurs que soulève d'une manière
globale l'utilisation du capital à savoir l'usure, l'obsolescence, la sous-capitalisation, le
surinvestissement etc... Nous nous appesantirons chaque fois sur leurs implications sur la
création, le développement et la gestion des PME camerounaises.
1.1 - Investissement en capital fixe et investissement en capital circulant
Le concept d'investissement est lié à celui de capital et, les économistes s'accordent pour
dire que la notion de capital pose un problème de définition 5. D'une façon générale on
distingue sur ce point deux conceptions opposées :
• d'abord le capital est considéré comme un ensemble de ressources financières en
quête d'une rémunération. Ce capital lorsqu'il est possédé par une entreprise au
début de son activité de production va être engagé dans le processus de
production, sous forme d'investissement;
• le capital peut être également conçu comme cette quantité physique de biens qui
au terme du cycle induit un enrichissement net. Cette accumulation de capital
suppose le recours à l'endettement ou à une autre forme de financement.
Ces deux approches ne semblent pas définitivement antagonistes. Elles devraient même
être rapprochées pour une meilleure intelligence de la relation de circularité qui apparaît
entre l'investissement et le capital et une appréhension plus large de la notion sous-
jacente de coût du capital.

Le processus de production se réalise en effet par absorption totale ou partielle d'un
ensemble de biens qui sont par ce fait incorporés dans le produit fabriqué, la distinction
entre capital fixe et capital circulant s'établissant dans la manière dont se réalise cette
incorporation. Ainsi, certains de ces biens appelés capital circulant et comprenant les
matières premières, les consommations intermédiaires disparaissent totalement au terme
du processus de production.
En fait, la notion de capital circulant est d'une grande complexité et ne fait pas toujours
l'unanimité des auteurs qui l'utilisent. L'un des aspects sur lesquels elle permet d'insister
est celui de la prise en compte ou non de paiement du salaire comme élément constitutif
de l'investissement en capital circulant 6.
Nous n'avons pas voulu intégrer cet élément parmi ceux qui composent le capital
circulant à cause de l'hétérogénéité du salaire dans les PME, objet de notre analyse. La
signification du salaire nous semble différente selon qu'il est payé aux ouvriers locaux ou
aux techniciens étrangers et risquerait de poser un problème d'homogénéité.
Le capital circulant s'oppose ainsi au capital fixe dont le stock demeure présent dans
l'entreprise et est constitué de l'ensemble des biens d'équipements. Certes, ceux-ci ne
disparaissent pas physiquement dans un même processus de production mais à chaque
étape ils subissent une "érosion" due à leur incorporation à la production. Cette forme de
consommation spécifique aux biens de capital se traduit souvent dans l'usure qui est une
dépréciation physique au fur et à mesure de l'utilisation. Mais, elle se manifeste
également dans l'obsolescence qui est plutôt une usure économique due au progrès
technique.
La prise en compte de la distinction entre investissement en capital fixe et investissement
en capital circulant est fondamentale ici dans la mesure où elle nous permet de soulever
au moins deux types de problèmes par rapport au choix de projet d'investissement par les
entreprises.
a) D'abord l'investissement concerne à la fois l'acquisition de machines de production et
celle de matières premières et de biens intermédiaires correspondant à la production à
réaliser. Le choix de tout bien d'équipement doit donc s'effectuer dans cette perspective,
c'est à dire intégrer l'ensemble des problèmes inhérents à l'acquisition de matières
premières et biens intermédiaires nécessaires à la fabrication du produit fini. Il s'agit
donc principalement de problèmes de sources et de délais d'approvisionnement qui
peuvent jouer considérablement, pour les PME camerounaises, sur le coût final des
investissements et sur le rythme de la production, les équipements et les inputs
provenant de l'extérieur pour leur grande part.
b) En outre, les équipements n'ont pas une durée de vie indéterminée. Leur choix doit
donc tenir compte de leur âge, de l'évolution de la technique et des risques que prend
l'entreprise en terme de coûts de maintenance, d'obsolescence, de compétitivité. Ce
dernier type de problèmes qui résultent de la dépréciation du capital du fait de la
production nous permet déjà de prévoir ou entrevoir les difficultés de fonctionnement
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
1
/
29
100%