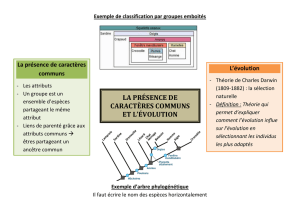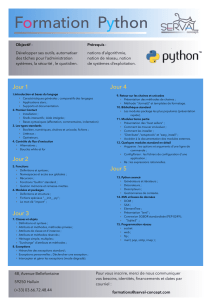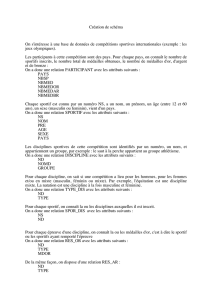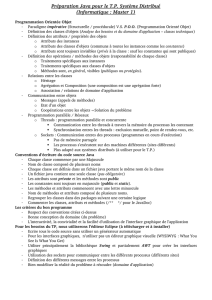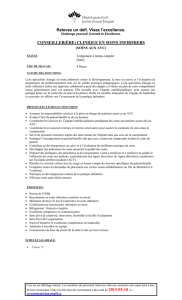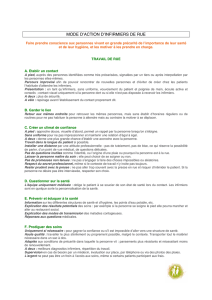otion de concept - Banque de données en santé publique

EXPLORATION DE LA BASE THÉORIQUE DES SOINS INFIRMIERS
À
L’AIDE DE
TECHNIQUES AVANCÉES D’ANALYSE DE CONCEPT
Janice
M. MORSE, PhD (Docteur) en soins infirmiers, PhD en anthropologie,
FAAN
Professeur de Soins Infirmiers et de Science du Comportement
Ecole d’lnfirmières
Université de I’Etat de Pennsylvanie
TRADUIT PAR L’ARSI
L’article
«
Exploring the theorical basis of nursing using advanced techniques of concept analysis
»
a été publié dans la revue américaine :
“
Journal of advanced nursing” Mars 17(3) 1995 p. 31-46
Nous remercions la rédaction de cette revue de nous avoir donné l’autorisation
de traduire et de publier cet article en français dans la revue :
«
Recherche en soins infirmiers
»
RÉSUMÉ
EXPLORATION DE LA BASE THÉORIQUE
DES SOINS INFIRMIERS À L’AIDE DE
TECHNIQUES AVANCÉES D’ANALYSE
DE CONCEPT
Cet article est une critique des méthodes tradition-
nelles de développement de concepts et une présen-
tation
d’autres méthodes ayant recours aux
méthodes qualitatives d’enquête. Vient ensuite une
description des variations des techniques de déve-
loppement de concepts appropriées à la maturité du
concept exploré, incluant des méthodes de délimita-
tion de concept, comparaison de concept, clarifica-
tion de concept, correction de concept et identifica-
tion
de concept. Afin d’illustrer l’application des
méthodes de développement de concept à la théorie
des soins infirmiers, on présentera un programme de
recherche pour délimiter l’élaboration du concept
de bien être.
Mots clés : bien-être, développement de concept,
recherche en soins infirmiers, théorie des soins infir-
miers.
LA REDACTION
OTION DE CONCEPT
SUMMARY
EXPLORINC THE THÉORETICAL BASIS
OF NURSING USINC ADVANCED
TECHNIQUES OF CONCEPT ANALYSIS
In this article, the traditional methods of concept
development are critiqued, and alternative methods
that use qualitative methods of inquiry are
presen-
ted. Variations of concept development techniques
appropriate to the maturity of the concept being
explored are then described, including methods for
concept delineation, concept comparison, concept
clarification, concept correction, and concept iden-
tification. TO illustrate the application of concept
development methods to nursing theory, a research
program to delineate the construct of comfort is des-
cribed.
Keywords: comfort concept development, nursing
research, nursing theory
Recherche en soins infirmiers N” 58
-
Septembre 1999

OTION DECONCEPT
EXPLORATION DE LA BASE THÉORIQUE DES SOINS INFIRMIERS
À
L’AIDE DE TECHNIQUES
AVANCÉES D’ANALYSE DE CONCEPT
DANS SON APPEL en faveur d’une recherche qui se
ferait plutôt sur que
dans
ce qu’on appelle
«
la santé
»,
Illich a noté que «la faiblesse des soins réside dans ses
concepts et ses mots plutôt que dans ses procédures
insignifiantes mais assez coûteuses
».
Par essence, il a
appelé à une recherche se concentrant plutôt sur la
façon dont les gens perçoivent la santé que sur le type
de soins que prodiguent les médecins. Alors que les
philosophes ont consacré du temps à débattre de
l’éthique et des valeurs du système de santé, on a passé
relativement peu de temps à examiner les fondations
théoriques du système de santé, des soins fournis et
même de la santé elle-même.
Les soins infirmiers, étant relativement des nouveaux
venus dans la recherche en santé, ont progressé Iégère-
ment plus en recherche conceptuelle que les autres
disciplines de soins. La synthèse biocompor-tementale
de la perspective infirmière a exigé des soins infirmiers
qu’ils se conforment aux normes des sciences sociales
ainsi qu’à celles des sciences physiques. Cela a obligé
le personnel infirmier à être attentif aux principes de la
recherche en philosophie ainsi qu’aux préoccupations
d’ordre épidémiologique; aux perspectives micro et
macro, et à la cellule, la personne et la communauté.
Inévitablement, la discipline a profité de la combinai-
son de perspectives aussi variées : pendant plus d’une
décennie, un nombre croissant de chercheurs en soins
infirmiers a été attentif aux fondements théoriques des
soins infirmiers qui donnent naissance à la fois à la
recherche et à la pratique. Depuis plus de deux décen-
nies, les élèves infirmiers s’intéressent aux composants
conceptuels de la théorie des soins infirmiers et les
techniques d’analyse de concept sont devenues un
point classique du programme de doctorat. Malgré ces
avantages, il reste encore beaucoup de travail d’explo-
ration conceptuelle à accomplir. Une grande partie de
la connaissance en matière de soins infirmiers reste
non-développée, implicite, non reconnue ou mal
adaptée au contexte clinique.
Dans les publications sur les soins infirmiers, il est de
plus en plus commun de trouver des articles qui déve-
loppent des concepts importants. Nombre de ces
articles utilisent une technique de développement de
concepts attribuée à Wilson et introduite dans le
domaine des soins infirmiers par Walker et Avants et
al. La méthode de Wilson de développement de
concepts utilise des «cas construits
-
souvent hypo-
thétiques
-
et des exemples uniques de prototype qui
soutiennent ou contredisent le concept ou représen-
tent un exemple allié ou un idéal hypothétique.
Récemment, Rodgers a mis au point la vue évolution-
niste du développement du concept en utilisant des
données brutes (c’est à dire soit des publications, soit
des interviews). II s’agit, dans la méthode de dévelop-
pement du concept, de prendre en considération le
contexte (c’est à dire les antécédents, les consé-
quences et les relations aux autres concepts) mais de
retenir le but final de développement d’un cas modèle
de prototype.
Mon argument, dans cet article, consiste à dire que la
méthode Wilson d’analyse de concept simplifie la
complexité du développement de concept et produit
souvent des résultats insignifiants et sans intérêt. Les
attributs identifiés sont privés de leur contexte si bien
que l’application pratique en est impossible, et les
résultats sont souvent si évidents que les efforts d’ana-
lyse ne permettent même pas de faire avancer la
connaissance en matière de soins infirmiers. Par
exemple, une analyse du concept d’espoir résulterait
dans l’identification de quatre attributs :
«
(1) L’objet de
l’espoir est important pour la personne; (2) l’espoir est
un processus qui inclue les pensées, les sentiments, les
comportements et les relations; (3) il y a un élément
d’anticipation; et (4) il y a une orientation positive de
l’avenir qui est ancrée dans le présent et liée au passé.
L’identification de ces attributs a peu de signification
pragmatique. De plus, leur validité peut être remise en
question, puisqu’ils pourraient tous être appliqués à
d’autres concepts, tels que la peur ou l’anxiété.
En revanche, alors que la vue évolutionniste est une
avance majeure, le but du développement d’un cas
modèle limite encore l’utilité de la méthode. Ainsi, la
dépendance continue des procédures dérivées de
Wilson ne permettra pas de produire une base théo-
rique utile. Comme la base théorique est le fondement
de la recherche et de la pratique en soins infirmiers, à
l’heure d’aujourd’hui, le besoin le plus urgent de déve-
loppement méthodologique dans les soins infirmiers se
manifeste dans le domaine de l’investigation concep-
tuelle.
Cet article présente une méthode d’analyse de concept
qui utilise l’investigation qualitative comme outil pri-
maire de développement de concept. La description
des variations de la technique sert à illustrer les
méthodes d’esquisse de concept, de comparaison de
concept, de clarification de concept, de correction de
concept et d’identification de concept. Pour finir, je
présenterai la contribution du développement du
concept dans le cadre d’un programme en cours de
recherche pour esquisser la construction de la notion
de bien-être.
36
Recherche en soins infirmiers N” 58
-
Septembre 1999

EXPLORATION DE LA BASE THÉORIQUE DES SOINS INFIRMIERS
À
L’AIDE DE TECHNIQUES AVANCÉES D’ANALYSE DE CONCEPT
CARACTÉRISTIQUES DES CONCEPTS
Chinn et Kramer ont défini un concept comme «une
formulation mentale complexe d’une expérience empi-
rique
».
Les concepts sont des
«
représentations cogni-
tives abstraites d’une réalité perceptible à partir d’une
expérience directe ou indirecte. Ils vont des observa-
tions empiriques directement observables à des déduc-
tions mentales indirectement observables et relative-
ment abstraites. Notre compréhension actuelle de
l’acquisition de concepts est dérivée de la psychologie
et tout d’abord des théoriciens du développement qui
étudient la formation de concept et la linguistique,
et des anthropologues cognitifs particulièrement dans
les domaines des ethnosciences et de la formation de
catégorie.
Lorsqu’on étudie les débats qui entourent l’analyse
de concepts, il en ressort avec évidence une confu-
sion terminologique entre les «catégories
»
et les
«concepts», et il arrive que ces termes soient inter-
changés. Lors de la vérification des concepts,
la distinction entre les deux a des implications
méthodologiques. La même appellation de concept
(par exemple espoir) peut se rattacher à l’émotion de
manière générale, ou elle peut être liée à une applica-
tion particulière, comme par exemple le type de mani-
festation de l’espoir chez les patients qui ont subi une
transplantation. Quand on regroupe de manière col-
lective les différents types d’espoir, ils forment une
catégorie qui s’appelle «espoir. De plus, à cause de la
nature abstraite des concepts, ces derniers sont véri-
fiés par la détermination de leur composants, compo-
sants qui ont des appellations variées dans les docu-
mentations telles que : éléments constitutifs, attributs,
caractéristiques, propriétés, particularités essentielles
ou définissantes et critères.
MÉTHODES D’ANALYSE DE CONCEPT
Quatre équipes de recherche ont, à l’heure actuelle,
esquissé des méthodes d’analyse de concept dans les
soins infirmiers. Certaines de ces méthodes ont recours
à des cas uniques et d’autres à des descriptions d’ob-
servations d’incidents ou d’événements pour mettre à
jour les attributs du concept. Par exemple, la méthode
Avant (adaptée de Wilson) utilise des études de cas
uniques pour mettre à jour les attributs essentiels d’un
concept :un cas modèle, un cas contraire, un cas
limite, un cas apparenté, un cas illogique et un cas
inventé. D’autres auteurs ont publié des descriptions
du concept ou des exemples de l’utilisation du concept
pour identifier les attributs conceptuels. De manière
surprenante, ce n’est que récemment, dans le domaine
des soins, que les méthodes de développement de
concepts ont dépassé le stade de la référence aux
publications pour utiliser des méthodes qualitatives,
qui permettent de recourir à la technique d’utilisation
des situations réelles comme données de base pour
développer des concepts. Le modèle hybride utilise des
observations cliniques pour engendrer et développer
des concepts et Rodgers et Knafl ont décrit comment
ils utilisent des groupes de focalisation pour décrire le
concept de chagrin. (Notez que je n’ai pas pris ici en
considération tout le travail qui a recours à la théorie
de base pour développer une théorie de moyenne por-
tée et pour affiner les concepts, car le but d’une théorie
de base est avant tout de développer une théorie plutôt
que d’identifier et de raffiner des concepts. Cependant,
à l’occasion, il arrive que cette méthode conduise
effectivement à la correction de concepts.)
Le choix d’une méthode pour l’analyse de concepts
dépend en premier lieu des critères de définition pour
intégrer un concept dans une catégorie conceptuelle,
et en second lieu, des méthodes utilisées pour I’identi-
fication des catégories conceptuelles.
Critères de définition
Ce débat sur l’opportunité d’inclure un concept dans
une catégorie conceptuelle est centré sur la rigidité de
la présence ou de l’absence de critères nécessaires à la
définition des caractéristiques qui forment le concept
et sur les exigences minimum d’appartenance à la
catégorie. Le courant classique insiste sur la présence
de critères rigoureux; le courant probabiliste est plus
tolérant, acceptant une appartenance partielle, si bien
que deux concepts peuvent appartenir à la même caté-
gorie à condition que certains de leurs attributs soient
similaires.
Le courant classique
Medin a relevé que le courant classique ou la théorie
de structure conceptuelle exige que tous les cas ou
exemples d’une catégorie aient certaines
«
caractéris-
tiques fondamentales en commun pour déterminer leur
appartenance à une catégorie. C’est à dire que les attri-
buts d’espoir identifiés chez les patients ayant subi des
transplantations cardiaques doivent être identiques aux
attributs d’espoir manifestés chez ceux souffrant de
37
Recherche en soins infirmiers N” 58
-
Septembre 1999

problèmes de mœlle épinière pour que le concept
puisse avoir l’appellation «espoir
»
dans les deux
contextes. Le courant classique a été critiqué pour plu-
sieurs raisons. Tout d’abord, il ne permet pas d’identi-
fier les caractéristiques de définition dans chaque cas;
ensuite, il a recours à une règle irréaliste selon laquelle
tous les exemples d’un concept ont la même «valeur
»
car ils possèdent toutes les caractéristiques requises de
définition; et troisièmement, il ne tolère pas
I’am-
bigüité. En d’autres termes, le courant classique insiste
sur l’uniformité et ne tient pas compte des exceptions,
des contradictions ou des désaccords. Les critères
rigides et irréalistes de la perspective classique ne sont
ni vraisemblables ni utiles dans la pratique.
Le courant probabiliste
Le courant probabiliste accepte la notion selon
laquelle les structures de la catégorie sont organisées
autour d’une série de propriétés ou groupes d’attributs
rattachés. Cette perspective est basée sur la similarité
et renonce aux exigences rigides de critère d’apparte-
nance à une catégorie. Deux exemples peuvent se par-
tager certains des attributs conceptuels (mais pas tous)
et faire quand même partie de la même catégorie.
Ainsi, cette perspective permet des variations à I’inté-
rieur d’une catégorie et le degré de points communs
définit la force de la relation du concept à la catégorie.
Alors que ce courant est compatible avec de nom-
breuses techniques statistiques, telles que l’analyse de
facteur, il faut noter que le recours aux techniques sta-
tistiques ne peut nous donner des informations que sur
une seule catégorie par le biais de sa force d’associa-
tion. II faut quand même identifier au départ la perti-
nence des variables avant de les inclure dans une série
de données et des raisonnements théoriques sur les
variables doivent être développés afin de les inclure
dans un ensemble de données ou de leur accorder une
position d’attribut possible.
Méthodes d’identification de concept
Tous les auteurs qui s’intéressent au développement de
concept s’accordent à dire que, alors qu’une définition
du dictionnaire peut fournir un premier éclaircissement
sur le sens d’un concept, elle est insuffisante. Chinn et
Kramer ont noté que plus le concept est abstrait, plus il
est complexe d’identifier les critères. Deux méthodes
sont utilisées au départ : l’exemplaire et le prototype.
Le courant exemplaire rejette l’utilité des définitions et
prétend que le meilleure représentation des catégories
se fait par le biais d’exemples. Cependant, les
exem-
plaires illustrent leurs théories par la description et le
sous-entendu plutôt que par la définition, si bien que le
lecteur doit avoir recours à la déduction pour établir le
lien entre l’exemple et le concept.
Selon la perspective prototype, un exemple d’un
concept doit posséder
toutes
les caractéristiques d’une
catégorie (conceptuelle) (italiques rajoutées) et
I’inclu-
sion dans une catégorie est permise si un exemple est
«suffisamment similaire
»
et possède toutes les caracté-
ristiques essentielles de définition. Je développe dans
cet article l’argument suivant : les méthodes de
recherche qualitative pour le développement de
concept ont recours à une version modifiée de la
méthode des prototypes. C’est à dire, toutes les carac-
téristiques primaires d’un concept doivent être pré-
sentes, mais ces caractéristiques peuvent se manifester
sous des formes différentes, selon le contexte dans
lequel le concept est utilisé. Lorsque le concept est très
abstrait, la caractéristique essentielle du concept peut
être identifiée par l’utilisation des «règles de relation
»
de Bolton, et cette méthode devient l’outil primaire
d’identification de l’expérience que les participants ont
de la réalité qui définit le concept.
Les règles de relation sont les modèles stables d’utili-
sation des facteurs, attributs, propriétés ou caractéris-
tiques qui forment le concept. Bolton avait tendance
à soutenir le courant classique en faisant observer que
chacun des attributs identifiés doit apparaître dans
chaque application du concept. Selon lui, ces attri-
buts forment le concept et sans eux, le concept
n’existerait pas. Ainsi, ces attributs apparaissant dans
chaque cas où se présente le concept, ils sont donc
universels.
Bolton
a prévenu qu’il était erroné de «se concen-
trer sur la dernière phase des concepts bien établis,
puisque ces règles de relation devenaient implicites
»
;
le chercheur devrait plutôt se concentrer sur
«
le pro-
cessus de formation du concept lui même
».
L’examen
de la formation des concepts est facilité par l’utilisation
des règles de relation de
Bolton
et la méthodologie
qualitative. Les règles de la relation sont les suivantes :
* Les concepts expriment les façons dont s’est organi-
sée l’expérience, à partir de l’intention du sujet.
* Tous les concepts sont les résultats de cas particuliers
qui deviennent généraux, en les considérant comme
des exemples d’un type ou d’une règle, et ces significa-
tions générales sont stabilisées par l’utilisation du lan-
gage dans l’interaction sociale.
* Les concepts sont les résultats de coordination et les
éléments inhérents au concept sont ordonnées par
cette même relation.
38
Recherche en soins infirmiers
No
58
-
Septembre 1999

EXPLORATION DE LA BASE THÉORIQUE DES SOINS INFIRMIERS
À
L’AIDE DE TECHNIQUES AVANCÉES D’ANALYSE DE CONCEPT
* Un individu perçoit un concept comme un moyen
d’organiser des événements et s’attend à ce que le
concept puisse être appliqué à des cas nouveaux.
* Parce qu’un concept est l’application d’une règle à
une situation particulière, la formation de concept doit
être étudiée en examinant
«
la corrélation émergente
entre ces actes et les conditions de stimulus auxquelles
elles sont apparentées ». II y a une «relation réci-
proque
»
entre les actes interprétatifs par lesquels nous
construisons nos modèles de réalité et les propriétés de
la réalité elle même.
Bolton a ainsi défini un concept comme «une organisa-
tion stable de l’expérience de la réalité, rendue pos-
sible par l’utilisation des règles de relation et à laquelle
on peut donner un nom.
Un individu perçoit un concept comme un moyen
d’organiser des événements en pensant pouvoir
appliquer ce concept à de nouveaux cas.
Cependant, alors que les applications de ces règles de
relation identifient les attributs universels, les méthodes
qualitatives prennent en considération l’extension de la
perspective de prototype en permettant l’identification
des attributs communs des concepts qui appartiennent à
la même catégorie conceptuelle mais se manifestent
sous des formes différentes. Ces manifestations variées
des concepts découlent des contextes, causes, et
contingences directes dans lesquels apparaît le concept.
Ces processus, conditions et contingences donnent
forme au concept et il se manifeste de différentes façons
selon son utilisation. Ce sont ces processus qui engen-
drent la variation conceptuelle et permettent pourtant
aux concepts de se maintenir dans la même catégorie
conceptuelle, et c’est cette tolérance qui contrebalance
l’esprit critique du courant classique. Finalement, la
façon la plus aisée d’identifier ces règles de relation qui
caractérisent les diverses manifestations du concept est
de recourir aux méthodes d’investigation qualitative qui
utilisent des données réelles ou extraites de documents
plutôt que des «cas inventés
»
et de brefs comptes ren-
dus qui manquent de détail.
LE DÉVELOPPEMENT DE CONCEPTS PAR LES
MÉTHODES QUALITATIVES
Le chercheur qui travaille avec des méthodes qualita-
tives a donc recours aux règles de relation pour identi-
fier les attributs d’un concept, délimiter ce concept et
documenter les diverses formes sous lesquelles se
manifestent les attributs. Dans ce but, on peut se servir
des méthodes d’investigation qualitative en utilisant
des données tirées d’observations et d’entretiens ou
bien, si l’on dispose d’une documentation adéquate sur
le concept concerné, en utilisant des techniques d’ana-
lyse secondaire c’est à dire en puisant ses données
dans la documentation.
Comme pour toute recherche, l’investigation com-
mence par une révision des documents. On étudie
donc toutes les bases de données bibliographiques
utiles et on rassemble les documents s’y rapportant,
c’est à dire les livres et articles qui discutent de la
nature du concept, les articles de recherche qui utili-
sent le concept, les instruments qui mesurent le
concept et les articles qui recensent toutes les
recherches effectuées sur le concept et son utilisation
dans la pratique. On peut aussi se pencher sur des
articles cliniques et des études de cas où l’on retrouve
des descriptions de concept, ainsi que les,compte ren-
dus des expériences autobiographiques. A ce point, il
peut aussi être utile de rassembler des définitions du
dictionnaire et d’explorer les dérivations étymolo-
giques du terme. Tout ceci représente probablement
une lourde tache, mais elle est cruciale, car on peut
aboutir à plusieurs possibilités.
* Si, après étude des documents, on s’aperçoit que le
concept est encore nébuleux et n’a pas été bien expli-
qué, on aura alors recours aux méthodes de dévelop-
pement de concept. On traitera ici du concept d’espoir
qui, contre toute attente, fait partie de cette catégorie.
(Morse JM, Doberneck B, données non publiées)
* S’il ressort de l’étude des documents que les deux
concepts sont mêlés et utilisés de façon interchan-
geable, les techniques de délimitation de concepts per-
mettront alors d’explorer les différences entre les deux
concepts. Cette situation sera illustrée par les concepts
d’endurance et de souffrance. (Morse JM, Carter B,
données non publiées)
* S’il reste une zone
d’Ombre,
les différents auteurs
pourront alors suggérer des concepts différents pour
remplir le vide théorique. On pourra avoir recours aux
techniques de comparaison de concept pour analyser
ces concepts en concurrence.
Pour comparer les concepts en concurrence de déduc-
tion, intuition et perspicacité, on prendra l’exemple de
la capacité des infirmières spécialistes à «sentir les
besoins des patients
».
* Si l’on dispose de nombreux documents, avec force
descriptions et mesures qualitatives, on pensera que le
concept est bien développé. Cependant, si, après un
39
Recherche en soins infirmiers
N”
58
-
Septembre 1999
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%