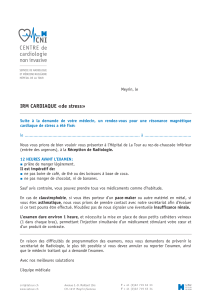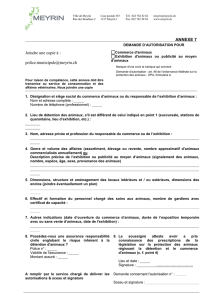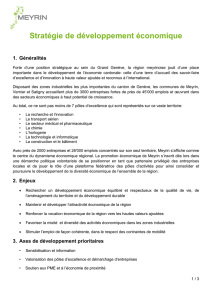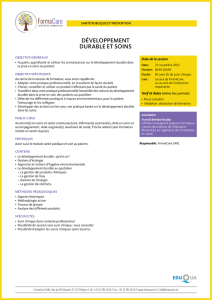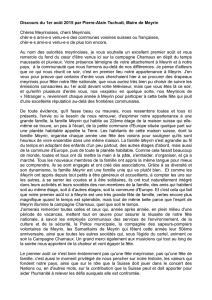en marge de candide

Spectacles
Stimmhorn
Christian Zehnder / Balthasar Streiff
Mardi 6 et mercredi 7 janvier (Meyrin)
En manteau rouge, le matin traverse la rosée
qui sur son passage paraît du sang.
Ou Ham. and ex by William Shakespeare
un cabaret.
Annulation > Lire page 148.
William Shakespeare / Matthias Langhoff
Mardi 13 et mercredi 14 janvier (Meyrin)
Stück mit Flügel
Anna Huber / Susanne Huber
Vendredi 16 janvier (Meyrin)
Candide
Voltaire / Yves Laplace
Du vendredi 16 janvier au dimanche 8 février
(Carouge)
Woyzeck
Georg Büchner / Andrea Novicov
Du mardi 20 au samedi 24 janvier (Meyrin)
Un champ de forces
Compagnie Heddy Maalem
Mercredi 28 et jeudi 29 janvier (Meyrin)
Le neveu de Wittgenstein
Thomas Bernhard / Serge Merlin
Mardi 3 et mercredi 4 février (Meyrin)
Cet enfant
Joël Pommerat
Du lundi 16 au mercredi 18 février (Meyrin)
Minetti
Thomas Bernhard / André Engel / Michel Piccoli
Du mercredi 18 février au dimanche 8 mars
(Carouge)
Trio Wanderer
Vincent Coq / Jean-Marc Phillips-Varjabédian /
Raphael Pidoux
Vendredi 20 février (Meyrin)
L’ingénu
Voltaire / Arnaud Denis
Mardi 24 et mercredi 25 février (Meyrin)
Faust
Cartoun Sardines Théâtre
Vendredi 27 février (Meyrin)
Expositions
Notre combat
Linda Ellia
Du mardi 13 janvier au mercredi 18 février
(Meyrin)
La grande question, etc.
Wolf Erlbruch
Du ma 13 janvier au me 18 février (Meyrin)
Films
Les Nibelungen
Fritz Lang (1924)
Samedi 17 janvier (Meyrin)
Café des sciences
Grands hommes, qui donc fûtes-vous ?
La Réforme revisitée
Mardi 24 février (Genève)
Goûters des sciences
1535 : Genève s’agite ! / La Réforme
Samedi 28 février (Meyrin)
Ateliers
La Nuit des Rois
Formation continue
pour comédiens professionnels
Du lundi 5 au samedi 17 janvier (Carouge)
Renseignements pratiques
En voiture : direction Aéroport-Meyrin;
sur la route de Meyrin, après l’aéroport,
prendre à droite direction Cité Meyrin puis
suivre les signalisations.
Deux grands parkings gratuits à disposition.
En bus : N° 28 / 29 / 55 / 56 arrêt Forum Meyrin
En Tram : N° 14 ou 16 jusqu’à Avanchet,
puis prendre le bus N° 29 / 55 / 56
Location
Achat sur place et au +41 (0)22 989 34 34,
du lundi au samedi de 14h00 à 18h00
Achat en ligne : www.forum-meyrin.ch /
Service culturel Migros,
Rue du Prince 7 / Genève / Tél. 022 319 61 11
Stand Info Balexert / Migros Nyon-La Combe
Administration
Théâtre Forum Meyrin
1, place des Cinq-Continents / Cp 250 /
1217 Meyrin 1 / Genève / Suisse
Tél. administration : +41 (0)22 989 34 00
[email protected] / www.forum-meyrin.ch
Renseignements pratiques
En voiture : sortie autoroute
de contournement A1 : Carouge Centre.
Sur la route de Saint-Julien, tout droit
jusqu’à la place du Rondeau (ne pas s’engager
à droite dans le tunnel – route du Val d’Arve).
Deux grands parkings à disposition.
En bus : N° 11 / 21 arrêts Armes ou Marché
En tram : N° 12 / 13 / 14 arrêt Ancienne
Location
Achat sur place et au +41 (0)22 343 43 43,
du lundi au vendredi de 10h00 à 13h00 et
de 14h00 à 18h00, le samedi de 10h00 à 14h00
Achat en ligne :
www.theatredecarouge-geneve.ch
Service culturel Migros,
Rue du Prince 7 / Genève
/ Tél. 022 319 61 11
Stand Info Balexert / Migros Nyon-La Combe
Administration
Théâtre de Carouge – Atelier de Genève
Rue Ancienne 57 / Cp 2031 / 1227 Carouge / Suisse
Tél. administration : +41 (0)22 343 25 55
www.theatredecarouge-geneve.ch
AGENDA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Linda Ellia
William Nadylam, comédien
No3IJanvier_Février 2009
Publication commune du THÉÂTRE FORUM MEYRIN
et du THÉÂTRE DE CAROUGE –ATELIER DE GENÈVE

— 91 —— 90 —
91 Edito. Par Jean Liermier et Mathieu Menghini
92–93 Théma Geist. L’esprit germanique en débat. Par Mathieu Menghini
94 Stimmhorn. Par Laurence Carducci
95 La grande question, etc. Par Laurence Carducci
96–97 Notre combat. Par Jean-Marie Antenen
98–99 Dossier Notre combat. L’art face à la barbarie. Entretien avec Linda Ellia. Par Ushanga Élébé
100–101 Dossier Notre combat. L’art connaît-il des tabous ? Entretien avec Thierry Illouz. Par Ushanga Élébé
102–103 Annulation > Lire page 148. Ham. and Ex by William Shakespeare un cabaret. Par Rita Freda
104–105 En marge d’Hamlet. Langhoff, l’Allemagne et le Berliner Ensemble. Trajectoire d’un exil. Par Delphine de Stoutz
106–107 Candide. Par François Jacob
108–109 En marge de Candide. L’œil de Candide. Par Yves Laplace et William Nadylam
110–111 Stück mit Flügel. Entretien avec Anna Huber. Par Julie Decarroux-Dougoud
112–113 Les Nibelungen. Par Vincent Adatte
114–115 En marge des Nibelungen. Histoire et déboires d’une légende. Des origines d’un mythe à son exploitation. Par René Wetzel
116–117 Woyzeck. Regard sur Woyzeck. Par Ludivine Oberholzer et Mathieu Menghini
118–119 Autour du Woyzeck de Büchner. L’irruption de la modernité. Analyse des enjeux d’un texte. Par Mathieu Menghini
120–121 Un champ de forces. Par Anne Davier
122–123 Le neveu de Wittgenstein. Entretien avec Serge Merlin. Par Sylvain De Marco
124–125 Thomas Bernhard : l’Autrichien. Comme l’oiseau souillant son propre nid. Par Sylvain De Marco
126–127 Cet enfant. Par Mathieu Menghini
128–129 Minetti. Par Delphine de Stoutz et Jean Liermier
130–131 Autour de Minetti. Entretien avec Michel Piccoli. Par Lucie Rihs
132–133 Trio Wanderer. Par Jean-Philippe Bauermeister
134
Café des sciences. Grands hommes, qui donc fûtes-vous ? La Réforme revisitée. Entretien avec Marc Vial. Par Sylvain De Marco
135 Goûters des sciences. 1535 : Genève s’agite / La Réforme.
Entretien avec Maud Ulmann-Cagnat et Philip Benedict. Par Sylvain De Marco
136–137 En marge du Café et des Goûters de sciences. L’Allemagne et la Réforme. Par Florent Lézat
138 L’ingénu. Par Ludivine Oberholzer
139 En marge de L’ingénu. Du conte au théâtre. Par Anne-Marie Garagnon
140 Faust. Par Mathieu Menghini
141 En marge de Faust. La légende de Faust. Naissance et évolution d’un mythe. Par Edith Kunz
142 Improvisations sur l’Allemagne. Entre mythe et réalité.
Impromptu sur une nation à la recherche d’elle-même. Par Mathieu Menghini
143
Bibliothèque du Forum Meyrin. Coup de projecteur sur la précieuse voisine du Théâtre Forum Meyrin. Par Laurence Carducci
144 Atelier d’écriture. Fragments autobiographiques II. Atelier d’éveil musical.
Par Laurence Carducci et Julie Decarroux-Dougoud
145 La nuit des rois. Stage n°2 du Théâtre de Carouge. Par Jacques Vincey
146–147 Les caprices de Marianne. Une aventure télévisuelle. Entretien avec Elena Hazanov. Par Lucie Rihs
148–149 É…mois passés.
150 Culture populaire. Débat autour d’une nouvelle orientation de la Fondation Pro Helvetia. Par Mathieu Menghini
151 Impressum. Partenaires.
152 Agenda. Renseignements pratiques.
Mathieu Menghini : Cher Jean, je tiens à te féliciter de ton Marivaux – ta
première création carougeoise. D’elle émane un savoir-faire indéniable. Sa
facture est élégante, délicate et sémillante ; son interprétation, de qualité
et équilibrée. De la belle ouvrage ! Toutefois, quelques questions me
demeurent. Celle-ci, par exemple : pourquoi avoir attribué la physicalité la
plus dominée à Dorante et à Arlequin la balourdise (je pense à son entrée) ?
Jean Liermier : Arlequin n'est pas balourd : les chaussures que son Maître lui
a prétées pour jouer son rôle sont juste un peu trop petites, et gravir des
escaliers peut devenir une épreuve dangereuse... Quant à Dorante, il n’est
clairement pas le jeune premier attendu ou convenu. C’est un jeune
homme de bonne famille, qui a été dressé dans la croyance que les êtres
inférieurs à sa classe sociale sont méprisables, et Marivaux le pousse à
s’affranchir de son éducation par le biais du jeu. Silvia tombera amoureuse
de lui surtout parce qu’elle se reconnaît dans ses manières, dans son esprit ;
c’est cela qui la trouble, et non pas son profil hollywoodien. Encore que la
silhouette de Mompart soit évocatrice du Casanova de Fellini... L’important
est surtout de distribuer au plus juste afin qu’aujourd’hui on puisse croire
au rapport de force dans le «couple» dominant/dominé. Que Mompart/
Dorante soit plus «frêle» que Nadin/Arlequin est pour moi un moyen de le
crédibiliser.
Quand au savoir-faire, je t’assure que je n’en ai aucun. C’est parce que je ne
sais pas faire que j’aime faire du théâtre, et que c’est une recherche en per-
pétuel mouvement.
MM : Que ressent Bourguignon (Arlequin ?) lorsqu’il est enveloppé sous un
aristocratique costume ?
JL : Au début de l’histoire, tout cela n’est qu’un jeu sans conséquences pour
Arlequin. Il s’agit d’obéir à l’ordre de se déguiser en Maître, et le costume lui
procure des avantages qui le grisent. Tout va basculer quand il va prendre
conscience qu’une supposée Maîtresse pourrait l’aimer. Mais elle l’aime
avec un costume d’emprunt, qui n’est pas sa livrée. L’aimerait-elle égale-
ment si elle savait qu’il n’était «qu’un» domestique ? Et Arlequin de sentir
le poids de la supercherie, car il se prend à rêver d’accéder à un statut qui
bouleverserait sa vie. Il lui faudra avouer qui il est réellement, au risque de
tout perdre. Finalement, Arlequin est un opportuniste au cœur d’artichaut.
MM : On se prend à apprécier le père, bonhomme et ludique ; pourtant, sa
manigance est une perversité, non ?
JL : Marivaux rompt avec Molière : les pères ne sont plus des barbons qui
obligent leurs enfants à des mariages d’intérêts. Il casse ainsi le person-
nage-caractère en lui dessinant un profil plus «psychologique». Orgon, le
papa de Silvia, ne cessera de s’étonner que la génération de ses enfants ait
tant de peine à s’engager dans une relation ; une génération qui veut des
garanties, être sur de ne pas se faire mal, une génération qui finalement a
peur. Mais peut-on
tomber
amoureux sans prendre le risque de se faire un
bleu ? Et d’ailleurs, peut-on contrôler la venue de l’amour ?
Orgon, pour le bien de sa fille, pour qu’elle grandisse, et parce qu’elle l’a choisi,
va la laisser souffrir, en allant même jusqu’à exaspérer cette souffrance.
C’est plus un paradoxe qu’une perversité : parfois par amour, on fait du
mal ! C’est une des fabuleuses singularités de l’écriture de Marivaux.
Jean Liermier: Mathieu, pourquoi tu as programmé cette théma Geist ?
Mathieu Menghini : Nous ne décidons pas
en amont
de nos thémas. Nous
choisissons des spectacles qui nous enthousiasment, puis cherchons des
transversalités de contenus ou formelles entre certains d’entre eux ; enfin,
la théma s’étoffe d’ajouts (les conférences, débats, etc.), eux, en effet, choi-
sis en fonction du sujet – une fois défini.
Entre autres interrogations, le festival Geist ou l’esprit germanique en
débat (lire pages 92-93) permet d’approcher une culture à laquelle partici-
pent, avec des accents propres, nos voisins alémaniques, autrichiens et
allemands. Elle prolonge, en outre, la fameuse question de Karl Kraus : com-
ment le peuple des poètes et penseurs (
das Volk der Dichter und Denker
)
a-t-il pu devenir celui des juges et des bourreaux (
der Richter und Henker
)?
JL : Y a-t-il un rapport entre ce que tu vis et les thémas que tu choisis de
développer ?
MM : Pas spécialement. Je veux dire que tout un chacun peut être touché
par les sujets abordés par le Théâtre Forum Meyrin :
L’art, c’est délicieux
sur
notre rapport à la gourmandise (2006),
Le jardin cultivé
sur le lien nature-
culture (2006),
Miroirs du monde
sur nos représentations du village plané-
taire (2006),
Tripalium
sur le travail,
Infinita
sur la manière dont nous appri-
voisons notre finitude,
Tracas d’Eros
sur les déboires amoureux (2008) –
entre autres exemples. Les sentiments, le labeur, la tombe, l’idée que je me
fais de l’Autre, etc., tous ces sujets préoccupent vraisemblablement chacun
de nous.
Même lorsque le théâtre semble s’évader dans des fantasmagories éthé-
rées, il dit quelque chose de l’humain et du monde. L’art dramatique nous
met en présence sensible d’individus s’exhibant, simulant ou en transe,
donnant corps à une re-présentation de notre univers ; il nous invite à nous
quitter un peu nous-mêmes pour suivre ces fantasmes. Or, se quitter soi-
même est un peu le préliminaire de la générosité et d’une interprétation
plus lucide de soi et des autres.
JL : Je crois savoir que tu essaies de retrouver du temps pour toi, notamment
pour écrire. L’écriture est-elle ton jardin secret, ta part la plus créatrice ?
MM : Un jardin secret qui se dit est une duperie. Permets que je me taise.
Par contre, il m’est agréable de rappeler combien le programmateur qui
arpente les salles – comme tout spectateur, du reste – s’implique dans ce
qu’il voit d’une manière qui m’apparaît créative. Pour les philosophes Berg-
son et Croce, d’ailleurs, la contemplation ne pouvait être distinguée de la
création artistique. Avant eux, Raphaël affirmait, même, que comprendre
l’œuvre revenait à l’égaler. «Égaler» est un peu fort, à mon avis ; mais je suis
assez de l’avis que toute contemplation attentive est recréation. L’œuvre
d’art parle si nous la faisons parler. C’est au développement de cette part
créatrice nichée en tout spectateur que nos thémas s’emploient.
ÉDITO
DE L’AMOUR CHEZ MARIVAUX
À L’ESPRIT EN GERMANIE !
Dialogue sur la première création de Jean Liermier à Carouge
et la théma Geist du Théâtre Forum Meyrin
Pp. 106–107
Candide
Pp. 116–117
Woyzeck
SOMMAIRE
Pp. 96–101
Notre Combat

THÉMA GEIST
L’ESPRIT GERMANIQUE EN DÉBAT
Festival pluridisciplinaire du Théâtre Forum Meyrin, du 6 janvier au 8 mars 2009
Deuxième théma de la saison 08/09, Geist inter-
roge la culture germanique, incluant dans cet
adjectif des œuvres de plusieurs pays de lan-
gue allemande : l’Allemagne, l’Autriche (par l’en-
tremise de Thomas Bernhard et du «premier»
Fritz Lang) et la Suisse alémanique (on pense ici
à nos deux duos : Anna Huber et Susanne
Huber ; Christian Zehnder et Balthasar Streiff,
ces derniers revivifiant la tradition musicale de
l’est de notre pays).
Retour sur la mythologie
Nous tutoierons le génie germanique au travers
de ses mythes les plus fameux : Faust, d’une
part, à travers son adaptation filmique par
Mur
nau revue par les Marseillais du Cartoun Sar-
dines ; Les Nibelungen, de l’autre, dans la formi-
dable
réalisation de Fritz Lang.
La figure de Martin Luther et sa Réforme (lire
pages 136-137) – dans ses liens avec celle qu’en-
treprit Jean Calvin à Genève – seront au cœur de
notre collaboration avec l’université de Genève
(lire plus loin la présentation des Goûters et du
Café des sciences).
Entre désespérance et espièglerie, le roman-
tisme musical allemand sera également à l’affi-
che avec trois trios de légende : l’archiduc de
Beethoven, le second trio de Schubert et le pre-
mier de Mendelssohn-Bartholdy.
Autre classique, l’œuvre qui, la première, fit du
Lumpenproletariat le principal protagoniste
d’un drame – celui que Georg Büchner tira d’un
fait divers : Woyzeck.
À hauteur d’enfant, mais qui ravira les adultes
aussi, l’accueil d’illustrations originales du
fameux artiste Wolf Erlbruch. Avec lui, nous reli-
rons Goethe et questionnerons le pourquoi de
la vie.
Le paradoxe allemand
Pays de l’art et de la philosophie les plus subtils,
l’Allemagne fut aussi le théâtre de l’horreur.
Comment, se demandait l’auteur Karl Kraus, le
peuple des poètes et des penseurs (das Volk der
Dichter und Denker) a-t-il pu devenir celui des
juges et des bourreaux (der Richter und Henker)?
Geist interrogera ce paradoxe.
On sait combien Les Nibelungen de Lang furent
diversement interprétés : certains y virent l’image
d’une jeunesse refusant de se soumettre à une
vie routinière ; d’autres – dont Hitler, le premier –
en firent l’appel à la rébellion nationaliste après
l’infâmante défaite de 1918 et l’insolent traité
de Versailles.
Faust pactisant avec Méphistophélès autorise, là
aussi, une seconde lecture. De même que Woy-
zeck sacrifiant sa santé en devenant le cobaye
d’expérimentations scientifiques qui annoncent
les pages les plus sombres du XXesiècle.
La création meyrinoise de l’exposition Notre
combat de l’étonnante Linda Ellia interrogera le
pouvoir de l’art, sa responsabilité et ses possi-
bles rebonds face à l’inadmissible.
Autre révolté face à un passé trop opportuné-
ment escamoté, Thomas Bernhard sera présent
à Meyrin et Carouge, avec deux textes : l’un évo-
quant l’art dans une vie singulière (Minetti);
l’autre fustigeant la place qui lui est réservée
dans une société superficiellement «éprise» de
culture (Le neveu de Wittgenstein).
De la musique, donc ; des films (parmi les plus
puissants du septième art), de la danse, du théâ-
tre (avec, notamment, l’accueil prestigieux de
l’un des grands héritiers de la tradition brech-
tienne : Matthias Langhoff), des créations plasti-
ques, des débats et une recherche bibliographi-
que réalisée par la Bibliothèque Forum Meyrin
qui permettra aux passionnés d’aller plus loin
encore dans l’étude de cette culture majeure de
l’Occident.
Mathieu Menghini
— 92 —
Une interrogation de la culture germanique.
Objectif des thémas
Il est plusieurs manières de dire
la vérité
d’un
objet d’étude, plusieurs manières de l’envisager.
Chaque approche, progressivement, alimente la
compréhension que l’on en a.
Nous avons choisi, au Théâtre Forum Meyrin –
lieu d’art et de connaissance, disposant d’une
salle multidisciplinaire, de galeries d’exposition,
d’une salle de projections filmiques, d’ateliers et
d’espaces de débat – de les additionner et de les
confronter.
Aussi les points de vue de chorégraphes, de
dramaturges, d’écrivains, de musiciens, de
cinéastes, d’académiciens et de plasticiens
s’agrégeront-ils pour approfondir le regard
que nous portons sur le monde. Gageons que
par l’appréciation de ces perspectives distinc-
tes seront également éclairées les spécificités
propres au langage de chacune des disciplines
convoquées !
MM
Spectacles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Stimmhorn > 6 et 7 janvier
Par Christian Zehnder et Balthasar Streiff
Hamlet > 13 et 14 janvier
Annulation > Lire page 148.
De William Shakespeare
par Matthias Langhoff
Stück mit Flügel > 16 janvier
De Anna Huber et Susanne Huber
Woyzeck > 20 au 24 janvier
De Georg Büchner par Andrea Novicov
Le neveu de Wittgenstein > 3 et 4 février
De Thomas Bernhard par Bernard Levy
Minetti > 18 février au 8 mars
De Thomas Bernhard par André Engel au
Théâtre de Carouge
Trio Wanderer > 20 février
Beethoven, Schubert,
Mendelssohn-Bartholdy
Faust > 27 février
De Friedrich Wilhelm Murnau
par le Cartoun Sardines Théâtre
Films _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Les Nibelungen >17 janvier
De Fritz Lang
Expositions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Linda Ellia, Notre combat >
13 janvier au 18 février
Dessins, collages, objets
Wolf Erlbruch > 13 janvier au 18 février
Illustrations
Café des sciences _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Grands hommes, qui donc fûtes-vous? La
Réforme revisitée > 24 février
Avec le professeur Philip Benedict et
les docteurs Béatrice Nicollier et Marc Vial
Modérateur : Emmanuel Gripon, journaliste
Goûters des sciences _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1535 : Genève s’agite ! > 28 février
Tout public, dès 5 ans
Ce samedi de l’UNIGE aura lieu en ville
de Genève.
Bibliothèque Forum Meyrin _ _ _ _ _ _ _ _ _
La Bibliothèque Municipale de Meyrin
proposera une vitrine bibliographique
sur le sujet de cette théma.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Le programme
— 93 —
Image extraite du film Les Nibelungen, de Fritz Lang (1924)

— 95 —— 94 —
L’illustrateur allemand Wolf Erlbruch possède
le surprenant talent d’aller droit au cœur des
idées et des émotions avec une douce ironie. La
force et la clarté des images séduisent les
petits et les grands, mais sous la patte du nou-
nours veillent les questions existentielles.
Privilège du regard en direct, les originaux de
La grande question et Cuisine de sorcière sont
présentés à Meyrin.
Savoir sourire des réalités les plus graves sans
les déguiser, en toute simplicité, serait-ce une
des facettes du Geist germanique ? L’exposition
dédiée au grand illustrateur Wolf Erlbruch per-
met d’approcher ce précieux point d’équilibre,
ambitieux sous son apparente modestie.
Pour les enfants, c’est une occasion rare d’entrer
en contact à plusieurs niveaux avec le monde
de ce grand bonhomme. Les leçons d’allemand
vont prendre une forme nouvelle à la vue des
documents bilingues présentés, des livres et
des jeux à disposition des classes et des famil-
les. À tous les niveaux, le questionnement sur le
monde en découle tout naturellement. Il faut
prendre le temps de consulter les albums à dis-
position (que l’on obtient également en prêt à la
bibliothèque voisine, voir page 143).
Sur des cahiers d’écoliers
Wolf Erlbruch dessine ses découvertes depuis
l’âge de deux ans. La différence avec tous les
autres bambins, c’est qu’il regardait et tentait
déjà des transpositions d’une manière très per-
sonnelle avec un réalisme surprenant. C’est
bien après, à l’issue de ses études d’art, qu’il a
choisi de raconter le monde à sa manière sur le
support le plus anodin, comme le papier qua-
drillé des cahiers sur lesquels il fait évoluer ses
personnages. Christian Bruel, éditeur et auteur
qui lui consacre une monographie, relève cette
particularité comme une nécessité d’ancrage à
la fois visuelle et symbolique dans la trame du
quotidien. Une omniprésence de quelque chose
de normé qu’Erlbruch traduit par le temps qua-
drillé. À partir de là, l’illustrateur pratique les
pas de côté et sort de la seule copie conforme et
rassurante une réalité dans l’image. Des indivi-
dus passent plus loin pour fuir la contrainte que
l’histoire leur impose, parfois ils se regardent
d’une page à l’autre. À les contempler attentive-
ment, les albums sont accompagnés d’indices,
objets ou personnages secondaires, qui jouent
apparemment un rôle discret, mais qui n’échap-
pent pas à l’œil attentif des enfants. Ces éléments
appartiennent tout simplement à la symbolique
des contes et comportent leur part de rêve.
Attiré par une réflexion constante sur la signifi-
cation cachée des choses, Wolf Erlbruch s’est
inspiré du texte de Goethe Das Hexen Einmal
Eins, paru aux éditions La Joie de lire sous le titre
Cuisine de sorcière. Les originaux de l’illustration
sont présentés dans l’exposition, tout comme
ceux de La grande question. L’auteur ne cache
pas sa fascination pour le questionnement philo-
sophique. À y regarder de plus près, c’est aussi
celui des très jeunes enfants qui ne ratent pas
une occasion de mettre les adultes dans l’embar-
ras par la pertinence de leurs interrogations. Au
lieu de leur répondre parce que c’est comme ça,
on peut les amener à chercher par eux-mêmes et
à trouver des pistes à travers les merveilleux
albums de cet auteur incomparable.
Laurence Carducci
Cadre biographique
Wolf Erlbruch est né en Allemagne, à Wup-
pertal, grande ville industrielle de la Ruhr. Il
a étudié le dessin à Essen-Werden et est
resté très attaché à cette ville qu’il consi-
dère comme une ville vraie, c’est-à-dire habi-
tée par des gens d’origines diverses. Il est
lui-même fils unique de parents très modes-
tes qui ne l’ont jamais empêché de suivre sa
formation artistique. Actuellement, à côté
de son activité d’illustrateur, il est profes-
seur d’art graphique, de musique et de musi-
cologie (il s’est mis à la cornemuse assez tar-
divement). Traduit dans plus de vingt
langues, il est considéré comme l’un des
grands illustrateurs de notre époque. Il a
reçu le prix Gutenberg en 2003.
Exposition
Du mardi 13 janvier au mercredi 18 février
Vernissage le mardi 13 janvier à 18h30
Au Théâtre Forum Meyrin
Galerie du Couchant
Ouverture publique : mercredi et samedi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00,
ainsi qu’une heure avant les représentations.
Accueil scolaire : du lundi au vendredi
sur rendez-vous au 022 989 34 00.
Entrée libre
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En multipliant les approches
et en les montrant, j’interroge
la diversité de la vie en la
considérant vraiment comme
la normalité.
LA GRANDE QUESTION, ETC.
Par Wolf Erlbruch, illustrateur (Allemagne)
Exposition bilingue français-allemand
Réalisée en collaboration avec les éditions La Joie de lire et le Goethe-Institut de Nancy,
cette exposition intègre la théma Geist ou l’esprit germanique en débat du Théâtre Forum Meyrin
(lire Si n° 3, janvier-février 09).
Il faut s’attendre à découvrir deux extraterres-
tres, Balthasar Streiff et Christian Zehnder. Ces
deux musiciens de formation ont choisi de visi-
ter leurs galaxies intérieures en sortant du
temps et de l’espace. La voix de Christian et le
souffle de Balthasar forment un duo sidérant,
mais ils n’oublient jamais pour autant de
s’amuser.
La youtse de Christian Zehnder, les cors des
Alpes et autres instruments à vent de Balthasar
Streiff appartiennent bien à l’enfance de la
musique. On peut les imaginer à l’aise avec les
Homo sapiens sapiens découvrant ensemble
l’emprise magique des sons sur l’âme humaine.
Pour eux, il ne paraît pas y avoir de différence
essentielle entre nous et une époque d’avant
l’évolution du langage, lorsque l’expression
sonore devait transmettre la notion de mystère
et l’approche des forces de la nature, bien
mieux que les mots. C’es d’ailleurs toujours le
propre de la musique.
L’intuition complice et farfelue
Pour Christian Zehnder, la découverte de la
puissance du yodle en dehors des traditions fol-
kloriques n’est pas fortuite, comme il s’en expli-
que dans le film Heimatklänge - Echoes of home
de Stefan Schwietert (disponible en DVD). Il vit à
Bâle aujourd’hui, mais les souvenirs acousti-
ques des Alpes de ses vacances d’enfance vivent
encore en lui. Il se veut disponible comme alors,
quand il se laissait surprendre par le rythme du
train et celui des deux oiseaux surgissant alter-
nativement du coucou de sa grand-mère. Tota-
lement disponible aux déclics émotifs, il refuse
les contraintes. Cette curiosité et cette liberté
lui ont ouvert toutes les portes. Il est capable
aujourd’hui de raconter tout ce qui lui passe par
la tête en jouant avec sa voix, sans jamais pro-
noncer la moindre parole, certain désormais
d’être compris partout sur la planète.
Même si le décor peut changer, les grands espa-
ces périphériques, les zones industrielles être
remplacés par les vallées et les sommets, les
échos intérieurs demeurent. Le jeune public
convié au Théâtre Forum Meyrin n’aura qu’à
tendre l’oreille pour découvrir les surprises
sonores de la ville. C’est probablement leur
ancrage urbain qui a permis aux deux compli-
ces de se débarrasser de la carapace folklorique
pour s’intégrer tout naturellement dans la créa-
tion contemporaine, composée à partir de sour-
ces culturelles multiples. Avec eux, il semble
que les frontières aient fondu pour laisser res-
surgir l’essentiel, un bagage intime et universel
qui se traduit sans codes ni limites.
Le patrimoine alpestre revalorisé
Échappés des conventions de cartes postales,
ils ne trahissent pas pour autant l’écho des
sonorités étranges du cor des Alpes et l’appel
des esprits à l’origine des chants de la monta-
gne. Le duo invente avec ses instruments et le
chant des voyages acoustiques en passant aisé-
ment de l’héritage à l’expérimental. Avec eux, le
patrimoine encore vivant de quelques régions
de Suisse prend une nouvelle épaisseur. Trop de
générations l’ont intégré dans la caisse de réso-
nance naturelle des lieux pour qu’il ne s’agisse
que d’une routine villageoise. Les orchestres
traditionnels sont maintenant rejoints par un
courant novateur, représenté par le duo
Stimmhorn, reconnu pour son authenticité et
sa créativité.
Aux limites de la musique et du son pur, ces voca-
lises hors du temps ont été utilisées comme
un
appel aux esprits, tant elles sont saisissantes.
Aujourd’hui encore, elles peuvent surprendre et
subjuguer. Dans le contexte actuel, cette musi-
que trouve sa place partout. En fait, les barriè-
res entre les publics sont artificielles pour des
musiciens tels que Christian Zehnder et Balthasar
Streiff.
Laurence Carducci
Cadre biographique
Christian Zehnder s’intéresse avant tout à
l’expression non verbale de la voix humaine,
ainsi qu’au perfectionnement des techni-
ques de chant diphonique. Une grande affi-
nité le relie à Balthasar Streiff formé au jazz,
trompette et chant. En plus de ses spectacles
de théâtre musical, le duo monte régulière-
ment des productions hybrides, combinant
la musique contemporaine, le théâtre, le
cinéma et la littérature.
Les interférences entre les expressions
artistiques sont de formidables stimulants
pour ces deux complices qui élaborent des
projets comme solistes, des performances,
des sculptures sonores et diverses com-
mandes de composition.
Musique / Tout public dès 9 ans
Mardi 6 et mercredi 7 janvier à 19h00
Au Théâtre Forum Meyrin
Durée 1h15
Plein tarif : Fr. 20.–
Tarif réduit : Fr. 17.–
Tarif étudiant, chômeur, enfant : Fr. 10.–
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Émerveillé par ce qu’il découvre,
le duo Stimmhorn dégage une vitalité extraordinaire.
STIMMHORN
Musiciens : Balthasar Streiff et Christian Zehnder (Suisse)
Ce concert intègre la théma Geist du Théâtre Forum Meyrin présentée pages 92-93.
(Lire aussi Si n°2, page 82).

— 96 —
Il est des souvenirs trop laids pour qu’on les
garde chez soi, trop douloureux pour qu’on les
brûle avec les vieux papiers. On les enfouit
alors dans les sous-sols de notre mémoire,
espérant qu’une poussière d’oubli les recouvre
à tout jamais. Mais la vie est ainsi faite que le
passé remonte toujours à la surface. Et ce sont
souvent les enfants qui nous reviennent les
poches pleines de ces bribes d’histoire.
Linda Ellia n’a pas échappé à cette loi. Un jour,
sa fille de douze ans est rentrée à la maison avec
un exemplaire de Mein Kampf trouvé dans une
cave. Que faire de ces lignes de haine exhumées
par l’innocence d’une enfant ? Comment trans-
mettre l’espoir en présence de ces pages de mal-
heur ?
À l’agression de ces mots elle a choisi de répon-
dre avec ses armes, celles de l’artiste, recou-
vrant les pages du livre avec ses images. Après
avoir réalisé une trentaine d’images, elle a
passé le relais à d’autres. Parce qu’il fallait oppo-
ser un geste collectif à ce texte et à la barbarie
qu’il a engendrée. Plus de sept cents personnes,
artistes connus, mais aussi quidams rencontrés
dans la rue, inconnus du monde entier informés
par Internet, ont participé à ce grand happening
voulu par Linda Ellia.
L’œuvre a été publiée aux éditions du Seuil en
2007. C’est Notre combat. Un livre né de la
volonté de «faire un autre livre, non pas seule-
ment un livre contre, un livre opposé, mais un
livre à la place», dit Thierry Illouz dans sa pré-
face à l’ouvrage. Cette idée de substitution
imposait donc le livre comme forme «natu-
relle», évidente. Mais cette relation de conflit
entre le texte et l’image fait de Notre combat un
objet singulier, voire unique, dans la production
éditoriale.
L’image antidote du texte
La comparaison avec les deux autres exposi-
tions présentées simultanément est intéres-
sante de ce point de vue. Wolf Erlbruch (lire Si
n° 2, pages 80-81 et Si n° 3, page 95), ainsi que
Renaud Perrin (lire Si n° 3, page 117) créent des
albums dans lesquels l’imbrication du texte et
de l’image constitue un langage graphique par-
ticulier. Il y a donc chez eux une relation de com-
plémentarité, de sympathie entre le texte et
l’image.
Ces deux démarches sont assez représentatives
de la manière d’aborder cette relation texte-
image aujourd’hui, aussi bien dans le livre
d’artiste que dans l’album, souvent dit «pour
enfants». La frontière entre ces genres n’est
d’ailleurs souvent que le reflet de la fragmenta-
tion économique des marchés. Les créateurs,
eux, ont un seul et même souci : réaliser le livre
qu’ils souhaitent.
Dans Notre combat, le texte est omniprésent
mais illisible. Effacé, gratté, recouvert, il nous
saute à la figure à chaque page. Ce texte, seuls
quelques historiens l’ont lu ces cinquante der-
nières années. Pas nous, et cela ne fait pas par-
tie de nos projets. Est-ce que vous vous imagi-
nez entrer dans une échoppe et demander :
«Bonjour, madame la libraire, j’aimerais Mein
Kampf de Hitler Adolf, chez F. Acho éditeur ?».
L’idée est glaçante, car ce livre apparaît un peu
comme une relique de son auteur, une incarna-
tion de sa haine.
Chacune des pages de Notre combat fait œuvre
de mémoire. Chasser la lettre de l’auteur de
Mein Kampf revient à convoquer l’esprit de ses
victimes, à recouvrir l’inhumain comme on pan-
serait une plaie. Restera une cicatrice, mais l’es-
poir aura survécu par la grâce d’un geste simple
et beau. L’image a pour vocation d’étouffer ces
mots qui gisent comme des braises, pour que
l’incendie ne reprenne pas, elle est l’antidote de
ce texte vénéneux.
Ni progression dramatique ou logique, ni narra-
tion dans ce livre. Plutôt des strates, comme
celles que le temps dépose sur les ruines des
empires. Un livre-sol sur lequel construire l’ave-
nir mais qui conserve enfouie dans ses entrail-
les la mémoire du passé.
Notre combat a connu un grand succès en
librairie. Les dessins originaux sont exposés en
première mondiale au Théâtre Forum Meyrin, et
nous n’en sommes pas peu fiers ! L’exposition
présentera l’intégralité des images reproduites
dans le livre ainsi que plus de deux cents inédits.
Au total, six cents originaux seront présentés
dans cette exposition-événement à ne manquer
sous aucun prétexte !
Jean-Marie Antenen
NOTRE COMBAT
Dessins, collages, objets
par Linda Ellia (France), peintre et photographe
Commissaires d’exposition Thierry Ruffieux & Jean-Marie Antenen
Ouverture publique les mercredis et samedis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00,
ainsi qu’une heure avant les représentations.
Cette exposition intègre la théma Geist du Théâtre Forum Meyrin, présentée pages 92-93.
Lire aussi pages 98 à 101.
Exposition
Du mardi 13 janvier au mercredi 18 février
Vernissage le mardi 13 janvier à 18h30
Dès 19h00, rencontre-débat
avec Linda Ellia, Thierry Illouz
et Jean-Marie Antenen
Au Théâtre Forum Meyrin
Galeries du Levant
Visites scolaires du lundi au vendredi
sur rendez-vous au 022 989 34 00.
Entrée libre
Accueil réalisé en collaboration avec les éditions du Seuil. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%