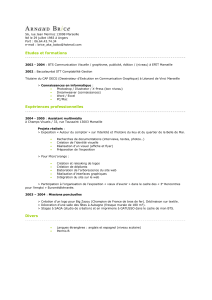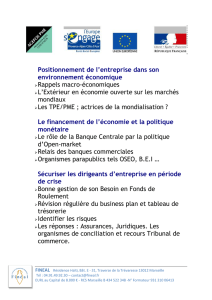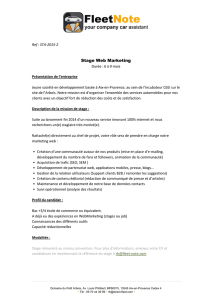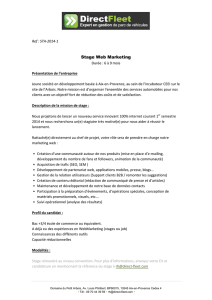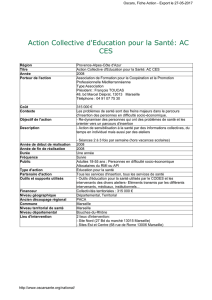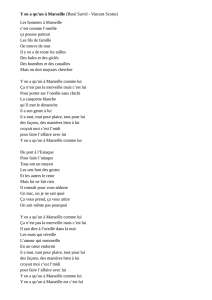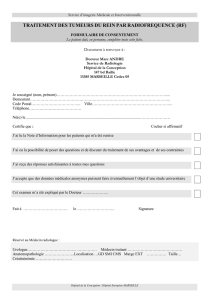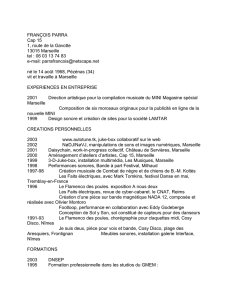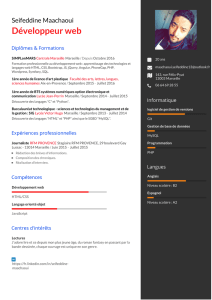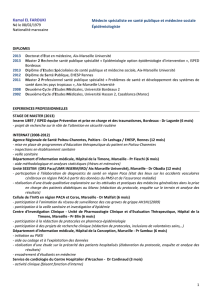Quel pourrait être le rôle et la place du CG13 dans le

1/46
« QUEL POURRAIT ETRE LE ROLE ET LA PLACE DU
CONSEIL GENERAL DANS LE DEVELOPPEMENT DE
L'ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE ? »
LE RAPPORTEUR : M. PHILIPPE LANGEVIN
LES VICE-PRESIDENTS : M. GILBERT JAUFFRET
M. ROGER MONGEREAU
LE JEUDI 4 JUILLET 2013
« Document de travail à ne pas diffuser à l’extérieur »

2/46
L’économie de la connaissance, promue par différentes organisations internationales et
européennes s’est imposée comme le nouveau modèle de développement économique.
Elle est mise en avant notamment dans les rapports du programme des nations unies pour le
développement (PNUD), dans les programmes de la Banque mondiale, World Development
Report 1999 et Knowledge for Development program au World Bank Institute, dans
différentes études (notamment de l'OCDE et de l'ISESCO), elle constitue également le cœur
de la stratégie de Lisbonne, définie lors du Conseil Européen de mars 2000 par l’Europe des
15 d’alors. L’ambition retenue est de faire de l’Union Européenne « l’économie de la
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde à l’horizon 2010, capable
d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et
qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale ». Sa stratégie de
développement, dans un contexte de mondialisation, est donc passée d’un développement
industriel à un développement basé sur la connaissance. Sa compétitivité internationale et le
bien-être de ses citoyens reposent aujourd'hui sur la connaissance, l'innovation, les
préoccupations sociales et environnementales, qui prennent le pas sur l'offre de services et de
produits à faible coût.
L’émergence de l’économie de la connaissance s’est amorcée dans les années 1970. Elle s’est
traduite par une réorientation des structures productives vers des activités reposant sur la
création, l’utilisation et la diffusion de nouvelles connaissances et une plus grande
dépendance de ces structures vis-à-vis des activités de recherche-développement. Elle
coïncide aussi avec l’accroissement de la part de l’immatériel dans le développement des
activités productives et de services. La tendance s’est accélérée dans les années 1990 avec le
développement des TIC qui ont eu un impact considérable sur les manières d’innover, de
produire et d’échanger, affectant tout particulièrement les secteurs stratégiques que sont
l'éducation, la recherche et développement, la santé, l'innovation, les services, la culture, les
industries créatives, l'internet. L’économie de la connaissance toutefois ne se ramène pas aux
TIC qui ne sont qu’un outil à son service.
L’économie de la connaissance a été définie comme étant l'économie des contenus, des
mondes virtuels et de la création numérique : une économie de la création, de l’audience, de
l’immatériel, de l’ubiquité des centres de production et de consommation, avec de profondes
questions sur l’évolution des notions de valeur, de propriété, d’innovation, de consommation.
Une économie dans laquelle les matières premières sont les compétences, et les moyens de
contrôle et de thésaurisation ne sont ni la terre, ni le capital, mais l’audience. (F. JUTAND )
L’économie de la connaissance en mettant l’accent sur les éléments intangibles que sont la
production de savoir, de sciences, de compétences techniques et de « capital humain », pose
les bases d’un nouveau type de société, la société de la connaissance, encore appelée société
du savoir.
Basée sur l’expertise, la créativité, le savoir, l'innovation, la société de la connaissance
dessine une vision plus humaine dans laquelle les TIC sont au service du développement
culturel et permettent de nouvelles formes d'organisation sociale et de communication ainsi
que le partage et la co-production des savoirs et des connaissances.
A ce titre, l’économie de la connaissance correspond à un découpage pertinent à côté de
l’économie productive, de l’économie des transports et de la logistique, de l’économie du
tourisme et de l’économie résidentielle. Au-delà, elle réinterroge en profondeur les
dynamiques territoriales et urbaines en offrant de nouvelle perspective aux territoires comme
lieux de création, valorisation et diffusion des principales ressources qui conditionnent le

3/46
développement économique à l’ère de cette économie post-industrielle volontiers qualifiée
aujourd’hui d’économie de la connaissance.
L’économie de la connaissance est évidemment très présente dans l’énergie, les
biotechnologies, les nouveaux matériaux, les sciences de l’environnement mais aussi dans le
soft (TIC, Logiciels et contenus…) et toutes les technologies sous forme de brevets, de
licences, d’open-source et d’open-innovation.
I- LES MOTEURS DE L’ECONOMIE DU TERRITOIRE
Une étude1, conduite par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole distingue les
cinq moteurs de l’économie locale :
- l’économie de la connaissance, économie d’entraînement qui regroupe les activités
immatérielles et de prestations intellectuelles publiques et privées : éducation au sens
large, recherche et développement des entreprises, recherche publique, services à
haute valeur ajoutée (conseil, activités juridiques et comptables, services
informatiques…),
- l’économie productive qui comprend notamment les industries agroalimentaires,
l’industrie manufacturière, la production- distribution de combustibles,
l’agriculture…,
1 Marseille- Provence, métropole euroméditerranéenne des échanges et de la connaissance- Une stratégie de
développement économique 2008- 2014.

4/46
- l’économie des transports et la logistique qui regroupe les activités de transit de
biens (des matières premières aux produits finis) et leur mise en place avant ou après
la relation client : entreposage, commerce de gros, transports terrestres, maritimes,
aériens…,
- l’économie du tourisme, des loisirs et de la culture dont les bénéficiaires sont les
résidents temporaires et les personnes de passage : hébergement et restauration,
activités récréatives, artistiques, culturelles, du spectacle, sportives et de loisirs,
- l’économie résidentielle qui regroupe les activités de services, à faible valeur ajoutée
dont les principaux bénéficiaires sont les résidents du territoire et qui comprend les
administrations et services publics et les secteurs de la santé et de l’action sociale, du
commerce et des services à la personne.
Le tableau suivant montre que la part des emplois salariés privés dans l’économie de la
connaissance et dans l’économie productive est nettement plus faible que dans d’autres aires
urbaines. En outre, la part des économies dites d’entraînement c’est-à-dire qui tirent le
système économique global (économie de la connaissance, du transport- logistique, économie
productive) est de 45% contre 57,7% à Paris, 61% à Lyon, 56,4% à Toulouse et 60,4% à
Grenoble. La part de l’économie d’accompagnement (économie résidentielle, du tourisme et
des loisirs) est de 55% dans l’aire urbaine, 10 points de plus que dans les autres grandes aires
urbaines françaises.
Structure économique- Part dans l'emploi salarié privé 2007
Aires urbaines
Marseille-
Aix
Paris
Lyon
Toulouse
Grenoble
Economie de la connaissance
16,4%
26,2%
18,8%
22,7%
18,1%
Econome productive
17,2%
16,6%
25,9%
21,5%
33,1%
Economie transport logistique
14,9%
14,9%
16,3%
12,2%
9,2%
Economie résidentielle
46,3%
30,5%
32,0%
36,0%
32,5%
Economie du tourisme et des
loisirs
8,7%
12,0%
7,0%
7,5%
7,0%
Source : Marseille-Provence : Métropole Euroméditerranéenne des échanges et de la
connaissance 2008-2014-AGAM-2007
Si on ajoute les emplois de l’économie de la connaissance et ceux de l’économie productive,
la situation de l’aire urbaine de Marseille-Aix ne s’améliore pas. Elle ne représente que 33,6%
des emplois contre 42,8% dans celle de Paris, 44,7% dans celle de Lyon, 44,% dans celle de
Toulouse et 51,2% dans celle de Grenoble.
Au sein de l’aire urbaine de Marseille-Aix, MPM et le pays d’Aubagne présentent un profil
plus présentiel (forte part des emplois dans l’économie résidentielle et touristique) tandis que
le pays d’Aix-en-Provence se révèle plus métropolitain que présentiel (forte part des emplois
dans l’économie productive et de la connaissance).

5/46
II- LES INTERVENTIONS DU CONSEIL GENERAL POUR
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, LA RECHERCHE ET
L’INNOVATION : CADRAGE GENERAL
Le Conseil Général consacre autour de 20 millions d’€ à l’enseignement supérieur et à la
recherche chaque année. Ces interventions dépendent de la réalisation des investissements,
récemment accélérée. Elles se montent à 24 M € en 2012 et à 26 M€ en 2013. Cette politique
volontaire se renforce avec les restructurations en cours : programme A*MIDEX
d’Aix-Marseille-Université, Pôles de compétitivité, Création de l’agence nationale de
valorisation de la recherche, Aix-Marseille Université... Il s’agit principalement d’aides à
l’investissement. La direction de la recherche et de l’enseignement supérieur est devenue un
service de la direction de l’économie, de l’aménagement du territoire et de la recherche en
2012.
Ces interventions ont été resserrées pour améliorer leur impact. Le Conseil Général
n’intervient pratiquement plus dans la vie étudiante, la professionnalisation des étudiants, la
culture scientifique grand public, les associations et le secteur privé. Il concentre maintenant
ses efforts sur le financement de grands projets comme ITER, le Centre d’Immunologie, les
plates-formes CERIMED et CIEL ASUR, le Centre Microélectronique Charpak à Gardanne.
Elles représentent, pour la période 2007-2013, 36 M€ pour la convention départementale du
CPER et 14 M€ pour le soutien à la recherche et à l’innovation.
La volonté du Conseil Général est de contribuer à la ré- industrialisation du département en
mobilisant son potentiel scientifique pour maintenir ou développer un tissu économique
performant dans tous les domaines, créateur d’emplois qualifiés non délocalisables ; qu’il
s’agisse d’immatériel (contenus et services multimédias de la Belle de Mai, logiciels sur le
site de Château-Gombert…), matériels (produits électroniques grand public, systèmes
électroniques professionnels) ou de services (Luminy, Sites hospitaliers…). La finalité
recherchée est la localisation simultanée de la recherche fondamentale, de la recherche-
développement et des lieux de production en facilitant les transferts de technologies sur
l’espace des Bouches-du-Rhône.
Les axes de développement de la politique de l’enseignement supérieur et de la recherche
1- Consolider les pôles d’enseignement supérieur et de recherche
A- Le CPER 2007-2013
Le contrat de projet précédent 2000-2006 avait déjà mobilisé le Conseil Général à hauteur de
76 M€ sur 6 ans qui ont permis :
- le regroupement des formations d’ingénieurs à Marseille Château-Gombert,
- le regroupement des équipes de recherche en économie publique sur l’ilot Bernard
Dubois (les travaux commencent !),
- des opérations de vie étudiante : équipements sportifs, cafeteria à Aix-en-Provence…
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
1
/
46
100%