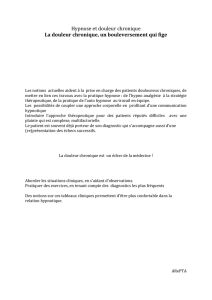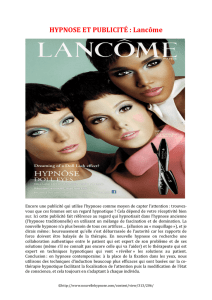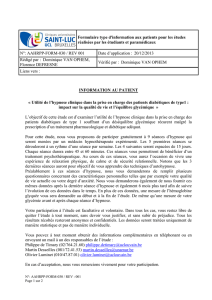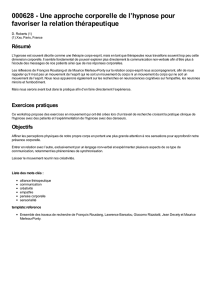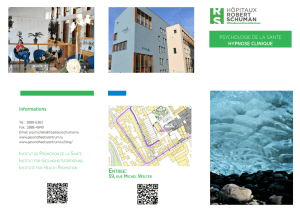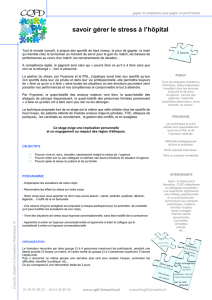Lire l`article complet

11
Le Courrier de l’algologie (5), n°1, janvier/février/mars 2006
Revue de presse
Revue de presse
Faut-il réviser les paliers OMS ?
L’échelle à trois niveaux de l’OMS est large-
ment reconnue et utilisée. Cette échelle est fon-
dée sur une utilisation progressive d’antal-
giques de plus en plus puissants, jusqu’à
l’obtention de l’efficacité optimale.
Dans une mise au point proposée sur le site de
l’IASP, Eisenberg et al. posent la question de
l’utilité du palier II à la lumière de plusieurs
essais cliniques. Ainsi une méta-analyse de
2004 (Eisenberg et al. J Clin Oncol 1994),
dans le cadre de douleurs liées à une patholo-
gie néoplasique, montre l’absence de diffé-
rence significative en termes d’efficacité anal-
gésique ou d’effets indésirables entre agents du
palier II et association AINS + agents du palier II.
Un essai récent, prospectif et randomisé (Mari-
nangeli et al. J Pain Symptom Manage 2004),
compare l’efficacité et la tolérance du palier III
en prescription de première ligne comparati-
vement au strict respect de l’échelle de l’OMS
chez une centaine de patients en phase termi-
nale. Pour des douleurs d’intensité moyenne
à modérée, les patients du groupe “palier III
d’emblée” avaient un meilleur soulagement,
moins de modifications thérapeutiques, une
meilleure satisfaction individuelle et une qua-
lité de vie identique.
Eisenberg et al. proposent donc une approche
fondée non pas sur une utilisation logique et
progressive de substances antalgiques de puis-
sance croissante, mais sur une adaptation
directe à l’intensité de la douleur :
– premier stade, douleur moyenne : non-mor-
phinique ± adjuvants ou coantalgiques ;
– deuxième stade, douleur modérée : non-mor-
phinique + morphiniques forts à faible dose
(après titration) ± adjuvants ;
– troisième stade, douleur sévère : morphi-
niques forts ± adjuvants ± procédures inva-
sives.
Cette approche nécessite donc d’évaluer soi-
gneusement la sévérité de la douleur et auto-
rise l’utilisation directe du palier III en cas de
douleur sévère. Nous avons tous dans notre
pratique utilisé le palier III en première ligne
chez des patients cancéreux très douloureux :
une titration correcte associée à une évalua-
tion rapprochée conduit dans la très grande
majorité des cas à un contrôle des effets indé-
sirables. Il n’en reste pas moins que les produits
du palier II rendent de bons services et évitent
ou retardent souvent la prescription d’opiacés
plus puissants, tout en gardant une efficacité
suffisante. Ils sont également une alternative en
cas d’intolérance ou d’effets indésirables
importants du palier III. Par ailleurs, le retrait
des marchés anglais, suédois et suisse du dex-
tropropoxyphène fortement dosé, en raison
d’un nombre élevé d’intoxications aiguës plus
ou moins volontaires, ne prive-t-il pas les pra-
ticiens d’un palier II efficace ?
Ces propositions de modification de l’échelle
de l’OMS pourraient peut-être s’inscrire dans
une démarche de logique économique.
L. Labrèze, F. Lakdja
Eisenberg E et al. Time to modify the WHO ladder?
Pain clinical updates. International Association
for the
Study of Pain. Décembre 2005 [http://www.iasp-
pain.org/PCU05-5.pdf].
Rotation par fentanyl
transdermique en pédiatrie :
innocuité et bonne tolérance
Ce travail multicentrique, réparti sur 66 sites et
conduit chez 200 patients âgés de 2 à 16 ans
présentant des douleurs cancéreuses ou non
cancéreuses, avait pour but de déterminer l’in-
nocuité et la tolérance des rotations par fenta-
nyl transdermique et de dégager des recom-
mandations de conversion et d’équianalgésie
pour ces rotations. L’évaluation a été menée par
échelle numérique et visuelle. Les qualités de
jeux et de vie ont été évaluées respectivement
par le “play performance scale” et le “child
health questionnaire”. Les effets indésirables
ont été notés du premier au quinzième jour et
une attention toute particulière a été consacrée
à l’hypoventilation et à la sédation pendant les
72 premières heures du traitement.
La titration initiale s’est faite sur la base d’une
conversion exprimée en morphine orale (soit
15 mg d’oxycodone = 30 mg de morphine per
os), puis d’une seconde conversion morphine
orale/fentanyl transdermique, sensiblement
identique à celle utilisée pour les adultes (à
savoir un patch de fentanyl 25 µg/h = 45-134 mg
de morphine per os). Dans 90 % des cas, l’ad-
ministration s’est déroulée sans problème et la
satisfaction globale était très bonne. Plusieurs
patients (13 sur 200) ont bénéficié d’un arrêt
des laxatifs, leur constipation s’étant amendée.
Les auteurs concluent à l’acceptabilité du fen-
tanyl transdermique en alternance avec les
opioïdes oraux ou parentéraux. Les tables de
conversion utilisées semblent appropriées pour
cette population jeune.
L. Labrèze, F. Lakdja

12
Le Courrier de l’algologie (5), n°1, janvier/février/mars 2006
Revue de presse
Revue de presse
Finkel JC, Finley A, Greco C, Weisman SJ, Zeltzer L.
Transdermal fentanyl in the management of chil-
dren with chronic severe pain. Cancer 2005;104(12):2847-57.
Douleur des cancers pancréatiques :
corrélation avec la progression
tumorale
Pour comprendre la relation entre l’évolution
tumorale des cancers pancréatiques et la douleur
induite, une série de souris transgéniques déve-
loppant un cancer pancréatique a été étudiée au
fur et à mesure de l’avancée pathologique. En
6 semaines, les changements cellulaires pré-
cancéreux sont évidents. Ils commencent par un
accroissement de la densité vasculaire et des
macrophages ainsi que par une augmentation
significative des fibres sensitives et sympa-
thiques du pancréas. Tous ces changements sont
parallèles à la croissance tumorale, et les com-
portements douloureux des animaux (vocalises,
attitudes voûtées…) deviennent significatifs à la
seizième semaine d’évolution, à un stade où le
cancer pancréatique est déjà avancé. Il semble
donc, comme chez l’homme, qu’il existe des
changements cellulaires et tissulaires patholo-
giques stéréotypés. Tandis que la perte de poids
signe généralement une évolution avancée, on
constate un décalage entre la progression tumo-
rale et les comportements douloureux. Définir
les mécanismes qui masquent cette douleur à un
stade précoce pourrait aider à un diagnostic plus
rapide et augmenter ainsi les chances de survie
et la qualité de vie des patients.
L. Labrèze, F. Lakdja
Lindsay TH et al. Pancreatic cancer pain and its cor-
relation with changes in tumor vasculature, macro-
phage infiltration, neuronal innervation, body weight and
disease progression. Pain 2005;119(1-3):233-46.
Réponse prévisible de la morphine
à partir du profil psychologique ?
Cette étude originale avait pour objectif de
mettre en évidence un rôle possible des traits
de personnalité dans les variations de réponse
aux opioïdes. L’évaluation psychologique a
été faite à partir du questionnaire tridimen-
sionnel de personnalité de Cloninger avant et
après le test. Trois types de personnalités ont
ainsi été testés : évitement du mal, dépendance
à la récompense et recherche de nouveauté.
Trente-quatre patients volontaires sains
(15 femmes et 19 hommes) ont été soumis au
cold pressor test ; seuil douloureux, tolérance
et intensité ont été mesurés à 30 minutes d’in-
tervalle avant et après administration d’un pla-
cebo ou de 0,5 mg/kg per os de morphine (essai
randomisé et en double aveugle).
Un score élevé du trait “évitement du mal” se
révélait hautement prédictif d’un plus grand
soulagement après administration d’un
opioïde. Les femmes montraient dans leur
ensemble une meilleure réponse dans les deux
bras de l’étude (morphine, placebo). Cette
étude confirme le rôle des différences indivi-
duelles de la réponse aux opioïdes, non seule-
ment selon le trait de personnalité, mais éga-
lement selon le genre. Ce type d’étude
mériterait d’être complété par des études plus
larges, le nombre de volontaires étant un peu
faible dans cet essai.
L. Labrèze, F. Lakdja
Pud D et al. Can personality traits and gender predict
the response to morphine? An experimental cold
pain study. Eur J Pain 2006;10:103-12.
Analgésie par électro-acupuncture
sur un modèle de douleur
cancéreuse chez la souris
L’électro-acupuncture est une alternative thé-
rapeutique simple, peu coûteuse et sans effets
indésirables dans la prise en charge de la dou-
leur. Ses mécanismes d’action restent peu
clairs. Le but de ce travail était d’examiner
l’activité antihyperalgésique immédiate de
cette technique sur un modèle de mélanome
chez la souris. Les douleurs apparaissent entre
le huitième et le quatorzième jours, avec des
intensités cotées de modérée à sévère.
Dans un protocole d’électro-acupuncture unique,
mis en place 8 jours après inoculation de cel-
lules mélaniques dans les régions plantaires, les
effets antihyperalgésiques apparaissent dans les
15 à 30 minutes pour une durée moyenne de 50
minutes. Toutefois, la même technique mise en
œuvre au vingtième jour n’entraîne pas d’effet
antihyperalgésique significatif.
Dans un protocole de séance d’électro-acu-
puncture quotidienne, les effets sont positifs
s’il est instauré au huitième jour, mais pas s’il
commence le seizième jour (considéré comme
un stade avancé chez ce modèle de souris). Les
auteurs concluent donc à une réelle efficacité
de cette technique si le protocole est instauré
à un stade précoce des douleurs.
L. Labrèze, F. Lakdja

13
Le Courrier de l’algologie (5), n°1, janvier/février/mars 2006
Revue de presse
Revue de presse
Mao-Ying QL et al. Stage-dependent analgesia of elec-
tro-acupuncture in a mouse model of cutaneous
cancer pain. Eur J Pain 2005;20.
Se reconnecter à la magie de la vie
Ce livre, est écrit par Joyce Mills, psychologue
et hypnothérapeute, qui a précédemment écrit
avec Richard Crowley Métaphores thérapeu-
tiques pour enfants.
Le livre de Joyce Mills cherche à permettre au
lecteur à travers l’utilisation de symboles et
d’histoires, de se reconnecter avec lui-même.
Il intègre les traditions du conte thérapeutique
et de l’hypnose ericksonienne ainsi que les
rituels traditionnels amérindiens et hawaïens
dont Joyce Mills est héritière. “Les rituels et les
cérémonies sont importants dans notre vie quo-
tidienne pour nous reconnecter à quelque
chose qui est au-delà de nos possessions maté-
rielles et de nous-mêmes, pour instiller en nous
le sens de la communauté et le caractère sacré
de la vie.”
Dans ce livre, l’auteur aborde à la fois des his-
toires amérindiennes ou hawaïennes, mais
nous parle aussi simplement d’histoires de sa
vie.
Différents outils thérapeutiques sont propo-
sés : le pot à rêves, le bouclier d’identité, le
bol de lumière, le cercle de la réussite, les
cérémonies de l’eau, les rituels et les cérémo-
nies pour guérir et célébrer la vie, la bouteille
de mémoire, etc.
Ce livre simple, très humain et d’une grande
profondeur, constitue à la fois une aide au
patient qui souffre, qui a perdu un être cher, et
un merveilleux outil de travail pour le psy-
chologue ou l’hypnothérapeute. Enfin, il peut
aider le médecin confronté à la lassitude, à se
ressourcer.
C. Wood
Mills J. Se reconnecter à la magie de la vie. Paris :
Le Courrier du Livre, 2006.
L’hypnose aujourd’hui
Que peut vraiment l’hypnose ? J.M. Benhaïem,
qui n’en est pas à son premier essai, relève
avec d’autres spécialistes, le défi de répondre
à cette question.
L’ouvrage émane d’un collectif de praticiens,
de chercheurs, de philosophes déjà familiari-
sés avec l’hypnose. Chacun de ces auteurs nous
fait par de son expérience et de ses espoirs dans
cette approche médicale susceptible de chan-
ger les relations thérapeutiques avec les
patients. Si l’on ne s’en tenait qu’à l’étymolo-
gie, l’hypnose pourrait être considérée comme
un “sommeil artificiel provoqué” mais dont le
maître mot serait “influence”.
Pour ces auteurs, l’hypnose serait un “proces-
sus” qui se schématise par une succession de
phases relativement instables : tout d’abord un
état de veille ordinaire, puis une fixation de
l’attention ou du regard du patient qui aboutit
à une dissociation de ses deux “sensorialités”
et à la fermeture du patient à toute sensation,
et enfin une troisième et dernière phase qui,
grâce aux ressources, à l’imagination et à l’in-
ventivité du patient, permet l’ouverture ou la
“perceptude”, terme imaginé par François
Roustang. La démarche globale en hypnose
vise à soigner la focalisation, la sidération et
l’immobilisation, et passe donc par les trois
étapes précédemment décrites pour obtenir le
soulagement, voire la guérison.
Le champ d’action de l’hypnose est très large.
C’est ainsi que, en anesthésie, l’hypnose est
l’une des plus anciennes techniques utilisées.
Très prisée depuis l’Antiquité jusqu’au milieu
du XIXesiècle, elle est par la suite reléguée au
dernier rang du fait de l’apparition des anes-
thésiques chimiques. Elle suscite de nouveau
progressivement l’intérêt à partir du milieu du
XXesiècle grâce aux travaux de Milton Erick-
son, son plus ardent défenseur et grand réno-
vateur. L’hypnose permet à l’anesthésiste
d’avoir une vision globale de son patient et,
de ce fait, instaure une relation soignant/soigné
privilégiée pour les deux partenaires du fameux
“colloque singulier”.
La prise en charge de la douleur gagnerait à uti-
liser l’hypnose à condition que le bénéfice/
risque de cette méthode soit bien évalué, et
qu’elle tienne compte également de certaines
contre-indications. Les travaux d’imagerie
cérébrale confortent l’hypnose dans son action,
reproductive et spécifique.
L’hypnose est de même un outil intéressant
dans la prise en charge de l’anxiété, des peurs,
voire des phobies. L’enfance étant empreinte
de rêve et d’imaginaire, les indications d’hyp-
nose dans ce contexte sont multiples (par
exemple, chez l’enfant subissant des soins den-
taires).
Dans le cadre des soins palliatifs, l’hypnose
ericksonienne mérite toute sa place avec, tou-
tefois, quelques nuances : l’utilisation, l’adap-
tation, la création d’un changement, l’attribu-
tion d’un sens et, enfin, le respect, dans un

14
Le Courrier de l’algologie (5), n°1, janvier/février/mars 2006
Revue de presse
Revue de presse
esprit kantien : “Je t’aiderai à venir, si tu viens,
à ne pas venir si tu ne viens pas” (Antonio Por-
cha).
L’auteur principal de l’ouvrage, le Dr J.M.
Benhaïem, dévoile en outre un talent de
conteur en mettant en scène une tulipe, un
saule pleureur et un papillon. La tulipe par sa
vérité épicurienne, s’oppose au saule pleureur,
fataliste, qui finit rassuré par la vérité hypno-
tique du papillon : “Si tu ne peux agir sur la réa-
lité, il nous reste alors à la vivre le mieux pos-
sible !”
Un livre à conseiller vivement à tout soignant.
S. Colombani, F. Lakdja
Benhaïem J.M. (sous la dir. de). L’hypnose aujourd’hui.
Paris : éditions In press, 2006.
Relaxation, hypnose et migraine
de l’enfant
Recommandée par l’ANAES comme traite-
ment de fond dans la migraine de l’enfant, la
relaxation est une méthode en pleine expansion
dans les secteurs de soins concernés. Ce DVD
propose au public de découvrir de quelle
manière se déroulent sur le terrain les séances
de relaxation et comment l’hypnose peut être
envisagée, seule ou en complément dans le
traitement des migraines de l’enfant. Après une
synthèse claire des signes de cette pathologie
et des images d’une “consultation-type”, le
film principal présente la façon dont les
groupes fonctionnent, tandis que des témoi-
gnages d’enfants et d’adolescents illustrent le
résultat obtenu. Enfin, des professionnels de la
relaxation et de l’hypnose (I. Célestin-Lhopi-
teau, J.M. Benhaïem, G. Salem et R. Amou-
roux) présentent de façon plus théorique les
diverses méthodes utilisables.
Ce DVD contient en fait deux films : le pre-
mier, le plus complet, s’adresse aux profes-
sionnels (32’13) ; le second, plus bref (6’50),
est destiné aux enfants, pour leur expliquer en
quoi consistent les groupes. Un livret contient
la présentation du DVD, une petite bibliogra-
phie et des liens sur le Net.
Relaxation, hypnose et migraine de l’enfant
est au final un support remarquablement
constitué, très clair et conçu de manière très
didactique. Il offre une perspective intelligible
des méthodes présentées, et peut être utilisé à
la fois comme support d’information pour les
soignants et comme outil plus clinique de pré-
sentation de la migraine et de ses méthodes de
prise en charge aux enfants et à leur entourage.
A. Bioy
I. Célestin-Lhopiteau (conseillers scientifiques :
D. Annequin et B. Tourniaire ; coordination :
P. Thibault), Paris : association Sparadrap 2005, avec le
soutien de la CNP.
1
/
4
100%