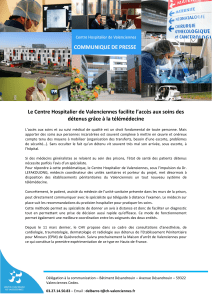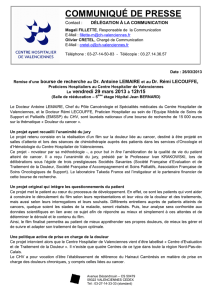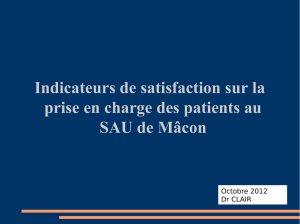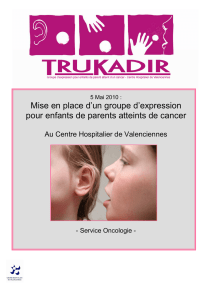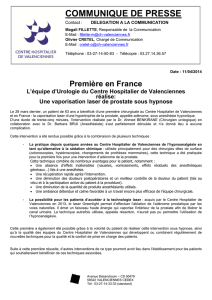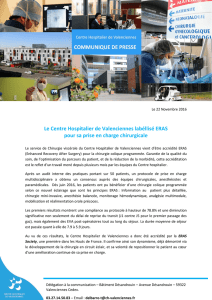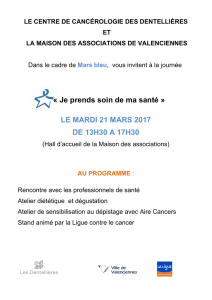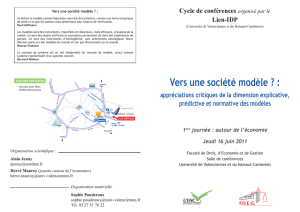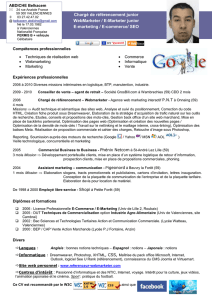Rapport d`observations définitives

ROD.0391
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
- Centre hospitalier de Valenciennes -
(Département du Nord)
SUIVI, LE CAS ECHEANT, DES REPONSES DES ORDONNATEURS ET
DES PRESIDENTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

- 2 -
Résumé
Le centre hospitalier de Valenciennes (CHV), avec une capacité proche de 1 800 lits pour
un bassin de vie de 800 000 habitants, est l’établissement le plus important de la région après le
CHU de Lille. Dans le cadre du plan « hôpital 2007 », de nombreuses opérations de restructurations
internes sont en cours, un groupement de coopération sanitaire (GCS) avec l’association
hospitalière Nord Artois clinique (AHNAC) a été créé et s’agissant des urgences, un partenariat
avec la clinique Teissier s’est développé. L’établissement a été accrédité sans réserve ni
recommandation par l’agence nationale d’accréditation et dévaluation en santé (ANAES).
Entre 2002 et 2004, le nombre des sorties primaires du SMUR diminue mais la durée des
interventions augmente. L’activité du SAU (accueil et traitement des urgences) se caractérise quant
à elle par un taux d’hospitalisation élevé pour les patients accueillis à l’hôpital et par une
augmentation globale du nombre d’admissions du fait de la création d’un second site d’accueil à la
clinique Teissier. Les relations nouées entre les deux établissements ont été établies malgré les avis
défavorables rendus par le comité régional de l’organisation sanitaire et sociale (CROSS) quant au
fonctionnement du site d’urgence (UPATOU) de la clinique. L’agence régionale de l’hospitalisation
(ARH) a fermement incité à une réorganisation de ce dispositif dans les plus brefs délais mais la
chambre constate que l’UPATOU de fait de la clinique perdure.
Le CHV s’est inscrit dans une politique de coopération transfrontalière avec notamment
deux établissements de la province belge du Hainaut : le centre hospitalier régional de Tournai
(dans le domaine de la réanimation) et la clinique de Peruwelz (pour les soins de suite et de
réadaptation). Ces actions de coopération rencontrent toutefois des difficultés en ce qui concerne les
modalités financières de prise en charge des patients du fait du défaut d’accord au niveau national.
La convention conclue avec le centre hospitalier de Tournai n’a pas été approuvé par la CNAM et
les surcoûts financiers liés à sa mise en œuvre sont supportés par les patients français, sans qu’ils en
soient préalablement informés, et par le CHV.
Entre 1999 et 2003 (dernière année avant la mise en œuvre de la tarification à l’activité,
T2A), les charges et les produits de l’établissement ont progressé de façon parallèle, et la valeur du
point ISA a toujours été légèrement inférieure aux moyennes régionales. Toutefois, le nombre de
points ISA (indice de mesure de la production de l’établissement) qui a progressé jusqu’en 2000
s’est stabilisé à la baisse les années suivantes. Cette situation, si elle devait perdurer, ne sera pas
sans conséquence sur les produits futurs du CHV avec la mise en place de la T2A qui établit un lien
direct entre les produits et l’activité.

- 3 -
I. PROCEDURE
L’examen de la gestion du centre hospitalier de Valenciennes a porté sur la période courant
à partir de l’année 1998.
L’entretien préalable prévu par l’article L. 241-7 du code des juridictions financières a eu
lieu avec le directeur de l’établissement, le 9 janvier 2006, avec le directeur par intérim du
1
er
juillet 2001 au 16 décembre 2001, le 9 janvier 2006 et avec le précédent ordonnateur, en
fonctions du 1
er
octobre 1995 au 30 juin 2001, le 12 janvier 2006.
Lors de sa séance du 9 mars 2006, la chambre a formulé observations provisoires qui ont été
adressées le 13 novembre 2006 au directeur de l’établissement et pour la partie qui les concerne à
ses deux prédécesseurs. Le même jour ces observations ont été adressées au président du conseil
d’administration et pour la partie qui les concerne aux présidents en fonction du 1
er
janvier 1998 au
15 mai 2001 et du 16 mai 2001 au 20 juillet 2004. Enfin, le 17 novembre 2006 un extrait de ces
observations a été adressé, en tant que personne mise en cause, au responsable légal de la clinique
Teissier.
Le directeur de l’établissement a répondu par lettre enregistrée au greffe de la chambre le
15 janvier 2007, et le directeur en fonction du 1
er
juillet 2001 au 16 décembre 2001 a répondu par
lettre enregistrée au greffe le 24 novembre 2006. Les autres personnes n’ont pas répondu.
Après avoir examiné ces réponses, la chambre a, lors de sa séance du 19 avril 2007, arrêté
les observations définitives suivantes :
II. OBSERVATIONS DEFINITIVES
Les observations de la chambre portent sur les points suivants : l’activité de
l’établissement (I), le fonctionnement des urgences (II), la coopération transfrontalière (III), la
fiabilité des comptes (IV) et la situation financière de l’établissement (V).
I - L’ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT
Le centre hospitalier appartient au secteur sanitaire n° 7 de la région Nord - Pas-de-Calais.
Avec une capacité proche de 1 800 lits, pour un bassin de vie de 800 000 habitants, il est le plus
important établissement régional après le CHU de Lille. Il est composé d'une unité centrale
constituée de plusieurs bâtiments et de nombreuses annexes (CMP : centre médico-psychologique
enfants et adultes dans les environs ; CATTP : centre d’accueil thérapeutique à temps partiel ;
hôpital de jour psy ; maisons de retraite ; EPHAD : établissement public d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes ; etc…) ; il regroupe 21 établissements rattachés.
L’environnement proche compte 6 cliniques privées dont la clinique Teissier à Valenciennes
(139 lits) avec laquelle une coopération est instaurée depuis 1999, s’agissant des urgences. En outre,
l'établissement a signé avec l'association hospitalière Nord Artois cliniques (AHNAC) une
convention de partenariat pour la mise en œuvre d’un groupement de coopération sanitaire (GCS)
qui prévoit un projet médical commun entre l’hôpital et la clinique, débouchant sur une répartition
des activités en matière de cardiologie, de pneumologie et de chirurgie lourde, notamment
thoracique.

- 4 -
Ce projet s'insère dans le plan « hôpital 2007 » et prévoit, entre autres, un pôle mère/enfant
(le service de néonatologie inauguré en janvier 2005), un établissement pour personnes âgées
dépendantes, une unité de psychiatrie rénovée, un service de soins de suite et de réadaptation de
195 lits, un institut de soins infirmiers (IFSI) et un pôle logistique autonome associant blanchisserie,
cuisine centrale et laboratoire d’analyses médicales. Ces restructurations représentent un
investissement de 190 M€, dont 172 M€ de travaux.
L'établissement a été accrédité sans réserve ni recommandation, par l'agence nationale
d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES). Son activité, mesurée selon la norme SAE
(statistique annuelle des établissements) fait apparaître une capacité (2003) de 823 lits de médecine,
chirurgie et obstétrique (MCO) qui résulte de la baisse, depuis 2001, des admissions et des lits, la
durée moyenne de séjour (DMS) et le taux d’occupation restant constants.
(Source : rapport de gestion 2000 et 2003)
Exercices 1999 2000 2001 2002 2003
Nombre de lits MCO
(en capacité réelle) 864 866 864 827 823
dont gynécologie-obstétrique 82 82 82 82 82
dont médecine 569 571 569 538 534
dont chirurgie 213 213 213 207 207
Nbre d'admissions 45 176 46 837 45 312 41 885 40 459
DMS 5,50 5,40 5,50 5,60 5,60
Nbre de journées 246 378 252 920 247 819 233 392 225 589
Taux d'occupation
79,73
81,81
80,16
74,65
79,86
Cette situation correspond à une tendance nationale, selon une étude de la direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère de la santé.
L'évolution de l'établissement est toutefois contrastée selon les services : la baisse est plus faible en
médecine (1,2 % des entrées ou 0,8 % des journées) qu’en chirurgie (4,3 % des entrées ou 2,8 %
des journées) ; a contrario, la gynécologie-obstétrique enregistre une légère hausse (0,7 % des
entrées ou 0,4 % des journées).
L'hospitalisation incomplète ne représente que 6 % dans la prise en charge MCO. Elle
intéresse les services d’endocrinologie, de dermatologie, de néphrologie, d'hématologie, d'oncologie
et de pédiatrie ainsi que de neurologie. L’activité en pédiatrie et en oncologie est en nette
augmentation avec des hausses respectives de 56 % et de 7,3 %.
L'ensemble de l'activité « soins de suites et réadaptation fonctionnelle » couvrait, pour sa
part, une baisse importante des admissions (- 55 %).
(Source : rapport de gestion 2000 et 2003)
Soins de suites et RF* 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Nbre d'admissions 1 733 1 436 1 191 1 012 925 960
DMS 21,09 25,90 31,76 35,67 40,82 39,83
Nbre de journée 36 555 37 212 37 825 36 103 37 754 38 237
Taux d'occupation
80,77
82,22
88,44
84,54
88,40
88,30
* RF (rééducation fonctionnelle)
L’allongement de la durée moyenne de séjour, dû aux soins supplémentaires liés à l'âge des
patients explique l’élévation du taux d’occupation.

- 5 -
L'activité « long séjour », retracée au tableau ci-après, témoigne d’un taux d’occupation
maximal.
(Source : rapport de gestion 2000 et 2003)
USLD 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Nbre d'admissions 129 126 112 95 109 125
Nbre de journées 67 846 65 895 62 933 64 644 67 602 66 442
Taux d'occupation 100,48 97,59 92,94 95,73 100,11 98,40
Enfin, l'activité du « secteur hébergement » (maisons de retraite) croît régulièrement.
(Source : rapport de gestion 2000 et 2003)
Hébergement 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Nbre d'admissions 421 363 202 156 225 252
Nbre de journées 125 473 127 261 129 474 131 911 132 623 134 048
Taux d'occupation
76,05
77,14
89,11
91,03
93,89
94,9
II - LE FONCTIONNEMENT DES URGENCES
Durand la période sous contrôle, le système de prise en charge des urgences se structurait
autour :
- d’unités d’accueil et de traitement des urgences : le service d’accueil et de traitement des
urgences (SAU), éventuellement spécialisé (POSU), ou unité de proximité, d’accueil, de traitement
et d’orientation des urgences (UPATOU) éventuellement saisonnière ;
- de centres de réception et de régulation des appels (SAMU ou centre 15), au nombre de
deux en région Nord - Pas-de-Calais, qui ont notamment pour mission de déterminer et déclencher,
dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ;
- de services mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) destinés à effectuer les
interventions médicales hors de l’établissement dans le cadre de l’aide médicale urgente, en liaison
ou à la demande des SAMU.
Le centre hospitalier de Valenciennes compte un service d’accueil et de traitement des
urgences (SAU) agréé et un service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).
A - Le SMUR
Le SMUR de Valenciennes comprend deux équipes, à la disposition 24h/24h du SAMU
(centre 15 situé à Lille). Le nombre d’interventions (sorties) effectuées en 2004 s’établit à 4 946,
pour un total régional de 54 550, dont 36 773 dans le département du Nord. A plus de 90 %, ces
« sorties » relèvent du « transport primaire » qui correspond à la prise en charge d’un patient au lieu
de détresse et au traitement et transport jusqu’à l’hôpital. Le solde intéresse « le transport
secondaire » qui concerne le transfert d’un malade d’un hôpital à un autre afin de soins ou
d’explorations spécialisés sans interruption de la chaîne des soins médicaux.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%