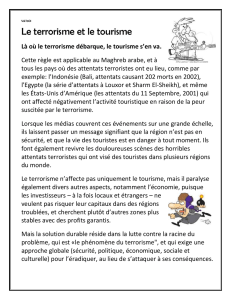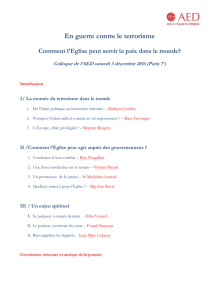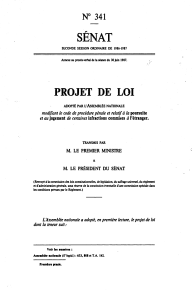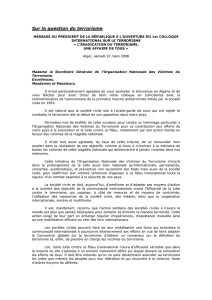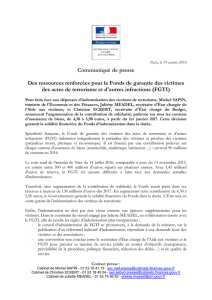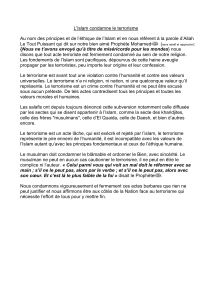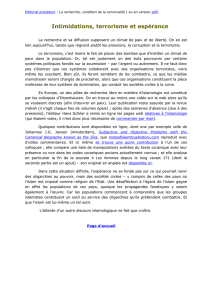Société - revue Risques

Risques
Les cahiers de l’assurance N°
105
SOCIÉTÉ
Prendre des risques
levier de la croissance
Emmanuel Macron
RISQUES ET SOLUTIONS
L’assurance automobile
face aux chocs du futur
Jean-Dominique Antoni
Jonathan Bibas
Anne-Charlotte Bongard
Valérie Cohen
Patrick Degiovanni
Guillaume Leroy
Stéphane Pénet
Frédéric Planchet
ANALYSES ET DÉFIS
Terrorisme et assurance
François-Xavier Albouy
Gilles Bigot
Alexandra Cohen-Jonathan
Valéry Denoix de Saint Marc
Bernard Durand
Pierre Martin
Laurent Montador
Jacques Pelletan
Philippe Séphériadès
François Vilnet
Michal Zajac
ÉTUDES ET DÉBATS
Arthur Charpentier
Marc Ferracci
Sylvestre Frezal
Dominique de La Garanderie
François Meunier
Hélène N’Diaye
Pierre-Charles Pradier
Gilles Saint-Paul
Hélène Xuan

Luc Arrondel, Philippe Askenazy, Didier Bazzocchi, Jean Berthon
Jean-François Boulier, Marc Bruschi, François Bucchini, Gilbert Canameras
Pierre-André Chiappori, Michèle Cohen, Alexis Collomb, Michel Dacorogna
Georges Dionne, Brigitte Dormont, Patrice Duran, Louis Eeckhoudt, François Ewald
Didier Folus, Pierre-Yves Geoffard, Claude Gilbert, Christian Gollier, Frédéric Gonand
Rémi Grenier, Marc Guillaume, Sylvie Hennion-Moreau, Dominique Henriet, Vincent Heuzé
Jean-Pierre Indjehagopian, Meglena Jeleva, Gilles Johanet, Elyès Jouini, Dorothée de Kermadec-Courson
Jérôme Kullmann, Dominique de La Garanderie, Patrice-Michel Langlumé, Régis de Laroullière
Claude Le Pen, Robert Leblanc, Florence Legros, François Lusson, Florence Lustman, Olivier Mareuse
Pierre Martin, André Masson, Luc Mayaux, Erwann Michel-Kerjan, Alain Moeglin
Marie-Christine Monsallier-Saint-Mleux, Stéphane Mottet, Michel Mougeot, Bertrand Munier
Stéphane Pallez, Carlos Pardo, Jacques Pelletan, Pierre Pestieau, Pierre Petauton, Pierre Picard
Manuel Plisson, Jean-Claude Prager, André Renaudin, Angelo Riva, Geoffroy de Saint-Amand
Christian Schmidt, Côme Segretain, Jean-Charles Simon, Kadidja Sinz, Olivier Sorba
Didier Sornette, Lucie Taleyson, Patrick Thourot, Alain Trognon, François de Varenne
Nicolas Véron, Jean-Luc Wybo, Hélène Xuan
Jean-Hervé Lorenzi
Directeur de la rédaction
François-Xavier Albouy et Charlotte Dennery
Société
Gilles Bénéplanc et Daniel Zajdenweber
Risques et solutions
Pierre Bollon et Pierre-Charles Pradier
Études et débats
Arnaud Chneiweiss et Philippe Trainar
Analyses et défis
Pierre Michel Arielle Texier
Marie-Dominique Montangerand
Secrétaire de rédaction
Comité éditorial
Comité scientifique

1
.
Société
Prendre des risques, levier de la croissance
Entretien avec
Emmanuel Macron, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
.
Risques et solutions
L’assurance automobile face aux chocs du futur
Arnaud Chneiweiss, Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valérie Cohen, Horizon 2030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patrick Degiovanni, Une nouvelle offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guillaume Leroy et Frédéric Planchet, Point de vue des actuaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anne-Charlotte Bongard, Explorer le champ des possibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stéphane Pénet, Véhicule autonome, quel impact ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jonathan Bibas, Le véhicule connecté, quels nouveaux risques ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jean-Dominique Antoni, Le nouveau rôle des assisteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
.
Analyses et défis
Terrorisme et assurance
François-Xavier Albouy, Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disruption de la terreur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Michal Zajac, Les conséquences économiques du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jacques Pelletan, Le regard de l’économiste sur l’acte terroriste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Philippe Séphériadès, Modélisation du risque terroriste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bernard Durand, La couverture des actes de terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
François Vilnet, Adapter les couvertures internationales du terrorisme aux nouvelles menaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laurent Montador, Terrorisme, un nécessaire partenariat public-privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gilles Bigot, Une crise éclata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valéry Denoix de Saint Marc et Alexandra Cohen-Jonathan, L’indemnisation des victimes d’un attentat,
le cas du DC-10 d’UTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pierre Martin, L'assurance française et la Seconde Guerre mondiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
.
Études et débats
Arthur Charpentier, La guerre des étoiles, distinguer le signal et le bruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
François Meunier, Immigration économique, vendre les visas d’entrée est-il une solution ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hélène N’Diaye et Sylvestre Frezal, Les modèles de risque et la prise de décision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les débats de Risques
Marc Ferracci, Dominique de La Garanderie et Gilles Saint-Paul, Faut-il réformer le contrat de travail ? . . . . . . . . . . . . . .
Actualité de la Fondation du risque
Hélène Xuan, Le contrat social entre générations est mort… il faut le réinventer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hubert Rodarie, La pente despotique de l’économie mondiale par Pierre-Charles Pradier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arnaud Chneiweiss, Schiste noir par Pierre-Charles Pradier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domingo de Soto, La cause des pauvres par Pierre-Charles Pradier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
17
19
24
29
35
43
49
55
63
65
73
79
85
95
99
106
112
115
120
127
133
141
144
151
157
158
159
Sommaire -
n° 105
-


S’il fallait dénommer le numéro 105 de Risques, on emploierait sans nul doute le mot d’avenir. Dans
l’ensemble des rubriques de ce numéro, est posée la question fondamentale de ce que sera notre monde
de demain, autant dans une perspective d’espoir que de doute.
L’entretien avec Emmanuel Macron, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, est ainsi
caractéristique de ce souhait que nous avons eu de façonner notre vision de demain. D’une certaine
manière, c’est presque une conception d’une France redynamisée qu’il nous propose, fondée très
largement sur la prise de risques. Cette conception de la politique, nous la retrouvons de façon quasi-
ment symétrique à la fin de ce numéro, lorsque nous nous interrogeons sur ce que doit être le contrat
de travail de demain et ce que pourrait être un contrat intergénérationnel, potentiel pilier de relations
apaisées entre les générations montantes et les seniors. Prenons-en conscience : tout cela est extrêmement
nouveau dans un pays comme la France. Les débats des dernières semaines entre économistes à
propos du projet de loi « travail », visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections
pour les entreprises et les actifs, illustrent à quel point nous avions vu juste lorsque nous avons décidé
de nous interroger en profondeur sur la réforme des contrats de travail.
Encore plus importante est la contribution d’Hélène Xuan sur la jeunesse. Élaborée autour de l’idée
forte selon laquelle un contrat intergénérationnel renouvelé pourrait partiellement se substituer à celui
qui nous lie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette présentation propose un dépassement
de notre contrat social actuel qui fige notre protection sociale et notre mode de répartition des revenus,
et empêche toutes velléités de réformes et d’évolution de notre société. Il s’agit ici de permettre les
changements nécessaires dans notre organisation sociale, ce qui passe par la construction d’accords
repensés entre générations sur les problèmes de santé, de retraite, de formation mais aussi et surtout
d’insertion sur le marché du travail. Adieu à Locke et Rousseau et bienvenue aux compromis entre
générations ! Ceux-ci permettraient à notre société ankylosée de se refonder et de donner à la jeunesse,
atout essentiel, la place qu’elle mérite. Prenons un exemple si important pour les assureurs : les retraites.
La jeune génération demeure sceptique sur la pérennité de notre système de retraite et les seniors réalisent
aujourd’hui à quel point ils vont voir leur pension diminuer à l’avenir. Consolidons le système en cons-
truisant un dispositif d’épargne retraite obligatoire. Mais, en contrepartie, modifions nos règles fiscales
de manière à favoriser la transmission du patrimoine non plus de la génération des quatre-vingts ans
vers celle des soixante ans, mais vers ceux qui en ont le plus besoin, c’est-à-dire ceux de trente ans. Ainsi
pourrait-on imaginer un système qui favorise les femmes et les hommes de cet âge afin qu’ils puissent
acquérir un logement, mais aussi qui encourage le financement de créations d’entreprises.
Par ailleurs, dans le corps de ce numéro, deux nouveaux défis sont traités : celui de l’assurance auto-
mobile d’une part, confrontée aux révolutions technologiques à venir et notamment à l’émergence de
la voiture autonome, et celui du terrorisme d’autre part, phénomène dont chacun voit bien qu’il ne
s’agit pas d’un accident de parcours, mais que nos sociétés doivent pouvoir envisager des solutions de
long terme, tant en matière de sécurité qu’en matière d’assurance.
Rarement la revue Risques n’a abordé de sujets aussi difficiles, délicats et complexes. Sur chacun des
problèmes analysés, nous avons mis en lumière des solutions qui certes n’épuisent pas les sujets, mais
qui permettent de penser de manière prospective et positive. Bien entendu, notre revue, aujourd’hui
comme toujours, ne fait que lancer le débat. Et elle poursuivra sans relâche cette noble mission.
Jean-Hervé Lorenzi
Éditorial
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
1
/
164
100%