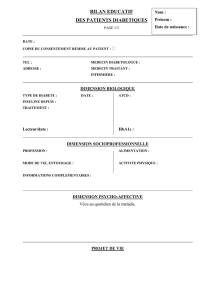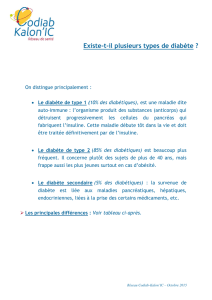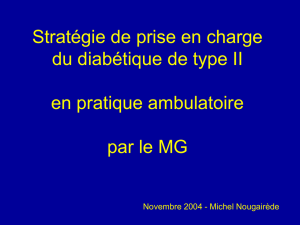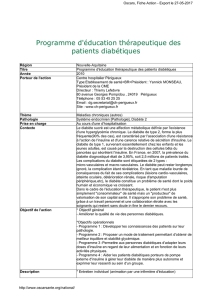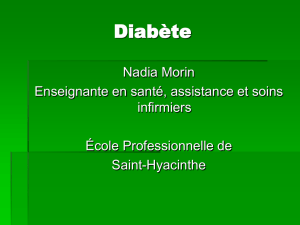Éducation thérapeutique, rôle dans la prise en charge d`une

Revue
Éducation thérapeutique,
rôle dans la prise en charge d’une maladie
chronique : exemple du diabète
et perspectives d’application
dans le domaine cardiovasculaire
Fabienne Elgrably, Agnès Sola, Jocelyne M’Bemba, Étienne Larger, Gérard Slama
Service de diabétologie, université René-Descartes Paris 5, AP-HP, Hôtel-Dieu, 1 place du Parvis Notre-Dame, 75181 Paris Cedex 04
Résumé.L’éducation des patients atteints de diabète est nécessaire et utile, donc incontournable. L’éducation thérapeutique, centrée sur le
patient, le place au centre du processus éducatif, avec ses opinions, ses idées, ses sentiments, ses croyances, son entourage... aussi bien qu’avec
son « statut » médical. Par l’éducation, il s’agit de l’aider à gérer son traitement, à prévenir les complications évitables en lui conservant, voire
en améliorant, sa qualité de vie, ce qui produit un effet thérapeutique associé à ceux des autres outils du traitement. Le diagnostic éducatif est
la première étape du processus éducationnel : il s’agit de la collection d’informations concernant le patient sur les plans bioclinique,
éducationnel et psychosocial. Récemment, dans le service de diabétologie de l’Hôtel-Dieu de Paris, un programme de prise en charge
ambulatoire des patients diabétiques de type 1 avec auto-apprentissage a été mis en place. Il s’agit d’un modèle d’éducation thérapeutique
découvert par Howorka en 1990, développé par Grimm et Berger en Suisse, que nous avons importé et adapté et que nous appelons
« auto-apprentissage ambulatoire au traitement du diabète de type 1 (AT1) ». Plus récemment encore, un programme adapté au type 2 a été créé
sur un modèle similaire. Cette méthode éducative peut être transposée à d’autres maladies chroniques, notamment dans la prévention du risque
cardiovasculaire, que le patient soit diabétique ou non. Un obstacle majeur reste à surmonter : la prise en compte financière de cette activité
humaine par les autorités de tutelle (remboursement).
Mots clés : éducation thérapeutique, diabète, diagnostic éducatif
Abstract. The role of therapeutic education in the management of chronic disease: example of diabetes and possible
application to cardiovascular diseases. Education for diabetic patients is necessary, useful, and consequently unavoidable. Therapeutic
education places the patient at the center of the educational process, with his opinions, ideas, feelings, health beliefs, his environment... as well
as his medical status. With this educational process, one tries to help patients to organize their own treatment, in order to prevent complications
and to maintain or enhance their quality of life. Thus, it becomes another therapeutic tool along side all the others. Educational diagnosis is the
first step of this process : it means collection of patient information related to bio-clinical, educational and psychosocial data. Recently, in the
Diabetes Unit of Hôtel-Dieu Hospital, in Paris, a self-learning ambulatory program for type 1 patients has been implemented; it is a model for
therapeutic education that we have imported and adapted which was invented by Howorka in 1990 and developed by Grimm and Berger in
Switzerland. More recently, we created a program devoted to type 2 diabetic patients, following the same model. This educational method can
be transposed to other chronic diseases and in particular in the cardiovascular prevention field, whether the patient is diabetic or not. A major
obstacle remains: the payment and reimbursement of this activity by our health authorities.
Key words: educational diagnosis, diabetes, therapeutic education
Nous savons depuis longtemps
que l’éducation des patients at-
teints de diabète est nécessaire et
utile, donc incontournable, [1, 2]. Il y
a eu une évolution importante au
cours des dernières décennies dans la
conception même de cette éducation,
considérée aujourd’hui comme « thé-
rapeutique » c’est-à-dire produisant
un effet thérapeutique associée aux
autres outils de traitement que sont
l’activité physique, les médicaments...
Il s’agit d’une maladie chronique,
que l’on doit soigner tout au long de la
vie, avec des objectifs médicaux à
court terme (l’absence de coma), à
moyen terme (l’absence de symptô-
mes de diabète, le confort de vie, la
m
t
c
Correspondance : F. Elgrably
mt cardio 2006 ; 2 (1) : 73-7
mt cardio, vol. 2, n° 1, janvier-février 2006 73
Revue
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

vie professionnelle, familiale, sociale...) et à long terme (la
limitation et la prévention des complications dégénérati-
ves chroniques invalidantes et coûteuses pour le patient,
son entourage, et la société). Face à ces objectifs ambi-
tieux, les moyens thérapeutiques restent imparfaits, puis-
que la maladie n’est pas curable, et ils font appel à des
médicaments, dont l’insuline, à une autosurveillance gly-
cémique, à une bonne hygiène de vie, requérant la parti-
cipation active du patient à son traitement, et donc son
éducation.
Étapes dans l’éducation des patients
Éducation centrée sur le médecin
« Moi, votre docteur, je sais ce que vous devez faire :
écoutez et faites » : dans cette formule éducative, ilyaun
maître et un élève « infantilisé » qui exécute : le pouvoir
médical est uniquement entre les mains du médecin.
Éducation centrée sur la maladie
« Je vais vous raconter le diabète : signes, diagnostic,
physiopathologie, traitement ». Il s’agit là d’un transfert de
connaissances pures, théoriques, certes utiles, mais insuf-
fisantes pour l’obtention des résultats escomptés.
Éducation centrée sur les comportements
Cette étape est essentielle car ici les trois différents
niveaux de connaissance apparaissent :
–la connaissance théorique – savoir,
–la connaissance pratique – savoir-faire,
–le comportement de santé adapté – savoir être, but
de l’éducation pour la santé : « toutes combinaisons d’ex-
périences éducatives dont le but est de faciliter l’adoption
volontaire des comportements favorables à la santé » [3].
Éducation centrée sur l’individu diabétique
Il s’agit de l’éducation thérapeutique. Les buts de cette
démarche éducative sont l’autonomie du patient, sa qua-
lité de vie, et la prévention des complications. Le patient
est ici au centre du processus éducatif, et il s’agit d’un
transfert de connaissances et d’expertise des soignants
vers le patient, d’un savoir partagé. Plus encore que par-
tenaire dans son traitement, le patient éclairé choisit,
prend les commandes, c’est l’empowerment des Anglo-
Saxons, avec la complicité attentive de ses soignants. Un
guide Éducation thérapeutique du patient a été publié
en 1998 par l’Organisation Mondiale de la Santé, et a été
diffusé aux ministères de Santé, centres collaborateurs
OMS, organismes de sécurité sociale [4]...
Éducation thérapeutique : pour qui ?
–Pour un individu qui a son quotidien, ses choix de
vie, une qualité de vie (dans ses trois dimensions physi-
que, psychologique et sociale) ;
–Pour un individu qui a sa « boîte noire personnelle »,
souvent déterminante pour comprendre sa conduite de
maladie, et dans laquelle se trouvent :
–des connaissances, parfois fausses, parasites, à
évacuer (« ne pas manger d’aliments contenant
du sucre me guérira de mon diabète », « tant que
je vois bien je n’ai pas besoin d’aller chez un
spécialiste »...), parfois justes, sur lesquelles on
peut s’appuyer,
–des croyances de santé (« j’ai un petit diabète »,
« je ne risque rien, moi, je me sens bien »...),
–des représentations de maladie, de traitement
(« tant qu’on n’a pas de piqûres d’insuline, le
diabète n’est pas grave »),
–une acceptation ou non de sa maladie (déni,
révolte, dépression...) : le refus peut être une fixa-
tion pathologique ; l’acceptation est parfois bru-
talement remise en cause par un incident de vie,
la survenue d’une complication ou son ombre (un
micro-anévrisme au fond d’œil par exemple),
–des possibilités personnelles de « faire avec »,
–une conception sur ses propres possibilités d’in-
tervention et de contrôle de son état de santé
(« ma santé dépend de mon médecin, de ma
femme, de ce que Dieu veut... »),
–une expérience : les histoires souvent tragiques de
diabète familial peuvent marquer au fer rouge cet
individu qui peut penser ne pouvoir échapper,
comme ses ascendants, à une amputation, une
cécité, une mort prématurée,
–un « vécu » de maladie : l’annonce du diabète,
les premières paroles dites, par exemple, restent
longtemps gravées dans la mémoire du patient, et
s’il les a perçues « terrifiantes », il peut choisir,
inconsciemment de baisser les bras devant cette
tâche insurmontable,
–une histoire de maladie et d’éventuelles compli-
cations...
–
Pour un individu qui a un entourage au sens large
(soignants, famille, collègues, amis, pairs...) où chacun a ses
idées, ses croyances, ses attitudes qui constitueront, ou non,
un soutien technique et/ou émotionnel pour le patient ;
–
Enfin pour un individu qui a ou non une connaissance
du système de santé et des possibilités d’accès aux soins.
Toutes ces données contribuent à l’établissement d’un
diagnostic éducatif.
L’éducation thérapeutique, centrée sur le patient, le
place au centre du processus éducatif, avec ses opinions,
ses idées, ses sentiments, ses croyances, son entourage...
aussi bien qu’avec son « statut » médical. Par l’éducation,
il s’agit d’aider le patient à gérer son traitement, à prévenir
les complications évitables, en lui conservant, voire en
améliorant sa qualité de vie, ce qui produit un effet théra-
peutique, associé à ceux des autres outils du traitement.
Éducation thérapeutique
mt cardio, vol. 2, n° 1, janvier-février 2006
74
Revue
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

Éducation thérapeutique : quand ?
Les occasions éducatives classiques sont la découverte
d’un diabète, un incident de la vie qui remet en question
l’individu, la survenue d’une complication, la mise à
l’insuline.
Ces moments sont effectivement cruciaux. L’essentiel
est de faire de ces moments le point de départ d’un
processus qui devra être continu, tout au long de la vie.
Par ailleurs, le soignant peut être amené à proposer
une phase de renouvellement de l’éducation devant une
carence ou l’évolution des connaissances médicales.
Éducation thérapeutique : par qui ?
Par des soignants formés : on ne s’improvise pas édu-
cateur, on apprend. Il existe des formations de formateurs
dispensés par le DELF (groupe Diabète Éducation de Lan-
gue Française), l’université de Bobigny (département
Sciences de l’éducation), l’institut de formation IPCEM
(Institut de Perfectionnement en Communication et Édu-
cation Médicale)...
Idéalement, par une équipe multidisciplinaire : diabé-
tologues, cardiologues... mais aussi paramédicaux, infir-
miers, diététiciens dont le rôle est essentiel, physiothéra-
peutes dont la place est à développer en France.
Encore plus idéalement, par une équipe interdiscipli-
naire : l’intervention des psychosociologues, pédagogues
et autres spécialistes des sciences humaines est extrême-
ment utile.
Ceci n’exclut pas la qualité du travail d’un soignant
isolé, mais formé.
Éducation thérapeutique : comment ?
Le diagnostic éducatif est la première étape du proces-
sus éducationnel. Il s’agit de la collection d’informations
concernant le patient sur les plans bioclinique, éducation-
nel et psychosocial.
L’éducation se fait par paliers, en respectant le rythme
individuel, avec empathie, en utilisant parfois le principe
d’un contrat avec objectifs progressifs consentis de part et
d’autre... de façon individuelle et en groupe. L’interaction,
la dédramatisation, la reconnaissance, le partage avec les
pairs constituent un plus dans l’éducation en groupe.
Celle-ci peut-être réalisée au cours d’hospitalisations pla-
nifiées de semaine ou d’hôpitaux de jour par exemple, ou
en médecine de ville dans le cadre des réseaux de soin.
L’entretien de la motivation des patients reste l’une des
difficultés majeures, il n’y a pas de recette miracle ; l’une
des pistes possibles est la recherche d’une adéquation
entre le discours soignant et les attentes des patients ;
identifier, entendre les besoins spécifiques, essayer de
trouver une solution aux obstacles, sociaux, culturels,
financiers, techniques, environnementaux..., telle est no-
tre tâche, parfois au-dessus de nos possibilités.
Le but est qu’à terme, le patient éclairé, formé, devenu
expert de sa propre santé, s’approprie les objectifs de son
traitement, choisisse d’agir et prenne les commandes.
Cependant, il ne s’agit pas de l’abandonner ; il s’agit de lui
proposer un accompagnement, en conservant un regard et
des interventions de soignant sur son statut biomédical. Il
ne faut pas non plus plaquer ce modèle systématiquement,
il faut savoir attendre le moment propice, garder le
contact ; certaines personnalités se prêtent mieux à ce
transfert que d’autres.
Récemment, dans le service de diabétologie de l’hôpi-
tal Hôtel-Dieu de Paris, un programme de prise en charge
ambulatoire des patients diabétiques de type 1 avec auto-
apprentissage, a été mis en place. Il s’agit d’un modèle
d’éducation thérapeutique, découvert par Howorka
en 1990, développé par Grimm et Berger en Suisse [5],
que nous avons importé et adapté et que nous appelons
l’auto-apprentissage ambulatoire au traitement du diabète
de type 1 (AT1).
Le principe est le suivant : 5 séances ambulatoires de
14h00 à 17h00 sont proposées à un groupe de 10 patients,
un jour fixe de la semaine, 5 semaines de suite ; les
patients sont accueillis par un médecin senior, un diététi-
cien, et un infirmier, identiques chaque semaine ; les
séances sont espacées de 8 jours et les patients ont des
« travaux pratiques », à faire à la maison entre deux séan-
ces, sur un thème sélectionné.
Chaque séance est partagée en deux parties : analyse
des résultats des travaux pratiques effectués à la maison la
semaine précédente et explication des travaux à faire pour
la séance suivante. Le patient accepte de se mettre dans
des conditions expérimentales, de s’auto-observer en réa-
lisant ces travaux pratiques ; l’analyse en groupe de ses
propres résultats, commentés par chaque patient, enrichie
des commentaires des autres patients et de ceux des
experts, permet à chacun d’acquérir sa propre expertise :
c’est en cela qu’il s’agit d’un auto-apprentissage. Le pa-
tient joue un rôle central, actif, il apprend de lui-même et
des autres à partir de sa propre expérience ; de plus, en
observant les résultats des autres participants, par la répé-
tition ou la découverte d’autres aspects, il complète sa
« formation d’expert ».
Ce programme est destiné à des patients qui ont déjà
une certaine expérience de leur maladie et de son traite-
ment, depuis au moins 6 mois.
Les thèmes des journées sont les suivants : auto-
enquête alimentaire, jeûne ambulatoire de 36 heures sous
insuline de base, repas tests apportant des quantités varia-
bles de glucides, repas libres avec notions d’index glycé-
miques différents, activité physique.
mt cardio, vol. 2, n° 1, janvier-février 2006 75
Revue
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

L’utilisation d’un schéma insulinique basal/bolus est
requise et au terme de la formation, le patient aura acquis
5 clés déterminantes pour sa propre gestion du diabète :
–savoir déterminer la quantité de glucides d’un repas
(ou savoir trouver seul l’information avec les outils don-
nés),
–connaître ses besoins en insuline de base (besoins
indépendants de toute alimentation),
–savoir combien d’unités d’insuline ultra-rapide lui
sont nécessaires pour 10 g de glucides,
–savoir de combien 10 grammes de sucre font monter
sa glycémie,
–savoir de combien une unité d’insuline fait baisser sa
glycémie.
Les objectifs de ce programme sont :
–d’améliorer le contrôle métabolique, sans majorer
les hypoglycémies, en libéralisant l’alimentation – horai-
res et contenu des repas,
–d’améliorer les connaissances sur les relations insu-
line, alimentation, activité physique,
–enfin de maintenir ou d’améliorer la qualité de vie.
À ce jour, près de 250 patients ont suivi ce programme,
avec enthousiasme. L’évaluation du premier groupe de
patients [6] nous a permis de constater une plus grande
souplesse de gestion, une moindre inquiétude dans la
modification des doses d’insuline, la pratique facile de
suppléments d’insuline, une augmentation de la fré-
quence de l’autosurveillance, toutes actions volontaires
du patient qui s’est approprié ses objectifs et qui a choisi
de les atteindre, sans faire davantage d’hypoglycémies,
avec une qualité de vie qui paraît améliorée.
Compte tenu du succès de cette méthode, un pro-
gramme analogue de prise en charge ambulatoire des
patients diabétiques de type 2 a été mis en place plus
récemment, toujours dans le cadre de ce concept d’auto-
apprentissage (auto-apprentissage ambulatoire au traite-
ment du diabète de type2:AT2).
Il s’agit là de 4 séances ambulatoires espacées de
8 jours, toujours pour un groupe de 10 patients avec un
programme de « travaux pratiques à la maison » bien sûr
adapté, par exemple :
–autosurveillance glycémique sur 24 heures (ordon-
nance de pratique de glycémies capillaires à jeun, avant et
après chaque repas) pour découvrir la variabilité des gly-
cémies au cours d’un cycle nycthéméral et d’un sujet à
l’autre, les notions de pic postprandial, de delta glycémi-
que (différence entre les glycémies pré- et postprandiales),
–activité physique : marche de 1 heure (sur ordon-
nance) avec un podomètre pour découvrir le rôle de
l’activité physique sur les glycémies,
–séance de dégustation (facultative) d’un ou deux
carrés de chocolat, à titre d’expérience, avec découverte
et auto-analyse des notions d’envie de manger, de faim,
d’émotions encadrant la prise d’un aliment « plaisir »,
–auto-enquête alimentaire : les patients apprennent
« en séance » à tenir un carnet alimentaire et à compter
eux-mêmes le total calorique et la répartition lipides,
glucides, protides en utilisant une table de composition
des aliments, avant de le faire eux-mêmes, chez eux : cette
plongée dans l’alimentation leur fait prendre conscience
des erreurs qu’ils font et lors de l’analyse de leur résultat,
un autodiagnostic leur est demandé avec identification
des trois comportements à modifier d’après eux, choix
validé par les diététiciens,
–discussion de groupe autour de chaque expérience
individuelle concernant la dimension émotionnelle, les
sensations de faim et de satiété qui ont accompagné la
prise alimentaire au cours de l’auto-enquête alimentaire,
–repas tests : autodécouverte du rôle sur la glycémie
capillaire de quantités variables de glucides de même
nature, de quantités équivalentes de glucides de nature
différente (index glycémique),
–goûters tests de nature différente au cours des séan-
ces, et observation des glycémies avant, une heure et
2 heures après, le dernier goûter étant précédé d’une prise
médicamenteuse pour toucher du doigt le rôle d’un médi-
cament spécifique de la glycémie postprandiale.
Des auto-questionnaires concernant les croyances de
santé, la qualité de vie, le comportement alimentaire et ses
facteurs déterminants sont utilisés avant le démarrage du
programme, puis au cours du suivi.
Une part non négligeable de ce programme est desti-
née à la dimension psychologique abordée dès la pre-
mière séance, puis en fin de programme, au cours d’une
table ronde animée par un psychologue, précisant les
objectifs du programme et initiant une discussion autour
des notions de maladie diabétique et d’alimentation.
Ce programme n’est pas destiné au bilan somatique de
la maladie : retentissement micro et macro-
angiopathique, expertise cardiovasculaire, choix du trai-
tement médicamenteux du diabète, de la pression arté-
rielle, des désordres lipidiques, introduction d’anti-
agrégants plaquettaires ou autres molécules, ou dépistage
et traitement des apnées du sommeil. Ces points évidem-
ment essentiels auront été réglés au préalable.
Ce programme est axé sur les comportements de santé
modifiables (alimentation, activité physique, observance
médicamenteuse), servis par l’autosurveillance glycémi-
que chez des patients diabétiques. Nous avons mis de
longs mois à le réaliser, en nous aidant d’experts en
comportement, en psychologie, et de notre savoir-faire en
éducation thérapeutique. La faisabilité de ce programme a
été testée avec un groupe de 20 patients, en janvier 2005,
nous permettant d’affiner le programme actuellement en
cours de finalisation avec un nouveau groupe.
L’adhésion enthousiaste des premiers patients utilisa-
teurs est possiblement due au fait que pour la première fois
en ce qui nous concerne, la nourriture par exemple est
concrètement abordée dans toutes ses dimensions,
Éducation thérapeutique
mt cardio, vol. 2, n° 1, janvier-février 2006
76
Revue
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

calorique, culturelle, sociale, hédonique, psychologi-
que... il ne s’agit plus de mots mais de faits concrets, et
nous sentons l’adéquation d’un tel programme aux atten-
tes des patients.
L’évaluation des objectifs de ce programme est bien
sûr prévue : en termes de santé (poids, tour de taille,
hémoglobine glyquée, pression artérielle, paramètres lipi-
diques...), de comportements de santé (aspects quantitatifs
et qualitatifs des choix alimentaires, activité physique,
observance médicamenteuse...) et de qualité de vie.
Cette méthode éducative destinée à assurer une
meilleure prise en charge des patients diabétiques par
eux-mêmes, concrétise un état d’esprit qui veut donner à
l’individu malade toutes les clés que nous connaissons
mais aussi lui permettre de découvrir et de choisir ses
propres clés. La relation soignant/patient est ici une rela-
tion de partage, de partenariat, d’accompagnement.
Cette méthode éducative peut être transposée à
d’autres maladies chroniques, notamment dans la préven-
tion du risque cardiovasculaire, que le patient soit diabé-
tique ou non :
–L’hypertension artérielle (dont la prévalence dépasse
50 % chez les patients diabétiques de type 2) pose des
problèmes d’observance médicamenteuse, de connais-
sance de l’intérêt de chaque médicament, de la prise en
compte des possibles effets secondaires, de l’intérêt de
l’automesure tensionnelle ;
–Le traitement des dyslipidémies (très souvent égale-
ment présentes dans le diabète de type 2) nécessite une
approche comportementale dans les domaines de l’ali-
mentation, l’activité physique, et/ou l’observance médica-
menteuse ;
–Le syndrome dysmétabolique, avec ou sans diabète,
associant surcharge androïde, résistance à l’insuline, dé-
sordres tensionnels et lipidiques, requiert aussi une modi-
fication des comportements de santé et des prises médica-
menteuses ;
–Le tabagisme, comportement complexe à modifier
de façon durable, nécessite souvent le savoir-faire d’ex-
perts dans cette prise en charge difficile ;
–L’apnée du sommeil (dont la prévalence est d’envi-
ron 50 % chez les diabétiques de type 2) nécessite une
prise en charge spécifique souvent concrétisée par la
ventilation en pression positive, dont l’observance peut
être difficile ;
–Le suivi du traitement anticoagulant, chez les « car-
diaques », pourrait bénéficier d’une approche similaire ;
–Il est démontré que l’éducation thérapeutique s’ap-
plique à d’autres maladies chroniques dans le domaine
des pathologies respiratoires, rhumatologiques, digesti-
ves.
Conclusion
L’éducation thérapeutique, c’est partager un savoir,
éduquer pour l’autonomie, la gestion du quotidien, la
prévention des complications. Par l’écoute active, la dé-
couverte et la prise en compte des priorités, difficultés,
obstacles, par le transfert de l’expertise, l’action devient
possible pour le patient volontaire, déterminé, sans an-
goisse : il s’est approprié les objectifs de son traitement, il
choisit d’agir, et le prix à payer est toujours moindre quand
on choisit, il prend les commandes aussi loin qu’il le
souhaite, et conduit sa santé, avec l’attention de ses soi-
gnants qui conservent leur regard et leurs interventions sur
son statut biomédical.
Un obstacle majeur reste à surmonter : la prise en
compte financière de cette activité humaine par les auto-
rités de tutelle (remboursement).
L’éducation thérapeutique est la concrétisation d’une
médecine technique à dimension humaine, c’est là, la
plus grande difficulté mais aussi la grande richesse de la
prise en charge de toute maladie chronique.
Références
1. Miller LV, Goldstein JN. More efficient care of diabetic patients in
a county hospital setting. N Engl J Med 1972 ; 286 : 1388-91.
2. Assal JP. Traitement des maladies de longue durée : de la phase
aiguë au stade de la chronicité. Une autre gestion de la maladie, un
autre processus de prise en charge. Encycl Med Chir Therapeutique
1996 : 25-005-A-10-18.
3. Green LW, Costagliola D, Chwalow AJ. Educational diagnosis and
evaluation of educational strategies (PRECEDE Model) : practical
methodology for inducing changes in behavior and health status.
Journ Annu Diabetol Hotel Dieu 1991 : 227-40.
4. Report of a Who Working Group. Therapeutic Patient Education.
Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Eu-
rope, 1998 ; (76 p).
5. Berger W, Grimm JJ. Insulinothérapie. Comment gérer au quoti-
dien les variations physiologiques des besoins en insuline. Paris :
Masson, 1999.
6. Elgrably F, M’Bemba J, Sola-Gasagnes A, et al. Jeûne ambulatoire
de 36 heures pour la détermination des doses de base d’insuline avec
auto-apprentissage intensifié ambulatoire : étude chez 27 patients
diabétiques de type 1 sélectionnés ; ALFEDIAM ; Nice 23-
27 mars 2004 ; 30 (hors série) : 1,3,1S36 (abstract).
mt cardio, vol. 2, n° 1, janvier-février 2006 77
Revue
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.
1
/
5
100%