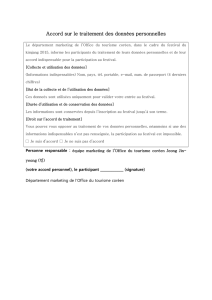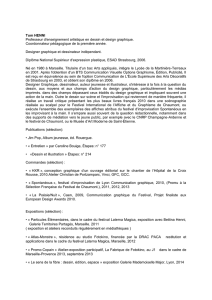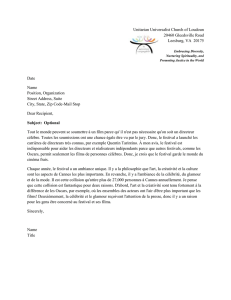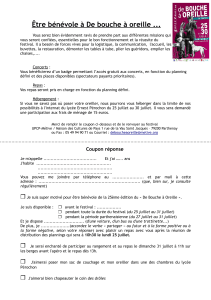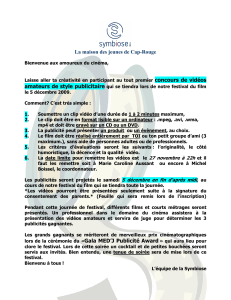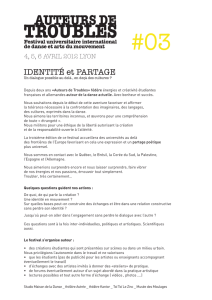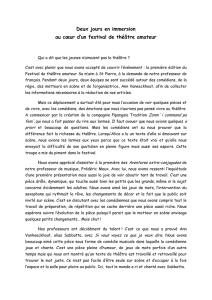Zibeline n° 75 en PDF

un gratuit qui se lit
N°75 du 17/06/14 au 16/07/14
Presse régionale,
culture libérale,
intermients...
En avant
les Festivals ?


Politique culturelle
Entretien avec Monique Pinçon-Charlot
et Michel Pinçon ............................................... 4, 5
Presse et médias régionaux ................................ 6, 7
Culture libérale, la Friche ................................... 8, 9
Trets, Prix littéraire ........................................... 10
Galerie du CG13
et Château d’Avignon ......................................... 11
MuCEM ............................................................
12 à 14
Critiques
Rue .............................................................16, 17
Théâtre ....................................................... 18 à 21
Danse ..........................................................22, 23
Musique ...................................................... 24 à 27
Festivals
Théâtre ......................................................28 à 33
Rue ................................................................ 34
Danse ........................................................ 36 à 39
Musique ..................................................... 40 à 55
Cinéma
....................................................56 à 59
Arts visuels
Au programme .............................................60 à 62
Les Arts éphémères,
la Cité Radieuse ................................................ 64
Saint-Chamas ................................................... 65
Musée Estrine, Mac,
Musée Cantini .............................................66, 67
CAC Istres,
collection Lambert ............................................68
Livres ........................................................... 70 à 77
Sciences .................................................. 78
Zibeline n’a jamais préparé son supplément festival avec
autant de tristesse, et de colère. Aurons-nous un été
sans spectacle ? Et, au-delà, des saisons privées de tout
élan créatif à cause des attaques constantes contre ceux
qui nous font rêver, penser, et vivre ? La diminution
des subventions, la casse irraisonnée de la production
artistique, l’abandon des intermittents sans lesquels le
secteur culturel ne peut pas vivre, s’ajoutent aujourd’hui
à des années de disette, de mépris envers ceux qui créent,
d’inconséquence dans le non-traitement du statut des
artistes plasticiens et des auteurs dramatiques, d’abandon
de tous les circuits de fabrique du cinéma d’auteur. À
cela viennent se mêler d’insupportables intrusions dans
les programmations artistiques de la part des politiques :
ainsi, à Aubagne, les œuvres sensibles de Marie Morel et
les machines de Demin sont déclarées indésirables par
la nouvelle municipalité, qui censure l’exposition d’Art
singulier.
L’appréciation du degré de «pornographie» et du bien fondé
d’exposer une œuvre n’appartient pas aux politiques ;
de même l’appréciation du mode de travail des artistes
et techniciens n’appartient pas au Medef, et dépasse
visiblement l’entendement de FO ou de la CFDT. Qui ne
s’occupent que des travailleurs, jamais des chômeurs et
des précaires. La coordination des intermittents travaille
sur la réforme nécessaire de leur statut depuis 10 ans ;
personne ne l’écoute, et le Gouvernement, aveugle, alors
même que ce statut des intermittents pourrait constituer
un modèle pour traiter socialement des nouvelles formes
de travail, s’apprête à signer un texte qui va mettre fin à
la vie artistique française.
Le déficit de l’Unedic n’est pas dû aux intermittents, mais
au chômage. Qui est conséquent de la casse systématique
du travail par le néolibéralisme et la financiarisation de
l’économie. Tuer le secteur culturel, qui représente 3.2%
du PIB français et permet à la France d’être le premier
pays touristique du monde, ne serait pas seulement injuste
pour les artistes et catastrophique pour les publics. Ce
serait aussi une énorme bêtise.
AGNÈS FRESCHEL
Monsieur
Rebsamen,
ne signez pas !

Z
ibeline : L’État français devient selon vous «une
société de service pour les dominants». Comment
se fait-il que l’opinion en soit inconsciente,
et que persiste l’idée qu’on s’en prend aux riches ?
Michel Pinçon : Le discours dominant est très fort,
d’une intense duperie idéologique. Pour la réforme
des retraites par exemple, la réalité a été étouffée.
Les gens se sont dit : on vit plus longtemps, il
est donc normal que l’on travaille plus. Alors que
le coût de l’espérance de vie supplémentaire est
largement compensé par les gains de productivité.
Le calcul sur la retraite n’inclut pas la croissance
des richesses produites ! Cette croissance se fait
toujours au profit du capital, jamais du travail,
volontiers considéré comme un coût, une charge.
Monique Pinçon-Charlot : En ce moment, après
les échecs électoraux du Parti socialiste, tous les
gens que j’ai interviewés depuis 15 jours disent la
même chose : le mille-feuille administratif ça coûte
trop cher, il faut simplifier. Alors que la réalité de
la réforme territoriale, c’est la libéralisation des
territoires : il s’agit d’inoculer la notion de compé-
titivité, qui est une notion issue de l’entreprise,
à tous les échelons de la vie économique
et sociale, y compris géographique. Mais
les gens n’en ont pas conscience, ils ont
intégré l’argument libéral.
Jamais la barbarie financière et écono-
mique n’a été aussi forte, jamais aussi
elle n’a été si bien mise à jour aussi ;
comment se fait-il que les contre-vérités
du discours dominant soient pourtant
admises ?
M.P.-C. : C’est quelque chose qui nous
tétanise tous. Cette situation est le
résultat de multiples processus qu’on
décrit dans La violence des riches. La
violence économique, d’abord : on casse
les emplois, on casse le système productif
français ; puis les 5 millions de chômeurs
deviennent une arme de chantage pour le Medef.
Et puis on trafique nos pensées, notre langage.
Tous les patrons du CAC 40 sont propriétaires des
médias, ils achètent même des maisons d’édition :
Denis Kessler vient de s’offrir les Presses Universitaires
de France !
Cette violence si forte devrait conduire à un sou-
lèvement, à un rejet !
M.P.-C. : C’est une violence perverse qui avance
sous le masque de la démocratie, de la liberté, des
droits de l’homme. Ils sont parvenus à se servir
de la défense de la liberté pour dominer ! Nous,
intellectuels de mai 68, en sommes, bien malgré
nous, responsables. Mai 68 a permis d’instaurer
le néolibéralisme dans nos pays, en confondant
liberté et liberté d’échange…
Comment parviennent-ils à mystifier nos esprits ?
Vous décrivez dans votre livre une rencontre avec
Antoine Seillière, qui vous avait en quelque sorte
cloué le bec !
L’oligarchie
des riches, des médias
et des politiques
Le conflit des
intermittents est
révélateur de
la soumission de
l’État à la violence
des riches :
un rapport de
la Cour des comptes
a construit un
déficit exorbitant,
monté de toutes
pièces afin
d’attaquer la
protection sociale
de la précarité.
Le commissaire
à la Cour des
comptes en charge
de ce rapport sur
les intermittents
est Michel de
Virville, dirigeant
du Medef, mis en
examen dans une
escroquerie de
plusieurs dizaines de
millions d’euros…
Dans La violence
des riches Monique
Pinçon-Charlot
et Michel Pinçon
identifient cette
violence et les
conflits d’intérêt
entre Hollande et
les milieux d’affaire.
Rencontre.
©
T
o
n
k
&
Y
o
u
4
P
O
L
I
T
I
Q
U
E
C
U
L
T
U
R
E
L
L
E

M.P. : On a expérimenté le pouvoir symbo-
lique de ces milieux dirigeants lors de nos
entretiens. On était dans des situations où
nous étions dominés, malgré nos études :
les habitants des beaux quartiers ont une
assurance personnelle fantastique, ils sont
sûrs de la justesse de leur combat, qui est
de s’enrichir, et de faire que ça dure : c’est
légitime, puisqu’ils sont les meilleurs ! La
reproduction de génération en génération
de leur conscience d’appartenir à une élite,
et d’avoir droit à plus que le commun, leur
donne une force inouïe.
M.P.-C. : C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il
n’y a guère d’autres sociologues qui travaillent
sur ce milieu : cette violence symbolique
est difficile à vivre. Les riches en imposent
par leur courtoisie, ils ont de «la classe»,
à savoir que leur seule apparence physique
indique leur appartenance à l’aristocratie de
l’argent. Et ils ne sont pas simplement riches
parce qu’ils ont beaucoup d’argent. Ils sont
riches aussi par leur capital culturel et leur
capital social, c’est-à-dire leurs relations,
leurs réseaux, qui se situent toujours au
sommet de la société.
M.P. : Oui, ce sont des gens qui cumulent
toutes les formes de richesse.
M.P.-C. : Les intellectuels négligent d’analyser
les dominants ; ils s’intéressent aux dominés,
et à leurs très nombreux problèmes. Pourtant
il faut comprendre la cause de ces problèmes.
Quant aux journalistes, nombreux sont ceux
qui ont intérêt à adopter les codes et à se
soumettre à cette classe bourgeoise qu’ils
interrogent.
M.P. : Il y a des financements pour aller voir
la misère sociale, pas pour aller voir chez
les bourgeois comment ça se passe.
On vous a reproché votre proximité avec les
riches que vous étudiiez…
M.P.-C. : Oui, on revendique l’empathie avec
les gens avec lesquels on travaille. Mais on ne
s’est jamais cachés, on a toujours écrit dans
L’Humanité et ceux que nous interrogions
le savaient très bien.
M.P. : Le capital de séduction des riches leur
permet de tout présenter comme naturel.
M.P.-C. : Oui, le système néolibéral est naturel,
comme le soleil. Les déficits publics, le «trou»
de la sécurité sociale, les inégalités, les
paradis fiscaux et l’État sont admis comme
allant de soi. Or ce sont des constructions
sociales de la classe dominante. Parvenir
à casser la machine idéologique qui est
derrière est très difficile.
Naturalisation des inégalités sociales et
discours dominant ou idéologique : tout
ceci n’est pas neuf…
M.P. : Mais avant il y avait un patron dans
l’usine et des ouvriers, ce qui rendait les
rapports de classe visibles ; aujourd’hui ce
sont des fonds de pension qui dépècent les
usines. Alors les entreprises sont devenues
des biens sur lesquelles on spécule.
M.P.-C. : La financiarisation de l’économie,
qui s’appuie sur une révolution techno-
logique avec l’informatique qui a permis
la mondialisation, repose sur un système
théorique mis au point dès les années 40,
par Friedman et Hayek. Ce système néolibéral
qui a été mis en œuvre par Pinochet, Reagan
puis Thatcher.
C’est une révolution incroyable, que nous
n’avons pas l’impression de vivre. Le
changement s’est fait par la capacité de
la classe des riches à intégrer le marxisme,
c’est-à-dire à intégrer la lutte des classes
pour la renverser en sa faveur. De sorte que
les riches apparaissent comme des créateurs
de richesses, des bienfaiteurs, et non pas
comme des délinquants en col blanc.
M.P. : Et de sorte que les ouvriers apparaissent
comme des coûts et des charges. Avec ce
processus, la classe ouvrière a été coupée de
son histoire, le travail, précaire et parcellisé,
n’est plus perçu comme source de fierté :
«surtout mon fils ne sois pas ouvrier».
Le massacre social n’est pas de la seule
responsabilité anglo-saxonne. Dans votre livre
vous montrez bien la participation active des
dirigeants français à cette financiarisation
néolibérale.
M.P.-C. : C’est plus qu’une participation ! Les
politiques, y compris de la gauche socialiste,
les journalistes, sont happés voire intégrés à
l’oligarchie dominante ; c’est une oligarchie
qui est politique, financière, économique et
médiatique. Et c’est ce qui a changé dans
cette révolution : les médias sont au cœur
de l’oligarchie ; ce qui n’était pas encore
le cas en 1986 quand on a commencé à
travailler sur les riches.
La vraie question est celle-là : ces dirigeants
socialistes pouvaient-il faire une politique
de gauche ? Avaient-ils le choix ?
M.P.-C. : Oui
Pourquoi ne l’ont-ils pas fait ?
M.P.-C. : Les élites du Parti socialiste sortent
de l’ENA, de polytechnique ou de HEC ;
c’est-à-dire de machines qui sont faites pour
réaliser la mayonnaise oligarchique entre les
différents pôles de la classe dominante : la
noblesse, la bourgeoisie et le pôle libertaire.
Bourdieu l’a très bien décrit dans La noblesse
d’État ; et Boltanski dans Le nouvel esprit
du capitalisme. Ces grands bourgeois ont eu
l’intelligence d’intégrer les critiques hédonistes
de Mai 68, à un moment où le capital avait
besoin de toujours plus de libre-échange.
Ce qui s’est traduit par la liberté du capital,
la suppression des frontières et à terme des
nations ; ainsi les multinationales dictent
leur loi.
M.P. : Quand on lit La gauche bouge de
François Hollande coécrit en 1983 avec de
futurs oligarques de ses amis, on voit qu’il
adhère pleinement au néolibéralisme.
Tout choix alternatif au néolibéralisme est
aujourd’hui taxé de populisme.
M.P.-C. : Ces choix ont toujours été vio-
lemment attaqués. Nous aussi nous vivons
personnellement cette opération de décré-
dibilisation ; quand je suis invitée sur un
plateau de télévision on me renvoie l’image
de la sociologue engagée, militante, alors
qu’en face de moi j’ai trois militants, mais
à fond, du néolibéralisme ! Mais pour eux
c’est naturel, ce n’est pas du militantisme.
S’agit-il, comme le décrit Foucault lorsqu’il
parle de la reproduction de la délinquance,
d’une stratégie sans stratège ?
M.P.-C. : Notre travail décortique la bour-
geoisie en tant que classe sociale au sens
marxiste du terme, une classe en soi, avec
des positions dans la société relativement
proches, et une classe pour soi, consciente
d’elle-même. C’est-à-dire consciente de ses
intérêts. Sa mobilisation est intense sur
le front économique, mais aussi culturel
et social.
Terminons sur le score du Front national aux
dernières élections européennes…
M.P. : Le Front national tient un discours
au plus près des aspirations du peuple mais
dans un mensonge terrible…
M.P.-C. : Une véritable imposture ! Le Front
national est mis en place par la classe domi-
nante pour éliminer la gauche radicale.
Regardez le temps de parole entre le Front
de Gauche et le Front national dans les
médias : c’est un rapport de un à vingt !
Les statistiques du CSA sont accablantes.
Comment en est-il arrivé là ?
M.P.-C. : Le Front national est largement une
création des socialistes, notamment depuis
Mitterrand ; et la politique au service du
Medef de François Hollande n’a rien arrangé.
L’intérêt des socialistes consiste à faire monter
le Front national pour ensuite le diaboliser
dans une stratégie de front républicain.
Leur ennemi n’est pas le Front national, qui
compte beaucoup de bourgeois comme eux ;
on en a même parmi nos interviewés. Leur
ennemi c’est la gauche radicale.
Situation désespérante alors !
M.P.-C. : Il y a des solutions, comme celle
de rendre le vote obligatoire avec compta-
bilisation des votes blancs. De nombreux
électeurs ne votent plus parce qu’ils ne se
sentent pas représentés, qu’ils ne veulent
plus voter PS ou UMP. Le vote obligatoire
avec comptabilisation des votes blancs est
une réformette facile à mettre en place.
Pourquoi les socialistes ne le font pas ? Parce
que c’est une mesure démocratique, mais
qui détruirait leur système de domination
politique aujourd’hui illégitime.
ENtREtiEN RéALiSé pAR RéGiS VLACHOS
Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon © R.Vlachos
5
P
O
L
I
T
I
Q
U
E
C
U
L
T
U
R
E
L
L
E
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
1
/
80
100%