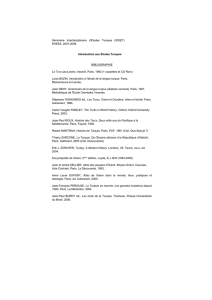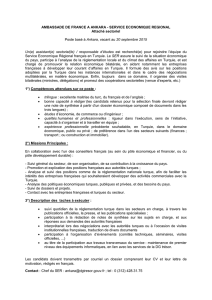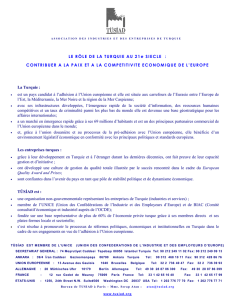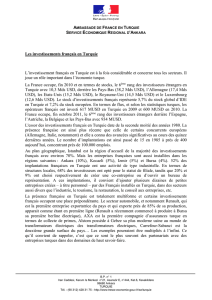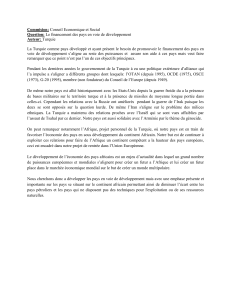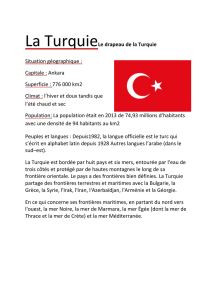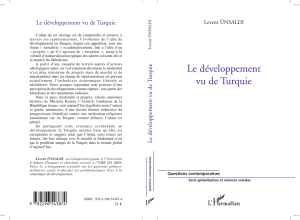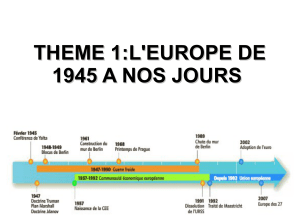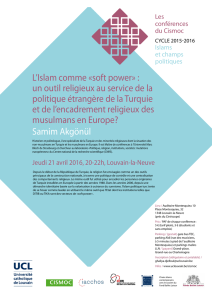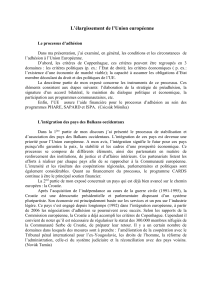lumiere turquoise - Direction générale du Trésor

Ambassade de France en Turquie – Service économique régional d’Ankara 1
LUMIERE TURQUOISE
N°69 - août - septembre 2016
Editorial
L’agence Moody’s a dégradé le 23 septembre la note de la dette
souveraine à long terme de la Turquie, la faisant descendre dans la
catégorie « investissement spéculatif ». Les autorités ont mal accepté
cette décision, mais M. Simsek a bien compris qu’elle devait être reçue
comme une incitation à accentuer les réformes. De fait, pour convaincre
les entreprises et hedge funds étrangers à poursuivre leurs
investissements productifs et placements financiers, si nécessaires à
la Turquie, le mieux serait qu’elle accélère ses réformes structurelles,
débloque les appels d’offre en souffrance, lance concrètement le
programme de privatisations annoncé, s’engage résolument en 2017
dans la modernisation de l’Union Douanière avec l’UE, s’appuie sur
les cadres bilatéraux (tenue des commissions mixtes, trop souvent
reportées, modernisation des conventions bilatérales fiscales, etc.),
améliore l’environnement des affaires, qui manque trop de
prévisibilité, et mette moins l’accent sur le slogan de produits à 100
% turcs, sans doute mobilisateur auprès de la population, mais qui
n’encourage pas les offres de partenariat à long terme des groupes
étrangers.
Ce bulletin rend compte d’évènements auxquels a participé
dernièrement le Service Economique Régional (inauguration du 3ème
pont d’Istanbul le 26 août, lancement industriel de la nouvelle
Mégane Sedan à Bursa), comme de certains de ses travaux récents :
points sur la conjoncture et la compétitivité turque ; analyses sur les
investissements directs et les échanges commerciaux bilatéraux ;
études sur le secteur bancaire, les marchés financiers, l’innovation,
etc.
Vous trouverez également un questionnaire rapide destiné à nous
permettre de vérifier si notre publication répond comme nous
l’espérons à vos besoins et centres d’intérêts, et à l’améliorer
constamment.
Sylvain Berger
Sommaire
Editorial………………………………………………………….....p. 1
Modération de la croissance au T2 2016 :
3,1%.……………………………………………………………....…p. 2
Premiers effets de la décision de Moody’s du 23
septembre 2016..............................................…p. 2 - 4
Conférence internationale sur la compétitivité
régionale en Turquie..…………….………….…...….p. 4 - 6
Investissements directs bilatéraux en
2015…………………….……………………………...……….p. 6 - 7
Echanges commerciaux bilatéraux France-
Turquie au 1er semestre 2016…………….……..p. 7 - 8
Le secteur bancaire turc en 2015 …………...p. 8 - 9
Les marchés financiers en Turquie ………..p. 10 – 11
Evolution de la Recherche-Développement en
Turquie…………………..…………………...…………....p. 12 - 16
Rencontre avec la Municipalité Métropolitaine
d’Istanbul au sujet des transports et de
l’environnement………………………………...…….p. 16 - 17
Lancement industriel de la nouvelle Mégane
Sedan à Bursa...…………………………..…………….……p. 18
Inauguration du 3ème pont à Istanbul…………..…p. 18
L’office turc des brevets poursuit la
modernisation de ses procédures…….…p. 19 - 20
Quelques chiffres sur le marché du travail...p. 20
Annonces du Ministre de l’énergie sur le
nucléaire et le solaire………………………………..….p. 20
Organigramme du SER……...................................p. 21
Carte et données conjoncturelles et
structurelles de la Turquie………………......p. 22 - 23

Ambassade de France en Turquie – Service économique régional d’Ankara 2
Modération de la croissance au T2
2016 : 3,1%
Après une croissance de 4,7% en glissement
annuel au T1, le taux de croissance au T2 2016
s’est affiché en glissement annuel à 3,1%,
contre les prévisions variant de 3,3 à 3,7%. Le
taux de croissance corrigé des variations
saisonnières et calendaires est de +0,3% par
rapport au trimestre précédent.
La consommation des ménages (2/3 du PIB) a
affiché, comme attendu, une nette modération
par rapport au trimestre précédent : 5,2% au
T2, après 7,1% au T1 de cette année. La
croissance au T2 a été soutenue
principalement par la dépense publique :
15,9%, après 10,9% au trimestre précédent.
Après une stagnation au T1, les
investissements ont baissé au T2 de -0,6%. Le
commerce extérieur a contribué négativement
à la croissance, avec une hausse de +0,2 % des
exportations contre +7,7 % pour les
importations, en glissement annuel.
En 2015, la croissance a été de 4%, avec un
revenu par habitant qui avait diminué à 9 261
USD, après 10 395 USD en 2014.
Le Vice-premier ministre Şimşek a déclaré qu’il
serait difficile d’atteindre l’objectif
gouvernemental pour 2016, initialement fixé à
+4,5%.
Premiers effets de la décision de
Moody’s du 23 septembre 2016
La tentative de coup d’Etat de juillet en Turquie
a été suivie d’une vague de commentaires sur sa
situation économique et financière, avec
notamment la dégradation de sa notation par
l’agence S&P. L’économie turque bénéficie
jusqu’à présent de fondamentaux économiques
sains, et le plus grand sujet de préoccupation
porte sur la sensibilité des investisseurs
étrangers à la situation géopolitique en
Turquie et sa capacité à continuer à attirer des
apports extérieurs pour financer son important
déficit courant. La dégradation de la note de la
Turquie par Moody’s le 23 septembre, qui prive
la Turquie de son « Investment grade » pour un
certain nombre d’investisseurs internationaux, a
eu pour l’instant des effets contenus sur les
marchés financiers. Soucieuses de l’image de la
Turquie auprès des investisseurs étrangers, les
Autorités turques ont entrepris une tournée
d’information dans 26 pays, en particulier
européens.
1/ La décision de Moody’s du 23 septembre:
Alors que Standard & Poor’s avait dégradé la
note souveraine de la Turquie quelques jours
seulement après la tentative du coup d’Etat du
15 Juillet, Moody’s avait déclaré se laisser un
délai supplémentaire pour analyser les
conséquences de ces événements dans la
durée. Moody’s a finalement décidé vendredi
23 septembre de dégrader d’un cran la note de
la Turquie, de Baa3 à Ba1, avec une perspective
stable, plaçant les obligations souveraines de la
Turquie au rang des placements spéculatifs («
junks »).
Décision très attendue depuis les événements
du 15 juillet, cette dégradation par Moody’s fait
monter au nombre de deux, avec Standard &
Poor’s, le nombre d’agences de notation
majeures considérant les obligations
souveraines de l’Etat turc comme des
investissements spéculatifs. La troisième
grande agence de notation internationale,
Fitch, avait abaissé le 19 août la perspective de
sa note pour la Turquie, de stable à négative, ce
qui fait également peser le risque pour la
Turquie de subir une nouvelle dégradation de
sa note par cette agence.
Dans la mesure où les statuts de nombreux
investisseurs institutionnels les obligent à se
séparer de certains de leurs actifs lorsque deux
de ces trois agences de notation
internationales les considèrent comme des
investissements spéculatifs, la décision de
Moody’s risque dès à présent de détériorer les
conditions auxquelles la Turquie accède à des
investissements internationaux, avec
potentiellement des conséquences également
pour le financement des entreprises turques.
2/ L’agence Moody’s justifie sa décision par
la montée du risque sur les financements
externes, et la détérioration des
fondamentaux de l’économie réelle de la
Turquie :
- La première raison avancée a trait aux
risques liés aux besoins de financement
externe de la Turquie :
Les récentes turbulences politiques en Turquie
viennent s’ajouter à un environnement

Ambassade de France en Turquie – Service économique régional d’Ankara 3
géopolitique déjà instable et exposent le pays à
une crise de confiance des investisseurs
internationaux, qui pourrait conduire dans le
pire des cas à une crise de sa balance des
paiements. Moody’s juge la vulnérabilité à un
choc sur les financements externes à l’aune du
niveau de déficit courant et à la croissance de
l’endettement externe, qui génèrent un besoin
de financement de l’ordre de 26 % PIB par an
pour 2016 et 2016. Moody’s estime qu’en cas
de perte de confiance des investisseurs
internationaux, les amortisseurs disponibles
(réserves de change notamment) ne seraient
pas suffisants.
- La deuxième raison majeure avancée
concerne l’évolution négative des
fondamentaux de l’économie turque :
Moody’s cite en particulier l’érosion de la
stabilité institutionnelle et du climat des
affaires, que les purges suite à la tentative de
coup d’Etat participent à dégrader. Moody’s
estime également que les perspectives de
croissance de l’économie turque se sont
significativement dégradées (Moody’s prévoit
une croissance annuelle de l’ordre de 2.7% par
an jusqu’en 2019, contre une moyenne de 5.5%
par an de 2010 à 2014), et s’interroge sur la
capacité des autorités à orienter le modèle de
croissance actuel, largement basé sur la
consommation et alimenté par les capitaux
extérieurs, vers un modèle plus équilibré.
3/ Plusieurs responsables politiques et
économiques en Turquie ont réagi :
- Au niveau politique :
Le Président et au moins 6 ministres sont
intervenus dans la presse nationale pour
commenter la décision de Moody’s.
Le vice-premier ministre Şimşek, qui a la
tutelle du Trésor turc, a déclaré que la
meilleure réponse à apporter à la dégradation
est d’accélérer les réformes et de maintenir une
bonne discipline budgétaire.
Plusieurs ministres ont pointé notamment les
bases saines de l’économie turque tout en
signalant les signaux contradictoires envoyés
par Moody’s, dont le directeur des Risques
Souverains Globaux, Alastair Wilson, avait
déclaré deux jours auparavant que l’onde de
choc de la tentative de coup d’Etat sur
l’économie turque s’était largement dissipée,
même si les problèmes structurels de
l’économie persistaient sur le long terme.
Selon la presse nationale, le président Erdogan
aurait dit qu’il se moquait de cette décision. Lui
et son Premier Ministre Binali Yildirim ont mis
en cause l’impartialité des agences de notation
en considérant cette dégradation comme un
acte motivé politiquement. Binali Yildirim a
déclaré que "ces jugements visent à créer une
certaine image de l'économie turque".
- Dans le monde des affaires :
Les réactions mettent plutôt en avant les
bonnes performances de l’économie réelle. Des
représentants du monde de l’entreprise ont
également tenu à rappeler la solidité des
finances publiques turques, la bonne
performance de la Turquie en termes
d’exportations, et jugent le climat des affaires
et la politique monétaire satisfaisants. Selon
eux, la décision de Moody’s ne devrait pas avoir
d’effet à long terme sur les investissements.
Certains représentants du monde des affaires,
selon les propos rapportés par la presse,
s’interrogent néanmoins sur la crédibilité et
l’indépendance des agences de notation, et à
évoquer des raisons politiques à cette décision.
A l’inverse, plusieurs voix s’élèvent pour
qualifier la décision de Moody’s de pertinente,
en rappelant l’importance d’avancer sur le
chemin des réformes.
Mesure de l’onde de choc suscitée par la
décision de Moody’s dans le débat économique
turc, les principaux quotidiens du pays ont
continué à rapporter, souvent en Une, les
commentaires suscités par cette décision tout
au long de la semaine qui l’a suivie.
4/ La décision de Moody’s a eu des effets
pour l’instant contenus:
A ce stade, les effets sur les marchés financiers
semblent plutôt contenus, notamment au
regard des mouvements qui avaient suivi la
tentative de coup d’Etat du mois de juillet et la
dégradation par Standard & Poor’s. La Bourse
d’Istanbul a perdu 4% de sa capitalisation dans
la journée du lundi 26 septembre, mais cela
reste modéré au regard de la baisse d’environ
7% le lundi suivant la tentative de coup d’Etat

Ambassade de France en Turquie – Service économique régional d’Ankara 4
du 15 juillet (et confirmée par la baisse de plus
de 13% à la fin de la semaine suivante). La Livre
turque s’est dépréciée dans un premier temps
de 0,8 % face au dollar dans le courant de la
journée du 26 septembre mais a regagné du
terrain pendant la journée sans jamais
dépasser le seuil symbolique de 3 Livres
turques pour 1 dollar. Du fait de la volatilité de
ces indicateurs, leur évolution est cependant à
surveiller sur une période plus large pour
pleinement mesurer l’impact sur le sentiment
des investisseurs étrangers.
Conférence internationale sur la
compétitivité régionale en Turquie
L’OCDE a présenté une étude, réalisée durant
deux ans avec le soutien de l’UE, portant sur
l’état et les leviers de développement de la
compétitivité régionale en Turquie.
Le rapport souligne que malgré la forte
croissance économique du pays depuis une
dizaine d’années, des écarts importants de
compétitivité persistent entre les régions de
l’Ouest, industrielles et urbanisées, et celles de
l’Est (notamment le Sud-Est et la mer Noire), à
dominante agricole, souffrant d’un déficit
d’infrastructures et d’un retard en termes
d’éducation et de formation professionnelle.
Afin de stimuler le rattrapage des régions de
l’Est, plus enclavées et moins attractives, l’OCDE
préconise notamment de réformer les processus
institutionnels de prise de décision relatifs aux
plans de développement régionaux
(renforcement de la coordination verticale et
horizontale, partage d’information, clarification
des rôles respectifs et des flux de financements).
I. Session introductive
M. Andra Mairate, chef de Département au sein
de la Commission européenne (Direction
générale de la politique urbaine et régionale), a
insisté sur la compétitivité des régions comme
levier de développement, de productivité et
1
Les différences de richesses inter-régionales,
mesurées par les écarts en termes de PIB/hab, sont
d’ailleurs plus fortes entre régions qu’entre les pays
membres de l’OCDE. Les pays où les écarts
d’innovation à l’échelle nationale. La
convergence économique des Etats membres
constitue d’ailleurs une priorité au sein de l’UE,
où il existe un index de compétitivité régionale
agrégeant des informations relatives, entre
autres, aux systèmes de santé et éducatifs.
La Turquie est aujourd’hui la 17ème économie
mondiale et connaît un fort développement
puisque son PIB/habitant a triplé en l’espace
de dix ans. Le pays a également progressé au
sein de l’index mondial de compétitivité
économique (classé 51ème sur un total de 140
pays, la France étant 22ème), grâce à son
potentiel économique et à l’amélioration de
son capital humain (qualifications et
compétences).
Pourtant, c’est le pays de l’OCDE où les
différences de richesses entre régions sont
les plus marquées.
1
L’UE pourvoit chaque
année des fonds dans le cadre de l’instrument
IPA (dont la nouvelle programmation, IPA II,
aura cours jusqu’en 2018). Ces fonds
permettent, pour beaucoup, de financer des
projets dans les régions les moins développées.
M. Ramazan Güven, Sous-Secrétaire d’Etat
adjoint au Ministère du Développement, a
évoqué la libéralisation des économies au
niveau mondial depuis la chute du bloc
soviétique en 1991, qui a été facteur de
croissance. La Turquie a accéléré son
processus de développement depuis les
années 2000, notamment en définissant une
stratégie nationale de développement
déclinée en sous-objectifs définis au sein de
chaque ministère et de chaque agence
régionale de développement. Si on privilégiait
au début une approche hiérarchique
descendante, où les autorités locales devaient
appliquer les politiques définies au niveau
national, le Ministère du développement
applique aujourd’hui une méthode de travail
stimulant le partage d’informations entre les
niveaux administratifs locaux et centraux.
La Turquie fait néanmoins face à des défis de
taille sur le plan économique, et doit
notamment, à horizon 2023, améliorer
l’environnement des investissements ainsi
que la qualité du capital humain. Il est
régionaux de richesses sont les plus importants sont
les pays émergents tels que la Chine, le Brésil, la
Russie, l’Inde, la Mexique, la Slovaquie et la Turquie.

Ambassade de France en Turquie – Service économique régional d’Ankara 5
également nécessaire de définir des
instruments et méthodes de mesure rigoureux
afin de pouvoir quantifier avec précision la
compétitivité régionale du pays.
II. Panel sur les leviers de
développement de la
compétitivité régionale en
Turquie
1. Renforcer le caractère inclusif de la
croissance
Malgré une croissance soutenue sur les dix
dernières années, il existe de fortes inégalités
géographiques de développement. Les régions
occidentales, en particulier les pôles
économiques d’Istanbul, Ankara et Izmir, ont
traditionnellement tiré la croissance. Les
régions des « Tigres anatoliens » (Aydin,
Denizli, Mugla, Konya, Karaman, Hatay,
Kahramanmaras, Osmaniye, Kayseri, Sivas,
Yozgat, Gaziantep, Adiyaman et Kilis) ont
ensuite, plus récemment, développé leur
production industrielle. En revanche,
l’économie de l’Est du pays, avec une
dominante agricole forte, est moins avancée.
Le cadre de mesure de la compétitivité
régionale utilisé par l’OCDE se réfère à deux
piliers : les performances économiques
(revenu et productivité) et les déterminants
de la compétitivité (PME et entreprenariat,
technologies et innovation, éducation et
compétences, marché du travail,
infrastructures, santé et environnement).
Les régions dont les performances
économiques sont les meilleures sont celles où
la production manufacturière ainsi que la
diversification sectorielle sont fortes (à
l’inverse les régions agricoles affichent de
faibles résultats), et qui bénéficient d’une
ouverture commerciale et
d’investissements étrangers.
Concernant les « déterminants de
compétitivité », Istanbul, Ankara, Bursa,
Eskisehir et Bilecik obtiennent les meilleurs
résultats ; Mardin, Batman, Sirnak, Siirt,
Sanliurfa et Diyarbakir les moins bons.
L’étude souligne en particulier le poids de la
localisation géographique qui, en plus des
indicateurs déjà mentionnés, est déterminant,
puisqu’on constate que les régions disposant
d’un accès à la mer ou bien dotées en
ressources naturelles affichent de meilleures
performances. Le régime de vent de la région
de Marmara stimule par exemple le secteur
éolien et les biens d’équipements dans la
région. Les effets d’agglomération d’activités
dans les régions les plus dynamiques, qui
disposent d’infrastructures développées
(transport et communication notamment), et
où les économies d’échelle sont supérieures,
renforcent d’autant les inégalités. Le rapport
mentionne enfin le problème d’émigration des
jeunes diplômés et des actifs qualifiés de l’Est
vers les villes de l’Ouest du pays.
2. Accroître la coordination économique
entre les acteurs centraux et régionaux
L’OCDE recommande d’accroître, dans le cadre
des politiques de développement actuelles, à la
fois la coordination verticale (entre l’Etat et
les collectivités locales) et la coordination
horizontale (entre les différentes parties
prenantes à un projet : banques, agences de
développement, KOSGEB, TÜBITAK…)
Le Ministère du Développement est
clairement identifié comme l’administration
de référence en termes de coordination
(verticale et horizontale). Il a déjà mis en place
des mécanismes de coordination au niveau
central entre le Ministère de la Science, de
l’Industrie et des Technologies et le Ministère
de l’Economie, et il a créé quatre
administrations régionales.
En outre, 26 agences de développement ont été
créées dans le but d’effectuer des études et de
la planification, de soutenir les projets
d’entreprises et d’institutions non-lucratives et
de promouvoir les investissements dans leurs
régions. Elles peuvent par exemple identifier
une entreprise prometteuse, et définir des
dispositifs d’aides adaptés à leurs besoins
(subventions directes ou indirectes).
2.1. La coordination verticale (Etat /
pouvoirs locaux)
Les agences de développement réalisent des
plans de développement régionaux qui, s’ils
sont alignés avec les grands axes des plans de
développement nationaux, ne sont pas
toujours coordonnés avec eux en termes de
temporalité et même de contenu. En outre, les
agences de développement soulignent qu’il
existe une asymétrie d’information
persistante entre les niveaux locaux et
centraux d’administration, ne permettant
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%