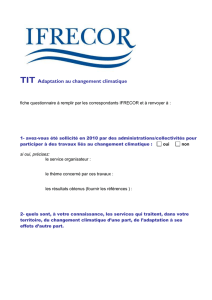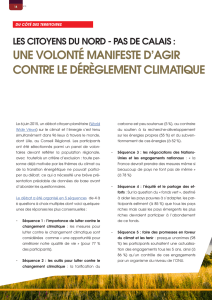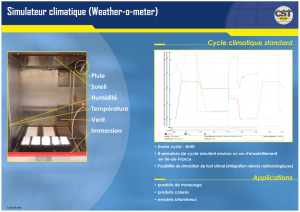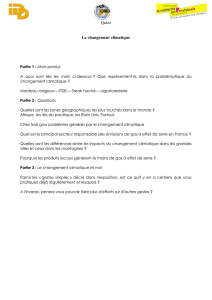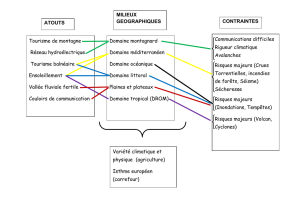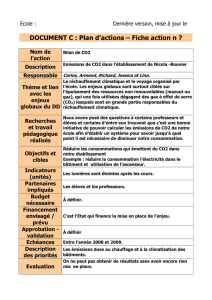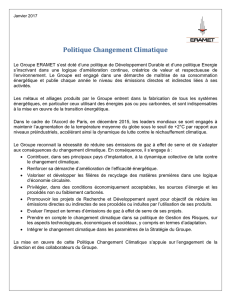fiche de lecture je crise climatique - Apprendre pour agir... Agir pour

MS GDDCC Fiche de Lecture
Je crise climatique : la planète, ma chaudière et moi
Laure Carrère – Janvier 2015
FICHE DE LECTURE
JE CRISE CLIMATIQUE
LA PLANETE, MA CHAUDIERE ET MOI
Jade Lindgaard
Editions La Découverte, 2015

Qui est l’auteure ?
Jade Lindgaard est une journaliste française née en 1973. Entrée dans le journalisme
en 1997 avec Aden, elle est ensuite devenue reporter aux Inrockuptibles avant de
rejoindre la rédaction de Mediapart (service société) dès sa création en 2008.
Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages d’enquête et de politique et plus récemment
d’écologie où elle développe le thème d’un accroissement des plaisirs sensoriels liés
aux modifications des techniques et des styles de vie nécessaires pour lutter contre
le réchauffement climatique.
Pourquoi lire ce livre ?
« Je crise climatique, la planète, ma chaudière et moi » est un roman documentaire dans lequel l’auteure mène
l’enquête sur ce qui, dans nos quotidiens, dans nos modes de vies de citoyens lambda affecte l’environnement.
A travers nos dépendances aux transports, aux technologies de communication, à notre consommation effrénée,
Jade Lindgaard s’attache à comprendre nos comportements autistes face à une évidence que tout le monde
semble ignorer : l’humanité va droit dans le mur.
A travers des sources solides, elle démontre l’absurdité de notre modèle de croissance et, sans jamais être
dogmatique, fait preuve de beaucoup de compréhension et de tolérance sur l’action individuelle parfois
totalement absurde. Elle parle, elle aussi de ses échecs, de sa propre transformation concernant la question
environnementale, de ses avancées, de ses expériences, de ses découvertes et de l’horreur qu’elles impliquent.
Enquête à la fois socio-culturelle, environnementale et politique, l’auteure fait parfois appel à la poésie, à
l’imaginaire et à beaucoup d’humour pour faire passer un message simple : un monde plus cohérent est possible,
plus cohérent pour la nature, pour l’homme et pour tout le système de la vie.

Introduction
Lire « Je crise climatique » c’est d’abord s’interroger sur ce qui fait que certains
d’entre nous sont écolos et d’autres pas. C’est se demander pourquoi chacun
peut s’intéresser à la planète, qu’est ce qui fait appel à notre « conscience
environnementale », qu’est ce qui ouvre nos yeux. C’est se demander pourquoi
certaines personnes n’y portent absolument aucun intérêt, rejettent les idées
écologiques, nient le réchauffement climatique ou lui tourne le dos pour retourner à leur vie fossiles. Cette
question est le début de tout. Elle est à la fois politique et sociologique car, en partant du principe que le concept
du réchauffement climatique est à la portée de tous et que tous doivent y trouver un intérêt, il est important de
comprendre l’obscurantisme qui habite nos vies. Jade Lindgaard apporte un point de vue singulier à cette
question de par le fait qu’elle n’est pas née avec un intérêt particulier pour l’écologie et que cette question n’a
habité ni son enfance ni son éducation, au contraire. Comme elle le dit elle-même dans la première phrase de
son livre, elle est née dans une bulle de plastique orange, au début des années 1970. Tout autour d’elle était un
paysage intégral de produits dérivés du pétrole (boule de polystyrène, mange disque, moquette à poils
synthétique…), au service d’une domesticité industrialisée. La nature n’existait pas, elle était abolie et le
quotidien formait un cocon confortable dans lequel il était possible de jouir d’une vie moderne, et d’en jouir sans
entrave. Cette vie était si facile, si évidente et si naturelle que personne ne se demandait ce que cela impliquait
et d’où venait la chaleur, les objets. Les années 80 furent calquées sur le même modèle. A l’école, chantre de
l’éducation, elle a appris l’histoire de France, de la Bastille mais pas celle des paysans ou des marins. Encore
moins des forêts, des mers, des moustiques ou des baleines : les éléments naturels n’avaient aucune existence
sociale. Comment alors que rien dans la vie d’un homme ne l’interroge sur ce qui lui permet de vivre peut-il tout
d’un coup prendre conscience de son interdépendance à quelque chose que personne ne lui a enseigné ?
Elle raconte que, pendant qu’elle grandissait dans son cocon hermétique, à l’extérieur les scientifiques se mirent
à parler de « sixième extinction » que, au cours du XXe siècle, l’utilisation des ressources naturelles avaient
augmenté deux fois plus vite que la population mondiale, que la moitié des zones humides dans le monde avaient
été drainées et que presque toute la photosynthèse se faisait désormais dans des ensembles écologiques
aménagés par les êtres humains. Le monde devenait un gigantesque produit manufacturé. Cétait invisible,
incolore, inodore mais le système climatique se déstabilisait sous la pression des GES émis en quantités
astronomiques.
Dans les années 90, Jade devient journaliste et travaille sur la politique et les mouvements sociaux. Elle interroge
un jour un militant vert et s’entends lui dire que « le droit des arbres, quand une société connait le chômage de
masse, franchement on s’en fout ».
La question environnementale soulève des enjeux de justice, de développement, de modes de vie et de discordes
Nord-Sud. Elle ouvre un espace politique mondial et conflictuel et pousse à poser les questions qui fâchent.
Lorsque Jade Lindgaard parle de son attrait pour l’écologie, elle ne parle pas de choc visuel de paysages sublime
ou au contraire du choc de paysages ravagés par l’être humain. Son déclic a été plus politique : il s’est produit en
2005 en visitant un campement altermondialiste autogéré et autonome en Écosse. Elle a aimé l’esprit "Do it
yourself", a découvert qu’on pouvait se doucher avec un verre d’eau. Elle découvre que l’autonomie peut être
douce. Le sentiment de scandale face au dérèglement climatique s’est accentué progressivement, à mesure
qu’elle accumulait des connaissances sur le sujet, qu’elle s’intéressait à la tuyauterie de sa chaudière...
Notre apathie collective face au changement climatique est gorgée d’inconscients, de frustrations, d’injonctions
contradictoires, de pulsions et de désirs. Ce livre est le récit d’un désapprentissage.
Table :
1. Ma chaudière est un scandale politique
2. Jamais sans ma voiture
3. Avions : le deal du terminal
4. Nous sommes tous des « zettabytes »
5. Scènes de guerre à l’Hyper
6. Psychopathologie du pollueur
7. Nos vies fossiles
Le récit d’un
désapprentissage

1. Ma chaudière est un scandale politique
Se questionner sur sa chaudière peut paraitre futile, mais loin s’en faut. C’est se questionner sur le coût
énergétique du confort de nos habitats, de ce que cela implique et ce que qui est caché : un véritable labyrinthe
technico-politique. Le descriptif d’une chaudière, à bien y regarder est extrêmement froid, objectif, et technique.
Lorsque l’on regarde ce que les industriels promettent au consommateur, on voit de l’aspirationnel, du
sensationnel : simplicité, convivialité, technologie maîtrisée. On garantit au consommateur un monde
confortable, simple et on lui assène que cela va de soi. Jamais, le critère écologique d’une chaudière n’est mis en
avant : quelle consommation exacte nos chaudières ont elle besoin pour nous apporter ce confort si évident ?
Demandez à un vendeur, on vous dira que l’information précise n’est pas disponible mais on vous ventera le
critère économique du produit. Il n’y a pas non plus d’étiquette de notation pour les chaudières. Cette notation
est remplacée par des critères d’évaluation dont l’efficacité énergétique ne fait pas partie.
Les projets d‘étiquetage environnemental des produits manufacturés sont freinés par un lobbying des industriels
et cette paralysie façonne notre quotidien. Les règlements européens d’écoconception et d’étiquette énergie
ont été adopté en 2013 après 5 ans de querelle et doivent entrer en vigueur courant 2015. Chaque jour de retard
a coûté aux européens environ cinquante millions d’euros selon les estimations des ONG.
En 2012, le taux d’équipement des chaudières à gaz a supplanté l’électrique, 45% contre 43%. Pourtant, à partir
de 2020, il ne sera plus possible de construire des bâtiments chauffés aux énergies fossiles. A leur place :
biomasse, solaire thermique, pompe à chaleur électriques. La chaleur représente en France la moitié de l’énergie
consommée par ceux qui y vivent et la source thermique est non renouvelable car issue de matières fossile. Ce
qui fait de chacun d’entre nous des aspirateurs à kilowatts. Et pourtant. Les données laissées aux particuliers
sont parfaitement illisible. Impossible par exemple de connaitre précisément sa consommation de gaz. A aucun
moment l’évaluation de GDF n’est comparée à la consommation réelle. Comment alors prendre conscience ?
L’empreinte carbone des logements représente environ 1.9 tonne de CO2 par personne et par an en France, c’est
presque autant que la consommation de carburants par les voitures individuelles. Et en plus, nous dépendons de
gaz que nous ne possédons pas.
La question énergétique et ses impacts environnementaux sont évacués de notre quotidien par un système
redoutablement efficace de délégation des responsabilités, d’efficacité routinière et d’absence d’informations
digestes pour le profane. Dans ce contexte, l’individu n’est invité à se comporter qu’en consommateur.
Mais nous produisons aussi notre propre servitude : nous n’accepterons jamais de remettre en cause le confort
moderne. Pourtant, le confort thermique est une notion très récente, apparue après la seconde guerre mondiale.
En premier lieu, le chauffage a surtout été pensé pour les besoins de l’industrie et c’est ce qui a guidé l’innovation
qui était justifiée pour produire des biens et non pour l’amélioration du milieu environnant. Lorsque le chauffage
a commencé à être pensé pour des lieux fréquentés par les humains, les habitations arrivent en dernier dans
l’ordre de priorité, devancées par les lieux publics.
L’énergie a fini par devenir l’un des plus étrange legs du XXe siècle. Un parfait hybride de technologie et de désirs,
d’industrie et d’intimité d’échelle collective et de comportement individuel. Le problème c’est que cette bizarre
épopée à produit notre assujettissement : nous nous sommes construit un besoin : avoir chaud, partout, chez
soi, nous en avons délégué la satisfaction et personne ne s’en plaint.
2. Jamais sans ma voiture
Dans ce chapitre, l’auteure nous met face à une expérience : l’amour de l’automobile au-delà de son utilité,
indépendamment des trajets qu’elle nous permet d’accomplir. Elles sont devenues une part de nous-mêmes. La
voiture est un mode de vie et même beaucoup plus : une véritable société. En France, 85% des déplacements se
font en voiture et seuls 19% des ménages n’en possèdent pas. Ce phénomène est notamment lié à l’étalement
urbain et au développement du taux d’activité des femmes.

En enquête au salon International de l’auto de Genève, Jade Lindgaard y
découvre un monde qui profère à un homme standard des supers pouvoirs
de vitesse : « de 0 à 100km/h en seulement 8 secondes » votre puissance est
sans limite. Que du discours, et plus de mécanique : liberté, indépendance,
innovation, performance, vitesse, sécurité, désirs, besoins, technologies.
Pourtant, l’informatisation des voitures écartèle le conducteur en lui offrant
plus de mobilité mais en réduisant son indépendance. Il ne peut plus réparer
son moteur lui-même. Il ne peut plus le « bidouiller ». Pire : il peut expérimenter le bug. Après une vaste enquête
sur les pannes et les rappels des constructeurs dans le journal Que Choisir en 2008, on découvre qu’une panne
sur deux est d’origine électronique ou électrique.
En ce qui concerne le taux de CO2, les politiques européennes de restrictions de GES peuvent se féliciter de
constater que le taux d’émission chute à vue d’œil. Mais comment les données sont-elles établies ? Par les
constructeurs eux-mêmes. Et la supervision des tests ainsi que leur vérification est assurée par des organismes
de certification payés par l’industrie. En 2011, l’écart entre la propagande concernant les émissions de CO2 par
les voitures et la réalité était de 25% (source Conseil International des Transports Propres), mais il n’était que de
10% en 2001, autrement dit, il augmente avec les années et s’est particulièrement aggravé après 2007 et 2008
alors qu’un certain nombre d’états européens mettent en place des systèmes de taxation basés sur le CO2 et
que Bruxelles rendait obligatoire des seuils maximum d’émission. En résumé : plus ces taux d’émission risquaient
de faire perdre de l’argent aux fabricants, plus ils faisaient l’objet de manipulations. Les rejets de gaz carbonique
des véhicules sont mesurés dans des conditions parfaitement artificielles (moins de poids, sans climatisation,
batterie déchargée…). Sur certains modèles, les émissions sont 50% plus élevées que ce que prétend leur
fabricant. Un nouveau système d’évaluation des émissions de CO2 est en cours d’élaboration pour pallier à ces
failles. L‘Europe s’est engagée à réduire de 60% les rejets de dioxyde de carbone dans le secteur des transports
d’ici 2050 (versus 1990) mais depuis 2005, c’est le seul secteur d’activité où ils augmentent. La voiture
individuelle en représente les 2/3. C’est l’état de mensonge permanent.
Autre considération, si on additionne tous les coûts externes de la voiture liés à son usage en Europe (accidents,
bruit, pollution de l’air, dommages aux sols, aux forêts…) on obtient un chiffre colossal : 373 milliards d’euros par
an, soit 3% du PIB de l’UE.
On peut se poser la question du véhicule électrique et constater la
lenteur de son démarrage dans le monde. En 2011 aux Etats Unis,
275 000 véhicules hybrides ont été vendus, soit 0.1% du parc
automobile. L’organisme de crédit Cetelem a réalisé une étude au sujet
de l’impopularité des véhicules électrique en 2012 et il semblerait que
les barrières à l’achat seraient son prix et le manque d’autonomie. 55%
des personnes interrogées déclarent ne pas envisager d’acheter un
véhicule électrique si ce dernier n’atteint pas 250 km d’autonomie. En
Allemagne et en France, cette opinion est partagée par 70% et 71% des individus questionnés. Or si on prend en
compte la réalité des faits et non l’autonomie annoncée par les constructeurs dont les limites ont été vues plus
haut, l’autonomie des véhicules va de 80km à 100km, soit bien en deçà du besoin des automobilistes. Est-ce
cependant un besoin objectif ? Si on regarde l’usage moyen d’un automobiliste en France, on constatera que le
conducteur ne parcours pas plus de 17.4 km par jour (données estimées par le Service de l’Observation des
statistiques du ministre des Transports en 2010)… A la suite d’Ivan illich, le philosophe Jean Pierre Dupuy nous
livre un calcul provocateur : compte tenu du temps que nous passons à gagner de quoi nous payer une voiture
et le carburant qui la fait avancer, les autos roulent moins vite que les bicyclettes. Ce même philosophe introduit
également l’idée du « temps social » que coûte chaque jour une voiture à son utilisateur. Il l’évalue à trois ou
quatre heures par jour. De ce point de vue, même si la voiture est rapide, compte tenu de son coût et de nos
rémunérations moyennes, l’auto ne nous fait pas gagner du temps, au contraire elle nous en fait perdre.
« L’usage moyen
d’une automobile en
France est de 17.4
km par jour. »
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%