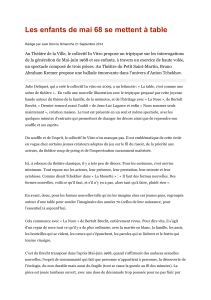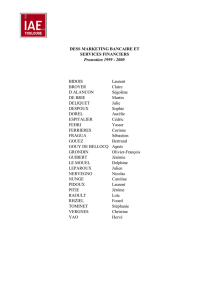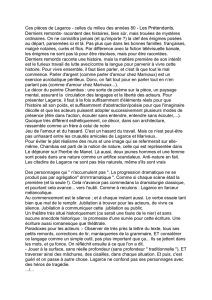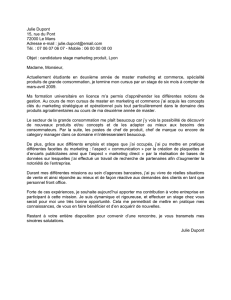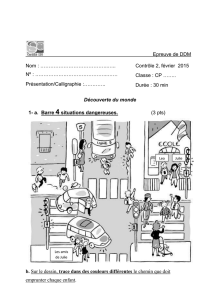Revue du presse du Triptyque

Revue de presse
Triptyque des années 70 à nos jours…
Collectif In Vitro
Julie Deliquet

Triptyque Des années 70 à nos jours…
Le 9 mars 2016

Triptyque Des années 70 à nos jours…
Le 16 mars 2016 par Caïn Marchenoir
Théâtre : Variations familiales In Vitro à la Croix-Rousse
In Vitro, collectif énergique et inventif, met en scène trois pièces portant sur les relations
familiales au théâtre de la Croix-Rousse. En commençant par la Noce de Brecht ce
mercredi.
“Familles, je vous hais ! Foyers clos ; portes refermées ; possession jalouse du bonheur.” C’est
souvent de façon incomplète, mais aussi inexacte, que l’on reprend cette phrase d’André Gide, tirée
des Nourritures terrestres. On oublie souvent le “s” final de “familles”. Il est pourtant essentiel : il
marque l’idée qu’il n’y a pas de modèle unique en la matière. On pourra s’en rendre compte en se
rendant à la Croix-Rousse cette semaine. Surtout si l’on y va à trois reprises. Le collectif In Vitro y
propose en effet un triptyque théâtral qui offre trois éclairages sur ce thème des relations familiales,
à travers différentes époques, différentes situations, une création collective et deux grandes pièces
de notre répertoire théâtral.
1970 – La Noce de Brecht
On trouvera d’abord une famille dans un moment clé de sa formation, celui du mariage, avec La
Noce chez les petits bourgeois de Bertolt Brecht, qui ouvre le bal et les hostilités. Une pièce à
l’incroyable force burlesque que Julie Deliquet, metteure en scène de la troupe, a choisi de transposer
dans les années 1970. Peut-être pour que la succession soit logique avec le deuxième
spectacle, Derniers remords avant l’oubli, de Jean-Luc Lagarce.
1980 – Les Remords de Lagarce
Nous sommes à présent dans les années 1980 et les mariages sont loin, les familles déjà
composées ou même recomposées. Les retrouvailles s’organisent autour d’une maison achetée en
commun en 1968. Règlements de comptes, dans tous les sens du terme, sont au programme. Tout
comme dans le dernier volet du triptyque...
1990 – Nous sommes seuls maintenant
Le dernier volet de ce triptyque, Nous sommes seuls maintenant, création collective de la troupe,
nous emmène dans la décennie suivante, celle des années 1990, à l’occasion d’un repas festif où se
retrouvent plusieurs générations, des petits-enfants aux grands-parents. Excellente manière de
clôturer ce cycle familial et théâtral qui s’annonce jubilatoire et passionnant.

Triptyque Des années 70 à nos jours…
Le 15 mars 2016 par Nadja Pobel
La fin des utopies
Généalogie d’aujourd’hui Sans être désenchantée, la génération de Julie Deliquet
regarde dans le rétroviseur via Brecht et Lagarce, avant de se coltiner à sa réalité dans
un triptyque peu novateur sur le fond, mais épatant dans sa forme.
Trentenaire passée par le Conservatoire de Montpellier, l’École du Studio Théâtre d’Asnières et
l’école de Jacques Lecoq, Julie Deliquet a trouvé en route des compagnons avec lesquels créer en
2009 ce collectif portant en lui la notion d’expérimentation, In Vitro. D’emblée, ils montent Derniers
remords avant l’oubli dans lequel Jean-Luc Lagarce signe la fin des utopies : un trio amoureux
ayant acheté une maison se retrouve flanqué et d’un nouveau conjoint, et de leur solitude, pour clore
ce chapitre. Sans éclat, entre cynisme et lassitude, ces personnages sont justement interprétés
; sans trop en faire, par une troupe qui une heure plus tôt a démontré à quel point elle savait jouer
collectif.
En effet, à cette échappée dans les années 80, Julie Deliquet a trouvé un prequel avec la pièce
de Brecht, La Noce, qui tourne comme dans un film de Vinterberg, au règlement de compte à
mesure que les verres d’alcool se vident et que le mobilier, construit par l’époux, se dézingue. La
metteuse en scène parvient habilement à établir une tension au long court, évitant les trous
d’air grâce à ses acteurs qui savent occuper l’espace et le temps sans jamais donner, ne serait-ce
qu’un instant, une impression de brouillon.
Tant pis pour les victoires, tant mieux pour les défaites
En fin de parcours, après plus de 2h30, elle présente la version 90’s : celle des descendants de
68 devenus bobos parisiens, partis s’installer à la campagne pour renaître ou s’enterrer, c’est selon.
Vidéo et témoignages d’enfants à l’appui, elle questionne l’héritage en réunissant autour de la table
(élément central et sommaire de ce triptyque) des quadragénaires désormais parents d’ados.
La famille et l’argent ne sont pas plus qu’hier les ingrédients d’un supposé bonheur après lequel
chacun court. Souvent drôle, cette dernière partie ne nous apprend pas grand-chose sur nos
condisciples, mais les regarde avec lucidité. Et donne surtout naissance à un collectif très uni,
convaincant, que l’on aimerait voir partir à l’abordage de textes plus rugueux ou, à défaut,
d'un grand classique comme celui que les Possédés – artistes qui leur ressemblent tant - ont
récemment livré avec Platonov.

Triptyque Des années 70 à nos jours…
Le 10 mars 2016 par Stéphane Caruana
Le collectif In Vitro tire le bilan des années post-Mai-68
Le collectif In Vitro, créé en 2009 par Julie Deliquet, défend l’idée d’un théâtre travaillé et élaboré
en groupe, à partir de longues séances d’improvisation, où chacun apporte sa pierre à l’édifice final.
Il n’est donc pas étonnant de le voir s’attaquer aux utopies nées de la révolte de Mai 68.
C’est la pièce de Jean-Luc Lagarde, Derniers remords avant l’oubli, qui sert de genèse au projet
du triptyque Des années 70 à nos jours du collectif In Vitro. Dans cette pièce, le dramaturge illustre
le passage des hippies des années 70 aux yuppies des années 80 à travers l’histoire de trois
personnages, Pierre, Paul et Hélène, qui ont acheté ensemble une maison en 1968 afin de vivre leur
idéal d’un foyer à trois, loin des carcans de la bourgeoisie d’alors. Néanmoins, dix ans après, les trois
amis ont suivi des routes différentes. Rattrapés par les normes sociales, ils se retrouvent pour vendre
la maison, tirant ainsi le bilan de leurs espérances et utopies passées.
Afin d’étoffer leur réflexion autour de la génération de Mai 68, les membres du collectif In Vitro
ont choisi de flanquer la pièce de Lagarce de deux propositions théâtrales au dispositif scénique très
similaire : ainsi La Noce, tirée de la pièce de Brecht La Noce chez les petit-bourgeois, et Nous sommes
seuls maintenant, création originale du collectif, accueillent en plateau un grand nombre de
personnages au cours d’un repas de famille.
Dans La Noce, pièce écrite en 1919 et transposée dans les années 70, il s’agit d’imaginer la
fougue de la jeune génération qui se révolte contre celle de ses parents.
Dans Nous sommes seuls maintenant, en revanche, l’heure est au bilan pour la génération de
Mai 68, embourgeoisée à son tour et soumise au regard de ses propres enfants, qui ont à leur tour
vingt ans. Face aux contradictions, aux lâchetés, aux oublis, chacun tente alors de tirer le bilan des
espoirs d’une jeunesse qui semble s’être perdue en route.
Bien qu’il se défende d’intenter le procès des années 70, le collectif In Vitro tient cependant le
compte des illusions envolées et des utopies avortées. Néanmoins, la présence du groupe sur le
plateau, la large place laissée à l’improvisation, l’anarchie légère qui habite la scène et le
capharnaüm apparent laissent transparaître la tendresse que les membres de la troupe continuent
d’éprouver à l’égard de leurs aînés et de leur tentative de changer le monde.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
1
/
50
100%