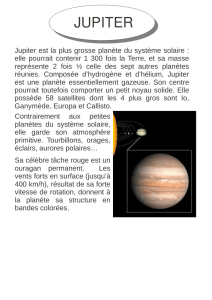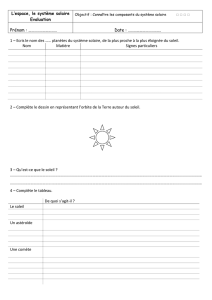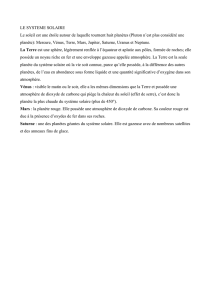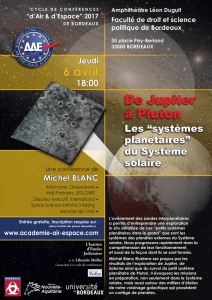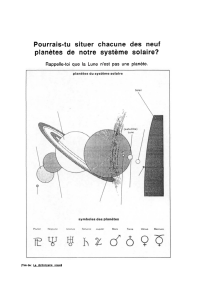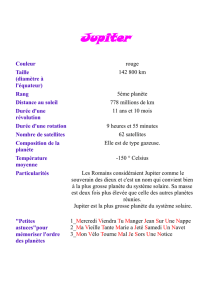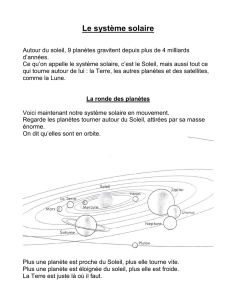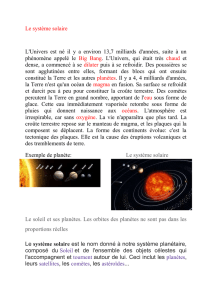planetes en vue - Planétarium de Saint

1
PLANETES EN VUE
L’Univers… Dans cet espace infini, les galaxies sont aussi nombreuses que les grains de sable sur
une plage. Parmi toutes ces étoiles, voici la nôtre : le Soleil. Il règne sur une multitude de petits corps
célestes et sur neuf planètes principales qui tournent autour de lui.
La Terre est la troisième de ces planètes. Il y fait ni trop chaud, ni trop froid. Une atmosphère dense la
protège. L’eau y abonde, tout comme la vie. Parmi toutes les espèces vivantes, l’humanité s’est
développée… Suffisamment pour partir un jour explorer les autres planètes et tenter de comprendre
leur histoire.
L’histoire du système solaire commence il y a plus de 4.6 milliards d'années. Dans la Voie lactée, un
immense nuage de gaz et de poussières s’effondre sur lui-même sous l’effet de sa propre masse.
Plusieurs condensations gazeuses se forment. En se contractant, elles donnent naissance à des
étoiles.
Le Soleil est l’une d’elles. Alors qu’elle est toute jeune, notre étoile se cache encore au sein de
grandes quantités de gaz et de poussières, restes de la nébuleuse qui lui a permis de naître. Cette
matière, animée d’un mouvement de rotation, se regroupe dans un disque. Puis, par le hasard des
rencontres et des collisions, les grains de poussières se collent les uns aux autres. Ils forment des
cailloux, qui s’ agglomèrent eux même pour donner des rochers, des planétoïdes, puis enfin des
planètes. Tout cela en moins de cent mille ans, un temps très court à l’échelle du cosmos.
Très près du Soleil, il fait chaud. C’est le domaine des planètes rocheuses :
Mercure… Vénus… Terre… Mars…
Au-delà de Mars, il fait bien plus froid. C’est le royaume des glaces et du gaz qui ont donné naissance
aux géantes gazeuses :
Jupiter… Saturne…Uranus… Neptune…
Encore plus loin du Soleil, tout est gelé. Les petits planétoïdes de glace, animés de mouvements très
lents, n’ont pas pu s’associer en grosses planètes. Ils en restent vraisemblablement des millions à
errer dans la pénombre, au-delà de Neptune. Pluton, la plus lointaine des planètes est le plus massif
de ces objets.
A part Pluton, les planètes tournent autour du Soleil à peu près dans un même plan. Les mouvements
sont bien ordonnés et chaque planète circule sur une orbite qui lui est propre. Aucun risque de
collision. Mais vue de la Terre, les trajectoire se superposent et se croisent, rendant la compréhension
du ballet planétaire moins évidente. Les planètes, la Lune, et le Soleil sont toujours situés dans une
étroite bande du ciel. Cette région privilégiée, théâtre des mouvements apparents des planètes,
s’appelle le zodiaque.
La nuit noire est progressivement gagnée par les lueurs de l’aube. En fait, le bleu du ciel est une
particularité bien terrienne. Ce sont les composants de notre atmosphère qui diffusent cette couleur.
Sur notre voisine la Lune, le ciel diurne n’a plus du tout le même aspect. Car la Lune ne possède pas
d’atmosphère qui diffuse la lumière solaire. En plein jour, si on se cache de la lumière éblouissante du
Soleil, les étoiles brillent sans scintiller sur une voûte céleste noire.
Ces paysages lunaires, douze hommes les ont déjà contemplé, entre 1969 et 1972. En levant les
yeux derrière la visière de leur casque, ils pouvaient également admirer la Terre, distante de 384000
km. A pied ou en voiture, ces astronautes des missions Apollo ont collecté des roches grâce
auxquelles on a pu connaître l’âge de la Lune et par extrapolation, celui de toutes les autres planètes :
environ 4,5 milliards d’années. Soit à peine plus jeune que le Soleil lui-même.
Dans les premiers âges du Système Solaire, les collisions entre planétoïdes étaient fréquentes. C’est
probablement d’une de ces rencontres cataclysmique que la Lune est née. La jeune Terre aurait été
percutée par une autre planète de la taille de Mars. Les débris de cette collision, éjectés dans
l’espace, se sont ensuite agglomérés pour former un nouveau corps céleste, en orbite autour de la
Terre, la Lune.
Pendant encore 800 millions d’années, les impacts de ce type se sont poursuivis sur toutes les
planètes. Les nombreux cratères qui modèlent la surface lunaire en attestent. Sur Terre, ils ont
presque tous disparus, les mouvements de terrain ou encore l’érosion renouvelant régulièrement la

2
surface. Ce n’est pas le cas sur la Lune qui conserve la trace des chutes de météorites depuis le
début de son histoire.
Ce monde criblé de cratères en rappelle un autre : Mercure. Elle aussi, garde les cicatrices des
impacts qui l’ont créée.
Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Mais le Soleil y apparaît seulement deux fois plus gros
que vu depuis la Terre. En l’absence d’atmosphère, les couchers de Soleil sont toutefois le théâtre de
spectacles grandioses au cours desquels la couronne et les éruptions solaires embrasent l’horizon.
Ces crépuscules flamboyants durent plusieurs jours, car Mercure tourne très lentement sur elle-
même. Cette lenteur a vraisemblablement pour origine une énorme collision qui naguère a ralenti la
planète. Ce cataclysme explique aussi pourquoi les deux tiers de la planète sont faits de fer : la plus
grande partie des roches légères, situées en surface, ont sans doute été dispersées dans l’espace.
Singulière planète que Mercure, à la fois brûlante et glacée. Exposée à l’intense rayonnement solaire
le jour, elle connaît la nuit les rigueurs de températures inférieures à –100°C. En 1974, Mariner 10, la
seule sonde spatiale à avoir approché Mercure, n’a pu photographier que la moitié de ce globe aride.
L’autre moitié restait caché dans une longue nuit.
Régulièrement, Vénus, la planète voisine, s’approche assez pour éclairer faiblement les nuits de
Mercure. Visible comme un astre étincelant dans le ciel mercurien, Venus peut être aussi brillante
qu’un croissant de Lune et éclairer faiblement le paysage.
Vénus à la même taille que la Terre. Elle doit sa forte brillance à une épaisse couche de nuages qui
ne se déchire jamais. Seule la sonde Magellan, équipée d'un radar, a dévoilé les reliefs de Vénus,
entre 1989 et 1994. Cet explorateur robotisé a découvert des volcans sans doute tout juste assoupis
et une surface plutôt jeune : 500 millions d’années au plus.
Deux sondes, baptisées Venera, ont réussi à se poser sur Vénus. Elles y ont trouvé une atmosphère
étouffante parcourue de nuages d’acide sulfurique. Cette atmosphère très chargée en gaz carbonique
et 90 fois plus dense que celle de la Terre, provoque un puissant effet de serre. La température atteint
ainsi 450°C, un record pour les planètes du Système solaire. Bref, Vénus est un enfer brumeux,
parfaitement hostile. Pour voir les étoiles depuis Vénus, il faut monter au-dessus des nuages, à 400
km d’altitude.
Les astronomes pensent qu’à l'origine, Vénus, la Terre et Mars se ressemblaient beaucoup. Toutes
trois possédaient une atmosphère qui régulait la température de surface au point que l’eau pouvait y
subsister à l’état liquide. Mais en raison de leurs différences de taille et de distance au Soleil, leurs
destins ont rapidement divergé.
De ces trois planètes, Mars est la plus petite. C’est ce qui a précipité sa mort. La planète s’est vite
refroidie, son volcanisme s’est tari et n’a plus renouvelé son atmosphère qui s’est évaporée dans
l’espace. Une vie aurait pu voir le jour sur Mars. Mais si c’est le cas, elle a péri en même temps que
l’atmosphère. Aujourd’hui, il ne reste à la surface de Mars qu'une atmosphère très ténue. C’est
suffisant pour soulever des tempêtes de sable qui recouvrent toute la planète, mais largement
insuffisant pour qu’une forme de vie, même primitive, ait pu survivre.
Mars est un monde minéral qui se distingue par des merveilles géologiques. Valles Marineris, un
canyon profond, aux parois abruptes qui court sur près de 4000 km.
Le Labyrinthe de la Nuit, cet immense dédale de gorges, qui marque le début de Valles Marineris.
Juste au-dessus : le plateau de Tharsis et ses volcans géants, qui culminent à plus de 25 km
d’altitude. Sur la pente occidentale du plateau : Olympus Mons, le plus grand volcan du Système
solaire, avec ses 600 km de diamètre et ses 27000 m de hauteur…
Une nouvelle journée s’achève sur la planète-désert. Dans sa nuit étoilée, un astre tourne en sens
inverse de tous les autres. C’est Phobos, l’un des deux petits satellites de Mars.
Avec ses 22 km de diamètre et sa forme vaguement ovale, Phobos est très probablement un
astéroïde capturé par Mars. Peut-être est-il originaire de la ceinture d’astéroïdes, située entre Mars et
Jupiter.
Des corps à l’image de Phobos, cette région du Système solaire en contient des millions. Comme
autant de briques qui n’auraient pas servi à la construction d’un édifice, ils représentent les vestiges
d’une époque où les planètes n’existaient pas encore. Le plus gros d’entre eux, Cérès, mesure

3
environ 950 km de diamètre. Mais la plupart sont des rochers aux contours irréguliers de quelques
dizaines de kilomètres de long.
433 Eros est l’un deux. Mais pas n’importe lequel : par son orbite, Eros flirte régulièrement avec
l’orbite de la Terre. Il était donc relativement facile d’envoyer vers lui une sonde. C’est ce voyage qu’a
fait le vaisseau automatique NEAR. Pendant un an ses caméras ont exploré sa surface. A la fin de la
mission, la NASA a décidé de le faire atterrir sur Eros alors qu’il n’était pas prévu pour cela. La
manœuvre a réussi et a permis d’obtenir des vues très rapprochées de l’astéroïde.
A l’image d’Eros, des centaines d’astéroïdes coupent les orbites de Mars et de la Terre, si bien qu’une
collision ne saurait être exclue.
Le 14 juin 2002, un rocher d’une centaine de mètre de diamètre est passé à seulement 120 000 km
de la Terre. Un jet de pierre à l’échelle du cosmos. Une quasi-collision.
Quelques mois auparavant, 2002 EM7 avait lui aussi créé la sensation en passant à peine plus loin de
nous. Vue depuis la surface de cet astéroïde potentiellement dangereux, voici ce qu’aurait donné la
scène, en temps accéléré…
Au même moment, à quelques millions de kilomètres de là, croisait la comète Ikeya-Zhang.
Les comètes ont un point commun avec les astéroïdes : elles sont elles aussi des restes de la
formation des planètes. Sans doute sont-elles encore plus intéressantes pour les scientifiques parce
qu’elles se composent de glaces. Or celles-ci ont piégé des éléments volatils – des gaz – qui datent
de la période de formation des planètes. Si des astronomes pouvaient disposer d’échantillons de
comète, ils seraient en mesure de dire précisément à partir de quels éléments et dans quelles
conditions le Système solaire a vu le jour. En particulier, certains chercheurs considèrent qu’une partie
de l’eau et peut-être des ingrédients nécessaires à l’apparition de la vie proviennent des comètes qui
se sont écrasées sur Terre. Mais ces collisions qui ont peut-être apporté la vie, sont aujourd’hui une
menace de destruction.
Il suffit de remonter au mois de juillet 1994 pour se convaincre qu’un tel risque est bien réel. Au beau
milieu de cet été-là, les astronomes attendaient un événement sans précédent depuis que des
télescopes observent le ciel. La comète Shoemaker-Levy 9, fragmentée en un chapelet de morceaux,
devait percuter Jupiter. Et à l’heure prévue, l’incroyable spectacle de bombardement cosmique a
commencé. En quatre jours, des blocs d’un kilomètre de diamètre ont balafré la géante gazeuse. Les
stigmates sont restés visibles pendant des mois. Ces chocs, plus dévastateurs que les plus
puissantes des bombes atomiques, rappellent qu’un tel cataclysme sur Terre, toujours possible, peut
provoquer une extinction massive des êtres vivants.
Attirant à elle une énorme quantité de gaz au moment de sa formation, Jupiter est devenue une
géante gazeuse. Une sphère gazeuse sans véritable surface solide. En 1995, le module de la sonde
Galileo a effectué une descente dans les nuages de Jupiter. Il a fini écrasé par la pression
atmosphérique, sans cesse plus forte à mesure qu’il s'enfonçait dans la planète.
Jupiter est le paradis des nuages et des vents. Depuis plus de 400 ans subsiste d’ailleurs la plus
grosse tempête du Système solaire : la Grande Tache Rouge. Cet anticyclone est à lui tout seul aussi
gros que deux Terre mises côte à côte.
Jupiter, c’est le royaume du gigantisme. En fait, cette planète a constitué autour d’elle un véritable
système planétaire. Il aurait suffi que la géante gazeuse soit dix fois plus massive pour qu’elle se
mette à briller et devienne une petite étoile. Ses dizaines de satellites auraient alors accédé au rang
de planètes. En particulier les quatre plus grosses lunes, celles qui furent découvertes par Galilée en
1610.
Io la volcanique, sans cesse tiraillée par des forces de marées colossales dues à la proximité de
Jupiter.
Europe la glacée, qui abrite sans doute un océan sous sa banquise de 15 km d’épaisseur.
Ganymède l’énigmatique satellite parcouru par d’étranges rayures.
Callisto considérée comme un monde figé, dont la surface ancienne a conservé la trace du
bombardement météoritique initial.
Après Jupiter les orbites des planètes sont de plus en plus espacées. Il faut parcourir 650 millions de
kilomètres dans le vide interplanétaire pour atteindre la planète suivante, Saturne.
Un peu moins massive que Jupiter, Saturne est aussi une géante gazeuse. Ses anneaux font sa
célébrité. Faits d’innombrables particules, de grains de sables prisonniers dans des gangues de glace,

4
de rochers gelés, ils fascinent les astronomes. Ils sont probablement les fragments de corps broyés
par les forces de marées, très puissantes au voisinage de Saturne. Les anneaux de saturne sont très
fins. Leur épaisseur ne dépasse pas quelques centaines de mètres. Vus exactement par la tranche, ils
sont quasi indiscernables.
Au-delà de Saturne, il existe encore deux planètes géantes gazeuses.
Uranus, fut très décevante lorsque la sonde Voyager 2 s’en approcha, en 1986 : elle est entièrement
recouverte d’une couche uniforme de nuages. Si bien qu’elle ressemble à une boule de billard,
désespérément lisse. L’axe des pôles d’Uranus est très fortement incliné. Une collision est
vraisemblablement à l’origine de cette curiosité.
L’autre bizarrerie du système d’Uranus, c’est Miranda. Ce satellite possède la falaise la plus haute de
tout le Système solaire : pas moins de 9000 m. Quand Voyager 2 a montré ce paysage tourmenté, les
scientifiques ont aussitôt pensé que le satellite avait été disloqué par un formidable impact avant de
se reconstituer rapidement. Mais la géologie de Miranda reste aujourd’hui une énigme.
Voici la plus éloignée des planètes gazeuses : Neptune.
Jumelle d’Uranus en taille, elle se distingue par des vents très violents, et des tempêtes qui n’ont rien
à envier à celles de Jupiter.
Mais plus étonnante encore fut la découverte par la sonde Voyager 2 de geysers sur son satellite
Triton. Ici, à plus de 4 milliards de kilomètres du Soleil, dans un monde pétrifié par le froid, un
volcanisme existe ! Des gaz à peine moins frais que la surface de Triton percent sa croûte glacée et
s’épanchent dans sa mince atmosphère. Peut-être s’agit-il d’un phénomène saisonnier. Nul n’en sait
rien.
Au-delà de Neptune, les astronomes connaissent depuis 1930 une ultime planète : Pluton.
C’est la plus petite du Système Solaire. C’est aussi la moins bien connue puisqu'aucune sonde
spatiale ne s’en est approchée. Comme la Terre, Pluton possède un seul satellite : Charon.
Longtemps, Pluton a semblé seule sur sa lointaine orbite, décrite en 248 ans. Mais depuis le milieu
des années 1990, de très nombreux planétoïdes ont été découverts à la même distance et au-delà.
Pluton, qui garde l’entrée de ce royaume des glaces éternelles, est probablement le plus gros d’entre
eux. Dans cette région du système solaire se cachent des millions de petits corps froids. Les plus
lointains sont peut-être à mi-chemin entre le Soleil et les étoiles les plus proches.
De Mercure à ces lointains glaçons errant dans l’obscurité de l’espace, tous ces objets sont sous
l’influence gravitationnelle du Soleil. Notre étoile, comme toutes les étoiles, est une gigantesque
sphère de gaz très chaud. Elle tire son énergie de la fusion nucléaire. A chaque seconde, le Soleil
transforme des millions de tonnes d’hydrogène en hélium. A ce rythme effréné, il peut encore briller
pendant 3 à 5 milliards d’années.
Puis, le Soleil s’épuisera. Il gonflera en géante rouge, engloutissant Mercure, Vénus et probablement
la Terre. Et enfin, son enveloppe gazeuse se dissipera au travers du système solaire. Il ne restera du
Soleil qu’une minuscule étoile, une naine blanche, et une nébuleuse de gaz et de poussière se diluant
lentement dans l’espace. Le cœur mis à nu du Soleil mettra des milliards d’années à se refroidir
complètement. L’histoire du Système solaire touchera alors à sa fin.
Mais à quelques années-lumière de là, d’autres étoiles plus jeunes possèdent elles aussi leurs
cortèges de planètes. Les premières, déjà découvertes, sont des géantes gazeuses inhospitalières
comme Jupiter ou Saturne. Mais il en existe probablement d’autres plus accueillantes. Et pourquoi pas
d’autres formes de vie...
Dans le ciel de ces mondes lointains, le Soleil ne sera plus qu’une faible lueur, presque invisible, une
étoile oubliée.
Philippe Hénaréjos
Production Astronef / Planétarium de Saint-Etienne 2003
www.astronef.fr
1
/
4
100%