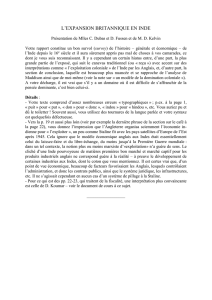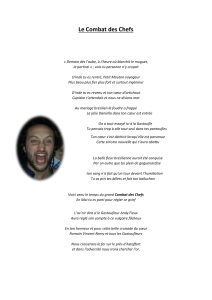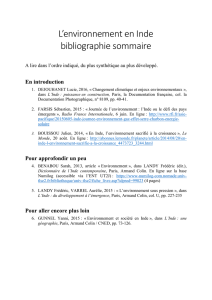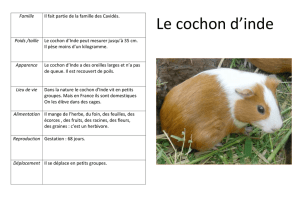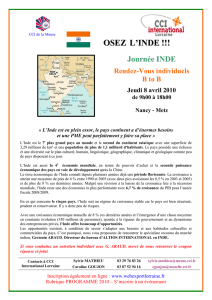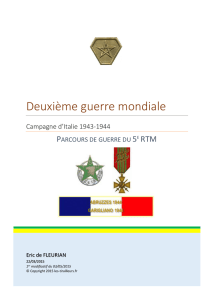Travail, femmes et migrations dans les Suds

ANALYSES BIBLIOGRAPHIQUES
FEMMES ET MIGRATIONS
Sreelekha Nair, Moving with the Times.
Gender, Status and Migration of Nurses
in India, New Delhi, Routledge/Center
for Women’s Development Studies, 2012,
226 pages, ISBN : 978-0-415-54061-2,
£ 65
Les infirmières constituent la catégorie la
plus importante de femmes professionnelles
qui migrent hors du Kerala à la recherche
d’un emploi que leur État ne parvient pas
à leur fournir. Et les infirmières indiennes, de
pair avec les Philippines et les Sri Lankaises,
représentent les plus gros contingents de
femmes migrantes dans le secteur des ser-
vices, au plan international.
Originaires pour la plupart de la petite classe
moyenne et de familles chrétiennes pauvres,
les infirmières kéralaises se retrouvent aux
quatre coins de l’Inde – depuis les années
1960 – et, plus récemment, dans divers
pays du monde, au point de devenir une
sorte de stéréotype culturel de l’Inde contem-
poraine. Pour autant, les infirmières kéra-
laises demeurent relativement invisibles
dans les études en sciences sociales
1
, peut-
être du fait de l’humilité de leur profession.
Et, bien que chaque famille kéralaise soit
réputée compter une infirmière, la bana-
lité même du phénomène et l’absence des
émigrées accroissent encore leur invisibilité.
C’est dans plusieurs hôpitaux et établis-
sements pour personnes âgées de Delhi,
mais aussi dans des trains, leurs logements
et pensions, que Sreelekha Nair conduit
ses entretiens et observations. Son ouvrage
analyse les imbrications des idéologies et
pratiques du genre, de la classe, du sta-
tut et de la position de migrante, dans la
construction de l’expérience des infirmières
kéralaises. Elle fait un détour nécessaire
par l’histoire coloniale, ses institutions et
contradictions, et par la trajectoire propre
du Kérala, les réformes et transformations
de ses systèmes agraires qui ont conduit
les familles de la petite classe moyenne à
rechercher d’autres formes de revenus, en
l’absence de politique industrielle significa-
tive. Ceci alors que le système éducatif et
de formation kéralais, connu pour son pro-
gressisme, engendre des contingents de
femmes professionnelles et que le niveau
des dots, surtout parmi les chrétiens, fait
de chaque mariage une transaction extrê-
mement coûteuse pour les familles.
L’ouvrage de Sreelekha Nair est divisé en
cinq chapitres, dont le premier explore l’his-
toire du développement de la profession
d’infirmière dans les contextes kéralais et
indien, et le second les expériences des
infirmières. Bien que requérant des niveaux
de qualification élevés, la profession est
marquée de façon durable du sceau de la
nécessité et de la pauvreté. Les infirmières
souffrent ainsi généralement de bas salaires,
de mauvaises conditions de travail, d’un
statut professionnel fragile, et d’une stig-
matisation liée à la prégnance des notions
de pureté et de souillure dans la culture
indienne, et aux canons de l’honneur fémi-
nin, qui fait se détourner d’elles les candidats
au mariage. Le chapitre 3 se penche sur la
façon dont le choix de cette profession s’im-
brique avec des stratégies familiales et des
choix de vie, tant devenir infirmière signifie
1
Marie Percot, dont la revue publie un article dans ce volume, s’est employée à en étudier la migration vers les pays du
Golfe notamment.
rticle on line
rticle on line
N°217 •janvier-mars 2014 •Revue Tiers Monde 217
“RTM_217” (Col. : RevueTiersMonde) — 2014/2/21 — 15:59 — page 217 — #217
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐

Analyses bibliographiques
devenir migrante. Le processus migratoire
lui-même, appréhendé comme une aven-
ture, et la constitution d’une communauté
migrante à Delhi, dans un partage de difficul-
tés, dont celles de la langue et de la vulnéra-
bilité, occupent les deux derniers chapitres.
Les réseaux jouent un rôle crucial dans ces
trajectoires, fournissent des ressources pra-
tiques et affectives, protègent contre une
discrimination parfois violente, font circu-
ler des informations sur des opportunités
de migration plus lointaine, permettent des
mobilisations (grèves notamment). Néan-
moins, les hiérarchies et les divisions de la
profession elle-même affaiblissent la capa-
cité à se constituer en collectif.
Blandine Destremau
CNRS/LISE
DÉVELOPPEMENT
Philippe Hugon, Mémoires solidaires et
solitaires, Trajectoires d’un économiste
du développement, Paris, Karthala, 2013,
312 pages, ISBN : 978-2-8111-1039-0,
26 €
P. Hugon a eu une vie bien occupée. Il est
connu par ses livres, son enseignement et,
maintenant, par ses interventions géopoli-
tiques nombreuses (radios ou télévision), au
nom de l’IRIS, sur les questions africaines.
Mais ce livre de mémoires, très personnel,
révèle de nombreuses autres facettes de sa
personnalité et de ses activités : ses origines
(« dans une famille bourgeoise privilégiée
et dans une société demeurant fortement
structurée par les règles morales et reli-
gieuses »), l’importance de sa vie familiale
avec la place privilégiée de sa femme et de
ses nombreux enfants et petits-enfants, son
amour de la musique en tant qu’auditeur
ou chanteur, le rôle de l’amitié et de ses
relations multiples.
Il commence sa carrière comme coopérant
au Cameroun et à Madagascar comme
enseignant à l’université de Yaoundé et
de Tananarive. P. Hugon semble cependant
choisir la coopération par engagement et
aussi pour éviter d’aller en Algérie. Il se
refuse à tirer un bilan de la colonisation cin-
quante ans après. « On ne peut juger la
colonisation aujourd’hui à l’aune des réfé-
rents de l’époque et l’analyser de manière
anachronique sans prendre en compte les
contextes historiques et les représentations
dominantes. Avec le temps, la colonisation
européenne apparaît comme une strate de
civilisations s’ajoutant à d’autres... Elle appa-
raît, à de nombreux égards, comme une
parenthèse historique ».
Mais il n’en occulte pas les faces obs-
cures. Au Cameroun, « l’armée française
avait construit des camps de regroupement
sur le modèle algérien et, sur le marché
de Dschang, étaient alignées des têtes cou-
pées pour que les rebelles soient avertis
de ce qui les attendait ». À Madagascar, il
n’ignore pas que « nous vivions dans un sys-
tème post-colonial et que les événements
de 1947 (la répression) avaient fait entre
60 000 et 100 000 morts ».
D’où, cinquante ans après, P. Hugon sou-
ligne « l’ambiguïté de la coopération » et
s’interroge sur la rupture entre l’adminis-
trateur colonial et les coopérants, tout en
faisant part « d’un certain désenchantement
vis-à-vis de la libération des damnés de la
terre » et de « la nécessité de la réappro-
priation de l’histoire par les Africains ».
Au-delà de ses premières expériences, l’au-
teur décrit ses trajectoires professionnelles
d’enseignant et de chercheur dans diverses
institutions, en France et à l’étranger.
Mais il nous livre aussi ses impressions de
voyage en Afrique, Asie, Proche et Moyen-
Orient, Amérique et Europe, une manière
subjective, parfois un peu superficielle, de
rendre vivant et concret le processus de mon-
dialisation. Mais P. Hugon va plus loin dans
l’introspection et nous livre un « qui suis-
je ? » ou « ce que je crois être » (chapitre 7)
218 N°217 •janvier-mars 2014 •Revue Tiers Monde
“RTM_217” (Col. : RevueTiersMonde) — 2014/2/21 — 15:59 — page 218 — #218
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐

Analyses bibliographiques
mais aussi « ce que je crois » (chapitre 8),
sur le plan religieux et des valeurs, entre
le spécifique et l’universel, mais aussi sa
conception de l’économie, « une science
austère mais qui doit être aussi morale
et politique et s’intéresser à l’histoire de
l’économie et aux autres sciences sociales,
tout en conservant la spécificité de l’éco-
nomie du développement », en la replaçant
dans « l’économie politique internationale et
transnationale ». Celle-ci doit « relier la mon-
dialisation du champ de l’économie (le capi-
talisme mondialisé) et le caractère essen-
tiellement statocentré du champ politique,
avec tensions, contradictions, régulations
limitées et non prise en compte des biens
communs collectifs ou publics mondiaux ».
Elle doit aussi prendre en compte « les inter-
dépendances asymétriques entre les nantis
et les exclus ».
Ces conceptions lui ont permis « de rester
indépendant mais, tout compte fait, assez
solitaire par rapport aux différentes écoles
économiques (...). Ma position éclectique
m’a interdit de participer à des débats où
l’essentiel est d’opposer des points de vue
contrastés et non nuancés ». Son souci de
complexité et de modération ne l’empêche
pas de s’indigner des inégalités et des souf-
frances humaines. De même, en politique,
son « référent est la démocratie avec ce que
cela suppose de confrontation, délibération,
discussion et décision par la majorité, mais
avec reconnaissance des droits des mino-
rités et jeu de contre-pouvoirs »... Tout cela
loin « du système binaire de l’affrontement
politique ».
En conclusion, l’auteur livre quelques
réflexions sur la retraite, la vieillesse et la
mort, et fait sienne la formule de Voltaire :
« La retraite pèse à qui ne sait rien faire ;
mais l’esprit qui s’occupe y goûte un vrai
bonheur. La retraite a pour moi des charmes
assez grands. J’y vis en liberté, loin des yeux
des tyrans ».
Dominique Gentil
PNUD, Rapport sur le développe-
ment humain 2013. L’essor du
Sud : le progrès humain dans
un monde diversifié, New York,
PNUD, 2013, ISBN : 978-92-1-126340-
4, 226 pages, téléchargeable sur
http://hdr.undp.org/fr/content/rapport-
sur-le-développement-humain-2013
Les rapports sur le développement humain
(RDH) sont publiés depuis 1990 par le Pro-
gramme des Nations unies pour le dévelop-
pement (PNUD), chacun avec un thème par-
ticulier. Des rapports régionaux et nationaux
ont également été publiés. Le RDH de 2013
se centre sur « l’essor du Sud ». Il prend
acte de l’émergence de nombreux pays du
Sud et observe que cet essor est favorable
au progrès en matière de développement
humain. Ainsi, aucun pays n’a vu son IDH
baisser entre 2000 et 2012. Mais le rap-
port souligne que la croissance économique
seule ne conduit pas automatiquement à un
progrès du développement humain. Il identi-
fie quatre domaines prioritaires spécifiques
pour soutenir la dynamique du développe-
ment : favoriser l’équité, notamment dans
les dimensions liées au genre ; permettre
une participation accrue, notamment des
jeunes ; faire face aux problèmes environ-
nementaux ; et gérer les mutations démo-
graphiques. Il appelle pour cela à une action
coordonnée entre les pays.
Le monde en 2013 apparaît contrasté avec
un Sud en essor (même les PMA com-
mencent à bénéficier d’investissements et
de transferts de technologie Sud-Sud) et
un Nord en crise : aujourd’hui, les pays du
Sud dans leur ensemble fournissent près de
la moitié de la production mondiale, contre
un tiers en 1990. Mais tant le Sud que le
Nord partagent des problèmes profonds : les
inégalités croissantes dans plusieurs pays,
et les problèmes d’environnement. Le rap-
port appelle les États à investir dans la santé,
l’éducation et d’autres services publics.
N°217 •janvier-mars 2014 •Revue Tiers Monde 219
“RTM_217” (Col. : RevueTiersMonde) — 2014/2/21 — 15:59 — page 219 — #219
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐

Analyses bibliographiques
Le chapitre 1 dresse un bilan de l’état actuel
du développement humain à l’échelle mon-
diale et régionale. Les grands pays émer-
gents sont devenus des moteurs puissants
de l’économie mondiale. En 2012, cepen-
dant, même les économies émergentes les
plus solides ont commencé à être touchées
par les problèmes financiers des pays du
Nord. Quant à ces derniers, ils ont souvent
imposé de sévères programmes d’austérité
« qui ne sont pas seulement problématiques
pour leurs citoyens, mais qui minent éga-
lement les perspectives de développement
humain de millions d’autres personnes dans
le monde. » Ainsi, le rapport se montre
critique sur les programmes d’austérité et
souligne que les inégalités freinent le déve-
loppement humain.
Le chapitre 2 analyse l’essor de certains
pays du Sud et montre son rôle de cata-
lyseur pour les autres pays en développe-
ment. La part du commerce Sud-Sud dans
le commerce mondial de marchandises a
plus que triplé entre 1980 et 2011, tandis
que le commerce Nord-Nord déclinait. Le
rapport souligne le rôle des diasporas et des
migrants retournés dans leurs pays. Ainsi,
de nombreux professionnels experts en tech-
nologie de l’information de la Silicon Valley
ont ramené dans leur pays d’origine leurs
idées, leurs capitaux et leurs réseaux. Et
aujourd’hui, près de la moitié des envois de
fonds des immigrés vers leur pays d’origine
au Sud provient d’autres pays du Sud. En
2012, le Forum mondial sur la migration et le
développement a accueilli pour la première
fois des débats sur les migrations Sud-Sud.
De nombreux pays du Sud ont également
profité du transfert de technologie et des IDE
Sud-Sud dans des secteurs contribuant au
développement humain. Par exemple, les
sociétés indiennes fournissent aux pays afri-
cains des médicaments bon marché, des
équipements médicaux ainsi que des pro-
duits et services en matière d’information et
de technologie des communications.
Le rapport met en garde sur le fait qu’« une
compétitivité basée sur de bas revenus et
une hausse du temps de travail n’est pas
viable. La flexibilité du marché du travail ne
devrait pas conduire à l’adoption de pra-
tiques qui remettraient en cause la décence
des conditions de travail ». Ainsi, l’un des
principaux indicateurs de la Banque mon-
diale (« Doing Business ») relatifs à l’emploi
des travailleurs, qui classait les pays en fonc-
tion de leur souplesse dans les conditions
de recrutement et de licenciement de tra-
vailleurs, a été abandonné « car il laissait
faussement entendre qu’une réduction des
réglementations était préférable ».
Le rapport observe que, de plus en plus, le
marché intérieur des pays du Sud constitue
le principal moteur de leur croissance, du
fait de l’émergence d’une classe moyenne ;
d’ici 2030, on estime que 80 % des classes
moyennes au niveau mondial vivra dans les
pays du Sud.
L’aide au développement, les prêts, les inves-
tissements Sud-Sud sont en plein essor.
Ainsi en 2009, la Chine a décidé d’accorder
un prêt d’un milliard de dollars à la Zambie
pour le développement des PME dans ce
pays. L’Inde et le Brésil contribuent aussi
à l’aide au développement en Afrique.
Le chapitre 3 se penche sur l’expérience
de certains pays du Sud ayant le mieux
réussi et met en évidence plusieurs des
moteurs de cette réussite, comme un État
développemental proactif, la capacité à inté-
grer les marchés mondiaux et l’engagement
en faveur des politiques sociales et de l’inno-
vation. Un État développemental ou proactif
désigne un État formé d’un gouvernement
activiste et, souvent, d’une élite apolitique
qui considère le développement économique
rapide comme l’objectif premier à atteindre.
C’est le cas par exemple des États-Unis et du
Japon et, dans la seconde moitié XX
e
siècle,
de pays comme la Corée du Sud, Singapour
ou Taïwan.
220 N°217 •janvier-mars 2014 •Revue Tiers Monde
“RTM_217” (Col. : RevueTiersMonde) — 2014/2/21 — 15:59 — page 220 — #220
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐

Analyses bibliographiques
Le rapport observe qu’un des facteurs de
réussite des pays du Sud est l’investisse-
ment dans l’agriculture, à l’image de la
Chine qui possède la structure de recherche
et développement en agriculture la plus
importante au monde. Un autre de ces fac-
teurs de réussite est de faire de la créa-
tion d’emplois une priorité, un autre encore
serait d’encourager les complémentarités
État-marché, c’est-à-dire les partenariats
public-privé. Le rapport donne l’exemple de
la Tunisie qui, depuis le début des années
1970, a mis en place des incitations finan-
cières et fiscales afin d’attirer le capital
étranger et national et a favorisé des formes
de partenariats public-privé, pour améliorer
son tissu industriel, ce qui a permis à ce
pays de figurer aujourd’hui parmi les cinq
premiers exportateurs de vêtements vers
l’Union européenne.
Plusieurs des jugements et des préconisa-
tions exprimés dans le rapport dénotent des
conceptions libérales : ainsi le rapport prône
une large marge d’action pour le secteur
privé et vante les partenariats public-privé. Il
s’affirme aussi favorable à la libéralisation
des échanges. Il fait l’éloge de l’établis-
sement de zones franches industrielles et
de l’abaissement des droits de douanes,
comme c’est le cas en Indonésie (qui a un
temps privatisé sa propre administration des
douanes) et d’autres pays d’Asie orientale
depuis les années 1990.
Mais le rapport contient aussi des concep-
tions plus progressistes : « L’expérience
montre que des investissements publics
conséquents, savamment déployés dans les
infrastructures, mais aussi dans la santé
et l’éducation, sont essentiels à un déve-
loppement humain durable ». Il appelle les
États à fournir des services sociaux : « les
États peuvent soutenir la croissance écono-
mique à long terme en fournissant des ser-
vices publics contribuant à développer une
main-d’œuvre instruite et en bonne santé.
Les pays en développement se voient par-
fois conseillés de considérer les dépenses
publiques dédiées aux services de base
comme un luxe (...). Toutefois, dans une
perspective à long terme, ces investisse-
ments sont payants ». Il donne des exemples
allant dans ce sens : ainsi, au Bangladesh,
le ministère de l’Éducation primaire et de
masse a été créé en 1992 en vue d’uni-
versaliser l’éducation primaire et d’éliminer
l’écart entre les sexes, et entre les riches
et les pauvres à ce niveau. Au Brésil, les
investissements publics dans l’éducation ont
suscité d’importants progrès en matière de
développement ; le Fonds pour le dévelop-
pement de l’enseignement primaire national,
créé en 1996, garantit un seuil de dépenses
publiques par élève dans l’enseignement
primaire.
En revanche, on peut s’étonner que le rap-
port qualifie de « progressiste » une déci-
sion récente de la Cour suprême de l’Inde
prévoyant que les enfants défavorisés pour-
ront aller dans des écoles privées : la loi
oblige les écoles privées à admettre au
moins 25 % d’élèves provenant de milieux
défavorisés ; en retour, l’État rembourse
aux écoles privées les frais de scolarité. Ne
serait-il pas plus progressiste de développer
un système scolaire public de qualité ?
Dans le domaine de la santé, le rapport
relève des progrès dans certains pays du
Sud, comme la Thaïlande, où la loi sur la
sécurité sociale nationale de 2002 a donné
à chaque citoyen le droit à une couverture
médicale complète et gratuite, financée tota-
lement par le gouvernement.
Le rapport identifie bien l’enjeu très impor-
tant pour les pays du Sud d’« assurer un
accès équitable aux services de santé et
de l’éducation » et d’« éviter un système
à double voie offrant, d’un côté, des ser-
vices publics de mauvaise qualité pour les
pauvres (ou zéro service) et, de l’autre, des
services privés de meilleure qualité pour les
riches ». Il vante les progrès faits en ce sens
dans certains pays du Sud comme le Bré-
N°217 •janvier-mars 2014 •Revue Tiers Monde 221
“RTM_217” (Col. : RevueTiersMonde) — 2014/2/21 — 15:59 — page 221 — #221
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%