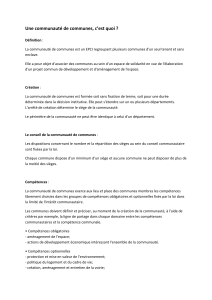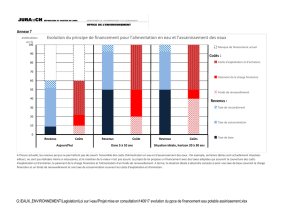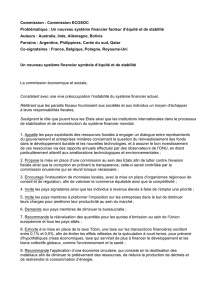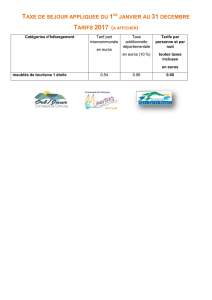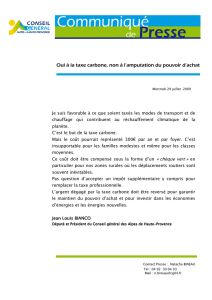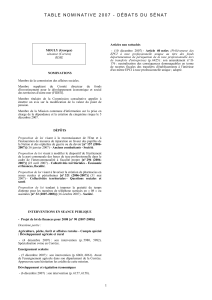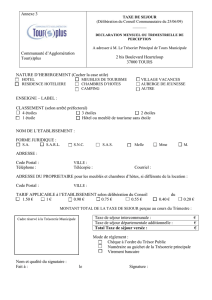le difficile ajustement des instruments aux objectifs

POLITIQUE DES TRANSPORTS
LE DIFFICILE AJUSTEMENT DES INSTRUMENTS
AUX OBJECTIFS
Recherche financée par l’ADEME et le PREDIT dans le cadre
d’un marché Mobilité Durable et incitations économiques
N° de marché 0866C0063)
Juin 2010
Pierre Kopp et Rémy Prud’homme
Professeur à l’université de Panthéon-
Sorbonne (Paris I) et professeur émérite à
l’université de Paris XII.

2
PLAN DU RAPPORT
Chapitre I – Introduction
Chapitre II – Les objectifs des politiques de transport
Chapitre III – Les instruments des politiques de transport
Chapitre IV – Objectifs et instruments : le cas des
politiques macro-économiques
Chapitre V – Les conditions politiques du changement : le
cas des politiques de la drogue
Chapitre VI – Concurrence entre les institutions : le
choix entre les différentes règles de droit
Chapitre VII – L’ajustement des instruments aux objectifs
dans le cas de la politique des transports
Chapitre VIII – Conclusion

3
CHAPITRE I – INTRODUCTION .............................. 7!
CHAPITRE II – LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DES
TRANSPORTS ............................................. 7!
A – Introduction ..................................... 7!
B – Les objectifs affiches de cinq politiques ........ 9!
1 – Les objectifs de la politique suédoise ........ 10!
2 – Les objectifs de la politique de la Banque
Mondiale .......................................... 11!
3 – Les objectifs de la politique des Etats-Unis
d’Amérique ........................................ 13!
4 – Les objectifs de la politique du Royaume-Uni .. 14!
5 – Les objectifs de la politique de l’Union
Européenne ........................................ 15!
C - Une typologie des objectifs des politiques de
transport ........................................... 16!
1 – Trois objectifs positifs ...................... 17!
2 – Cinq objectifs défensifs ...................... 18!
3 – Une dizaine d’objectifs instrumentaux ......... 20!
D - Défaillances du marche versus défaillances de
l’intervention publique ............................. 22!
E – Une ou plusieurs politiques des transports ? .... 24!
F – Conclusion ...................................... 26!
CHAPITRE III – LES INSTRUMENTS DES POLITIQUES DES
TRANSPORTS ............................................ 27!
A – Introduction .................................... 27!
B – Les normes ...................................... 30!
1 – Normes relatives aux infrastructures .......... 30!

4
2 – Normes relatives aux véhicules ................ 31!
3 – Normes relatives aux comportements ............ 32!
C – Les taxes ....................................... 34!
1 – Taxes sur les carburants ...................... 35!
2 – Taxes sur les véhicules ....................... 37!
3 – Taxes sur l’usage des véhicules ............... 38!
D – Les dépenses publiques .......................... 39!
1 – Dépenses directes ............................. 40!
2 – Dépenses indirectes (subventions) ............. 40!
E – Conclusion ...................................... 42!
CHAPITRE IV – OBECTIFS ET INSTRUMENTS : LA REGLE D’OR
DES POLITIQUES MACROECONOMIQUES ....................... 45!
A – Introduction .................................... 45!
B – La règle de Tinbergen ........................... 46!
C – Portée normative des règles ..................... 50!
D – Conclusion ...................................... 51!
CHAPITRE V – LES CONDITIONS POLITIQUES DU CHANGEMENT :
LE CAS DES POLITIQUES DE LA DROGUE .................... 56!
A – Introduction .................................... 56!
B – L’opinion publique .............................. 57!
C – Le design de la politique publique .............. 61!
1 – L’approche normative .......................... 63!
2 – Les difficultés de la mise en œuvre ........... 64!
D – Changement de paradigme ......................... 70!
1 – Le régime de la preuve ........................ 71!
2 – Les condition du changement de politique ...... 72!
E – Conclusion ...................................... 79!

5
CHAPITRE VI – CONCURRENCE ENTRE LES INSTITUTIONS : LE
CHOIX ENTRE LES DIFFERENTES REGLES DE DROIT ........... 81!
A - Introduction .................................... 81!
B - L’allocation des droits ......................... 83!
C – La protection des droits ........................ 90!
1 – Propriété des dispositifs juridiques .......... 90!
2 – Choisir entre règles de propriété et de
responsabilité .................................... 91!
D – Le poids des asymétries d’information ........... 93!
E – Conclusion ...................................... 97!
CHAPITRE VII - L’AJUSTEMENT DES INSTRUMENTS AUX
OBJECTIFS DANS LE CAS DES POLITIQUES DE TRANSPORT .... 101!
A – Introduction ................................... 101!
B – Les principes d’une intervention publiques
optimale ........................................... 103!
1 – Principes généraux ........................... 103!
2 – La compétition entre deux instruments ........ 107!
C – La hiérarchie des instruments .................. 108!
1 – Réglementation et taxation ................... 108!
2 – Quelques problèmes posés par la taxation ..... 111!
3 – Deux instruments pour un seul objectif ....... 112!
D - Le conflit entre les instruments : le cas du
partage modal ...................................... 114!
1 – Un objectif imprécis ......................... 115!
2 – Des instruments aux propriétés ignorées ...... 117!
E – La cacophonie des instruments : le cas de la
taxe carbone ....................................... 123!
2 – La taxe carbone optimale ..................... 124!
2 – L’empilement des instruments ................. 125!
CHAPITRE VIII - CONCLUSION ........................... 130!
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
1
/
142
100%