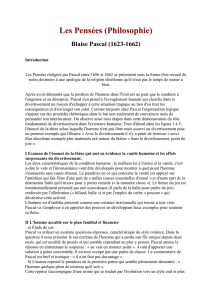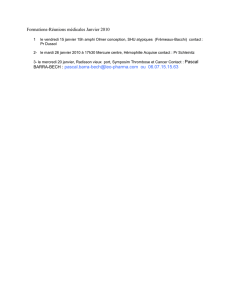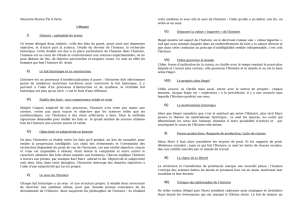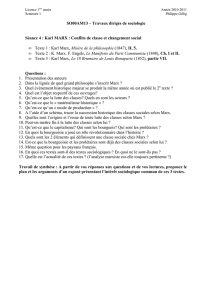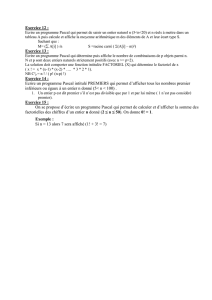PASCAL ET LE DIVERTISSEMENT

1
PASCAL ET LE DIVERTISSEMENT
Copyright Pierre Macherey
L’un des thèmes dominants de la pensée pascalienne est le désaveu de la
philosophie, dont sa critique du cartésianisme est l’expression concentrée. A ses
yeux, l’entreprise de la philosophie, davantage encore que défaillante,
“incertaine”, est avant tout dénuée de sens, “inutile”, en raison de sa prétention
déplacée et abusive à l’universalité, prétention que la raison humaine, avec les
moyens dont elle dispose, bien que ceux-ci ne soient pas négligeables, est
certainement incapable de satisfaire : car il lui est définitivement impossible
aussi bien de voir absolument les choses au point de vue de Dieu que de donner
à son propre point de vue un fondement stable qui, dans les limites qui sont
imparties, en garantirait une fois pour toutes les certitudes. De là pour la pensée
humaine, pour autant qu’elle ne se résout pas à consacrer uniquement son
attention à quelques questions ciblées du type de celles qui sont accessibles à
l’esprit géométrique, questions qu’elle parvient formellement à résoudre à
condition d’adopter à leur égard une attitude ludique, sans trop les prendre au
sérieux, - Amos Dettonville est avant tout un joueur, et c’est ce qui le distingue
fondamentalement de Salomon de Tultie, et même de Louis de Montalte -,
l’obligation de se rabattre sur l’unique problème qui demeure à sa portée, mais
dont les enjeux sont pour elle cruciaux : à savoir celui que lui pose l’existence
humaine, dont elle ne peut éluder les innombrables contradictions, qui rendent à
la limite celle-ci inviable et invivable. De ce point de vue, on peut trouver chez
Pascal les éléments de base d’une critique radicale de la métaphysique, qui
anticipe sur celle de Kant, et a pour conséquence, conséquence radicale écartée
par le rationalisme kantien, de rabattre toutes les tentatives précédemment
conduites par les philosophes sur un unique terrain, le seul qui reste à la
philosophie, pour autant que ce terme soit encore approprié : celui d’une
anthropologie, au sens d’une élucidation critique de la condition humaine, avec
ses hauts et ses bas, ses grandeurs et ses misères, dans le cercle desquels elle
est définitivement enfermée, ce qui la condamne à en recenser les contradictions
en ayant à jamais déposé l’espoir de les résoudre.
Ce qui surnage principalement de la composition de l’Apologie de la religion
chrétienne, dont ne subsistent que des lambeaux épars auxquels il est vain de
chercher à restituer une cohésion ou une cohérence dont ils sont à jamais privés,
ce sont les éléments, ou plutôt les bribes, de cette anthropologie philosophique,
qui se ramène pour l’essentiel à une exploration des différents aspects de la vie
humaine, dans une perspective très proche en première apparence de celle
adoptée par les moralistes. Cependant, si Pascal est moraliste, c’est d’une
manière tout à fait originale, comme le donne en particulier à comprendre
l’Entretien avec M. de Saci, où il est expliqué qu’il y a eu, dans le passé lointain et
proche de l’Antiquité païenne et de la tradition chrétienne, deux manières
alternatives de considérer la condition humaine : l’une consiste, une fois rejeté
ce qui peut être tenu pour accidentel et inessentiel, à identifier et à glorifier les
marques subsistantes de la grandeur de l’homme, c’est-à-dire l’aptitude dont, en
dépit de tout, il dispose en vue de se donner par lui-même les moyens de mener
une vie libre dont il ait personnellement la maîtrise ; l’autre, en sens exactement
inverse, met l’accent sur les obstacles qui rendent une telle tentative
problématique, voire même impraticable, obstacles que l’homme rencontre, non
à l’extérieur, mais au dedans de lui-même, du fait que sa nature soit déchue et
corrompue, ce qui entache d’incertitude ses espoirs de salut, dans lesquels il se

2
lance à corps perdu, sans garantie, témoignage par excellence de sa misère. Or
ce qui distingue radicalement la position de Pascal, c’est le refus de choisir entre
ces deux options : “Qui fait l’ange fait la bête”, “Nous sommes au rouet”, sont de
ce point de vue les formules cruciales qui donnent à son anthropologie sa
coloration unique, sur des bases qui sont celles d’une logique du paradoxe, dont
les sources seraient sans doute à chercher du côté de Nicolas de Cuse et de sa
thématique de la coïncidentia oppositorum, selon laquelle l’esprit humain est
confronté à des contradictions insolubles dont la tension ne se relâche jamais et
qu’il doit, en se résignant à pratiquer la “docte ignorance”, s’exercer à supporter
puisqu’elles constituent en dernière instance la condition de son fonctionnement
normal.
L’idée de base de l’anthropologie pascalienne, c’est donc que l’homme est grand
et misérable, le pivot de cette affirmation étant constitué par le mot de liaison
“et”, qui signifie à la fois que l’homme est grand bien que misérable, et aussi, si
étonnant que cela puisse paraître, qu’il est grand parce que misérable ;
autrement dit, pour concentrer ces deux thèses en un énoncé unique, il est
grand en étant misérable, grand jusque dans sa misère même, ce qui est l’une
des clés de la fameuse métaphore oxymorique du “roseau pensant”, ensuite
passée à l’état de cliché et vidée par là de l’essentiel de sa portée spéculative. Si
l’homme est un être à part, ce qui justifie qu’il fasse l’objet d’une étude séparée,
c’est en raison de sa nature monstrueuse qui fait de lui l’égal d’une chimère ;
cette nature consiste en une combinaison exceptionnelle d’ordre et de désordre,
qui fait naître le désordre de l’ordre et l’ordre du désordre, sans que l’un ou
l’autre parvienne définitivement à s’imposer et sans que leur alternance puisse
jamais trouver de terme. Notons en passant qu’en adoptant un tel point de vue,
Pascal est bien loin de considérer l’homme comme un empire dans un empire,
c’est-à-dire comme étant capable d’établir et de confirmer son règne sur un
domaine bien délimité et indépendant où il exercerait ses pouvoirs sans partage,
dans une perspective uniment positive : s’il y a un monde de l’homme, celui-ci
est un monde en loques, dont les frontières sont pour toujours indécises, et qui
n’a d’autre fondement que celui qui est fourni par ses lacunes, dans un mélange
inclarifiable de puissance et d’impuissance, où la seule assurance de stabilité est
celle qui est fournie par l’état de fait, c’est-à-dire la radicale contingence qui
décide du choix d’un métier ou de la forme d’un Etat, dans un univers où le vide
se trouve virtuellement partout, et où Dieu ne se révèle qu’à travers son
absence irrémédiable, Deus absconditus, face cachée que seuls illuminent par
instants, pour certains, les éclairs imprévisibles de la grâce.
C’est dans ce contexte trouble et empreint de confusion que prend place la
réflexion consacrée par Pascal au thème du divertissement, qui éclaire les
extraordinaires singularités de cette manière de concevoir la condition humaine,
dont elle fait ressortir la précarité, qui constitue son unique loi:
“Sans examiner toutes les occupations particulières, il suffit de les comprendre
sous le divertissement.” (Br. 137)
Examiner tous les aspects de la vie humaine, en élucider les plus infimes détails,
sur un plan où c’est le “je ne sais quoi” qui fait toujours en dernière instance la
décision, serait une tâche infinie, vouée de ce fait à l’échec ; mais il est possible
de parer à cet inconvénient en allant directement, par le moyen de la raison des
effets, à ce qui, pour elle constitue, non son centre, mais l’expression par
excellence de son décentrement, c’est-à-dire son absence totale de centre : le
divertissement, qui, écrit Pascal, doit “suffire” pour la comprendre, ce qui veut
dire que, n’y en ayant pas d’autre disponible, il faut bien se contenter de cette

3
explication.
On est plongé par là en plein paradoxe : c’est à l’extrême de la particularité, car
le divertissement est par excellence un régime de dispersion et de
déconcentration, que se trouve le principe générique permettant d’effectuer la
récollection d’une totalité démembrée, dont les éléments sont définitivement
épars, et à laquelle il faut renoncer à restituer une unité quelque peu
consistante. Or, quoiqu’en pratiquant le divertissement l’homme ne cesse de
s’engager, dans un monde sens dessus dessous, sur des chemins de traverse, en
s’évertuant à mettre au point des façons de se divertir inédites, il y a un fait
global, massif et permanent du divertissement en tant que tel, qui pousse
toujours dans le même sens, même si c’est en divergeant. Le coup de force
effectué par Pascal se trouve, comme très souvent chez lui, concentré dans un
trait de style, manière imperceptible de modifier la façon d’utiliser les mots qui,
d’un seul coup, et sans qu’on s’en soit rendu compte, change tout : ce trait de
style consiste à parler, au singulier et en utilisant l’article défini, du
divertissement, ce qui métamorphose celui-ci en une allure commune de la vie,
alors même que la vie, en proie à la logique du divertissement, ne cesse de
changer ses allures, en se prêtant aux attraits et aux élans, non seulement des
différents divertissements, mais du divertissement, occupation de détournement
ou de distraction n’ayant pas fatalement pour destination l’agrément, et qui
exerce sa force sur le plan du divers, et d’un divers irréductible à l’unité, et
trouve en celui-ci, sinon un fondement stable, du moins les conditions de son
inimaginable persévérance ou continuité. Autrement dit, il y a une puissance du
divertissement comme tel, qui se traduit par une constance dans la culture de
l’éphémère, la seule constance à vrai dire dont soit capable la vie humaine, qui
se caractérise ainsi par le fait qu’elle fait de l’inconstance un principe.
Pascal n’a pas inventé le mot divertissement, qui s’était introduit dans la langue
française un siècle et demi avant lui, mais il a créé une toute nouvelle façon de
s’en servir, qui l’a élevé au rang d’une hypothèse directrice, dont il a fait le
concept de base de la nouvelle anthropologie édifiée sur les ruines de la
métaphysique et de ses illusions perdues, anthropologie du divertissement dont
cet énoncé abrupt fournit un assez bon résumé :
“Condition de l’homme : inconstance, ennui, inquiétude.” (Br. 127)
Le divertissement, qui est une manifestation d’instabilité, puisque les fixations
auxquelles il se consacre de manière obsessionnelle sont fatalement provisoires,
traduit une inquiétude et un ennui, au sens très fort qu’avait ce dernier terme au
XVIIe siècle, proche de celui qu’exprime aujourd’hui le mot angoisse, sourde
préoccupation qui n’est pas une peur ciblée sur un objet précisément identifiable,
mais correspond à un malaise généralisé, très difficile pour cette raison à
dissiper, qui, de proche en proche, se communique à l’ensemble du milieu de vie
de l’homme : c’est le monde entier qui l’ennuie, en le plongeant dans une
désespérance, un souci, une incapacité à se satisfaire, un sentiment inexpiable
de vide et de perte, qui ne lui laissent comme solution que la possibilité toujours
présente de se divertir, ce qu’il fait pour oublier, en se lançant à corps perdu,
avec l’espoir de combler ce vide, dans de nouvelles recherches qui n’aboutissent
qu’à relancer le cours de son inquiétude, et ceci suivant un mouvement qui ne
peut s’interrompre ni trouver de terme définitif. L’ennui, comme le désir, dont il
est l’envers ou le revers, la vérité cachée, est un sentiment qui se nourrit de lui-
même, ce qui lui interdit toute promesse de résolution :
“Ennui - Rien n’est si insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos,
sans passions, sans affaire, sans divertissement, sans application. Il sent alors
son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son

4
vide. Incontinent, il sortira du fond de son âme l’ennui, la noirceur, la tristesse,
le chagrin, le dépit, le désespoir.” (Br. 131)
Pourquoi se divertit-on, au sens absolu que prend le divertissement lorsqu’il est
pratiqué pour lui-même, indépendamment donc de la recherche d’une
satisfaction extérieure dont la possession puisse être garantie ? Pour échapper à
l’ennui profond que provoque le fait d’être en repos, c’est-à-dire tout simplement
d’être, de subsister sans occupation définie, en étant alors confronté à soi-même
et à son vide, dont il faut à tout prix être diverti, en faisant diversion, et en
payant pour cela le prix, - il est fort élevé -, qui est de se lancer dans une
agitation vaine, qui permette pour un temps de penser à autre chose, en
reléguant à l’arrière-plan son ennui, selon une procédure qui évoque à l’avance
celle du refoulement. Le divertissement permet donc de gagner du temps en
pratiquant l’art de perdre son temps, et ceci en se dépensant sans mesure, et
sans autre perspective de gain que celle qui consiste dans la promesse de passer
du temps, - le divertissement a toujours la forme d’un “passe-temps”, d’une
“distraction” qui permet d’éloigner ses soucis en pensant à autre chose -, en vue
de suspendre pour un petit moment l’insupportable inquiétude qui inonde
l’existence entière de sa noirceur.
Ce point est évoqué de manière saisissante dans la phrase que Pascal a écrite en
marge du fragment le plus développé qu’il a consacré au thème du
divertissement :
“Raison pourquoi on aime mieux la chasse que la prise.” (Br. 139)
Le divertissement est une quête qui ne tend vers rien, mais procure seulement
une chance de s’échapper à soi-même, tant que dure la poursuite du leurre
auquel elle s’attache, dont la seule fonction, la “raison pourquoi”, saisie au point
de vue de la raison des effets, est de tromper une attente dont la pression ne
cesse de tarauder celui qui y est en proie :
“De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands
emplois sont si recherchés. Ce n’est pas qu’il y ait en effet du bonheur, ni qu’on
imagine que la vraie béatitude soit l’argent qu’on peut gagner au jeu, ou dans le
lièvre qu’on court : on n’en voudrait pas s’il était offert. Ce n’est pas cet usage
mol et paisible, et qui nous laisse penser à notre malheureuse condition, qu’on
recherche, ni les dangers de la guerre, ni la peine des emplois, mais c’est le
tracas qui nous détourne d’y penser et nous divertit.” (Br. 139)
Quel trait commun réunit la chasse, la guerre, le jeu, la conversation des
femmes ou l’accomplissement des obligations liées aux grandes charges ? Rien
d’autre que le fait que tout cela est du divertissement, c’est-à-dire, sous toutes
les formes imaginables, un moyen de s’absenter à soi-même, afin de se défendre
contre son ennui, tout en sachant obscurément que ce n’est qu’un palliatif
dérisoire qui ne change rien aux données du problème, puisque celui-ci, l’instant
suivant, va se reposer, le même toujours, car il s’avère impossible d’échapper à
son retour lancinant. C’est pourquoi le divertissement, agitation démente qui
tourne en rond et s’effectue sur place, témoigne exemplairement des
contradictions de l’existence humaine qui n’a pour se supporter et pour
persévérer que la culture du superflu, dont les satisfactions imaginaires ne
peuvent que la décevoir : le divertissement est à la fois absurde et plein de sens,
l’essentiel de sa signification consistant dans son absurdité, qui met cruellement
à nu les ressorts cachés de la condition humaine, dont il révèle l’ultime vérité,
qui n’est rien d’autre que l’absence même de vérité, au sens d’une vérité qui lui
appartiendrait à elle seule en propre.
C’est pourquoi il faut aller plus loin, et reconnaître dans le divertissement, et

5
dans le sérieux et l’application que, hors de toute raison, on lui consacre, alors
même qu’il se révèle à terme sans objet, et sans issue, la forme pure, et la plus
pure qui soit, d’un exercice spirituel. En remontant à la clé de toutes les
conduites humaines, qui est le divertissement en tant que tel, on se donne le
moyen de restituer à l’existence saisie sous ses aspects les plus humbles en
apparence une dimension transcendante, même si celle-ci se traduit par la perte
de sens et déclenche un sentiment profondément déprimant, ce qui est la rançon
à payer pour profiter des révélations qu’il comporte. Que fait-on au juste
lorsqu’on s’adonne à la conversation des femmes, pudique euphémisme qui
recouvre toute une gamme variée d’intérêts, d’émotions et d’attitudes? A
première vue, on cède à une attraction dont les bénéfices escomptés sont
directement palpables. Mais comment s’en tenir en une telle affaire à ce que
Pascal appelle “un usage mol et paisible”, c’est-à-dire au fond indifférent ? La
fonction du divertissement est précisément de faire pièce à l’indifférence, et l’on
sait la place que tient dans l’Apologie la thématique de l’indifférence, qui, avec
l’apparence de tranquillité qu’elle affiche, est la forme la plus viciée et la plus
condamnable de l’oubli de Dieu : il en arrache de force le masque, au prix d’une
dépense d’énergie insane, dont la seule justification est la poursuite indéfinie
d’un bien qui ne se présente qu’à travers son absence. L’homme qui se divertit
brûle ses vaisseaux, et, à son insu même, se fait violence à lui-même, se sacrifie
pour son salut, même si cette quête, dans la forme où il s’y consacre, est sans
espoir, d’autant plus méritante et digne d’admiration à sa manière qu’elle est
ainsi désintéressée et gratuite, puisqu’elle s’accomplit en ayant déposé toute
chance de succès et en misant en quelque sorte sur son échec. Le divertissement
est comme un pari à l’envers, qui révèle les dessous du pari véritable : car ce
dernier, de la même manière que le divertissement, est un saut dans le vide, un
calcul désespéré, - l’argument du pari consiste à expliquer qu‘il est raisonnable
de choisir de faire en conscience quelque chose de déraisonnable -, comme une
dernière chance ressentie comme impossible, ce qui n’empêche d’essayer de la
saisir, en l’absence de toute prise assurée qui en garantirait le succès.
C’est pourquoi le divertissement, qui est parfaitement déraisonnable, n’en répond
pas moins à une cause, une “raison pourquoi”, ce qui lui restitue, au niveau qui
est le sien, une sorte de légitimité, qui le sanctifie :
“Mais quand j'y ai pensé de plus près, et qu’après avoir trouvé la cause de tous
nos malheurs, j’ai voulu en découvrir la raison, j’ai trouvé qu’il y en a une bien
effective, qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et
mortelle, et si misérable, que rien ne peut nous consoler, lorsque nous y pensons
de près.” (Br. 139)
“Y penser de près”, formule qui revient à deux reprises, au début et à la fin de
cette phrase, et qui pourrait faire penser à une psycho-analyse avant la lettre,
c’est précisément ce qui est pour nous le plus difficile, parce que nous sommes
des êtres de divertissement, qui, spontanément, nous ôtons les moyens
d’appréhender la juste mesure des choses et du rapport que nous entretenons
avec elles. Notre ignorance s’explique tout d’abord par le fait de prendre distance
par rapport à ce que nous sommes en réalité, par peur du terrible secret qui
nous hante : de ce secret, nous cherchons par tous les moyens à écarter la
menace, le meilleur de ces moyens étant donné par l’oubli de notre condition,
dont la vue nous fait horreur, ce qui est l’ultime raison du divertissement,
conduite lucide et opaque à la fois, comme nous ne pouvons manquer de nous en
apercevoir si nous y pensons de plus près, et si nous faisons l’effort de percer le
mystère de sa banalité ordinaire et d’en apercevoir l’inquiétante étrangeté. Avec
le divertissement, et son obsédante intranquillité, nous touchons du doigt notre
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
1
/
29
100%