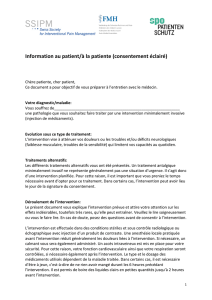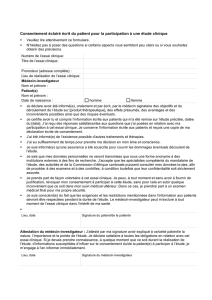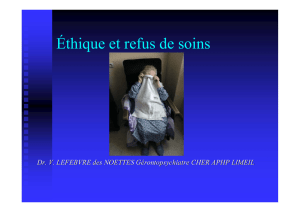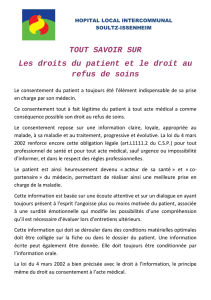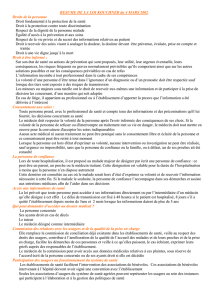Lire l`article complet

15
La Lettre du Gynécologue - n° 270 - mars 2002
évolution et la complexité croissante du contexte
médico-légal ont incité Charles Nahmanovici et
Félix Bénouèche à organiser, lors des 18es Jour-
nées de gynécologie de Nice et de la Côte d’Azur, en juin
2000, une table ronde consacrée à l’information et au consen-
tement.
Les procédures d’information et de consentement structurent
une nouvelle relation médecin-patient, un nouveau contrat
redéfinissant le lien social, base de la confiance minimale qui
se doit d’exister entre les deux parties.
Ce nouveau contrat social repose sur l’évolution de la méde-
cine, du droit, de la jurisprudence, de l’assurance, de la déonto-
logie et sur de nouveaux rapports entre la pratique et l’éthique.
Cette table ronde, organisée en partenariat avec les laboratoires
Besins-Iscovesco, réunissait des représentants de toutes les
parties concernées[1] et a permis que s’expriment des opinions
opposées et que soient exposés des moyens simples devant
permettre au praticien d’améliorer sa pratique quotidienne.
Cette table ronde était animée par Sylvain Attal, journaliste à
France 2 et animateur de l’émission Argent Public.
À l’initiative des organisateurs, une enquête originale a été
réalisée dans les mois qui ont précédé le congrès. Christian
Fossat a présenté les résultats du questionnaire envoyé aux
gynécologues obstétriciens de la Région parisienne et proposé
aux utilisateurs du site Gyneweb. Quatre points principaux
ressortent de l’analyse des 350 réponses obtenues:
1.
1. Dans quelles situations devons-nous absolument fournir une
information claire, précise et détaillée?
2.
2. L’information que nous délivrons est-elle exhaustive?
3.
3. Comment recueillons-nous le consentement?
4.
4. Dans quelles situations un consentement signé est-il indis-
pensable?
DANS QUELLES SITUATIONS DEVONS-NOUS
ABSOLUMENT FOURNIR UNE INFORMATION CLAIRE,
PRÉCISE ET DÉTAILLÉE ?
Quatre-vingt-dix pour cent des personnes interrogées s’accor-
dent pour dire que l’information est nécessaire.
Le support de l’information varie. Le plus souvent orale, elle
est délivrée:
•
•lors de plusieurs consultations,
•
•à la remise de documents explicatifs.
Cette attitude se retrouve:
•
•dans 20% des cas pour la pose d’un DIU ou une stimulation
de l’ovulation,
•
•dans 50% des cas si une hystéroscopie, une cœlioscopie ou
une hystérectomie sont envisagées,
•
•dans 60% des cas pour une amniocentèse.
L’accouchement est un cas particulier, puisque l’oralité prime.
Les réponses des praticiens mettent en évidence plusieurs
modalités de transmission de l’information:
•
•information orale lors de la consultation et lors des réunions
de préparation à l’accouchement,
•
•à chaque consultation pour la moitié d’entre eux, essentielle-
ment à la dernière pour les autres,
•
•dans moins de 10 % des cas, par la remise d’un document,
•
•lors d’un projet d’accouchement élaboré par la patiente et
discuté avec le praticien.
L’INFORMATION QUE NOUS DÉLIVRONS
EST-ELLE EXHAUSTIVE ?
En matière d’accouchement, seuls 20 % disent donner une
information exhaustive. La plupart pensent qu’il est inutile
d’inquiéter les patientes, l’accouchement étant inéluctable.
Dire à chaque patiente “femme grosse, un pied dans la fosse”
ou délivrer les statistiques de mortalité maternelle va inquiéter
les patientes tout à fait inutilement.
Si dans certains cas l’information se doit d’être exhaustive, la
réalité est autre et l’exhaustivité n’est réelle que dans :
•
•30% des cas pour le DIU,
•
•40% des cas pour l’hystéroscopie et la cœlioscopie,
•
•45% des cas pour la stimulation de l’ovulation,
•
•55% des cas pour l’hystérectomie.
Il est intéressant de noter que, dans la plupart des situations,
GYNÉCOLOGIE ET SOCIÉTÉ
Information et consentement
18es Journées de gynécologie de Nice et de la Côte d’Azur
●I. Leguillette*, C. Proust**
L’
* Maternité des Vallées, 6, rue des Vallées, 92290 Chatenay-Malabry.
** Service du Pr Valleur, hôpital Lariboisière, 2, rue Ambroise-Paré, 75010 Paris.
[1] Christian Fossat, gynécologue obstétricien et webmaster du site Gyneweb ;
Nicolas Gombault, directeur juridique du Sou Médical ; Dominique Thouvenin,
professeur de droit et responsable du dossier information des patients à
l’ANAES ; Anne Langlois, philosophe ; Robert Saury, docteur en médecine,
docteur en droit, vice-président de la section éthique et déontologie au
Conseil de l’Ordre ; François Goffinet, au titre du Collège national des gynéco-
logues obstétriciens ; Paule Verdineau, gynécologue médicale à Nice ; Chantal
Ramogida, présidente de l'association Pauline et Adrien et représentante des
patientes ; Gérard Lévy, professeur en gynécologie et obstétrique et représen-
tant officiel de Mme Dominique Gillot, secrétaire d’État à la Santé et aux
Handicapés ; Alain Proust, membre du comité scientifique des journées
Éthique, religion, droit et reproduction.

moins de la moitié des médecins donnent une information
exhaustive quant aux complications possibles.
COMMENT RECUEILLONS-NOUS LE CONSENTEMENT ?
Le recueil du consentement est à l’image de la volonté d’infor-
mation.
Le recueil se fait une fois sur deux pour la pose d’un stérilet,
une stimulation de l’ovulation ou un accouchement, mais près
de 4 fois sur 5 dans un contexte chirurgical ou lors de la pro-
position d’une amniocentèse.
Par ailleurs, un soin tout particulier est à prendre quant aux
modalités de recueil.
Dans les réponses obtenues, deux modalités prédominent:
•
•l’annotation dans le dossier pour le DIU (80%); la stimula-
tion de l’ovulation (60%); l’accouchement (70%); l’hysté-
roscopie, la cœlioscopie et l’hystérectomie (50%);
•
•l’utilisation d’un document type pour l’amniocentèse (plus
de 50%); l’hystéroscopie, l’hystérectomie et la cœlioscopie
(30 à 40%).
Le document type est très peu utilisé pour la stimulation de
l’ovulation et l’accouchement; il ne l’est jamais pour la pose
d’un DIU.
Il ressort de l’analyse des réponses que l’annotation dans le
dossier est le moyen privilégié pour le recueil du consente-
ment. La discussion nous permettra d’évaluer si cela est suffi-
sant. Des documents élaborés par le médecin peuvent être uti-
lisés: courrier au médecin traitant, lettre à la patiente énonçant
à nouveau les données ou les risques de l’examen ou de
l’intervention et demandant, par retour de courrier, la confir-
mation de la décision. Ce dernier moyen constituerait une
excellente preuve en cas de litige, mais il paraît être assez peu
utilisé dans la pratique quotidienne.
DANS QUELLES SITUATIONS UN CONSENTEMENT
SIGNÉ EST-IL INDISPENSABLE ?
Un consentement signé, pour la population interrogée, est
indispensable dans les cas suivants:
•
•le dépistage T21,
•
•la ligature des trompes,
•
•le refus d’intervention,
•
•les études cliniques,
•
•la PMA.
Pour conclure son exposé, Christian Fossat a présenté une ana-
lyse des réponses à un questionnaire prospectif. Si la plupart
de nos confrères ne remplissent pas toutes les obligations
actuelles du devoir d’information et de recueil du consente-
ment, ils sont, en grande majorité, soucieux des modifications
que ces “nouvelles façons de procéder” entraîneront dans leur
pratique quotidienne:
•
•80% des personnes interrogées pensent que toutes ces obli-
gations médico-légales ont profondément modifié la relation
médecin-malade; elles estiment que, hormis dans les domaines
de la psychosomatique et de la sexologie, la pratique quoti-
dienne de la gynécologie obstétrique est concernée par ces
mesures, et surtout que, même si la réflexion est collégiale,
c’est à l’opérateur et à lui seul de donner l’information;
•
•par ailleurs, la majorité pense que le secteur privé et les prati-
ciens libéraux sont les premiers concernés par cette obligation,
même si dans l’esprit tous le sont.
En conclusion, l’annotation dans le dossier, la bonne foi et le
témoignage des patientes sont essentiellement mis en pratique,
et assez peu le consentement signé.
Le flou qui existe concernant les modalités de recueil est
essentiellement dû au problème posé par l’exhaustivité, surtout
dans le cas de l’accouchement: faut-il, en effet, considérer que
l’accouchement entre dans le cadre de l’obligation d’informa-
tion complète et de recueil du consentement?
Le premier intérêt de ce sondage a été de montrer combien la
plupart des gynécologues obstétriciens sont éloignés, dans leur
pratique quotidienne, des obligations ou des précautions en
matière d’information et de consentement. À ce titre, Nicolas
Gombault, directeur juridique du Sou Médical, a rappelé les
principes du “devoir d’information”.
Le devoir d’information est fondamental. Il procède de deux
exigences, l’une déontologique et l’autre juridique. La pre-
mière stipule que, sans information, il ne peut pas y avoir de
consentement valable à l’acte médical, et la seconde précise
qu’un consentement n’est éclairé et juridiquement recevable
que si l’information préalable est claire et intelligible.
Deux questions se posent : “Qui doit informer?” et “De
quoi doit-on informer?”.
L’information pèse et sur celui qui prescrit l’acte et sur celui
qui le réalise. L’anesthésiste se doit d’informer de tous les
risques de l’anesthésie, au même titre que le chirurgien le fera
concernant son intervention et comme le médecin traitant
l’aura fait en exposant les différentes possibilités et les risques
et avantages de chacune. Aucun d’entre eux ne peut et ne doit
le faire pour l’autre.
L’information doit porter sur l’état de santé du patient, son
évolution probable et les conséquences de la thérapeutique
envisagée, dont il sera précisé les conséquences possibles. Ce
dernier point est fondamental dans le débat juridique actuel:
les risques qui sont inhérents à l’acte, au traitement, à l’inves-
tigation, à l’intervention chirurgicale doivent être clairement
expliqués au patient. Tout le contentieux juridique actuel en
matière d’information repose en effet sur cette notion de
risques encourus.
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt que: “le patient
doit être informé de tous les risques graves quelle que soit leur
fréquence”. Est de ce fait abandonné par les magistrats le cri-
tère ancien de la fréquence du risque auquel on se référait.
Tout risque, même exceptionnel, doit être mentionné, et la
charge de la preuve de cette information pèse sur celui qui la
donne. Ainsi, dans un débat juridique, si un juge n’arrive pas à
fonder son opinion quant à l’exhaustivité de l’information
donnée, le doute profitera à la victime et une condamnation
pourra s’ensuivre.
La preuve de cette information est au cœur de tous les débats.
Le plus souvent orale, elle est dispensée lors du colloque sin-
gulier médecin-patient, sans témoin. Comment, dans ce cas,
16
La Lettre du Gynécologue - n° 270 - mars 2002
GYNÉCOLOGIE ET SOCIÉTÉ

prouver, lors des débats juridiques, que non seulement l’infor-
mation a été donnée dans son exhaustivité, mais aussi qu’elle a
été parfaitement assimilée et comprise?
L’oral ne suffit pas. La preuve par présomption est trop aléa-
toire; quant à l’appel à témoin, il est toujours suspect. Reste la
preuve écrite.
Sans tomber dans l’excès, on pourrait envisager l’établisse-
ment de fiches d’information dans lesquelles l’acte, sa fina-
lité, les avantages escomptés et tous les risques encourus
seraient décrits. Le patient le signerait en ajoutant une formule
précisant qu’il a reçu la totalité des informations.
Dominique Thouvenin, professeur de droit, a ensuite abordé
l’aspect juridique de la relation médecin-malade.
Elle a insisté sur l’aspect pervers des règles juridiques impo-
sées aux médecins.
Les règles juridiques se veulent avant tout des règles sociales
visant à instaurer un climat harmonieux entre les citoyens; or,
dans le contexte médical, ces règles sembleraient plutôt devoir
générer un climat conflictuel et suspicieux.
Pourquoi une telle déviance?
L’obligation d’information n’est pas nouvelle. Ce qui l’est, en
revanche, c’est la responsabilité qui en découle et l’obligation
d’en apporter la preuve; comme le précise le discours de la
Cour de cassation: “le médecin doit faire la preuve de l’infor-
mation”.
Ce biais juridique ne doit pas modifier la relation médecin-
patient.
Le médecin doit toujours garder à l’esprit que la personne
qu’il a en face de lui est un patient qui ne sait pas; il se doit
donc de lui exposer les faits le plus clairement possible afin
qu’il puisse faire un choix.
Le premier but du colloque singulier, c’est le recueil du choix
du patient, de ce qui sera le mieux pour lui, tout en se gardant
du risque que les éléments avancés puissent être un jour la
base d’un conflit juridique.
Il serait catastrophique pour la relation médecin-patient que,
lors du colloque singulier, l’interlocuteur soit vu, non comme
un patient, mais comme un futur plaideur.
Dominique Thouvenin a conclu par un encouragement à la
sérénité. Si les règles sont toujours aussi floues et que l’on uti-
lise le biais de l’information, c’est qu’il est bien souvent diffi-
cile de faire la démonstration de la déficience de l’activité
médicale.
La parole a ensuite été donnée à Robert Saury, représentant du
Conseil national de l’Ordre, pour aborder le versant déontolo-
gique de la profession.
Un vieil adage juridique enseigne que “la plume est serve et la
parole est libre”. Parallèlement à cela, le Code civil, dès 1804,
précisait que, pour qu’un contrat soit valable, il faut qu’il y ait
eu échange d’informations entre les parties.
Il est surprenant que cette obligation d’information étonne les
médecins.
Cette réaction du corps médical amène plusieurs réflexions.
•
•Le défaut d’information n’est qu’un des éléments de la faute
médicale. Encore faut-il qu’il ait un rapport avec le préjudice.
La commission d’une faute, en revanche, est l’élément essen-
tiel de la mise en jeu de la responsabilité médicale.
•
•La mise en jeu de la responsabilité médicale relève, le plus
souvent, de trois motivations du patient: un tiers demande
“quel est l’imbécile qui a fait ‘ça’”; le patient prétend ne pas
avoir été informé; l’attrait de l’indemnisation.
•
•Comment va-t-on informer?
L’écrit doit être le moyen d’informer, d’expliquer, à condition
que le document d’information ne devienne pas un contrat au
même titre qu’un acte notarié. Une telle attitude, d’une part,
risquerait d’être mal interprétée par les magistrats (si l’absence
de preuves peut être préjudiciable, l’excès de preuves est sus-
pect), et surtout dénaturerait la relation de confiance entre le
médecin et son patient.
La fiche d’information remise au patient reste un excellent
moyen pour prouver qu’il y a eu information. En cas de refus,
pour garder la preuve qu’il y a eu explication et refus, il faut
transmettre au Conseil de l’Ordre le refus et la raison pour
laquelle le praticien se dégage de l’obligation de soins à
l’égard de son patient.
Informer le patient est essentiel: il faut répondre à son besoin
d’explications. On n’explique jamais assez.
Au nom du Collège national des gynécologues obstétriciens,
François Goffinet s’est ensuite exprimé.
Une information claire et loyale est nécessaire; elle implique
une réflexion concertée sur les modalités de sa délivrance et
du recueil du consentement. L’élaboration de fiches d’infor-
mation s’est faite, dès 1998, sous l’impulsion du Collège
national des gynécologues obstétriciens français, notamment
sous celle de Fabrice Pierre et de Bruno Carbonne[2].
Deux points sont à noter: l’esprit et le but.
L’information est complète, mais sans énumération exhaustive
de tout ce qui peut se produire.
Il s’agit d’aider les praticiens à donner l’information sans
régler ou résoudre les problèmes. Sont exclues les situations
d’urgence, qui suppriment tout dialogue véritable médecin-
patient.
Ces fiches sont essentiellement un moyen positif et didac-
tique de transmettre une information. Elles doivent contribuer
à l’évolution de la relation médecin-patient vers un dialogue
plus ouvert, et en aucun cas ne doivent être prises comme un
instrument de défense.
Jamais ce support écrit de l’information ne peut ni ne doit rem-
placer l’information orale et le dialogue.
Informer clairement et loyalement le patient, communiquer
avec le médecin traitant, permettre au patient de réfléchir, de
revenir poser d’autres questions et, en cas de survenue d’un
accident, discuter clairement avec lui sont les bases du col-
loque singulier médecin-patient. Dans ce contexte, les procé-
dures ne seraient pas supprimées mais assurément bien mini-
misées.
Remplaçant David Serfaty, président des collèges de gynéco-
logie médicale de France, Paule Verdineau a pris la parole
pour préciser, au sein de la spécialité, la place particulière, en
17
La Lettre du Gynécologue - n° 270 - mars 2002

matière d’information et de consentement, de la gynécologie
médicale.
La place de la gynécologie médicale est privilégiée dans ce
domaine pour trois raisons:
•
•la relation est assurée, car les patientes ne nous consultent
pas seulement pour un acte technique. La relation s’est établie
au fil des ans sur la base du dialogue et de la confiance;
•
•l’acte technique envisagé en accord avec la patiente sera dis-
cuté avec un confrère par l’intermédiaire d’un courrier, qui
inclura la copie de l’information donnée, tout en sachant que
ce dernier donnera, à son tour, une information similaire. La
patiente recevra donc une double information sur le même
sujet, par deux personnes différentes;
•
•l’information impose parfois la signature de la patiente,
comme dans le tritest de dépistage en début de grossesse.
Demeure toutefois le risque de l’incompréhension. Souvent, le
praticien pense avoir fait son travail objectivement, mais la
patiente ne l’a pas bien compris. Dans certains cas, deux expli-
cations, voire plus, sont nécessaires pour informer et, surtout,
pour être à peu près certain que l’essentiel, à défaut de la tota-
lité, a été compris.
Il existe parfois un fossé entre ce que la ou le gynécologue
pense avoir transmis et le vécu de la patiente. De la compré-
hension plus ou moins grande des explications du médecin par
la patiente naît l’incompréhension de cette dernière lors de la
survenue d’un résultat différent de celui escompté ou d’une
complication. Que dire aussi de l’incompréhension totale de la
famille qui, elle, n’a pas assisté à la consultation et ignore
l’information donnée?
C’est également dans ce sens que sont allés les propos de
Chantal Ramogida.
L’information doit être différente pour chaque pathologie.
Le consentement, bien souvent, est signé par la patiente sans
qu’elle analyse clairement ce qu’elle fait; elle pense ne pas
pouvoir faire autrement:
•
•le médecin le lui demande, donc elle le fait;
•
•elle n’ose pas demander de plus amples explications.
Le fossé est immense entre la patiente, désireuse que son pro-
blème soit résolu, et le médecin, qui tente de lui donner la
meilleure réponse.
L’intervention d’une philosophe était à ce niveau la bienvenue.
Anne Langlois a évoqué un autre aspect de l’information.
Informer est un devoir déontologique et téléologique, donc en
vue d’un objectif. Dans le cas présent, l’information doit per-
mettre d’obtenir un consentement libre et éclairé.
Étymologiquement, consentir, cum sentire, signifie sentir
ensemble, avoir une opinion ensemble.
L’information va permettre de:
•
•créer un univers commun de signification entre un patient et
un médecin en dehors duquel aucune prescription ne peut
avoir de réalité vécue pour la personne;
•
•créer une alliance thérapeutique ou, comme l’exprime la
Charte du malade hospitalisé, la participation à un choix;
•
•transformer le patient d’objet de soins en sujet de soins. Le
patient acceptera une prescription ou un traitement parce qu’il
en aura compris la nécessité.
L’information doit être réciproque, et le patient se doit de faire
confiance au médecin en l’informant complètement.
L’authenticité de la relation médecin-patient repose sur une
information claire et loyale qui permet, sur la base d’une
confiance réciproque, un consentement libre et éclairé à un
acte médical, mais aussi la liberté, pour le patient, d’exprimer
son refus et d’en discuter avec le médecin dans un dialogue
constructif et ouvert.
Gérard Lévy, représentant Mme Dominique Gillot, a essayé
d’exposer la pensée des autorités de tutelle:
“Au fil des ans, la société a évolué, la médecine non; de ce fait, la
pratique actuelle de la médecine n’est plus adaptée aux nouvelles
exigences de la société. Il est donc impératif qu’elle s’adapte.
Le tournant historique, en ce domaine, est l’affaire du sang
contaminé. La méfiance à l’égard du corps médical et la mon-
tée en puissance des associations de consommateurs ont fait
réfléchir la société et le corps médical. Maintenant, le nombre
de réunions comme celle-ci augmente et on y rencontre de
manière régulière les mêmes personnes. Cela exprime bien
qu’il existe une préoccupation, qui ne doit pas être dramati-
sante et qui doit faire réfléchir.
Dans un groupe social, l’ensemble des personnes qui compo-
sent ce groupe n’est pas parfait: c’est une vérité première.
Alors, première alerte, la multiplication des plaintes, qui a fait
prendre conscience au corps médical qu’il avait des devoirs.
J’ai toujours dit, et cela n’est pas agressif, que, pour un certain
nombre de médecins, la crainte du procès devenait la prothèse
de la conscience professionnelle. En fait, si tous les médecins
avaient une conscience professionnelle de qualité, ils ne redou-
teraient pas un procès.
L’arrêt Edrol est la prise de conscience par le corps médical
dans son ensemble qu’il doit y avoir une communication avec
les patients. Nombreux sont ceux qui ne le faisaient pas et que
cet arrêt interpelle.
Lors des multiples réunions des États généraux du cancer et de
la santé, les représentants des personnes malades, les malades
reviennent sur le manque de communication et d’information
de la part des médecins. Une prise de conscience en ce
domaine est indispensable. Les aléas dont on parlait précédem-
ment seront d’autant plus importants qu’on n’aura pas appris à
communiquer.
Communiquer est une véritable technique, qui ne s’improvise
pas. Il faut apprendre. Certains sont plus doués que d’autres.
À ce propos, abordons le plan gouvernemental de réformes,
dont l’apprentissage de la communication est un volet.
Notre devoir de formateur est de donner une bonne formation.
Ce n’est pas lorsque les mauvaises habitudes sont prises qu’il
faut les corriger; l’enseignement, c’est donner de bonnes habi-
tudes dès le départ. Il s’agit de donner une bonne formation
médicale et une bonne pratique de la communication.
Le deuxième point est la loi de modernisation du système de santé
et de la défense des droits des malades, qui comporte une série
de mesures qui ont d’emblée irrité beaucoup de médecins. La
communication de leur dossier aux personnes malades les inquié-
tait. Peu à peu, le corps médical s’est fait à l’idée que ce n’était
pas une arme, mais une façon de responsabiliser le patient.
18
La Lettre du Gynécologue - n° 270 - mars 2002
GYNÉCOLOGIE ET SOCIÉTÉ

19
La Lettre du Gynécologue - n° 270 - mars 2002
Le dernier point concerne l’aléa thérapeutique. Mme
Dominique Thouvenin disait tout à l’heure qu’en matière de
circulation routière les choses sont beaucoup plus simples, car
il y a des règles précises. C’est exact, et il y a aussi des assu-
rances extrêmement bien structurées, où chacun sait qui
indemnise qui et quoi. Dans le corps médical, il est difficile-
ment imaginable que la profession soit chargée, via ses assu-
rances, dont les primes augmentent sans arrêt, d’indemniser
les personnes malades victimes d’un accident, dans la surve-
nue duquel la responsabilité médicale n’est pas en cause.
C’est ce qu’on appelle l’aléa. Et l’aléa existe en médecine:
cela peut être une catastrophe individuelle comme il existe des
catastrophes naturelles collectives et, à ce titre, il doit être
indemnisé. Ainsi que nous l’a dit M. Gombaut, cet aléa fait
encore l’objet d’arbitrage. Cependant, dans le projet de moder-
nisation du système de santé, en cours d’élaboration, l’aléa
thérapeutique va devenir une réalité. Il restera encore un point
obscur, toujours le même: les modalités de financement de
l’indemnisation.
En conclusion, nous nous inscrivons dans une évolution de la
société. Il faut y répondre avec philosophie et réflexion. Il est
normal que les professionnels du monde médical soient formés
pour répondre aux besoins et aux demandes de cette nouvelle
société, qu’ils réfléchissent sereinement, sans crainte ni levée
de boucliers inappropriées.
Informer les personnes malades ne fera pas disparaître la
confiance, bien au contraire. Ce qui est crucial, cependant, c’est
la manière dont on délivrera l’information. La relativisation du
risque et l’objectivité de l’information donnée permettront de
préserver le dialogue, ce colloque singulier si important dans la
relation médecin-malade et dans la conduite du traitement.”
Voici à présent quelques mots de conclusion, que nous
emprunterons à Alain Proust, chargé de la synthèse de cette
table ronde:
“Les choses évoluent; tout le monde, chacun dans son
domaine, réfléchit. Nous avons peur d’être confrontés à des
procès sans avoir commis de faute. Un véritable travail est à
réaliser dans la définition de la faute médicale pour que nous
n’échappions pas, sous le couvert du recours aux avocats et
aux magistrats, à ce qui est de notre responsabilité propre:
faire de la relation médecin-patient une relation de confiance
et un des éléments fondateurs du lien social dans la pratique
médicale quotidienne.
Notre première responsabilité est le devoir d’information que
nous avons vis-à-vis de nos patients et que nous devons rem-
plir. Mais, comme le professeur Gérard Lévy a l’habitude de
dire, n’oublions pas que ‘le consentement éclairé dépend du
nombre de lampes que l’on allume’.
Au-delà de ce point, souvenons-nous que nous sommes là pour
faire de la médecine, que l’on peut être informé et consentant
sans pour autant guérir”. ■
Evestrel
1
/
5
100%