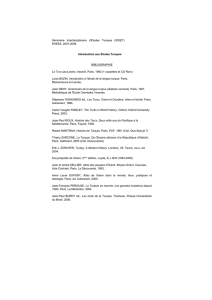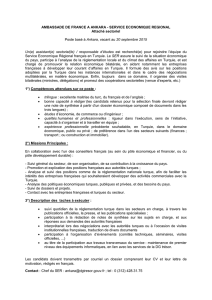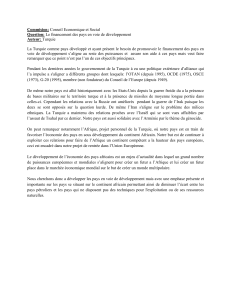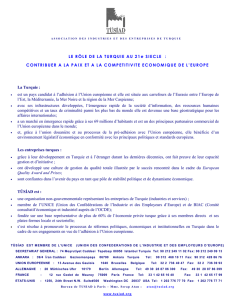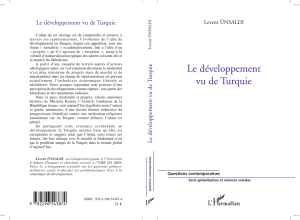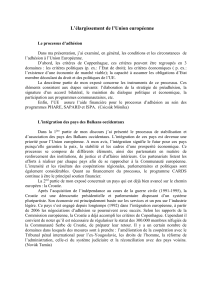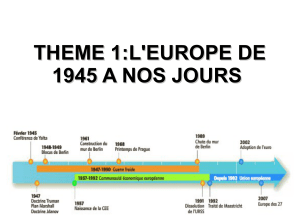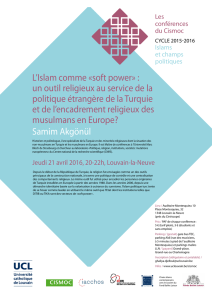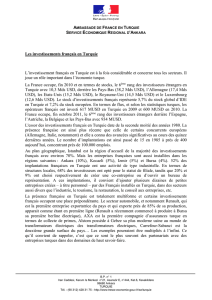Turquie, entre croissance et développement

Apériodique - n° 10 - avril 2011
Turquie, entre croissance et développement
• La Turquie est capable de résister à une crise financière. Elle l’a prouvé en 2010 avec l’un des taux de
croissance les plus élevés du monde.
• Depuis dix ans, elle s’est dotée d’une industrie performante. Elle a assaini son budget et son système
bancaire. La richesse globale s’est élevée, socle d’une classe moyenne qui a déplacé les lignes de partage de
la vie politique. Cette transition est historique.
• Mais elle ne concerne qu’une partie de la population et du territoire : l’industrie, tournée vers l’extérieur, n’a pas
diffusé assez de gains de productivité et les effets de concentration l’ont emporté. Le modèle de croissance reste
donc inégalitaire – les femmes et les jeunes en paient le prix – et la croissance produit des déficits externes.
• La Turquie explore aussi les limites d’un développement axé sur l’ouverture financière et commerciale : elle est
dépendante de capitaux courts et son change est à la merci de la confiance des marchés. Après avoir accéléré la
croissance pendant dix ans, la globalisation financière complique donc aujourd’hui la stratégie économique.
• Enfin, les Turcs achètent plus aux Russes et aux Chinois qu’ils ne vendent à l’Europe. Ce n’est pas un
positionnement industriel durable.
a Turquie a-t-elle clos cinquante ans d’une histoire
où l’économie et le politique ont été étroitement
mêlés, enfermés dans des cycles d’up and down, de
surchauffe et de crise de change, de démocratie et de
pouvoir militaire ? Cinquante ans de promesses non
tenues. En 1950, la loi sur le multipartisme était votée,
c’était la promesse démocratique. En 1960, le taux
d’accroissement de la population dépassait 2%, c’était la
promesse démographique. Pourtant, trois coups d’Etat ont
eu lieu depuis. Quant au décollage économique, il est
resté au point mort jusqu’au milieu des années 1970,
période à laquelle une vague d’IDE a enfin accéléré la
modernisation du pays.
Mais le temps n’est pas neutre, surtout en économie, et
cette histoire chaotique a produit un système dans laquelle
les anticipations des agents sont résolument ancrées dans
le court terme.
Pourtant, entre 2002 et 2008, la croissance se stabilise et
s’installe enfin sur des niveaux élevés (6,8% en moyenne).
L’horizon des agents économiques s’allonge. Le taux
d’investissement dépasse 20% du PIB et un faisceau
d’indicateurs laisse espérer une transition structurelle. De
même, en 2010, la rapidité et la vigueur de la reprise
montrent que la résistance aux chocs est plus forte
qu’avant. Serait-ce la confirmation de fondamentaux plus
solides ?
On est tenté d’acheter cette histoire, et les marchés le sont
aussi, qui, en période de crise, valorisent à son plus haut le
facteur croissance. La Turquie a longtemps souffert d’être à
la frontière de l’UE, mais voilà qu’elle en profite, car la crise
souveraine en Europe bouleverse les anticipations de
marché et les déterminants de la confiance.
Pourtant, le prix du risque turc reste difficile à trouver. Et les
agences de rating hésitent, au seuil de l’Investment Grade.
Surestimé pendant de longues années, ce risque aurait été
presque sous-estimé en 2010, car ce pays, s’il est à coup
sûr engagé dans une transition structurelle, est encore à la
recherche d’un modèle de croissance. On peut craindre,
comme dans d’autres pays émergents, que sa
financiarisation n’entretienne une économie à deux
vitesses : les écarts de productivité sectoriels se creusent
au lieu de se résorber et le marché du travail comme les
déficits externes sont les réceptacles de ce dualisme.
Tout cela conduit à s’interroger d’abord sur le degré optimal
d’intégration financière pour un pays encore en
développement, et ensuite sur le rôle de l’Etat dans les
années à venir.
2002/2008 : de la croissance au
développement, la Turquie se réforme en
profondeur
Les changements enregistrés entre 2002 et 2008 sont
structurels parce qu’ils sont multisectoriels : ils ont modifié la
géographie du pays, son profil démographique, ses
équilibres économiques et politiques. Ils ont eu lieu de
façon simultanée. Ils sont complexes et interdépendants : ils
ont une vraie dimension systémique.
L

Tania SOLLOGOUB
n°10 – avril 2011
2
1.1 - Croissance : la progression des revenus
change la donne
Il a fallu deux choses pour que la promesse
démographique turque prenne enfin sa valeur : une
progression des revenus par habitant et une croissance
ralentie dans une Europe vieillissante.
La Turquie est jeune : 28% de la population a moins de 14
ans contre 15% dans les pays d’Europe centrale et
orientale. La moyenne d’âge est de 27 ans. Aujourd’hui,
elle est le 3e pays le plus peuplé d’Europe, derrière la
Russie et l’Allemagne, et elle est au 17e rang mondial
(75,7 mns d’habitants). En 2050, elle conservera ce rang,
en se rapprochant des 100 mns d’habitants (soit à peu
près la population de l’Asie centrale, qui ne sera plus alors
qu’à une « distance » de 15 millions d’habitants de la
Russie…). Ce ne sera pas le cas des autres pays
d’Europe qui, tous, perdront des places dans ce
classement. Et en 2020, la Turquie passera devant
l’Allemagne.
Graphique 1 – En 2050, les pays les plus peuplés du monde
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
Inde
Chine
Etats-Unis
Pakistan
Nigéria
Indonésie
Bangladesh
Brésil
Ethiopie
Philippines
Congo (rép.
Egypte
Mexique
Russie
Vietnam
Tanzanie
Japon
Turquie
Iran
Ouganda
Kenya
en milliers d'habitants
Sources : Banque mondiale, Crédit Agricole S.A.
Le PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat a franchi
le cap des 10 000 dollars en 2005. Aujourd’hui, Il est au-
dessus de celui des pays émergents ayant la même
notation dans les ratings des agences (« peer group »), ce
qui est un facteur important pour mériter l’Investment
Grade1. Il se situe en 2009 à 47% de la moyenne des pays
de l’UE à 27 membres, soit le même niveau que la
Roumanie. Et surtout, depuis 1995 (date à laquelle il était
à 30% de la moyenne de l’UE), il a progressé plus vite que
celui des Roumains ou des Bulgares, ce qui relativise les
effets bénéfiques de l’intégration européenne…
Dans les années à venir, la croissance potentielle pourrait
être légèrement plus forte en Turquie qu’en Pologne, en
Roumanie ou en Bulgarie (respectivement 4,5% contre
des taux qui se situent plutôt vers 4% en Europe centrale).
Mais l’environnement inflationniste turc sera également
plus élevé que dans ces pays, tous engagés dans la
convergence monétaire européenne. La Banque centrale
vise un taux de moyen terme de 5%.
1 Moodys cite trois facteurs importants dans son évaluation de la
résilience des économies : le PIB par habitant, la capacité
d’absorber les chocs et la qualité des institutions.
Des hommes et du pouvoir d’achat : le cœur du
modèle ?
La hausse du PIB par habitant a trois conséquences : elle
stimule et modifie la nature des investissements directs, elle
impacte la spécialisation industrielle, et surtout, elle change
les moteurs de la croissance.
Au dessus de 10 000 USD par habitant, le panier de
consommation se transforme2. Le marché intérieur d’un
pays devient une composante plus importante de sa
croissance et il est plus attractif pour un investisseur. Ainsi,
la consommation privée et le commerce de détail ont
fortement tiré la reprise turque début 2010, avant que
l’investissement ne prenne le relais. La Turquie est d’ailleurs
le seul pays de la région, avec la Pologne, dans lequel la
demande domestique a retrouvé dès 2010 ses niveaux
d’avant crise. Avantage : cela va soutenir la croissance dans
les années à venir. Inconvénient : cela va également nourrir
les importations et le déficit externe car, selon le FMI, la part
des biens importés dans la demande domestique augmente.
L’apparition d’un marché intérieur : un capital précieux
en Europe
L’industrie turque représente au maximum 25% du PIB et
20% de la population active. Les principaux employeurs sont
d’abord les services (le commerce de détail et les transports
représentent chacun 13% du PIB), puis l’agriculture qui,
malgré la forte progression de l’urbanisation, reste un
employeur important. Le développement des services est
normal avec l’augmentation du PIB par habitant mais il a été
particulièrement stimulé en Turquie par le secteur du
tourisme3.
Graphique 2 – Composition de la population active turque :
le retard de l’industrie
agriculture
industrie
construction
services
En % du total
Sources : EIU, Crédit Agricole S.A.
Une industrie durablement segmentée
La structure de l’industrie est révélatrice du modèle de
développement de ce pays, de ses ressorts comme de ses
limites. Elle est très hétérogène, que ce soit dans les
structures de propriété, dans la taille des unités de
production ou dans l’accélération des gains de productivité.
Le développement industriel a été stimulé à partir des
années 70 par une première vague d’investissements
directs étrangers, venus tirer partie du faible coût de la
main-d’œuvre turc sur des activités d’assemblage. Le
meilleur exemple en est l’industrie automobile, dans laquelle
à peu près tous les grands majors sont présents (Ford,
2 Il inclut moins de produits de première nécessité, mais plus de
produits électroménagers ou de biens durables.
3 La Turquie a reçu 28 millions de visiteurs en 2010 contre 10
millions en 2000, qui ont dépensé l’équivalent de 18,5 mds USD en
2007. La région d’Antalya concentre un tiers des visiteurs.

Tania SOLLOGOUB
n°10 – avril 2011
3
Renault, Fiat, Toyota) et dont la production est destinée à
l’exportation, essentiellement vers les marchés européens.
Ces investissements réorientent la production industrielle
turque vers les marchés extérieurs. Les usines sont
grandes et très productives (les niveaux de productivité de
l’usine de Bursa de Renault sont parmi les plus élevés de
toutes les implantations de cette entreprise dans les pays
émergents et, malgré la moyenne d’âge très jeune des
salariés, le taux de turnover est proche de zéro).
Graphique 3 – Part des exportations turques dans le total de la
production : une évolution inverse entre l’industrie et
l’agriculture
0
20
40
60
80
100
1963
1967
1971
1975
1979
1983
1987
1991
1995
1999
2003
2007
agriculture mine industrie
en % du total de la production
Sources : Turkstat, statistical handbook 2010, Crédit Agricole S.A.
Viennent ensuite les entreprises publiques, dont la part
dans la production totale s’est effondrée mais qui restent
très actives dans le secteur énergétique (maîtrise du
trading pétrolier, de la distribution du gaz, etc.). Puis
surtout, les PME, à l’origine concentrées sur le marché
intérieur (construction, agro-alimentaire) ou sur des
activités à faible valeur ajoutée (textile) dont la productivité
a progressé moins vite. Certaines d’entre elles sont
aujourd’hui devenues de vastes conglomérats (du ciment
aux télécoms par exemple) qui exportent vers les marchés
de proximité du Caucase, de l’Asie centrale et de l’Afrique
du Nord.
1.2 - Le schéma de développement industriel
explique la vulnérabilité externe
L’industrie turque est donc composée d’une douzaine de
grandes entreprises très exportatrices et de dizaines de
milliers de petites structures tournées vers le marché
national. Les premières sont productives mais très
dépendantes de la conjoncture internationale ce qui
explique l’impact fort de ce secteur sur le PIB.
Jusqu’à présent, l’industrialisation turque est donc allée de
pair avec son intégration dans les marchés internationaux.
Cela a longtemps été un atout, permettant d’accélérer le
décollage de la croissance. Néanmoins, c’est l’une des
fragilités actuelles du modèle de croissance : la
dépendance de l’industrie vis-à-vis de quelques marchés
d’exportations est trop forte, et la part des exportations
dans le PIB progresse moins vite que celle des
exportations.
Celles-ci sont stimulées par l’augmentation de la
consommation domestique mais surtout par la part
croissante des importations utilisées dans l’industrie : la
hausse des exportations entraîne donc celle des
importations…
Selon le FMI, la part des produits importés dans les biens
intermédiaires utilisés par l’industrie a augmenté de
10 points entre 2002 et 2007 et s’élève aujourd’hui à 62%.
Cette hausse s’explique par une conjonction de facteurs. En
premier lieu, les grandes entreprises industrielles
exportatrices, majoritairement pilotées par les investisseurs
étrangers, ne se fournissent plus sur le marché local : celui-
ci n’est pas capable de lui proposer des biens intermédiaires
de qualité suffisante (la montée en gamme n’a pas été
assez rapide dans la sous-traitance). De plus, les décisions
sont prises au niveau des sièges sociaux, dans d’autres
pays, et en fonction d’une politique internationale intégrée
de supply chain (l’industrie automobile est l’exemple le plus
abouti de cette planification internationale : les producteurs
locaux ne maîtrisent ni la destination de leurs ventes ni la
localisation de leurs achats). Mais à l’autre bout du secteur
industriel, les entreprises à faible valeur ajoutée et à forte
intensité du travail préfèrent elles aussi importer leurs
produits intermédiaires, qu’elles trouvent à des prix plus
attractifs dans d’autres pays émergents à plus faible coût
salarial.
Le syndrome chinois
L’explosion des achats en provenance de Pékin montre
d’ailleurs que la Turquie est l’un de ces pays émergents
victimes du « syndrome chinois » : développement
exponentiel et récent des importations de biens de
consommation et de biens intermédiaires tandis que les
ventes vers la Chine stagnent, condamnant la Turquie à un
échange inégal. Elle se retrouve donc dans une position
intermédiaire très inconfortable sur l’échelle des
spécialisations internationales, entre les pays développés et
l’Asie, cette dernière exerçant une compression des marges
dans les secteurs à forte intensité du travail. La Turquie a
souffert de l’irruption de la Chine sur la scène commerciale
internationale, présence qui oblige à s’interroger sur la
nature de la spécialisation industrielle optimale, dans les
années à venir.
Graphique 4 – Des échanges structurellement déficitaires entre
la Turquie et la Chine
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1963
1967
1971
1975
1979
1983
1987
1991
1995
1999
2003
2007
% des exportations % des importations
en %
Sources : Turkstat, statistical handbook 2010, Crédit Agricole S.A.

Tania SOLLOGOUB
n°10 – avril 2011
4
Graphique 5 – Une intégration internationale de la Turquie
dans les flux commerciaux et une montée des vulnérabilités
externes (part des exportations et des importations dans le
PIB)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
Exportations Importations
% du PIB
Sources : Turkstat, statistical handbook 2010, Crédit Agricole S.A.
Vers une diversification sectorielle
des investissements directs étrangers ?
L’une des façons de réduire cette vulnérabilité externe et
de faire évoluer le profil industriel turc serait de réorienter
les investissements directs soit vers le marché intérieur,
soit vers des marchés extérieurs autres que l’Europe.
A partir des années 2000, les investisseurs ont
accompagné la croissance, concentrés dans le secteur
financier (44% du stock investi entre 2005 et 2009) suivi
par les activités de logistique et de distribution (23%) puis
par l’énergie (6%) et l’agroalimentaire (5%). Aujourd’hui, la
promesse d’un marché intérieur devrait attirer les flux
surtout dans ces trois derniers secteurs – bien que la
pénétration du secteur agroalimentaire soit difficile pour
les investisseurs étrangers, car les acteurs locaux y ont
souvent acquis une position dominante, en particulier dans
les boissons ou la filière viande. Une telle modification
sectorielle de l’investissement direct permettrait de
déconnecter les importations des exportations4 et donc de
réduire la dynamique de déficit externe, qui s’accumule à
chaque fois que la croissance redémarre.
Enfin, le développement de ce marché intérieur
commence à faire apparaître de nouvelles spécialisations
industrielles destinées au marché domestique. Dans le
secteur automobile, la production est surtout destinée aux
exportations mais le décollage de la croissance turque a
stimulé depuis 2004 la production de petits véhicules
utilitaires très adaptés à la taille des entreprises (PME)
ainsi qu’aux besoins de certains secteurs en plein
décollage (boissons). C’est un des meilleurs exemples de
l’adaptation d’un secteur industriel à la modification de la
demande intérieure et à la hausse des revenus. Cela
devrait aussi permettre à la Turquie d’exploiter des
marchés d’exportation tels que la Russie ou le Caucase,
qui ont à peu près les mêmes besoins (par exemple
l’explosion du secteur du discount russe après la crise de
2009 va conduire à l’achat d’un parc de petits véhicules
utilitaires, qui peuvent être importés de Turquie).
4 Selon le FMI (voir revue article IV juillet 2010), la part des
importations destinées à la fabrication des produits d’exportation
a augmenté.
Graphique 6 – Décollage du secteur automobile turc
2 000
202 000
402 000
602 000
802 000
1 002 000
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
automobile camionnettes camions
nombre de véhicules
Sources : Turkstat, statistical handbook 2010, Crédit Agricole S.A.
1.3 - Les anticipations des consommateurs amplifient
la crise mais soutiennent ensuite la reprise
La hausse du PIB par habitant peut modifier les
composantes de la croissance turque : parce que les
anticipations des agents sont en train de changer et parce
que cela va influencer leur comportement.
En 2009, habitués aux crises de change historiques, les
Turcs ont réagi fort et vite, en réduisant immédiatement leur
consommation et leurs investissements. La crise, venue de
l’extérieur, a donc été relayée par le canal des anticipations :
tous les indicateurs de confiance se sont effondrés. Mais
contrairement à 2001, quand la crise de la dette publique
s’était transformée en crise bancaire et donc en crise
systémique, cette fois, le canal financier de transmission est
limité, car le secteur bancaire est en bonne santé. Les
enchaînements systémiques sont inexistants, ce qui n’est
pas le cas dans la plupart des autres pays européens.
Encadré 1 - Les banques : un avantage comparatif
Cause de la crise en 2001, le secteur bancaire a, au contraire,
limité la transmission du choc mondial de 2009.
La plupart des indicateurs prudentiels bancaires ressortent
favorablement (crédits/dépôts à 70%, ratio de solvabilité –fonds
propres/actifs pondérés– à 18%, taux de crédits non performants à
5% du total). Ils expliquent à la fois la faible transmission de la crise
financière de 2009 mais aussi la forte réactivité de l’économie aux
mesures de stimulation monétaire.
La croissance des crédits à la consommation (35% en 2010) devrait
se poursuivre en 2011 et elle devient une composante importante
du PIB. Plus généralement d’ailleurs, la financiarisation de
l’économie turque est en train de s’accélérer : 52% des entreprises
financent aujourd’hui leurs investissements grâce à des prêts
bancaires contre 30% en 2005 (et respectivement 5,5% et 8,8% en
Egypte ou en Algérie).
Cette accélération du crédit laisse aussi redouter une dégradation
de la qualité des actifs bien que le stock de crédits rapporté au PIB
ne soit pas encore très élevé –40% du PIB au total et 14% pour les
crédits à la consommation. Les créances douteuses s’accumulent
plus vite dans les plus petites entreprises, dans le secteur des
cartes de crédits (taux de NPL à 10%) et des crédits automobiles
(ces tendances étaient déjà sensibles avant la crise de 2009).
Il faudra également surveiller l’accélération attendue des crédits
immobiliers bien que les prêts dans ce secteur ne représentent que
5% du PIB en 2009 contre une moyenne de 43% dans l’UE. En
2010, la construction a redémarré plus vite que prévu, dès le
second semestre, et elle restera portée par une triple dynamique :
le développement de l’immobilier individuel, les chantiers
d’infrastructures publiques et les nouveaux marchés d’Asie
centrale, de Russie, d’Azerbaïdjan et d’Ukraine.

Tania SOLLOGOUB
n°10 – avril 2011
5
En 2010, grâce au redémarrage rapide de la croissance,
les Turcs prennent donc conscience que leur économie
est devenue plus résiliente face aux chocs externes. C’est
un avantage comparatif dans un contexte de crise
bancaire mondiale… La vigueur de la reprise a surpris
aussi les analystes, qui se demandent alors s’ils n’ont pas
sous-estimé les acquis structurels de la croissance avant
la crise.
Le rebond de la confiance est donc marqué, non
seulement dans le pays mais aussi sur les marchés
financiers. On peut espérer que cette confiance contribue
à stabiliser le cycle de croissance turque. C’est également
un point positif pour les ratings car c’est un facteur de
résistance face aux chocs externes.
Graphique 7 – Turquie : une confiance des industriels et des
ménages
-65
-45
-25
-5
15
35
mars-08 oct.-08 mai-09 déc.-09 juil.-10 févr.-11
65
75
85
95
Confiance dans l'industrie manufacturière
Confiance des ménages (éch. d.)
pts de base pts de base
Sources : Turkstat, OCDE, Crédit Agricole S.A.
La confiance des agents est particulièrement importante
pour un pays qui est structurellement déficitaire, et dont le
change est également structurellement fragile. Mais elle
sera liée à la capacité de la Turquie à contenir son
inflation. En effet, le rebond des indicateurs de confiance
en 2010 s’explique par deux caractéristiques importantes
de l’environnement monétaire.
1.4 - L’épée de Damoclès : l’inflation
Tout d’abord, avec une hausse des prix de 4,2% en février
2011, soit le point le plus bas des quarante dernières
années, les Turcs ont à juste titre la sensation stimulante
de vivre une période d’inflation historiquement faible. Cette
situation est à mettre au crédit de la politique de ciblage
d’inflation imposée par le FMI en 2001. Cependant, la
confiance a également été entretenue de façon plus
artificielle par le niveau des taux réels après la crise : en
effet, la Banque centrale n’a pas pu gérer sa sortie du plan
de relance de façon orthodoxe, à cause de la politique de
« Quantitative easing » américaine, qui l’a empêchée de
monter les taux, au risque d’attirer trop de capitaux courts.
La donne va cependant changer en 2011, car
l’accélération des prix à la production en janvier (10,87%
en rythme annuel) annonce une plus forte inflation par les
coûts. L’indice de prix turc est très sensible à la hausse
des prix énergétiques5 et les prix alimentaires restent plus
5 Selon la Banque centrale, les prix énergétiques et alimentaires
ont contribué à la moitié de la hausse de l’indice des prix en 2010.
volatils que dans d’autres pays émergents6 – à cause de la
concentration de la production, de l’impact fort du climat, de
la mauvaise organisation des marchés et d’une trop grande
imprévisibilité des subventions de l’Etat. Reste que l’inflation
sous-jacente est parvenue à des niveaux historiquement
bas et que le taux d’utilisation des capacités de production
ne revient que lentement aux niveaux d’avant crise. Tout
cela a donné une vraie marge de manœuvre à la politique
monétaire fin 2010, pour lutter contre l’afflux de capitaux
courts. Mais en 2011, les marchés redeviennent très
sensibles à la question inflationniste, après avoir un temps
acheté la croissance turque. La volatilité du change s’accroît
sur le début de l’année.
Graphique 8 – Turquie : après la reprise, des taux directeurs
qui restent trop bas
1
5
9
13
17
21
janv-
08
mai-
08
sept-
08
janv-
09
mai-
09
sept-
09
janv-
10
mai-
10
sept-
10
janv-
11
Taux overnight Inf lation
%
Sources : CBRT, SIST, Crédit Agricole S.A.
Graphique 9 – Turquie : la convergence des taux d’inflation
nominaux et sous-jacents
20
30
40
50
60
70
80
90
janv-07
juin-07
nov-07
avr-08
sept-08
févr-09
juil-09
déc-09
mai-10
oct-10
0
2
4
6
8
10
12
14
taux d'utilisation des capacités industrielles (éch gauche)
CPI ( éc h dte)
Inflation sous jacente (éch dte)
en %
Sources : Turkstat, OCDE, Crédit Agricole S.A.
Des anticipations de marché plus optimistes sur
la qualité de la croissance turque
En 2010, le retour de la confiance a été particulièrement net
sur les marchés financiers. L’OCDE a étudié l’évolution du
spread souverain turc sur longue période7, en le comparant
à celui d’autres pays émergents (Brésil, Bulgarie, Chili,
Hongrie, Malaisie, Mexique, Pologne, Afrique du Sud). Cette
analyse montre que la Turquie souffrait historiquement d’un
déficit de crédibilité qu’elle payait par une prime de risque
supplémentaire, y compris pendant la phase de croissance
des années 2000. Cet handicap structurel semblait lié en
premier lieu au risque politique8 mais aussi à l’instabilité des
6 Öğünç, F. (2010), "Volatility of Unprocessed Food Inflation in
Turkey: A Review of the Current Situation", CBRT Economic Notes
No. 10/05.
7 OCDE economic survey, sept 2010, country report.
8 Les spreads souverains des émergents sont influencés par un
nombre restreint de facteurs, parmi lesquels le risque politique ainsi
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%