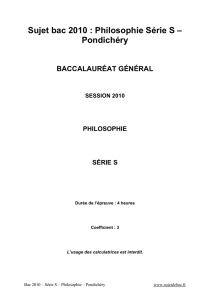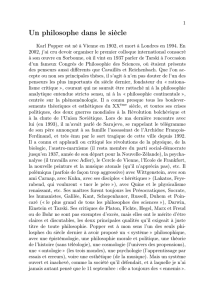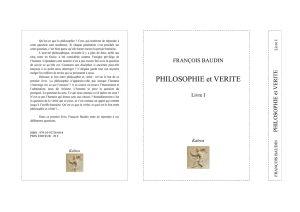Qu`est-ce que connaître

Philosophie des sciences Plan du cours Page 1/48
Qu’est-ce que connaître, en science ?
Un exemple : Semmelweis
Comment procède les sciences pour expliquer et connaître ? Commençons par un exemple,
emprunté à Carl Hempel.
Ignace Semmelweis, médecin d’origine hongroise, réalisa ses travaux à l’hôpital général de
Vienne de 1844 à 1848. Comme médecin attaché à l’un des deux services d’obstétrique – le
premier – de l’hôpital, il se tourmentait de voir qu’un pourcentage élevé des femmes qui y
accouchaient contractaient une affection grave et souvent fatale connue sous le nom de fièvre
puerpérale. En 1844, sur les 3157 femmes qui avaient accouché dans ce service n° 1, 260, soit
8,2 %, moururent de cette maladie ; en 1845 le taux de mortalité fut de 6,4 % et en 1846 il
atteignit 11,4 %. Ces chiffres étaient d’autant plus alarmants que, dans l’autre service
d’obstétrique du même hôpital, qui accueillait presque autant de femmes que le premier, la
mortalité due à la fièvre puerpérale était bien plus faible : 2,3, 2 et 2,7 % pour les mêmes
années.
Il commença par examiner différentes explications qui avaient cours à l’époque : « influences
épidémiques », entassement, blessures, explications psychologiques, accouchement sur le dos,
empoisonnement du sang.
Semmelweis mit alors son idée à l’épreuve. Il trouva aussi plusieurs confirmations
supplémentaires de son hypothèse.
Vérité et déduction
Une des lointaines origines de la science, telle que nous la connaissons, se situe en Grèce.
Platon affirme que c’est le divin qui est la mesure de toute chose : il y a une vérité absolue,
indépendante de nous, et que nous connaissons plus ou moins bien. Connaître, pour Platon,
c’est partir de l’opinion communément admise (mélange de vérité et d’erreur, de savoir et de
croyance) pour en éliminer les erreurs et en dégager ainsi la science.
Platon se méfie des sciences de la nature, puisque celle-ci est une apparence. L’idéal du
savoir, pour lui, ce sont les sciences mathématiques, pures car formelles.
Contrairement à Platon, Aristote est un physicien, un biologiste et un logicien. Il est le
premier à avoir classé les différentes formes de discours, et à avoir formalisé le raisonnement
scientifique. On lui doit le modus ponens, qui est une technique permettant de passer d’une
affirmation générale à un cas particulier. Par exemple :
•Majeure : Tous les humains sont mortels.
•Mineure : Tous les Grecs sont des humains.
•Conclusion : Tous les Grecs sont mortels.
Retenons de l’Antiquité (1) l’idée qu’il existe une vérité indépendante de nous, mais qui nous
est accessible ; (2) que la science est un discours formalisé, plus précis que l’opinion
commune.

Philosophie des sciences Plan du cours Page 2/48
Empirisme et induction
La déduction passe du général au particulier. L’induction fait l’inverse : on y passe du
particulier au général.
A.B. Wolfe a résumé cette conception inductiviste : Essayons d’imaginer un esprit d’une
étendue et d’une puissance surhumaines, mais dont la logique soit semblable à la nôtre. S’il
recourait à la méthode scientifique, sa démarche serait la suivante : en premier lieu, tous les
faits seraient observés et enregistrés, sans sélection, ni évaluation a priori de leur importance
relative. En second lieu, les faits observés et enregistrés seraient analysés, comparés et
classés, sans hypothèses ni postulats autres que ceux qu’implique nécessairement la logique
de la pensée. En troisième lieu, de cette analyse des faits, seraient tirés par induction des
énoncés généraux affirmant des relations de classification ou de causalité entre ces faits.
Quatrièmement, les recherches ultérieures seraient déductives tout autant qu’inductives, et
utiliseraient les inférences tirées d’énoncés généraux antérieurement établis.
Cette conception inductiviste a été théorisée par l’Anglais John Locke (1632-1704). Elle est à
la base de l’empirisme. Contre Descartes, Locke pense que toutes les idées dérivent de
l’expérience, même celles qui semblent innées.
N’en déplaise à Locke et à Wolfe, cette conception est fausse. L’observation ne peut pas être
le point de départ de la science. Pourquoi ?
1. Tout d’abord, il est impossible de réunir tous les faits.
2. Pour la même raison, il est impossible de classer des données sans postulat.
3. L’induction n’est pas une procédure mécanique : il y a nécessairement un saut
qualitatif entre « beaucoup » et « tous ».
David Hume (1711-1776) est le premier à avoir attiré l’attention sur ce problème de
l’induction. Du point de vue logique, il souligne que l’induction ne peut mener à la certitude :
ce n’est pas parce que le principe de l’induction a donné de bons résultats dans un grand
nombre de cas qu’il fonctionnera toujours ! Par conséquent, nous ne pouvons pas être certains
de la vérité des lois de la science.
Et pourtant, nous ne pouvons pas nous empêcher de croire à nos lois, et en tout cas à la
régularité des phénomènes de notre monde. Il y a là une raison psychologique, précise Hume :
l’habitude. Dans la première partie du Traité de la nature humaine – rédigé entre 1735 et
1737 mais publié en 1739 et 1740 –, Hume explique que nos idées se combinent entre elles
selon trois lois d’association : la ressemblance, la contiguïté dans l’espace et le temps, la
relation de cause à effet.
Quelques solutions ont été proposées pour résoudre le problème de l’induction :
•Au XIXe siècle, John Stuart Mill proposait d’admettre un principe d’uniformité du
cours de la nature.
•Thomas Bayes établit en 1763 une méthode pour calculer la probabilité subjective des
hypothèses (c’est-à-dire le degré de croyance que l’on est en droit d’accorder à une
hypothèse).
•Une autre manière non pas de résoudre mais d’envisager le problème de l’induction
est de réfléchir en terme de probabilités objectives. Pour Hans Reichenbach, qui
propose cette solution, l’induction n’est pas tant une forme d’inférence qu’une
méthode permettant de parvenir à des hypothèses, concernant, par exemple la

Philosophie des sciences Plan du cours Page 3/48
proportion de A qui sont des B. Ces hypothèses ne sont pas vraies, mais sont des
sortes de paris, comme ceux que fait un joueur, sur l’état de la nature.
Falsificationnisme
Dans les années 1920, un philosophe va tenter une autre approche, pour contourner le
problème : Karl Popper. Son idée, très simple, est que la science ne doit pas trouver le vrai (ce
qui est impossible, en vertu du problème de l’induction) mais s’éloigner du faux.
Pour cela, Popper se réfère à une maxime antique : « Du vrai il ne sort que du vrai ; du faux, il
peut sortir du faux ou du vrai ». (V V ; F V ou F).
Ce mode de raisonnement a été formalisé dès l’Antiquité, sous le nom de modus tollens :
•Si H est vrai, I est vrai aussi.
•Les faits montrent que I est faux.
•Par conséquent, H est faux.
Là où les approches classiques cherchent le vrai, Popper cherche le faux. Cette stratégie prend
toute son importance quand il s’agit d’examiner plusieurs théories explicatives concurrentes.
Sans une solution au problème de l’induction, nous sommes incapables de décider quelle
théorie est vraie (ou la plus vraie). Mais la recherche de la fausseté nous permet d’éliminer
certaines théories.
Popper affirme que le premier pas de la connaissance n’est pas l’observation (nous ne
sommes pas un seau vide ou une table rase) mais l’imagination. Le chercheur imagine des
conjectures, des hypothèses. Dans un deuxième temps, il teste ces conjectures grâce à des
expériences. Et il essaie de réfuter, de falsifier, ses hypothèses. D’où le titre d’un ouvrage de
Popper, Conjectures et réfutations.
Ces considérations ont amené Popper à considérer que les êtres vivants raisonnent eux aussi
par essais et erreurs : la principale différence entre Einstein et une amibe, c’est qu’Einstein
recherche consciemment l’élimination de l’erreur.
La méthode de falsification ne permet donc pas d’établir avec certitude si une théorie est vraie
(elle peut seulement dire qu’à un instant donné t, une théorie n’est pas falsifiée). Elle ne peut
même pas donner une direction de recherche, c’est-à-dire d’acheminer automatiquement vers
la vérité. En outre, le nombre de théories proposées est toujours fini, et il se pourrait
(théoriquement) que toutes soient réfutées sans que nous puissions en imaginer une nouvelle.
D’autre part, parmi les différentes théories en concurrences, il se peut que plusieurs ne soient
pas réfutées.
Tout ceci dévoile une nouvelle image de la science, très éloignée de la conception cartésienne
d’une science sûre et véridique. La science, dit Popper, n’a pas de fondement infaillible. Elle
est comme bateau en pleine mer, qu’il faut réparer au coup par coup sans jamais pouvoir
accoster.

Philosophie des sciences Plan du cours Page 4/48
Base empirique, hypothèses et expériences cruciales
La théorie de Popper n’est pas exempte de problèmes.
1. Elle se veut une logique de la découverte scientifique, et pas une description historique
du développement de la science.
2. Si on appliquait le falsificationnisme à la lettre, presque toute théorie serait réfutée dès
sa naissance.
3. Problème de la base empirique.
4. Les défenseurs d’une théorie attaquée peuvent aussi chercher à immuniser leur théorie
par des hypothèses complémentaires.
Illustrons ces problèmes par un exemple, emprunté à
nouveau à Carl Hempel, celui des expériences de Torricelli
et de Pascal sur la pression de l’air. Comme on le savait à
l’époque de Galilée, et sans doute bien avant, une simple
pompe, qui aspire l’eau d’un puits au moyen d’un piston qui
s’élève à l’intérieur du corps de la pompe, ne fera pas monter
l’eau à plus de 10 mètres 33 au-dessus de la surface du puits.
Après la mort de Galilée, son disciple Torricelli avança une
solution. La Terre, raisonnait-il, baigne entièrement dans un
océan d’air qui, en raison de son poids, exerce une pression
sur la surface de la Terre ; et, quand celle-ci s’exerce sur la
surface de l’eau d’un puits, elle fait monter cette eau dans le
corps de la pompe si l’on élève le piston. La hauteur
maximum de 10 mètres 33 de la colonne d’eau dans le corps
de la pompe correspond simplement à la pression totale de
l’air atmosphérique sur la surface de l’eau du puits.
Torricelli pensa que si sa supposition était vraie, la pression
de l’atmosphère serait aussi capable de faire contrepoids à
une colonne de mercure proportionnellement plus courte.
Pascal eut l’idée d’une autre implication de cette hypothèse que l’on pourrait vérifier. Si le
mercure du baromètre de Torricelli, raisonnait-il, fait contrepoids à la pression de l’air sur la
surface libre de la cuve à mercure, sa hauteur devrait décroître quand l’altitude augmente,
puisque le poids de l’air au-dessus de la cuve devient plus faible. A la demande de Pascal,
cette implication fut examinée par son beau-frère, Périer : il mesura la hauteur de la colonne
de mercure dans le baromètre de Torricelli au pied du Puy-de-Dôme.
Avant que Torricelli n’introduisît sa conception de la pression d’un océan d’air, on expliquait
l’action de la pompe aspirante par l’idée que la nature a horreur du vide. Quand Pascal écrivit
à Périer pour lui demander de réaliser l’expérience du Puy-de-Dôme, il allégua que le résultat
qu’il en attendait constituerait une réfutation décisive de cette conception. Mais Pascal
supposait acquise l’hypothèse auxiliaire suivant laquelle l’intensité de cette horreur est
indépendante du lieu.
L’exemple de Torricelli-Pascal nous montre que les hypothèses ne viennent jamais seules et
qu’une partie importante du travail scientifique consiste à isoler les hypothèses que l’on veut
tester, autrement dit à s’assurer qu’il n’y a pas de variables cachées ou parasites.
Prenons un autre exemple, qui a eu des conséquences historiques importantes. L’astronome
Tycho Brahé, dont les observations précises fournirent à Kepler la base empirique de ses lois

Philosophie des sciences Plan du cours Page 5/48
du mouvement des planètes, rejetait la conception copernicienne du mouvement
héliocentrique de la Terre. Il en donnait, parmi d’autres raisons, la suivante : si l’hypothèse de
Copernic était vraie, la direction dans laquelle un observateur terrestre aperçoit une étoile fixe
à un instant déterminé de la journée devrait changer progressivement. Mais l’implication
vérifiable selon laquelle on peut observer que les étoiles fixes ont des mouvements
parallactiques ne peut être dérivée de l’hypothèse de Copernic que si on lui adjoint la
supposition auxiliaire que les étoiles fixes sont si proches de la Terre que leurs mouvements
parallactiques sont assez grands pour être décelés par les instruments dont Brahé disposait.
Ces considérations font saisir combien est grande la difficulté de mettre au point une
expérience cruciale. Une expérience cruciale est une expérience qui permet de trancher, de
manière décisive, entre deux théories rivales.
Les expériences sont donc souvent moins cruciales qu’on aimerait le croire. On peut même
dire qu’aucune expérience, à elle seule, ne peut permettre de rejeter une hypothèse. Les
scientifiques doivent décider de tenir compte (ou non) du résultat d’une expérience. En fait,
c’est toujours par rapport à une théorie et à des hypothèses qu’une expérience est cruciale ou
non. Accepter le résultat d’une expérience, ce n’est que très rarement renoncer à une
hypothèse. La plupart du temps, c’est remodeler un ensemble d’hypothèses et de propositions
plus ou moins théoriques, ce qui implique parfois de modifier la « vision » que l’on a du
domaine scientifique.
Prenons un autre exemple exprimant bien la nécessité de changer de « vision du monde » : la
découverte de l’oxygène. Un apothicaire suédois, Scheele, fut le premier à produire un
échantillon d’oxygène, mais sa découverte ne fut publiée que longtemps après. En 1774,
l’Anglais Joseph Priestley identifie ce qu’il commence par nommer du « protoxyde d’azote »,
avant d’y voir, l’année suivante, de l’air commun mais débarrassé d’une partie de sa quantité
de phlogistique. Le Français Lavoisier, toujours en 1775, décrivit le gaz obtenu en chauffant
l’oxyde rouge de mercure comme de l’air pur, plus respirable ; en 1777, il conclut que
l’oxygène était un corps distinct, un des principaux composants de l’atmosphère.
Thomas Kuhn pense qu’aucune expérience n’est jamais cruciale, parce que les expériences
sont toujours liées à des théories. Cette idée a été développée par le Français Pierre Duhem
puis reprise par l’Américain Willard Van Orman Quine. Elle est connue sous le nom de thèse
de Duhem-Quine ou sous celui de « holisme » (holos = tout).
Exemple : les zèbres du Serengeti. Lecture du texte avec des questions :
1. Quelle hypothèse les auteurs du texte veulent-ils démontrer ?
2. Sur quels faits s’appuient-ils ?
3. Montrez, dans le texte, le type d’argumentation utilisé (inductivisme ?
Falsificationnisme ?...).
4. L’hypothèse des auteurs leur semble-t-elle prouvée ? (Relevez dans le texte le
passage vous permettant de répondre à la question).
5. L’hypothèse des auteurs vous semble-t-elle prouvée ? Pourquoi ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
1
/
48
100%