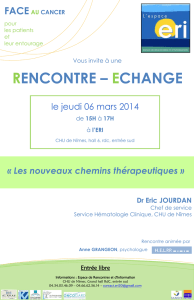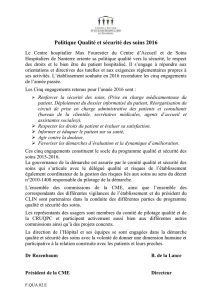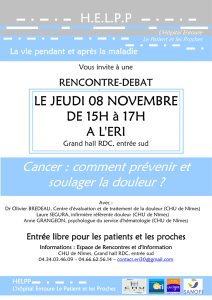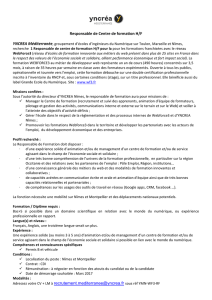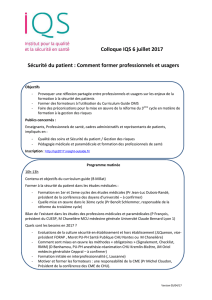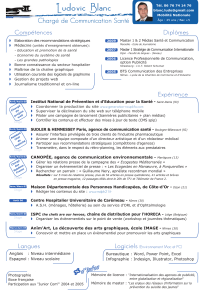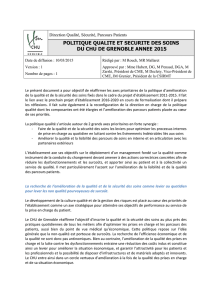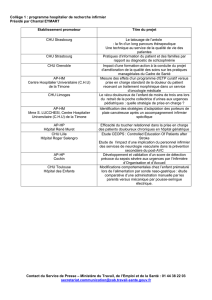projet d`établissement

projet d’établissement
le
patient
au cœur du
2012-2016
Depuis plus de dix ans, le mouvement législaf
inéchit manifestement la gouvernance
hospitalière dans le sens d’une médicalisaon du
pilotage : le
, au cœur
du management hospitalier, la substuon d’un
directoire majoritairement médical à un comité
exécuf paritaire pour conseiller le directeur dans
ses décisions, le renforcement des responsabilités
des chefs de pôle d’acvité clinique et médico-
technique en sont autant de traducons.
Ces évoluons autorisent une plus grande
diversité des formes de la collégialité médicale
.
L’enjeu du projet de gouvernance du CHU, à
parr du nouveau cadre issu de la loi HPST,
est d’organiser un système de management
cohérent qui permee la meilleure mise en
, conçu comme
un projet intégré de prise en charge du paent, et
de ses déclinaisons.
L’agencement des niveaux stratégiques et
doit être
de la solidarité entre les acteurs hospitaliers : la
mise en place de réels
, à chaque niveau de l’instuon,
en constue la ligne directrice.
Le CHU de Nîmes s’inscrit dans cet objecf en
au-
delà des aendus législafs : la créaon du
collège des chefs de pôle, pour accompagner
les poliques opéraonnelles, ainsi que
de délégaons et commissions médico-
administraves donne une portée très concrète à
cee volonté instuonnelle.
Corollairement, il convient d’être vigilant à la
repenser la conduite de projet de façon à en
faire un élément véritablement structurant de
l’organisaon instuonnelle.
2
Livre deuxième
La gouvernance pour conjuguer
réactivité et concertation
55
centre Hospitalier régional universitaire de nîmes
la gouvernance pour conjuguer réactivité et concertation
2

projet d’établissement
le
patient
au cœur du
2012-2016
en évitant la confusion avec les compétences de
Le directoire, qui exerce la mission de conseil
du directeur dans la geson et la conduite de
l’établissement, constue une instance de pilotage
médico-stratégique composée de 9 membres,
dont au moins 5 issus du personnel médical,
pharmaceuque, maïeuque et odontologique.
Le CHU de Nîmes a fait le choix de médicaliser
davantage le directoire en portant sa composion
médicale à 6 membres, de façon à permere la
présence, aux côtés du président de CME (premier
vice-président), du vice-président doyen et du
vice-président recherche, d’un représentant des
chefs de pôle, d’un représentant des médecins
hospitaliers et d’un représentant des disciplines
transversales.
Clairement inves du pilotage stratégique de
l’établissement, à travers sa mission de conseil
auprès du directeur général, le directoire
possède également des compétences propres
au tre desquelles il a approuvé le projet
médical 2011-2016 du CHU de Nîmes et préparé
le projet d’établissement : il dénit ainsi la
stratégie médicale et la polique de geson
instuonnelles, et est appelé à ce tre à suivre
les contrats de pôle.
Parallèlement, la loi HPST a considérablement
élargi les compétences de la Commission
à tous les secteurs
de l’
la qualité des soins ainsi que des
.
Composée, de droit, de l’ensemble des chefs de
pôle d’acvité clinique et médico-technique,
ainsi que de représentants élus des responsables
de structure interne, des praciens enseignants
et hospitalier, des praciens hospitaliers et des
personnels médicaux non tulaires,
qui est à la fois consultée et informée dans
tous les domaines de la vie de l’établissement
(organisaon, invesssements, nancement).
complémentaires des missions dévolues au
directoire, au président de CME et au directeur
selon les modèles de chaîne de décision dénis
par la loi HPST et ses décrets d’applicaon :
• Projet d’établissement : préparaon (directoire)
– consultaon (CME) – délibéraon (conseil de
surveillance),
• Convenon constuve HU, statuts des
fondaons hospitalières : consultaon (CME) –
délibéraon (conseil de surveillance),
• Projet médical : élaboraon (directeur et
président de CME) - approbaon (directoire) –
consultaon (CME),
• Programme d’acon qualité : élaboraon
(CME) – concertaon (directoire) – décision
(directeur et président de CME),
• Autres domaines (EPRD, programmes
d’invesssement biomédicaux, polique
d’intéressement, règlement intérieur) :
concertaon (directoire) – élaboraon
(directeur) - consultaon (CME) – décision
(directeur).
Cee arculaon, très précisément formalisée par
les textes, permet de lever toute confusion entre
les instances concernées tout en enrichissant et
en médicalisant le processus de décision polique.
et au directoire par la loi, le CHU de Nîmes a
de la vie hospitalière (cf. infra).
2.1 Directoire et CME :
deux instances complémentaires
56
centre Hospitalier régional universitaire de nîmes 2
.1 directoire et cme : deux instances complémentaires

projet d’établissement
le
patient
au cœur du
2012-2016
Dans le cadre de la nouvelle gouvernance, le
CHU de NIMES a mis en place, n 2006, 10 pôles
cliniques et médico-techniques. A l’issue d’une
phase d’évaluaon, un onzième pôle, centré sur la
lière gérontologique, a été créé en janvier 2009.
Tous se sont dotés d’un bureau et d’un conseil
de pôle conformément à la législaon alors en
vigueur.
Avec la loi HPST, l’organisaon interne en pôles
a été conrmée et les chefs de pôle se sont vus
confortés dans leurs missions et responsabilités.
Aux termes de la loi, le chef de pôle d’acvité
clinique ou médico-technique se voit aribuer
une mission générale de mise en œuvre de la
polique d’établissement an d’aeindre les
objecfs xés au pôle.
Il est également chargé d’organiser le
fonconnement du pôle et l’aectaon des
ressources humaines en foncon des nécessités
de l’acvité et compte tenu des objecfs
prévisionnels du pôle. Cee mission d’organisaon
s’exerce :
• avec les équipes médicales, soignantes,
administraves et d’encadrement du pôle, sur
lesquelles il a autorité fonconnelle,
• dans le respect de la déontologie de chaque
pracien et des missions et responsabilités des
structures – services ou unités fonconnelles –
prévues par le projet de pôle.
Les compétences managériales sont donc au
cœur de la foncon de responsable de pôle,
qu’elles soient stratégiques ou opéraonnelles.
Selon le , les chefs de
service et d’unité sont invess de responsabilités
managériales spéciques, à l’échelle de la
structure interne, qu’il apparent à chaque projet
de pôle de préciser.
Plus globalement, il conviendra de mener une
dévolues aux
praciens – responsabilité exercée sur la discipline,
responsabilité organisaonnelle, responsabilité
clinique – ainsi que sur l’arculaon des
d’enseignant, de chercheur et de clinicien. Ce
travail de claricaon des rôles parcipe d’une
meilleure structuraon de la vie en équipe et du
fonconnement du pôle.
Le chef de pôle a en charge l’élaboraon du
projet de pôle, dans le respect des orientaons
stratégiques de l’établissement et coordonne à ce
tre l’acon des structures internes du pôle et ses
instances.
Il lui apparent en parculier de décliner le
projet médical et le projet d’établissement qui
l’accompagne au niveau de son pôle, dans toutes
leurs dimensions (recherche, acvité clinique,
parcours et organisaon des soins, qualité et
sécurité, poliques clientèle et partenariats,
ressources humaines médicales et non médicales,
logisque, équipements et travaux, contrôle de
geson, opmisaon des recees et des coûts,
système d’informaon, communicaon…).
Le sens de ce pilotage est de permere l’ecacité
collecve, nécessaire à l’aboussement des
projets portés par les acteurs internes du pôle
(services, unités, équipes, responsables médicaux
et cadres).
La constue la clé de cee
: l’objecf est de créer les
condions d’une organisaon transversale des
compétences en cohérence avec le parcours de
soins du paent.
2.2 Les pôles hospitalo-universitaires,
structures de politique opérationnelle
57
centre Hospitalier régional universitaire de nîmes 2
.2 les pôles hospitalo-universitaires, structures de politique opérationnelle

projet d’établissement
le
patient
au cœur du
2012-2016
En conséquence, le chef de pôle est inves
d’une double mission de développement des
:
• les partenariats internes pourront prendre la
forme de contrats de fonconnement, axés
sur la dénion des besoins du paent, en lien
avec son chemin clinique, les objecfs visant à
y répondre et les règles de bonnes praques
s’y raachant.
• les partenariats externes viseront à structurer
le parcours territorial de soins du paent dans le
cadre de la mission régionale et interrégionale
du CHU et des coopéraons existantes avec les
autres établissements publics ou privés de la
région ou du territoire, et en conformité avec
les orientaons stratégiques instuonnelles.
Ce rôle d’ambassadeur du pôle s’exercera en
parculier dans le cadre de la mise en œuvre du
projet médical de la Communauté Hospitalière
de territoire et des Fédéraons Hospitalo-
universitaires Interhospitalières.
Le chef de pôle exerce une foncon d’animaon
en associant en tant que de besoin toutes les
catégories de méers. A ce tre, il préside le
bureau de pôle, organise la concertaon interne,
hiérarchise les priorités, gère les tensions et veille
à assurer la circulaon de l’informaon au sein du
pôle.
Il est également inves d’une mission de geson
et d’évaluaon, qui se traduit par :
• la coordinaon de l’ensemble des moyens
humains, matériels et nanciers du pôle
qui sont alloués dans le cadre d’une acvité
prévisionnelle et leur ajustement aux résultats,
avec l’appui du cadre de santé et du cadre
administraf de pôle et en lien avec les pôles
de geson concernés,
• la dénion, dans le cadre de la délégaon de
geson, des priorités en maère de geson
du personnel médical en liaison avec la
communauté médicale du pôle, ainsi qu’en
maère de geson du personnel non médical
et de formaons avec le cadre supérieur de
santé,
• le développement des démarches et ouls
de type conduite de projet, en impliquant les
professionnels médicaux et non médicaux
concernés.
58
centre Hospitalier régional universitaire de nîmes 2
.2 les pôles hospitalo-universitaires, structures de politique opérationnelle

projet d’établissement
le
patient
au cœur du
2012-2016
Indépendamment des ressources du pôle, le chef
de pôle dispose d’un oul pour mener à bien ses
missions : le contrat, qui repose sur un projet de
pôle (dimension stratégique) et une délégaon
de signature (dimension opéraonnelle), en
contrepare d’objecfs assignés au pôle et
évalués à l’aide d’indicateurs spéciques.
En complément, un collège des chefs de pôle a
été mis en place au mois de mars 2011 de façon
à associer plus étroitement ces derniers à la mise
en œuvre, à l’évaluaon et à l’ajustement des
diérentes poliques fonconnelles (recherche,
acvité clinique, parcours et organisaon des
soins, qualité et sécurité, poliques clientèle et
partenariats, ressources humaines médicales
et non médicales, logisque, équipements et
travaux, contrôle de geson, opmisaon des
recees et des coûts,
système d’informaon,
communicaon…).
Composé du directeur
général et du directeur
général adjoint, du
président de CME, de l’ensemble des 11 chefs
de pôle d’acvité clinique et médico-technique
et des 3 directeurs coordonnateurs de pôle de
geson, ce collège se réunit à la demande du
directeur général.
Il a pour mission de conforter la mise en œuvre
démarche projet – en parculier s’agissant des
projets transversaux - et d’informer le directeur
général et le président de CME de toutes dicultés
constatées dans cee mise en œuvre.
Les travaux des chefs de pôle, assisté du cadre
de santé de pôle et du cadre administraf de
pôle, s’appuient sur les équipes collégiales de
pôle – responsables médicaux, cadres de santé
– ainsi que sur les sous-commissions médico-
administraves (cf. infra).
, à travers
le développement de la communicaon interne
(assemblée générale des médecins, newsleer
médicale), des disposifs d’intégraon des
jeunes médecins et des formaons proposées
aux responsables de pôle et de structure interne
(formaons au pilotage médico-économique, au
management d’équipe, etc.).
Les acons détaillées dans le livre trois
(cf. Personnel médical et vie instuonnelle : les
voies de progrès) parcipent pleinement de cet
objecf.
Fondamentalement, le contrat de pôle doit être
compris comme un moyen de co-construire la
mise en œuvre du projet médical.
En eet, l’esprit de la contractualisaon n’est
pas l’autonomie mais la solidarité : la délégaon
de signature doit avoir
pour objecf de doter le
chef de pôle de leviers
renforcer la qualité du
service rendu.
En ce sens, l’objecf n’est pas de redistribuer aux
pôles des missions administraves assumées par
des direcons fonconnelles qui disposent de
toutes les compétences et experses nécessaires.
Il s’agit d’abord de donner aux chefs de pôle les
moyens de mere en place une
qui leur permee de gérer au
(maîtrise des
organisaons et des ressources qui leur sont
aectées).
Une
signés entre décembre 2008 et la n du premier
semestre 2009 s’est structurée autour de trois
volets :
• Le projet de pôle (objecfs soins, enseignement,
recherche) ;
• La qualité et la sécurité des soins ;
• La geson (geson des moyens du pôle,
données nancières).
L’évoluon du système de management implique
l’élaboraon, en 2012, de contrats de pôle de
, dont la trame-type donnera
Le contrat de Pôle :
outil de mise en œuvre
du projet médical
59
centre Hospitalier régional universitaire de nîmes 2
.2 les pôles hospitalo-universitaires, structures de politique opérationnelle
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%