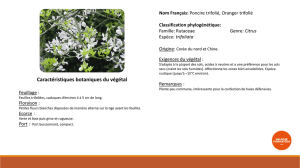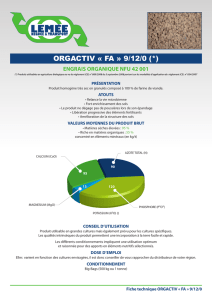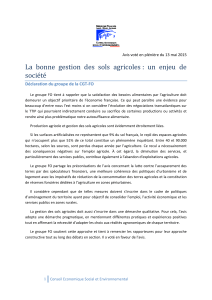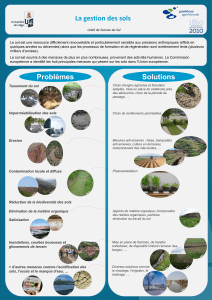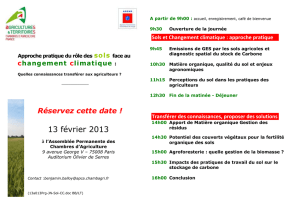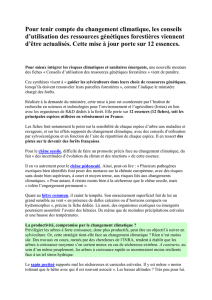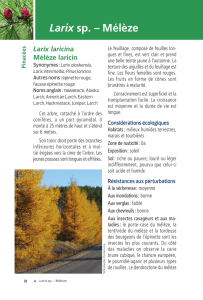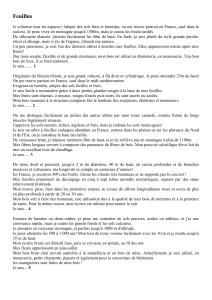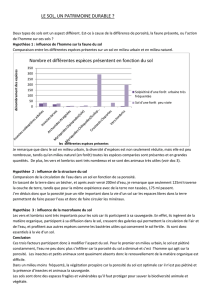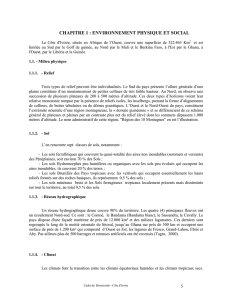II. - PEDOLOGIE ET FACTEURS BIOTIQUES

Etudes
sur
l'Ecologie
et la Sylviculture
du
Mélèze
(Larix europeea
D.
C.)
II.
- PEDOLOGIE
ET FACTEURS BIOTIQUES
PAR
Ph.
DUCHAUFOUR
Docteur ès
Sciences
Ingénieur
des Eaux et
Fore.ts

.

CHAPITRE
I
CONSIDERATIONS
GENERALES
LES
METHODES
Dans l'étude publiée d'autre part, M. l'Ingénieur FouRcxv a
traité le problème d'ensemble de l'Aire et de l'Ecologie du Mélèze:
Les questions climatiques ont retenu tout particulièrement son atten-
tion. En outre, des conclusions pratiques, relatives â la sylviculture
du Mélèze ont pu etre formulées.
Dans cette seconde partie, nous nous placerons un point de vue
différent; nous étudierons plus spécialement les facteurs pédologi-
mies et b'otiques. Ces deux groupes de facteurs ne peuvent être
séparés, ils se conditionnent mutuellement: l'évolution du sol est, en
effet, étroitement liée à. celle de la végétation et l'action du pâtu-
rage, si importante en montagne, influence de faon profonde l'une
et l'autre.
D'autre part, l'état du sol et la nature de la végétation en surface
sont les facteurs essentiels qui régissent la
régénération
du Mélèze:
c'est surtout ee problème de la régénération que nous avons envisa-
gé dans cette seconde partie, en essayant d'y apporter quelque clarté
par l'application des méthodes modernes de la pédologie, ce qui n'a
pas encore été fait en
France.
Par contre, certains travaux suisses
récents nous ont fourni. ce point de vue, une documentation im-
portante [HEss 37 - LUDI 45 -
AUER
2].
Notre méthode, très sirnple, a consisté
repérer sur le terrain
des stations voisines,
disposées par paires,
l'une dans laquelle les
semis de Mélèze étaient nombreux, l'autre où ils étaient inexistants.
Ces stations étaient choisies de faon â, ne différer entre elles que
par
Setil
facteur écologique si possible, par exemple: pente, in-
tensité du pâturage, ou nature de la végétation .
Une cinquantaine de stations a été ainsi passée minutieusement
en revue et, parmi celles-ci, 34 jugées particulièrement démonstra-
tives ont fait l'objet d'une étude complète, écologique, pédologique
et
floristique.

136
PÉDOLOGIE ET FACTEURS BIOTIQUES DU MÉLÈZE
Comme on l'a vu dans l'article de P.
FOURCHY
publié d'autre
part, le Mélèze est une essence assez plastique, relativement au cli-
mat. Il était donc nécessaire de choisir les stations d'étude en des
points variés de l'aire de cette essence, de façon dégager nette-
ment l'influence des conditions de sol, de celle du climat et du micro-
climat. C'est la raison pour laquelle nous avons prospecté aussi bien
les
Mélézeins
des vallées de la zone interne des Alpes septentrio-
nales (Maurienne
-
Oisans) que ceux des régions intérieures des
Alpes méridionales (Briançonnais, Oueyras,
Col de Vars, Vallées
des Alpes-Maritimes). Les stations ont été choisies presque toujours
dans l'étage subalpin,
à.
exposition fraîche. Cependant le Mélèze des-
cend parfois dans l'étage montagnard et,
à.
titre de comparaison,
quelques relevés floristiques
accompagnés de prélèvements de sols
ont
été
effectués dans cet étage
:
Dans les Alpes du Nord, les Alpes-
Maritimes, il
s'ag,it
alors de l'étage montagnard supérieur, humide,
caractérisé surtout par
l'Epicéa.
Dans les Alpes méridionales sè-
ches (Briançonnais, Queyras), c'est plutôt un étage montagnard
xérophile, oit domine le Pin sylvestre, accompagné des éléments les
plus montagnards du cortège du Chêne pubescent.
I.
— METHODES D'ETUDE
ET CLASSIFICATION DES SOLS
Les stations étudiées sont localisées sur des affleurements de ro-
ches-mères très différents, ce qui a permis d'utiles comparaisons.
Nous
disting,tierons
essentiellement deux grandes catégories de ro-
ches-mères
:
les roches-mères
silico-alumineuses,
pauvres en matières
minérales et en bases (schistes métamorphiques
permo-houillers,
grès
d'Annot,
gneiss, schistes rouges du permien, etc...) et les roches-
mères carbonatées, ou riches en éléments basiques, comprenant les
calcaires tendres du crétacé supérieur (Alpes-Maritimes), le
flysch
calcaire, les calcaires dolomitiques du trias oit domine le carbonate
de magnésie, enfin certains schistes lustrés et schistes cristallins.
Dans chaque station, le profil a été l'objet d'une étude morpho-
logique l'occasion de laquelle on a noté
:
la profondeur, l'impor-
tance de la couche humifère et la disposition des racines, la texture,
la structure, l'abondance et la
g,rosseur
des cailloux. S'il s'agit d'un
sol horizons différenciés, la description des horizons, bien entendu,
n'a
pas été négligée.
Les analyses ont porté sur les points suivants
:
Pour caractéri-
ser le sol au point de vue physique, on a mesuré la
porosité totale
et parfois la perméabilité sur place. La
porosité totale
a été calculée
par la méthode de la densité apparente
[DEMOLON - 19]
:
celle-ci
s'obtient en mesurant le poids de terre sèche contenue dans un
cy-

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
137
lindre
de dimensions standard, de 25o cm3, le prélèvement devant
se faire sans modification de la structure. A l'aide de la densité ap-
parente
D',
comparée la densité réelle
D,
on obtient aisément la
porosité : celle-ci est donnée par la
formule
D
—
D'
X wo.
D
Les quelques essais de perméabilité ont été également effectués sur
place l'aide du cylindre de BORGER, d'une section de Io() cm2,
enfoncé dans le sol de io cm, et qui permet de mesurer la vitesse
d'écoulement de litre d'eau.
La porosité totale exprime la valeur du volume des vides du sol,
en % du volume total. Il était utile de préciser cette notion de po-
rosité en faisant intervenir deux valeurs particulièrement impor-
tantes : la
porosité capillaire (ou
microporosité),
correspondant au
volume des canaux très fins, « capillaires » du sol ; et la
poro-
sité non capillaire (ou
macroporosité),
correspondant au vo-
lume des pores les plus grossiers. La porosité totale est donc la
somme de la porosité capillaire et de la porosité non capillaire. Ces
deux valeurs sont obtenues en étudiant le comportement de l'eau du
sol : L'eau d'infiltration, en effet, se divise en deux parties, une par-
tie qui s'écoule par gravité, qui circule dans les pores les plus vo-
lumineux du sol (eau de gravité) ; une autre partie qui est retenue
par les forces capillaires dans les pores les plus fins, même après
ressuyage énergique (eau capillaire). La porosité capillaire corres-
pondra donc au volume d'eau retenu par le sol (en % du volume
total) après saturation, puis « ressuyage » permettant l'élimination
•
de l'excès d'eau de gravité. Ce ressuyaf.,,e est obtenu au laboratoire,
soit par centrifugation, soit par filtration à. la trompe à vide sur filtre
en verre pilé (méthode de mesure de « l'humidité équivalente »
décrite par Bouvoucos). Cette humidité équivalente, exprimée en
volume, représente sensiblement le maximum d'eau retenue par ca-
pillarité, donc la porosité capillaire.
La porosité non capillaire est obtenue par différence entre la po-
rosité totale et la porosité capillaire. En période sèche, elle corres-
pond sensiblement à. la capacité en air du sol; après les pluies, elle
est occupée par « l'eau de gravite » qui s'écoule plus ou moins
rapi-
dement
et il est clair que
ta. perméabilité est en gros proportionnelle
cette porosité non capillaire:
c'est ce que M. l'Ingénieur BARTOLI
a pu vérifier en f aisant des essais de perméabilité dans la forêt d'Al-
banne (Savoie). Voici les résultats qu'il a obtenus, dans deux sta-
tions voisines, de même pente (2o-3o %):
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
1
/
73
100%