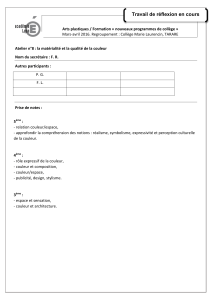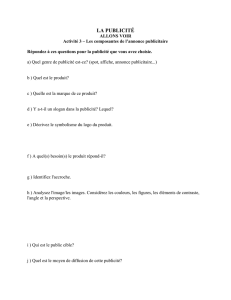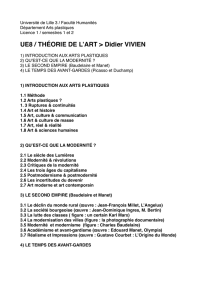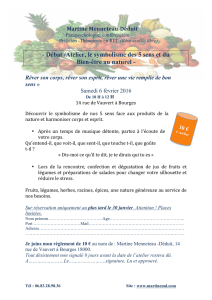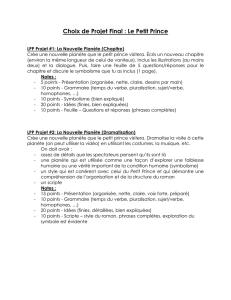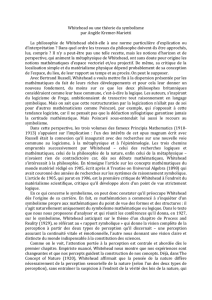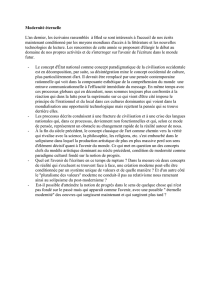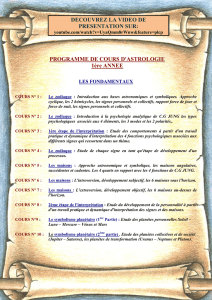Le symbolisme existe-t-il?

Le mot Symbolisme fait songer les uns d’obscurité, d’étrangeté, de
recherche excessive dans les arts; d’autres y découvrent je ne sais quel
spiritualisme esthétique, ou quelle correspondance des choses visibles
avec celles qui ne le sont pas; et d’autres pensent à des libertés, à des
excès qui menacent le langage, la prosodie, la forme et le bon sens. Que
sais-je? Le pouvoir excitant d’un mot est illimité. Paul Valéry1.
1) Commencement
Il est deux principes épistémologiques, connexes et généraux, valant pour toute
pensée qui cherche à connaître et définir un objet quel qu’il soit.
Premier principe : un objet n’est jamais donné. Un objet n’est jamais donné à
l’esprit comme une réalité toute faite qu’il aurait immédiatement à observer et à
explorer. Un objet est construit. Il est construit par l’esprit et devient de ce fait le
résultat d’un processus qui est l’ensemble des médiations par lesquelles la pensée
se donne à elle-même l’objet de sa propre intellection. Comme aucun objet n’existe
sur le mode du « déjà-là », on peut dire qu’il n’existe que des mouvements d’ob-
jectivation au terme desquels les objets de la pensée sont délimitables, définissables
et connaissables à l’extérieur d’elle, justement parce qu’elle les a fait sortir d’elle
et les a posés devant elle de manière à ce qu’ils deviennent véritablement et éty-
mologiquement des ob-jets. L’objet est donc un résultat patiemment advenu; il
n’est pas dévoilé d’un coup (révélé en quelque sorte), ou même trouvé; il est éla-
boré et construit méthodiquement, c’est-à-dire au sein d’un cheminement : ce che-
•1–Existence du symbolisme, repris dans Variété, in Œuvres, Bibl. de la Pléiade, Gallimard, 1957,
t. 1, p. 687.
Le symbolisme
existe-t-il ?
Introduction

minement sans véritable terme, toujours précaire et jamais définitivement acquis,
est celui de la connaissance.
Second principe. Si l’objet n’est pas séparable du processus d’objectivation en
quoi consiste la pensée, la méthode n’est pas non plus séparable de l’objectivation
même, c’est-à-dire du savoir. Il ne saurait y avoir de discours de la méthode anté-
rieur aux essais de cette méthode sous peine de courir le risque du formalisme, de
l’abstraction ou de la stérilité. La méthode n’est ni avant ni après le savoir. Ni
avant, parce qu’elle n’est pas un outil parfait de recherche ou un ensemble de règles
a priori auxquelles le savoir devrait se conformer. Ni après, parce qu’elle n’est pas
la vision rétrospective et parfaitement ordonnée d’un savoir qui se serait conquis
sans elle. Dans les deux cas, la méthode entretient avec le savoir une relation d’ex-
tériorité qui impose une discontinuité ou un impossible passage entre méthode
et savoir, entre savoir et méthode. Dans le premier cas et comme l’a montré Spinoza,
la recherche d’une méthode comme règle ou paradigme a priori et parfait du savoir
à venir, nous condamne à la stérilité d’une régression à l’infini2ou d’un scepti-
cisme radical3. Dans le second, comme l’a montré Hegel, la recherche d’une
méthode récapitulative et seulement réflexive est inutile ou dérisoire dans la mesure
où le savoir a déjà été produit. La méthode est ainsi contemporaine du savoir lui-
même. Elle est ce savoir4qui montre sa validité, non par sa conformité à des règles
préalables ou finales, mais par sa puissance de développement, par la nécessité
interne du contenu duquel elle n’est plus différente.
Ces deux principes préalables s’imposent à celui qui commence toute recherche,
et spécialement une recherche sur le symbolisme historique de la fin du XIXesiècle
en France, tant cet objet semble se dérober à des frontières stables. Il est néces-
saire de commencer par se guérir des deux illusions que l’on vient de souligner
quant au commencement lui-même : l’illusion d’un objet préexistant à son explo-
ration; l’illusion d’une méthode préexistant à sa mise en œuvre. Dans cette pers-
pective qui vaut dans les sciences, dans celles de l’homme plus que dans celles de
la nature puisque le rôle des mathématiques y est moins puissant, qui vaut en his-
toire de l’art comme en esthétique, constituer son objet c’est, en même temps,
constituer sa méthode : c’est, de ce fait, considérer comme dérisoires ou nuisibles
tous les préalables, toutes les préfaces dont Hegel dit, dans celle qu’il rédigea quand
même (et ironiquement)5pour la Phénoménologie de l’esprit, qu’elles sont « super-
• 2 – S’il faut une méthode pour connaître, alors il faut une méthode pour trouver cette méthode
et ainsi de suite à l’infini.
•3–Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement, trad. Appuhn, GF, 1979, t. 1, § 26, p. 189 et
§ 31, p. 194 et 195.
•4–Encyclopédie, trad. B. Bourgeois, Vrin, 1970, § 243, t. 1, p. 462-463.
•5–Voir Jacques Derrida, La Dissémination, Seuil, 1972, p. 9 sqq.
Introduction
- 18 -

flues6». Il n’y a pas pour la pensée de bon commencement qui la mettrait une
fois pour toutes sur des rails sûrs7. Si la pensée est une activité et non une repré-
sentation passive, elle ne peut rien faire d’autre que de déployer l’activité qu’elle
est en se mettant en œuvre. En se mettant en œuvre, elle ne peut rien faire d’autre
que de se mettre à l’épreuve. Or mettre à l’épreuve sa pensée, c’est la produire ou
la former en l’exerçant et en la réformant8. Tout en sachant deux choses : d’abord,
qu’il n’y a rien ni avant ni après cet exercice; ensuite, que le commencement est
toujours précaire, soit parce qu’on a déjà toujours commencé, soit parce que le
commencement doit être dépassé du fait de sa fragilité et de son imperfection en
tous points comparables à celles de ces « instruments naturels » dont parle Spinoza
qui sont certes très imparfaits mais sans lesquels les hommes, à grand-peine, n’au-
raient jamais appris à forger le fer ou à penser9. Il n’y a donc pas de commence-
ment absolu, pas de savoir originaire, pas de fondement inébranlable, pas de règle
a priori. Il n’y a surtout pas d’objet immédiat, trouvable ou constatable dans cette
immédiateté ou réalité mêmes. Ce par quoi il faut commencer, c’est donc par
« une épochè, par la mise entre parenthèses de la réalité10 ». Et cela est d’autant
plus nécessaire que la pensée s’attaque ici à ce que l’on désigne du terme de sym-
bolisme, terme dont la construction et le suffixe indiquent d’emblée une doctrine,
un corps de thèses articulées, une homogénéité qui serait celle d’une époque, d’une
école ou d’un style; bref d’une réalité dont la constitution, préalable à son explo-
ration et à son explication, passe pour évidente. Or, je voudrais montrer qu’il n’en
est rien et que l’évidence est, là comme ailleurs, trompeuse.
Telle est la raison de la mise en exergue du texte que Paul Valéry écrivit en 1936
afin de fêter le cinquantième anniversaire du Manifeste du symbolisme de Jean
Moréas. En effet ce texte, écrit de l’extérieur du symbolisme après que son auteur
l’a exploré de l’intérieur, nous met d’emblée au cœur du problème qui occupera
la totalité de mon travail : le problème de l’existence et de l’unité du symbolisme.
Celles-ci, déclare Valéry, sont douteuses au moins pour quatre raisons. D’abord à
cause de la signification du terme de symbole, multiple et fort générale : elle donne
lieu en conséquence à des variations plus ou moins imaginatives; elle est, selon le
mot de l’auteur de Charmes, « un gouffre sans fond ». Ensuite, parce que cette
signification fut explorée par « des lettrés, des artistes, des philosophes », sans
qu’elle se circonscrive dans un domaine lui-même délimité. Si bien qu’à la plura-
lité du sens et à sa généralité s’ajoutent sa mobilité, son flou et sa confusion. Par
• 6 – Trad. J. Hyppolite, Aubier Montaigne, 1941, t. 1, p. 5.
• 7 – Voir Pierre Macherey, Hegel ou Spinoza, F. Maspéro, 1979, p. 43 sqq.
• 8 – Gaston Bachelard, La Formation de l’esprit scientifique, Vrin, 1980, p. 23.
•9–Traité de la réforme de l’entendement, op. cit., § 26.
• 10 – G. Bachelard La Philosophie du non, PUF, 1940, p. 34.
Le symbolisme existe-t-il ? - 19 -

conséquent, troisième raison, le terme de symbolisme apparaît aussi « conven-
tionnel » que celui de Moyen Âge dont les hommes qui y vécurent « ne se dou-
taient guère qu’ils y vivaient ». Enfin, à l’arbitraire et à l’extériorité du terme, il
faut ajouter le fait qu’il est impossible de faire de la détermination « symboliste »
la propriété commune d’œuvres qui ne semblent exister que par leurs différences :
« Quoi de commun entre Verlaine et Villiers de l’Isle-Adam, entre
Maeterlinck, Moréas et Laforgue?… Qu’est-ce donc qui les fait unir, puisque
tous les traits possibles et positifs – doctrines, moyens, manières de sentir
et d’exécuter – semblent plutôt les écarter les uns des autres? […] Ces
quelques remarques nous permettent de concevoir assez clairement ce que
nous faisons en ce moment : nous sommes en train de construire le sym-
bolisme, comme l’on a construit une foule d’existences intellectuelles, aux-
quelles si la présence réelle a toujours fait défaut, les définitions n’ont jamais
manqué, chacun leur offrant la sienne et bien libre de le faire. Nous construi-
sons le symbolisme; nous le faisons naître aujourd’hui à l’âge heureux de
cinquante ans. […] Oui, célébrer en 1936 ce cinquantième anniversaire,
c’est créer en 1936 un fait qui ne sera jamais le Symbolisme de 1886; et ce
fait ne dépend pas le moins du monde de l’existence en 86 de quelque chose
qui se soit appelé le Symbolisme. […] Il est merveilleux de penser que nous
célébrons comme existant, il y a cinquante ans, un fait absent de l’univers,
il y a cinquante ans. Je suis heureux et honoré de prendre part à la généra-
tion d’un mythe, en pleine lumière11.»
La construction d’un objet, indique cependant Valéry, n’en fait pas nécessai-
rement un « mythe » ou un simple effet « de perspective », c’est-à-dire une illu-
sion. Car « il y a bien quelque chose » qui est mis en perspective, mais « nous
savons que ce quelque chose ne réside pas dans les caractères sensibles » de l’art
symboliste. Alors, Valéry introduit sa propre hypothèse : si « l’Esthétique » divi-
sait les symbolistes, « l’Ethique les unissait ». « Les artistes symbolistes se recon-
naissaient identiquement séparés du reste des écrivains et des artistes de leur
temps12. » Dit autrement : c’est leur conscience et leur volonté de séparation qui
font leur union; « ce n’est qu’une négation qui leur est commune » et qui est le
mode contradictoire sur lequel ils pensent leur identité ainsi que leur commu-
nauté. Cette négation, que Valéry nomme « éthique », est plutôt d’ordre psycho-
logique et social : elle est « une résolution commune de renoncement au suffrage
du nombre13 »; elle est une posture générale qui fait de la fragmentation ou de la
division la trame, déchirée et reprise, de l’existence individuelle ou collective.
•11–Existence du symbolisme, op. cit., p. 689 et 688.
•12–Ibid., p. 690.
•13–Ibid., p. 691.
Introduction
- 20 -

La thèse que je voudrais présenter, défendre et évaluer dans le sens de Valéry
mais finalement contre lui, est la suivante : ce n’est pas seulement « une négation »
ou « quelque négation », comme le dit Valéry, qui est commune aux symbolistes.
Ce qui construit leur communauté est la négation à la fois comme opération logique
et comme principe métaphysique d’où sort leur position esthétique, existentielle,
sociale et politique. Si l’existence et l’unité du symbolisme ne sont pas artistiques, elles
sont d’ordre philosophique. L’intérêt pour le symbolisme ne peut être que philosophique
parce que la philosophie est ce qui ordonne le symbolisme et lui confère une consistance.
Par-delà (ou en deçà de) la diversité des œuvres et des textes théoriques ou critiques, il
y a une pensée spéculative symboliste alimentée à l’ensemble de la tradition philoso-
phique explicitement citée et travaillée dans le sens d’une pensée de la négation.
Pour démontrer cette thèse, je voudrais reprendre à nouveaux frais, la méthode
valéryenne du doute sur l’existence même du symbolisme. Je voudrais penser et
rejeter trois évidences s’exprimant sur le mode du « il y a » (évidences qui forment
comme trois cercles concentriques) :
– d’une part l’évidence qu’il y a immédiatement des œuvres symbolistes;
– d’autre part celle qu’il y a des œuvres symbolistes immédiatement distinctes des
œuvres impressionnistes;
– enfin celle qu’il y a une période, une condition et une pensée commune qui per-
mettent de les circonscrire : ce que les hommes de la fin du XIXesiècle ont appelé
la modernité.
Prendre appui sur, et en même temps prendre ses distances par rapport à ces
trois constats, tel est l’objet de cette introduction visant à se forger les outils de
construction et d’interprétation du symbolisme, non dans un discours préalable
à cette construction (et qui chercherait illusoirement, on l’a vu, un outil parfait),
non dans une observation prétendument directe d’une portion de l’histoire de
l’art, mais dans un discours d’emblée constructeur et interprétateur de son objet.
2) Une illusion rétrospective
On sait que dans la première conférence de La Pensée et le mouvant, Bergson
définit ce qu’il appelle « le mouvement rétrograde du vrai14 ». Cette expression
désigne l’illusion consistant, pour chaque homme ou chaque société, « à créer sa
propre préfiguration dans le passé et une explication de lui-même par ses antécé-
dents ». C’est la position ou la préoccupation d’un individu (singulier ou collec-
tif) dans le présent, c’est la conscience ou l’intérêt qu’il possède pour lui-même,
qui l’obligent à repérer dans son passé ce qu’il prend illusoirement pour les causes
•14–In Œuvres, édition du centenaire, PUF, 1959, p. 1253-1270.
Le symbolisme existe-t-il ? - 21 -
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
1
/
30
100%