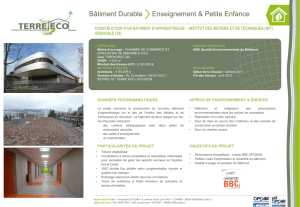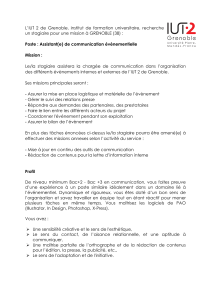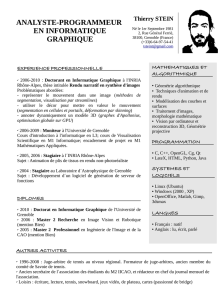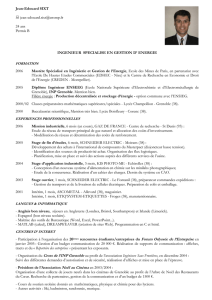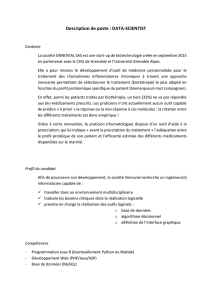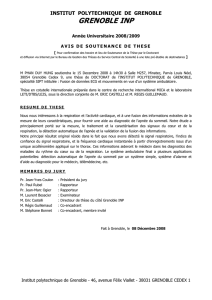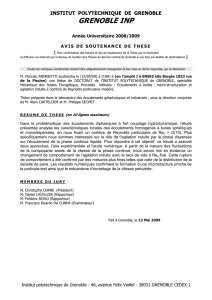urbanisation de l`agglomeration grenobloise

PROGRAMME THEMATIQUES PRIORITAIRES
REGION RHONE-ALPES
THEMATIQUE DEVELOPPEMENT DURABLE
EVALUATION DE LA VULNERABILITE SISMIQUE A L’ECHELLE D’UNE
VILLE RHONE-ALPINE
– APPLICATION A GRENOBLE – réf : 03 104686
URBANISATION DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE
Produit Final PF1
Philippe GUEGUEN
(Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonophysique – Université de Grenoble)
Thierry VASSAIL
(Bureau VERITAS – Grenoble)

Résumé : Le projet VULNERALP doit permettre d’apprécier le niveau de vulnérabilité sismique de
Grenoble et de son agglomération. A cet effet, plusieurs échelles d’analyses sont prévues, depuis
l’échelle globale concernant l’ensemble de l’agglomération à une analyse détaillée à l’échelle du
bâtiment, en passant par l’échelle du quartier, du bloc ou du pâté de maisons. Avant toute analyse
de vulnérabilité, il convient donc de connaître la ville, ses évolutions, ses contraintes socio-
économiques passées et présentes ayant orienté son aménagement ainsi que les contextes culturel et
historique qui ont contraint son développement. Ce travail n’est pas un traité d’urbanisme ni
d’architecture, encore moins un travail historique sur l’évolution de la région grenobloise. Mais
évidemment, il s’appuie sur ces informations pour tenter de classer et de définir les grands
ensembles constructifs, qui du point de vue de la vulnérabilité sismique peuvent être considérés
comme homogènes. Pour la plupart d’entre elles, on peut trouver ces informations dans Parent
(1982) et Joly et Parent (1988) qui abordent le développement de la ville d’un point de vue
urbanistique.
Ce document a donc pour objectif principal la représentation de Grenoble et de son agglomération
en zones d’habitat homogène. Il faut donc à la fois définir ces zones mais aussi les types de
constructions qu’on y trouve. Ces derniers doivent d’autre part pouvoir être associés à la typologie
de l’EMS98, échelle européenne macrosismique qui définit pour chaque catégorie de construction
un niveau de vulnérabilité. Cette première étape nous permettra à terme d’estimer une vulnérabilité
EMS98 pour Grenoble et son agglomération. Cette typologie Grenobloise assurera également la
classification des constructions qui seront analysées ultérieurement par des méthodes de diagnostics
plus sophistiquées menées dans le cadre du projet VULNERALP. On pourra ainsi constituer une
base de données typologique, la BDT-Grenoble, qui pour chaque construction donnera sa
localisation géographique et son appartenance à une catégorie de la typologie. Cette BDT-Grenoble
sera ouverte, c’est-à-dire qu’elle constituera un fond d’informations sur le bâti grenoblois collectées
durant ce projet, mais devra continuer à s’enrichir de données collectées ultérieurement.

1. Introduction
Les Alpes constituent une des zones les plus sismiques de France. La connaissance de cette
activité fait appel d'une part aux archives historiques, qui permettent de remonter jusqu'à 5 à 6
siècles, et d'autre part aux réseaux sismologiques instrumentaux, et en particulier le réseau
Sismalp (http://sismalp.obs.ujf-grenoble.fr/) : au bout de 10 ans de fonctionnement, ce dernier a
permis d'obtenir une vision très fine de l’activité des Alpes du Nord, mettant en évidence deux arcs
de sismicité, l'arc piémontais et l'arc briançonnais, ainsi qu'une sismicité soutenue en bordure
occidentale des massifs cristallins externes (Belledonne – Aiguilles Rouges).
L'analyse de toutes ces informations montre
que pour la région grenobloise on doit
considérer la possibilité de séismes au moins
comparables à ceux d'Annecy-Epagny (1996),
de Corrençon (1962) ou de Chamonix (1905),
à proximité immédiate (quelques kilomètres)
de l'agglomération sur la faille dite de
Belledone (Thouvenot et al., 2003). Certains
géologues/sismologues n'excluent pas non
plus la possibilité de séismes similaires à ceux
du Valais de 1855, dont la magnitude
dépassait 6 selon toute probabilité. Leur
magnitude pourrait donc être au moins égale à
5.5, avec un mécanisme soit en
chevauchement sur la rampe présente sous les
massifs cristallins externes, soit en coulissage
dextre sur la faille "de Belledonne", soit enfin
en coulissage senestre sur une autre faille
conjuguée dans la cluse de l'Isère. Au cours
des dernières décennies, les habitants de
Grenoble ont eu plusieurs fois l'occasion de
ressentir, plus ou moins fortement, des
secousses sismiques produites par un
tremblement de terre local, le dernier en date
étant celui de Laffrey du 11/01/1999
(Ml=3.5). D’autre part, le sous-sol grenoblois
présente une configuration très particulière, avec sa cuvette en Y remplie d'alluvions postglaciaires
très épaisses (plusieurs centaines de mètres de sables, argiles et graviers) et confinée entre
Belledonne, Chartreuse et Vercors. De telles amplifications locales ont montré en d'autres lieux
qu'elles pouvaient être à l'origine d'énormes dégâts, comme par exemple à Caracas en 1967, à
Mexico en 1985, à San Francisco en 1989, à Kobé en 1995, à Istanbul en 1999 ou à Bhuj en 2001.
Cette structure encaissée conduit à des effets de site 3D (Cornou, 2002), dus aux réverbérations et à
la résonance sur les bord rigides du bassin : les ondes sismiques sont quasiment "piégées" dans les
formations superficielles, beaucoup plus déformables que le substratum rocheux, et il en résulte un
phénomène d'écho, avec des réflexions successives entre la surface et les parois rocheuses. A
certaines fréquences privilégiées, il s’établit alors des phénomènes de résonance, caractérisés par à
la fois de fortes amplifications (un facteur 10 entre le rocher proche et le centre du bassin), et une
prolongation importante des mouvements en surface (Lebrun et al., 2001). D’autre part, cette
amplification se produit dans la gamme de fréquences correspondant aux immeubles de plus de 5
étages (soit entre 0.3 et 5 Hz) qui représentent la plupart des immeubles grenoblois. Ces
observations ont été depuis lors systématiquement confirmées grâce au déploiement de stations du
Figure 1 : Sismicité instrumentale des Alpes du Nord
depuis 1989. En particulier, on peut noter l’alignement de
la sismicité en bordure externe de la chaîne de Belledone,
(d’après Sismalp)

Réseau Accélérométrique Permanent (RAP ; http://www-rap.obs.ujf-grenoble.fr) dans la cuvette
grenobloise.
L'existence de tels effets attire aussi l'attention sur la sensibilité potentielle des bâtiments de grande
hauteur (10 étages et plus) à de gros séismes plus lointains (Durance, Ligurie, Valais, ...) : dans les
tours les plus hautes de l'Ile Verte, le tremblement de terre du Friul en 1976 à 500 km à l'Est a
même provoqué une frayeur suffisante pour amener certains habitants à passer la nuit dehors, tandis
que lors du séisme de Remiremont du 22 février 2003 (Ml 5.4 à 400km au Nord) des témoignages
rapportent des vibrations ressenties dans les plus hauts étages. Tout récemment, le séisme de
Baumes les Dames dans le Jura (23 février 2004, Ml=5.4), localisé à environ 150km au Nord de
Grenoble, a été lui aussi fortement ressenti par la population. Les niveaux d’accélération dans la
cuvette grenobloise ont atteint 0.006g au sol et montraient des amplifications importantes dans une
gamme de fréquence comprises entre 0.3 et 7Hz, soit celles de la plupart des bâtiments de Grenoble.
De nombreuses études ont ainsi été menées (et continuent de l’être) telles que le forage de
Montbonnot (Nicoud et al. 2001), des reconnaissances géophysiques sur le remplissage quaternaire
(Dietrich et al., 20001), des mesures de bruit de fond (Lebrun et al., 2001 ; Bettig et al., 2001), des
reconnaissances géotechniques et des modélisations numériques (Moczo et al., 2000 ; Chaljub et al.,
2004) qui permettent de mieux prévoir les mouvements du sol susceptibles d’être observés dans la
cuvette grenobloise pour des scénarios réalistes : les estimations d'accélération maximale à la
surface du bassin peuvent atteindre et même dépasser 0.3 g à des niveaux spectraux notablement
supérieurs aux niveaux réglementaires, surtout pour les bâtiments de plus de 6-7 étages.
Cette "menace" (modérée) se traduit concrètement par le classement de la région grenobloise en
zone "Ib" du zonage sismique national, ce qui rend obligatoire l'application des règles de
construction parasismique (dites règles PS92) avec une accélération de calage de 0.15 g. Une
révision du zonage sismique national selon une approche probabiliste (Beauval, 2004) est en cours
dans le cadre de la préparation à l’arrivée de la nouvelle réglementation européenne à l’horizon
2005. Les résultats préliminaires des études en cours indiquent des niveaux de cet ordre de grandeur
pour l’ensemble de la zone « Nord des Alpes françaises », alors qu’elles révisent plutôt à la baisse
les niveaux dans les zones réputées les plus sismiques de métropole (Alpes-maritimes, Provence,
Pyrénées orientales, Sud-Alsace). Grenoble devient ainsi une des régions les plus sismiques de
France métropole, les effets de site particuliers (actuellement non pris en compte dans la
réglementation) aggravant encore cette situation.
La connaissance de l’aléa sismique local et régional à Grenoble justifie amplement les études
de vulnérabilité que nous menons actuellement. Cependant, le risque sismique grenoblois reste
modéré en comparaison des zones très actives qui ont vu se développer des méthodes d’évaluation
de leur vulnérabilité (par exemple, Etats-Unis, Italie, Japon…). Ces méthodes, souvent très
sophistiquées, nécessitent un coût de réalisation qui est difficilement justifiable pour un
environnement à sismicité modéré comme celui de Grenoble, même si le risque sismique n’y est pas
négligeable. L’objectif du projet VULNERALP n’est pas de proposer une nouvelle méthode
d’évaluation de la vulnérabilité, mais plutôt d’adapter celles existantes au cas de Grenoble.
Une première étape consiste donc à établir l’inventaire des constructions que l’on rencontre
dans l’agglomération. Cette dernière a été urbanisée à des époques différentes, ce qui donne une
variabilité importante dans les techniques de constructions employées. Cette première étape doit
permettre d’établir une typologie grenobloise de la construction dont les répartitions spatiales et
géographiques seront analysées. La ville sera ainsi divisée en zones (ou secteurs) homogènes au
sens de la vulnérabilité sismique, chacune d’entre elles caractérisée par une répartition de
construction de chaque type. La relation entre la typologie grenobloise et celle donnée par l’Echelle
Macrosismique Européenne (EMS98) sera systématiquement proposée, ce qui nous permettra
d’évaluer la vulnérabilité niveau 0 de Grenoble selon l’EMS98.

2. Méthode d’évaluation de la vulnérabilité
2.1 L’évaluation envisageable à Grenoble.
Depuis 1994 et 1995, les règles parasismiques françaises PS92 ont été rendues obligatoires
pour tous les bâtiments "à risque normal" neufs (y compris les maisons individuelles) situés en zone
sismique, comme c'est le cas de l'agglomération grenobloise. Pour le bâti courant "à risque normal",
même si la réglementation technique présente des défauts (en particulier sur la prise en compte
d’effets de site particuliers décrits précédemment), le faible taux de renouvellement (estimé
généralement à 1% par an) fait que l'essentiel de la vulnérabilité sismique vient de l'existant. Devant
le volume de constructions qui compose le bâti existant, plusieurs choix stratégiques et politiques
peuvent être envisagés pour remédier au problème de la vulnérabilité sismique :
1. Attendre le renouvellement du parc, c’est-à-dire accepter de prendre le risque que pendant
un siècle la majorité des constructions puisse offrir un niveau de sécurité inférieur à celui
visé par les règles. Politiquement, cette solution est envisageable pour des constructions
individuelles, mais le séisme de Molise (Italie) a montré qu’il ne fallait pas l’envisager pour
des établissements publics ou scolaires.
2. Renforcer tout le bâti existant de façon à le ramener au niveau des règles parasismiques.
Théoriquement, cette solution est celle qui réduirait au mieux le risque sismique, mais elle
n’est pas économiquement envisageable. L’exemple de la maison de la culture de Grenoble
donne une idée de la charge financière pour une ville telle que Grenoble d’une
requalification d’un établissement de ce genre, face à des obligations non seulement
fonctionnelles et techniques, mais aussi culturelles, symboliques et historiques.
3. Choisir parmi les bâtiments d’un parc ceux qui présentent les plus grandes faiblesses (ou
défauts) structurales, et décider selon les priorités, l’investissement disponible et la
hiérarchisation des bâtiments d’un programme de réhabilitation.
Cette dernière solution est la plus raisonnable, mais il faut alors pouvoir se représenter le
niveau de vulnérabilité d’une ville, d’un parc immobilier, d’un quartier ou d’une commune, voir
d’un bâtiment. C’est l’objectif d’une étude de vulnérabilité sismique qui doit permettre la
représentation du taux de dommage des constructions en fonction d’un paramètre caractérisant le
séisme. Cette représentation doit illustrer les conséquences de la vulnérabilité par la caractérisation
qualitative ou quantitative des dommages de façon à rendre compte de ce qui est supportable ou
non. Devant le faible taux de renouvellement du parc immobilier, c’est le bâti existant qui
concentre les études de vulnérabilité. Dans une immense majorité des cas, il a été construit sans
aucune conception parasismique, et, entre autre, pour une certaine classe de bâtiments datant des
années 50-60-début 70, à une époque où les besoins étaient tels que la quantité primait sur la
qualité. Sur Grenoble, les premières études dont nous ayons connaissance sont celles réalisées dans
le cadre de la thèse de M. Farsi (1996), qui a d'une part mesuré les fréquences propres d'une
cinquantaine de bâtiments de l'agglomération (essentiellement des HLM), et d'autre part effectué
une étude préliminaire de vulnérabilité en utilisant différentes techniques, du très rudimentaire
(échelle d'intensités et classes de bâtiments) au plus élaboré (calculs pseudo-statiques sur plans
disponibles). Ces études ont révélé que la fréquence propre de la majorité des bâtiments d'habitation
collective se situe dans la plage d'amplification de la cuvette grenobloise et que l'on peut donc
s'attendre, en cas de séisme de magnitude 5.5 proche, à une intensité EMS de l'ordre de VIII dans la
cuvette, avec des niveaux de dommage atteignant 20 à 30 % pour les bâtiments en maçonnerie, et 7
à 15 % pour ceux en béton armé (non parasismique) qui forment l'essentiel du parc grenoblois.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
1
/
38
100%