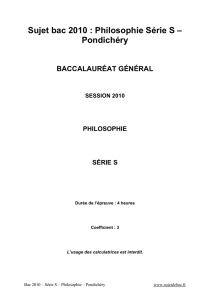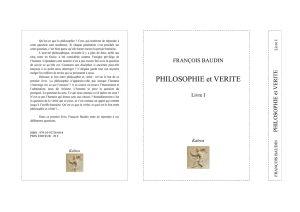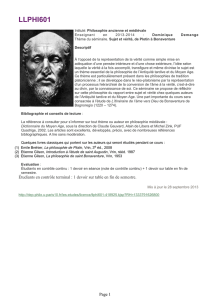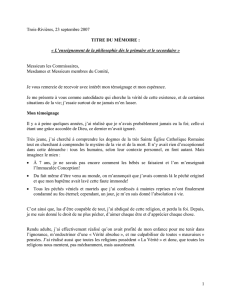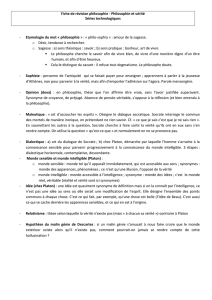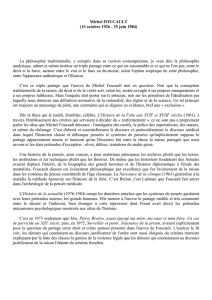Biopolitique ou politique ?

Biopolitiqueoupolitique?
parJacquesRancière
EntretienrecueilliparEricAlliez
Miseenlignemars2000
MULTITUDES Dans votre livre, La mésentente, vous mettez à l’épreuve le questionnement politique en le
confrontantàlafausseoppositionsurlaquelleilprendappui,dansLapolitiqued’Aristote:ladualitédelavoix
(phônè),commeexpressiondel’utile,etdelaparole(logos)commeexpressiondujuste,dualitéparlaquelle
l’animalitéseraitoriginairementscindée.Endeçàdecetteopposition,vousrepérezlelitige,ouletort,comme
levéritablelieudupolitiquecetortquirésideprécisémentdanslerejetdelamajoritédesêtresparlantsdans
lebruitvocaloùs’exprimelasouffranceetl’agrément.
Si nous nous sommes adressés à vous pour penser l’usage qu’il est possible de faire de la catégorie de
Biopolitique, c’est que le geste que vous accomplissez nous semble constituer une tentative singulière pour
reconduirelapolitiqueàlaviedessujetsettransformersonconceptàceniveauderadicalité.Maiscegeste
paraît comme immédiatement retenu : tout se passe comme si la politique prenait toute entière place dans
l’écartquisecreuseentredeuxformesdeviesetdanslelitigeproduitparcetécartmême.Nepeutonalors
dire, en se situant dans votre perspective, que la biopolitique est ce qui reste l’impensé constitutif de la
politiqueellemême?Etdansquellemesurepeutilêtreinvestipourluimême?
JACQUESRANCIÈREJen’aipas«reconduitlapolitiqueàlaviedessujets»ausensoùj’auraismontréson
enracinement dans une puissance de la vie. La politique n’est pas pour moi l’expression d’une subjectivité
vivante originaire opposée à un autre mode originaire de la subjectivité ou à un mode dérivé, détourné,
commedanslespenséesdel’aliénation.Enrevenantsurladéfinitionaristotéliciennedel’animalpolitique,mon
objetétaitdemettreencauselafondationanthropologiquedelapolitique:lafondationdelapolitiquedans
l’essence d’un mode de vie, l’idée du bios politikos, qu’on a vu refleurir ces derniers temps à travers des
référencesplusmodernes(LéoStraussetHannaArendt,pourl’essentiel).
J’aivoulumontrerqu’ilyavaituncerclevicieuxdanscettefondation:la«preuved’humanité»,lepouvoirde
communautédesêtresdouésdulogos, loindefonderlapoliticité,esten fait l’enjeu permanent du litige qui
séparepolitiqueetpolice.Maiscelitigen’estpasluimêmel’oppositionentredeuxmodesdevie.Politiqueet
policenesontpasdeuxmodesdeviemaisdeuxpartagesdusensible,deuxmanièresdedécouperunespace
sensible,d’yvoirouden’ypasvoirdesobjetscommuns,d’yentendreouden’ypasentendredessujetsquiles
désignentouargumententàleursujet.
Lapolice est lepartagedusensiblequiidentifie l’effectuationdu commund’unecommunautéàl’effectuation
despropriétésdesressemblancesetdesdifférencescaractérisantlescorpsetlesmodesdeleuragrégation.
Elle structure l’espace perceptif en termes de places, fonctions, aptitudes, etc., à l’exclusion de tout
supplément. La politique, elle, est et n’est que l’ensemble des actes qui effectuent une « propriété »
supplémentaire,unepropriétébiologiquementetanthropologiquementintrouvable,l’égalitédesêtresparlants.
Elleexisteensupplémentàtoutbios.Cequis’oppose,cesontdeuxstructurationsdumondecommun:celle
quineconnaîtquedubios(depuislatransmissiondusangjusqu’àlarégularisationdesfluxdepopulations)et
cellequiconnaîtlesartificesdel’égalité,sesformesderefigurationdu«mondedonné»ducommuneffectuées
pardessujetspolitiques.Ceuxcin’affirmentpasunevieautremaisconfigurentunmondecommundifférent.
Entoutétatdecause,l’idéedusujetpolitique,delapolitiquecommemodedeviedéveloppantunedisposition
naturellecaractéristiqued’uneespècevivantesingulièrenepeutêtreassimiléeàcequeFoucaultanalyse:les
corps et les populations comme objets du pouvoir. L’animal politique aristotélicien est un animal doué de
politicité,c’estàdire capabled’agircommesujetparticipantàl’agirpolitique,danslestermesaristotéliciens,
unêtreparticipantàlapuissancedel’arkhècommesujetenmêmetempsquecommeobjet.Lecorpsconcerné
parla«biopolitique»deFoucaultest,lui,uncorpsobjetdepouvoir,uncorpslocalisédanslepartagepolicier
descorpsetdesagrégationsdecorps.LabiopolitiqueestintroduiteparFoucaultcommedifférencespécifique
danslespratiquesdupouvoiretleseffetsdepouvoircommentlepouvoiropèredeseffetsd’individualisation
descorpsetdesocialisationdespopulations.Orcettequestionn’estpascelledelapolitique.Laquestiondela
politiquecommencelàoùestencauselestatutdusujetquiestapteàs’occuperdelacommunauté.
Cettequestion,jecrois,n’ajamaisintéresséFoucault,surleplanthéoriqueentoutcas.Ils’occupedupouvoir.
Et il introduit le « biopouvoir » comme une manière de penser le pouvoir et sa prise sur la vie. Il faut se
souvenirducontextedanslequelilleprésentedansLavolontédesavoir:celuid’unecritiquedesthèmesdela
répressionetdelalibérationsexuelle.Ils’agitpourluides’opposeràundiscoursdetypefreudomarxiste,
demontrercommentunecertaineidéedela«politiquedelavie»reposesurlaméconnaissancedelamanière
dontlepouvoirs’exercesurlavieetsurses«libérations».Ilyauncertainparadoxeàvouloirretournerle
dispositif polémique de Foucault pour affirmer un enracinement vitaliste de la politique. Et si l’idée de
biopouvoirestclaire,celledebiopolitiqueestconfuse.CartoutcequedésigneFoucaultsesituedansl’espace
decequej’appellelapolice.SiFoucaultapuparlerindifféremmentdebiopouvoiretdebiopolitique,c’estparce
que sa pensée de la politique est construite autour dela question du pouvoir, qu’il ne s’est jamais intéressé
théoriquementàlaquestiondelasubjectivationpolitique.Aujourd’huil’identificationdesdeuxtermesvadans
deuxdirectionsopposées,quejecroisétrangèresàlapenséedeFoucault,etquisontentoutcasétrangèresà
lamienne.
Il y a, d’un côté, l’insistance sur le biopouvoir comme mode d’exercice de la souveraineté, qui enferme la
question de la politique dans celle dupouvoir et tire le biopouvoir sur un terrain ontothéologicopolitique :
ainsi, lorsque Agamben explique l’extermination des juifs d’Europe comme conséquence du rapport à la vie

inclus dans le concept de souveraineté. C’est une façon de ramener Foucault du côté de Heidegger par la
médiation d’une vision du sacré et de la souveraineté à la Bataille. Or, s’il est clair que si Foucault a des
coquetteriesdececôté,iln’identifiepassimplementleconceptdelasouverainetéàceluidupouvoirsurlavie
etilpenseleracismemodernedanslestermesd’unpouvoirquis’appliqueàmajorerlavie,pasdansceuxdu
rapportdelasouverainetéàlavienue.Laproblématiquearendtienneheideggerienneendernièreinstance
desmodesduvivre,quisoutientlathéorisationd’Agamben,mesembletrèsétrangèreàcelledeFoucault.
D’unautrecôté,ilyalatentativededonneruncontenupositifàla«biopolitique».Ilya,àunpremierniveau,
lavolontédedéfinirdesmodesdepriseencharge,derapportsubjectifaucorps,àlasantéetàlamaladiequi
s’opposentàlagestionétatiqueducorpsetdelasanté,commeonapulevoirnotammentdanslescombats
menéssurlesquestionsdeladrogueetduSida.Ilya,àunautreniveau,l’idéed’unebiopolitiquefondéesur
uneontologiedelavie,identifiéeàunecertaineradicalitéd’autoaffirmation.Cellecis’inscritdansunetradition
de marxisme anthropologique, héritée desGrundrisse, qui s’est politiquement retrempée dansl’opéraïsmeet
théoriquement rajeunie dans le vitalisme deleuzien. Cela revient pour moi à une tentative d’identifier la
questiondelasubjectivationpolitiqueàcelledesformesdel’individuation,personnelleetcollective.Orjene
croispasqueriensedéduised’uneontologiedel’individuationàunethéorisationdessujetspolitiques.
MULTITUDES Dans La mésentente, vous introduisez votre définition de la police (que vous opposez à la
politique) par une référence à la généalogie de la police que propose Foucault dans Omnes et singulatim,
commes’étendantàtoutcequiconcernel’hommeetsonbonheur.Maisquefaitesvousdufaitqu’auxyeuxde
Foucault,lapoliceneconstituequ’unaspectdecetteformedepouvoirquis’exercesurlaviedesindividuset
despopulations?
JACQUESRANCIÈREIlsembleyavoireuuneéquivoquesurmaréférenceàFoucaultdansLamésentente.J’y
aidéfinilapolicecommeuneformedepartagedusensible,caractériséeparl’adéquationimaginairedesplaces,
des fonctions et des manières d’être, par l’absence de vide et de supplément. Cette définition de la police,
élaboréedanslecontextedelapolémiquedesannéesquatrevingtdixsurlaquestiondel’«identité»esttout
àfaitindépendantedel’élaborationdelaquestionbiopolitiquechezFoucault.Enlaproposant,j’aieulesouci
debienécartercettenotiondesassociationshabituellespolice/appareilrépressifetaussidelaproblématique
foucaldiennedeladisciplinarisationdescorpsoudela«sociétédesurveillance».C’est,danscecontexteque
j’aicru utilederappeler que, chezFoucaultluimême, la question dela policeétaitbeaucoup pluslarge que
celledel’appareilrépressifetdeladisciplinarisationdescorps.
Maisilestclairquelemêmemotdepolicerenvoieàdeuxdispositifsthéoriquestrèsdifférents.DansOmneset
singulatimFoucaulttraitedelapolicecommedispositifinstitutionnelparticipantducontrôledupouvoirsurla
vie et les corps. Police, chez moi, ne définit pas une institution de pouvoir, mais un principe de partage du
sensibleàl’intérieurduquelpeuventsedéfinirdesstratégiesetdestechniquesdepouvoir.
MULTITUDES Dans l’interprétation quedonne Foucaultdans Lavolonté de savoir,de la biopolitique comme
transformationdupouvoirsouverain,passagedupouvoirdevieetdemortaupouvoircommegestiondelavie,
l’émergencedusocialcomme nouvelespacedupolitiquejoueun rôlemajeur. C’est surce point quese sont
concentrées les interprétations foucaldiennes de l’EtatProvidence, plus récemment nommé (par Balibar, par
Castel)Etatnationalsocial.Pourvousaussi,le socialconstitueun thème fondamental detransformation.Ce
vousappelezl’«incorporationpolicière»,c’estjustementlaréalisationdusujetpolitiquecommecorpssocial.
Estil possible, selon vous, de courtcircuiter cette incorporation en restaurant un autre point de vue sur le
social?Estilpossibledeportersurlesocialunregardpolitiquequiéchappeàunetelleréduction,etlenomde
biopolitique peutil convenir, au prix d’un certain renversement de son usage foucaldien, à désigner cette
intention?
JACQUESRANCIÈRELesocialestchezFoucaultl’objetd’unsoucidupouvoir.Foucaultatransformélaforme
classique de ce souci (l’inquiétude devant les masses laborieuses/dangereuses) en une autre forme :
l’investissementpositifdupouvoirdanslagestiondelavieetlaproductiondeformesoptimalesd’individuation.
Cette préoccupation peut sans doute s’inscrire dans une théorisation de l’État social. Mais l’État n’est pas là
l’objet de mon étude. Pour moi, le social n’est pas un souci dupouvoir ouune production dupouvoir. Il est
l’enjeu du partage entre politiqueet police. Il n’est pasainsi un objet univoque,un champ de rapports de
production et de pouvoir que l’on pourrait circonscrire. « Social » veut dire au moins trois choses. Il y a
d’abord«lasociété»,l’ensembledesgroupes,placesetdesfonctions,quelalogiquepolicièreidentifieautout
delacommunauté.
C’est dans ce cadrelà que rentrent pour moi les préoccupations de gestion de la vie, des populations, de
productiondeformesd’individuation,impliquéesdanslanotiondebiopouvoir.Ilyaensuitelesocialcomme
dispositifpolémiquedesubjectivation, construitparcessujetsquiviennentcontesterla «naturalité»deces
places et fonctions, enfaisant compter ceque j’ai appelé lapart des sanspart. Il ya enfin lesocial comme
inventiondelamétapolitiquemoderne:lesocialcommelavérité,plusoumoinscachée,delapolitique,que
cettevéritésoitconçueàlamanièredeMarxoudeDurkheim,deTocquevilleoudeBourdieu.
C’est l’opposition et l’intrication de ces trois figures du social qui m’a intéressé, et cette intrication ne me
semblepaspasserprioritairementparunethéoriedelavieetparlaquestiondesesmodesderégulation.Jene
croispas,unefoisencore,qu’onpuissetirerdel’idéedubiopouvoir,quidésigneunepréoccupationetunmode
d’exercicedupouvoir,l’idéed’unebiopolitiquequiseraitunmodepropredesubjectivationpolitique.
_____________________________________________________________________
Lapoétiquedusavoir
Aproposde"Lesnomsdel’histoire"
parJacquesRancière
Miseenlignelemardi25janvier2005

Cetexteaétéécritàpartird’unentretienréaliséàl’occasiondelapublicationdulivredeJacquesRancière"Les
nomsdel’histoire"en1992.
Ilaétépubliédanslenuméro11&12delarevue"Lamaindesinge"en1994.
“Necherchonspasd’excusestropcirconstanciéesauretardaveclequelparaÎtnotreannonce:pourquialule
livre,ceretardestsansconséquence...ilnes’agiraenl’occurrencequedecompléterunjugementparunautre
;quantàceluiquinel’apaslu,iln’auraqu’àseféliciterd’êtreàprésentconvié,etmêmecontraint,àlelire.”
(ExtraitdelapréfacedeJeanPaulàFantaisiesdeETAHOFFMANEditionPressespocket)
Ce terme est d’abord un refus de certaines notions. J’ai parlé de poétique, non de méthodologie ou
d’épistémologie. C’est que ces termes, pour moi, opèrent une dénégation à l’égard des formes réelles de la
constitutiond’unsavoir.Lechoixdutermedepoétiqueaplusieursraisons:
L’histoireproduitdusensàl’aidedeprocéduresempruntéesàlalanguenaturelleetauxusagescommunsde
cettelangue.Epistémologieouméthodologieinsistentsurlesprocéduresdevérificationdesfaits,demisedes
chiffres en série. Elles constituent la certitude du savoir avant qu’il ne s’expose dans l’écriture et dans sa
solitude. L’historien est alors celui qui “fait” de l’histoire, qui travaille sur le “chantier” de la communauté
savante.Savoir,communautéetmétiersegarantissentmutuellement.Mais,unefoisqu’onautilisélesbonnes
méthodesdevérification,faitlesbonscalculs,ilfautbienpasserpardesarrangementsdelalanguecommune
pourdirequelesdonnéesdesstatistiquesproduisentcesensetpasunautre.Etilfautdéjàlefairepourdéfinir
l’objetdelarecherche.L’écrituredel’histoiren’exprimepaslesrésultatsdelascience,ellefaitpartiedeleur
production.Etécrireesttoujoursunactedesolitudequ’aucunecommunauté,aucunmétier,aucunsavoirne
garantit.
Le terme de poétique cherche aussi à cerner un rapport historique entre la constitution de deux
configurations conceptuelles. L’époque de la naissance des sciences sociales est celle où le concept de
littératures’établitcommetel,surlaruinedesanciensartspoétiques.Lanotiondelittératurefaitappelàune
poétique qui n’est plus celle des genres poétiques, avec les objets et les modes de traitement qui leur
conviennent,maisquirenvoieautoutdelalangueetàsacapacitédeconstituern’importequoienœuvred’art
(le“livresurrien”deFlaubert).Lapoétiquedusavoirveutcernercerapportentrel’aberrationlittéraire–lefait
que la littérature est un art de la langue qui n’est plus normé par aucune règle et engage une poétique
généralisée – et la production du discours des sciences sociales avec ses manières de faire vrai. Ce pouvoir
sansnormesdelalangueestàlafoiscecontrequois’insurgel’idéaldessciencessociales.Etpourtantellesen
ontbesoinpourseposercommedelascienceetpasdelalittérature.
Poétiqueenfins’opposeàrhétorique.Celleciestl’artdudiscoursquidoitproduireteleffetspécifiquesurtel
typed’êtreparlantentellecirconstancedéterminée.J’appellepoétique,àl’inverse,undiscourssanspositionde
légitimité etsans destinataire spécifique, qui suppose qu’il n’ya pas seulement un effet àproduire mais qui
implique un rapport à une vérité et à une vérité qui n’ait pas de langue propre. J’essaie de penser cela :
l’histoire,pouravoirunstatutdevérité,doitpasserparunepoétique.Etcommecellecin’estpasconstituée,le
discourshistoriquedoitsedonnersaproprepoétique.Poétiquedusavoirainsinedésignepasunedisciplinequi
s’appliqueraitentreautresàl’histoire.Laquestiondel’écritureesttoutparticulièrementaucœurdelascience
historiqueparce quel’histoire,ayantaffaireà l’événementdeparolequiséparede luimême son“objet”est
tenue de régler ce trouble de l’être parlant, parce que, n’étant ni une science formelle ni une science
expérimentale,nepouvantselégitimerd’aucunprotocolequitiennelavéritéàdistance,elleestbrutalement
enprésencedurapportmêmedelavéritéautemps,delafonctiondurécitqui,depuisPlaton,doitmettredans
l’ordre du devenir un analogon de l’éternité. La sociologie ou l’ethnologie qui campent sur le même sol
épistémologicopolitique que l’histoire utilisent aussi certaines procédures poétiques mais elles peuvent
s’assurerplusaisémentdeleurscientificité,entreunemétaphysiquedelacommunauté(dufaitsocialtotal)qui
apaiseletroubledel’êtreparlantetdesprotocolesexpérimentauxoustatistiquesdu“faceàface”avecl’objet.
Ellespeuventréglerséparémentlaquestiondelavériténouéedansladéterminationdutemps,elledoitécrire
letempsdel’êtreparlantcommecontenantdelavérité.
Vraiescience,faussescience
J’aiaffaireàununiversdudouteuxquejetraitecommetel–cequin’estpasdurelativisme.Ilyauncertain
nombredediscoursquisontclassésdanslarubriquedessciences.Certainsleurrefusentcettequalitéaunom
decritèrespopperiensouautres.Moi,cequim’intéresse,c’estlesmodesdediscoursparlesquelssesoutient
cestatutd’unesciencequiatoutletempsàprouverqu’elleestvraimentunescience.Celanepeutêtreaffaire
d’épistémologie.Oubienonditqu’iln’yalàqu’unerhétorique,oubienonditqu’ilyaquelquechosequiest
plus qu’une rhétorique sans être une épistémologie. C’est ça que j’appelle une poétique. J’essaie de rendre
sensiblelemodedevéritéquelediscourshistoriquedoitsedonnerendehorsdetoutequestiond’exactitude
desprocéduresdevérification.L’histoireabesoind’autrechose:uncorpsdevéritépoursesmots.Maisellene
seledonnepassurlemoderéflexif,elleseledonnedanslatexturemêmedurécit.Ilarrivepourtantqu’ellele
fasse explicitement. C’est ceque faitMichelet : une poétique explicite de l’histoire comme voyage épique et
descenteauxEnfers;unethéorieetunepratiquedelachairdesmotssusceptibledetraverserl’absenceetla
mort.
La question de l’institution historique ne m’intéresse pas vraiment. Elle instaure un courtcircuit entre la
questiondusujetetundiscourssociologique,undiscoursdupouvoirsurlequelMicheldeCerteauadittoutce
qu’ilyavaitd’intéressantàdire.Jen’aipascherchéàpenserlapositiond’unsavoirdanslechampdessavoirs,
qu’ilsoitépistémiqueoupolitique.Pourmoilaquestionpolitiquedusavoirhistoriquepasseparl’analysed’un

rapportspécifique:lerapportentrelaparolequetraitel’histoireetlesmotsdanslesquelselles’écrit.L’écriture
del’histoireestuneinterprétationenacteducorpsparlantquifaitl’histoire,delamanièredontilparleetdont
il“fait”.Cequim’intéresse,c’estlerapportentrecettesaisiedel’êtreparlantetlaquestiondesfrontièresentre
lesmodesdudiscours:queditonquandonditqueteldiscoursrelèvedelascienceetnondelalittérature,ou
lecontraire?Lediscoursdel’histoirem’intéresse,setientsurcettefrontièreoùlesortd’unmodedediscours
estliéàlamanièredontilinterprètelerapportdel’êtreparlantàlavéritédesaparole.
Clôturedel’âgedel’histoire
La clôture dont je parle ne s’identifie pas à ce que certains appellent fin de l’histoire. J’entend par âge de
l’histoire le temps où l’histoire a été pensée comme processus de production d’une vérité : une vérité de la
communautéhumaineproduiteparl’agirhumainetpassimplementuneversionséculariséedesthéologiesde
l’histoiredetypeaugustinien.Jeneparlepasdeclôtureausensheideggerien.J’essaiesimplementdedirececi
:actuellementsetiennentdeuxgrandsdiscoursdelafindel’histoire:lediscoursd’inspirationhégéliennequi
nousditquel’histoireaatteintlafinverslaquelleelletendait:l’Etatuniverselhomogène;etpuislediscours
ressentimentalsurlafindesillusionsdel’histoire,lafindel’âgedesillusionsdel’émancipation.Ceuxquionten
principe la charge du nom d’histoire, les historiens, proclament volontiers la fin de son âge, de diverses
manières. Cela tourne autour de la Révolution Française, de l’idée que l’ère ouverte par la Révolution est
terminéeetpeutêtrequ’ellen’ajamaiscommencé,qu’ellen’aétéqueledéveloppementd’unevasteillusionou
folie:précisémentlafolieconsistantàvouloir“fairel’histoire”.L’historiensefaitalorspenseurdelapolitique
enproclamantlapéremptiondutempsoùl’oncroyaitquel’histoirecommeprocessusproduisaitdelavérité.Il
choisitdumêmecouplasciencecontrelerécit,maisunesciencequifaitbasculerlaquestiondelavéritédans
l’ordre du commentaire. Ainsi une certaine histoire de la Révolution Française est devenue histoire de son
historiographie.Oninvalidelescatégoriesdelaparolerévolutionnaireetdeleurrécit.Restealorsàinterpréter
cequifaitlamatièredecerécitnonvalideetonfaitappelàdescatégoriessociologiques,sciencespoliticiennes
ouautres.
L’histoirede“l’âgedel’histoire”,celledestempsrévolutionnairesetdémocratiques,estcommecoincéeentre
cesformesducommentairequiseveutaudelàdurécitetdesformesd’histoirequin’ontpasgagnélestatut
devéritéquiestliéaurécit.Cettehistoirelàse condamneàunesorted’empirismeappuyésurdesdonnées
scientifiques, renonçant à poser la question des modes d’écriture qui donnent aux mots de l’histoire et aux
motsdel’historienlafigured’unevérité.Ilyaainsiunbalancemententreunendeçàetunaudelàdurécit
vérité. A l’ombre du discours politique sur la fin de l’histoire, les historiens pratiquent volontiers la fin de
l’histoiredanslapratiquemuséaleetencyclopédique.L’EncyclopédiedeDiderot:ouvraitl’âgedel’histoire.Les
encyclopédies/muséesd’aujourd’huienconstituentlaclôture.
Lestroiscontrats
L’opération micheletiste de récitscience nouait les trois exigences de la science, de la narration et de la
communauté;ilestclairqueMicheletpouvaitlefaireparcequ’ilécrivaitl’histoired’unsujet,lesujetFrance:
unsujetterritorialisé,lapatries’apparaissantàellemême.Cesujetseprêtaitàl’opérationquiconfieàlaterre
àlafoisséjourdel’êtreensemble,instancematernelledetransmissionetpassageduséjourdesvivantsàcelui
desEnfers–lafonctiondesurfaced’inscriptiondelavéritéquifaitcommunauté.FairesurgirlesujetFrancede
ses territoires, c’était aussi le penser comme le produit de sa propre généalogie, refuser d’autres types de
sujet,celuiquisefondesurla race,celuiquiestforgéparlapuissanceétatique.MaisaprèsqueMicheletait
effectué cette inscription territoriale du sujet France, il y a eu séparation entre le récit communautaire du
contrat politique, devenu celui de l’histoire qu’on raconte aux enfants, et la procédure de sens : l’idée du
témoinmuet,delachoseouduterritoirequiretientetdélivrelesens.Cetteprocédureestdevenueunenorme
de scientificité en se séparant du sujet comme puissance rassemblante. On a eu alors l’engouement des
historiens pour la géographie, l’idée que le bon sujet pour la science historique, c’est le territoire dont on
déchiffrelesens,opposéausujetcollectifracontantsonmythe.
Pourêtrescience,l’histoiredevaitneplusêtre“l’histoirede”.Orcetterupturen’ariend’évident.L’histoireavait
toujoursétélamémoiredesgrandsfaitsoudesgrandshommes,lamémoired’unpouvoir,d’unecommunauté.
Elledevenait“histoireengénéral”àtraversl’idéeque“leshommes”,descommunautéshumainesdélibérément
rassemblées “faisaient” l’histoire. L’histoire de France à la Michelet inventait un sujet à cheval sur cette
frontièrededeuxâges.Quandl’histoireavouluêtreunescienceàméthodeuniverselles’appliquantàn’importe
quelobjet,elleaécartécetypedesujet,renvoyéauxcontraintespolitiquesdel’éducation,maiselleagardéla
procédure herméneutique que Michelet avait utilisée pour sa manifestation : celle du témoin muet, du sens
territorialisé.Lesujetn’estpluslà,c’estenquelquesortesonmodedemanifestation,leterritoirecommelieu
de sens, qui est devenu sujet. C’est ainsi qu’on passe du “ Tableau de la France” de Michelet à la
“Méditerranée” de Braudel. La Méditerranée y vaut comme le lieu d’une culture qui n’est plus celle du sujet
national,uneculture/univers.MaisfairedelaMéditerranéeunsujetimpliquequel’onfassenaîtrecetuniversel
d’unespace,delamêmemanièrequeMicheletproduisaitl’unitédusujetFrancecommenédesonterritoire.La
ruptureducontratpolitiqueetsonreste“herméneutique”n’ontpasétépensésparleshistoriens.
Subjectivitédémocratiqueetsciencesociale
Les sciences humaines et sociales ont été largement dépendantes d’un projet politique : celui de penser et
d’aménager la communauté postrévolutionnaire, que ce soit sous la forme contrerévolutionnaire de la
restauration du lien social et des croyances communes ou sous la forme de la République comme
institutionnalisationetcivilisationdeladémocratie.Lecorpsrépublicaindevaitdonnerdesmœurs,unethosà
ladémocratie.Lasociologieetl’histoireontétépartiesprenantesdeceprojet.EntrelafinduXIXetledébut
duXX,ellessontdevenuesdessciencesuniversitairesrespectables,endéniantprogressivementleurcaractère
militant, tout en en conservant un certain nombre de formes de thématisation de leurs objets et de modes
d’interprétation. Mais le conflit n’a jamais été vraiment résorbé. L’histoire et la sociologie en témoignent
particulièrement, soit que le militantisme de la science y ait la fonction et la véhémence du militantisme

politique;commedanslasociologiedeBourdieu,soitqueledésenchantementdelapolitiques’yidentifieàla
preuvedescientificité,commedanslerévisionnismehistorien.
Danstouslescaslemilitantismedelasciencesociale–commescienceetcomme“sociale”–lametdansun
rapport difficile avec la subjectivité démocratique. L’histoiresavante s’est massivement consacréeauxtemps
prédémocratiques parceque la manière dont les mots et lesagencementsdiscursifs circulent dans l’univers
démocratiqueneseprêtepasàsesopérationsdeterritorialisationdusens.Ladémocratieesttisséedemotset
de figures quine constituent jamais une territorialisation. Non que ladémocratie soit l’errance absolue. Mais
elle est l’absence de fondement de la communauté, l’absence de corps qui installe la communauté dans sa
propre chair. Ses sujets sont toujours provisoires et locaux, ses formes de subjectivation ne sont pas des
incarnationsoudes identifications,elles sontbienplutôt des intervallesentreplusieurscorps,entre plusieurs
identités.Ladémocratien’apparaîtjamaisavecunvisage“propre”.Ellealasingularitéd’unêtreensemblesans
corps,investidansdesactesetdesfidélitéshistoriques.Cesonttoujoursdesnomsetdesactessinguliersqui
fontconsistercetêtreensembledansunesortedepolémiqueinterminableaveclesformesd’incorporation.
C’est ce qui rend difficile d’écrire une histoire sociale ou une histoire ouvrière comme histoire des temps
démocratiques. Cette histoire a affaire à des mots et à des énoncés voyageurs (ouvriers, prolétaires,
mouvementouvrier,émancipation...)quinerenvoientpasàdescorpssociauxobjectivables,àdespropriétés
etàdesactesdecescorps.Elleaaffaireàdesdésignationsquieffectuentdesmodesdesubjectivationaulieu
dedésignerdescorps,àdesclassesquinesontpasdesclasses.Onnepeutpasyappliquercesprocéduresde
territorialisationquivontchercherunlieudelaparoleducôtédegrandesétenduesmontagnardesoumarines,
quitte àlesretrouvertisséesdemots commela Méditerrannée deBraudel qui estcelled’Homère.Lessujets
démocratiquesparlenttrop,enfont tropparrapportàleurpeud’être.D’oùl’impossibilitédeterritorialiserle
lieu de leur parole et l’usage de ces résidus herméneutiques que sont les “sociabilités” ouvrières ou les
“cultures”ouvrièresoupopulaires.Cesontdeseffortsdésespérésetvainspourdonnerunechairauxmotsde
la démocratie. Il ya un défi de la démocratie à l’égard de l’écriture de l’histoire, d’où des procédures
d’évitement qui se redoublent aujourd’hui par l’effet de ces procédures politiques qui constituent ce qu’on
appellelelibéralismeconsensuel.
Démocratieetconsensus
Les événements de la démocratie ont généralement pris la figure d’une contestation de la démocratie. La
traditiondumouvementouvrier,desgrèvesdemasse,toutecettetraditionquiaétérejouéeen1968acette
particularité très étrange etqu’ilfautprendre ausérieux : ily ade ladémocratie dans la contestation de la
démocratie. Le mode d’être de la démocratie est un mode d’être en torsion à l’égard de luimême. On peut
annuler cette torsion de deux manières opposées : il y a eu l’opposition démocratie formelle / démocratie
réelle,réduisantlapremièreaustatutd’apparence,denonvéritéàsupprimerpourquelasecondeexiste,ilya
aujourd’hui laréductioninverse qui identifieladémocratieà l’Etatdedroit,lesDroitsdel’Homme,le régime
parlementaire et, au bout de la chaîne, le consensus. Pour moi la vraie démocratie, c’est précisément ce
combatdesdémocraties,ladémocratiesecontestantellemême,s’exposantàsaproprelimite.C’estpourquoi
laruinedelacontestationdeladémocratieestunechoseterriblepourladémocratie.Lorsqueladémocratie
n’estplusengagéedanslaconfrontationdesformesdesubjectivationauxmodesd’identification,brutalement
onsetrouvedevantlaquestiondecequ’elleestensonprincipe:singularitéouconsensus.
Levoyagecommeexpériencepolitique
Ilyaplusieursmanièresdevoyager.Ilyaplusieursmanièresderevenirdevoyage.Danslevoyagegauchiste,
jepensequ’ilyaeuquelquechosedefortquiaconsistéàdire:touscesmotslà,ouvriers,usine,prolétariat,
etc...doiventvouloirdirequelquechose.Ilyaunlieuoùl’ondoitvérifiercequecelaveutdire,enquelcorps
celaconsiste.Levoyageaétéimportantpourdéfairelesincarnations.Aunomd’autresincarnationsd’abord,
mais,danslamesureoùcellesciontétédécevantesetquelàoùildevaityavoirlevraicorps,iln’yavaitpas
levraicorps,l’expériencepouvaitêtreprofitable.Letoutétaitdesavoircequ’onenfaisait.Onpouvaitfairele
bilan surle moded’unempirismeraisonnable, onpouvait enfairel’armed’une dénonciation politique, disant
quetouscescorpsdesubjectivationsontfauxetqu’ilfautenrevenirauseulvraicorpspolitique,oubienau
vraicorpsdelascience. Onintégraitl’expériencedansunegrandeOdysséeaurabaisdel’expérience.Cequi
m’a intéressé a été la tentative d’inventer des formes du savoir qui gardent la mémoire du voyage comme
voyage,enparticulierdecemomentdepassageoùl’incorporationestdéniéeetoùl’onenchercheuneautre.
Ontientsurlefaitque“prolétariat”estunmotquiasonpoidsdevéritémêmesisoncorpsnesetrouvenulle
part.Lavéritédumotestd’êtreunintervalleentreplusieurscorps,unetraverséesingulièredesdésignationset
des savoirs, des multiples manières dont des mots se tissent à des choses et des savoirs, des multiples
manièresdontdesmotssetissentàdeschosesetàdesactes.
Ilyadeuxleçonstraditionnellesduvoyage:ontrouvelevraicorps(lecorpsdel’autrecommelemêmeque
luimême)etonleramène;oubienonneletrouvepasetl’onditquetoutestvanitéetqu’ilnefallaitpas
partir. J’ai essayé de faire autre chose, de conserver dans la pratique de la recherche et de l’écriture la
mémoireduvoyage,lefaitquelevoyagen’aéténiladécouvertedumêmenilarévélationdufaux.C’estun
autre voyage que j’ai entrepris vers 72/73, au moment de la retombée de l’espérance politique. Mon idée
première était quelevraicorps n’avaitpasététrouvépolitiquementen raisond’un malentenduetjevoulais
remonter par l’histoire à l’origine de ce malentendu : à l’écart entre la détermination marxienne de l’être
ouvrier et sa réalité propre. Pendant longtemps j’ai cherché un “propre” ouvrier du côté de ces formes de
territorialisationaurabaisdontjeparlaistoutàl’heure:ducôtédescorporationsdemétiers/descultures/des
formes d’enracinement originaires. Cela ne marchait pas. Impossible de voir la parole ouvrière se produire à
partir d’uncorps propresurgissant deson lieupropre.Ce quise manifestait àlaplacec’étaituneparolequi
essayaitdes’arracheràcesincarnations,deneplusparlerouvriermaisdesesubjectiversouslenomd’ouvrier
dansl’espacedelalanguecommune.J’airencontrécesexistencessuspenduesàl’impossibledevivreplusieurs
vies et la manière dont leurs singularités se rencontraient, inventaient pour le sujet “commun” ouvrier ou
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%