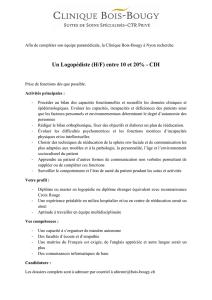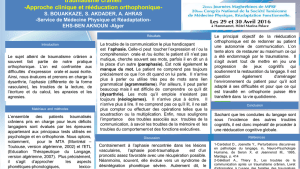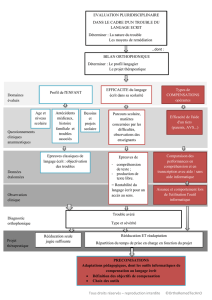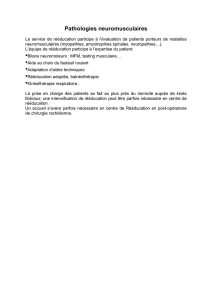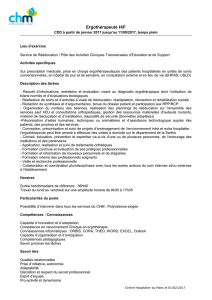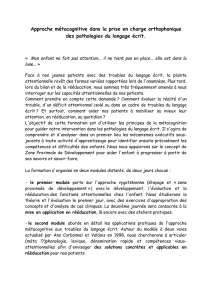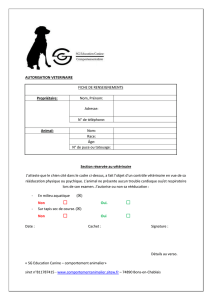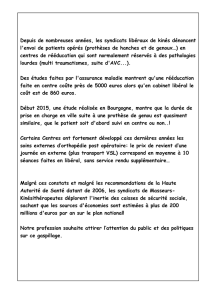Lire l`article complet

La Lettre du Neurologue - n° 3 - vol. IV - juin 2000 151
MISE AU POINT
Intérêt de la rééducation prolongée des aphasies
au décours des accidents vasculaires cérébraux
● M. Barat, J.M. Mazaux, P.A. Joseph*
l n’existe pas actuellement de position uniforme sur la
durée optimale de la rééducation orthophonique pour
aphasie vasculaire. Les traités sur l’aphasie illustrent
cette diversité d’appréciation. Roch-Lecours et Lhermitte
(1979) proposent une première tentative brève (un à deux mois)
et une poursuite de la rééducation en fonction des résultats. Tis-
sot (1980) propose l’arrêt après deux années de rééducation si
le patient ne fait plus de progrès. Sarno (1981) n’évoque aucun
délai. Ducarne (1986) et Potier (1995) indiquent une fourchette
de quelques mois – 3 mois – à plusieurs années... Basso (1990)
n’indique pas de durée mais évoque l’arrêt en l’absence d’amé-
lioration pendant deux à trois mois, sauf si une approche diffé-
rente peut être tentée. Mazaux, Lion, Barat (1995) recomman-
dent une durée de 12 à 18 mois, en signalant que des progrès
sont possibles au-delà de ce délai.
L’absence d’amélioration aux bilans successifs est le critère
le plus souvent évoqué pour justifier l’arrêt de la rééducation.
Mais, comme on le verra, cette notion ne résout la question
qu’en apparence. En effet, la plupart des bilans de langage sont
destinés au diagnostic : ils identifient le type d’aphasie et/ou le
mécanisme du trouble du langage mais n’évaluent pas les capa-
cités fonctionnelles de communication dans la vie courante.
Et pourtant, ces capacités devraient être le critère principal
d’efficacité de la rééducation orthophonique et, partant,
l’élément essentiel de décision de poursuite ou d’interruption
de la rééducation.
Ainsi, la question de la durée de la rééducation orthophonique
pour aphasie vasculaire soulève par elle-même de nombreuses
interrogations, certaines ayant un intérêt théorique, d’autres un
aspect plus pratique. Nous aborderons ces interrogations en
trois volets :
•quel est le délai postlésionnel à partir duquel il convient de
parler de rééducation prolongée dans l’aphasie ?
•quelles sont les données méthodologiques et scientifiques qui
permettent d’affirmer l’intérêt et l’efficacité de la rééducation
prolongée ?
•quelles sont les modalités pratiques de la rééducation à long
terme et pour quels objectifs ?
LE DÉLAI POSTLÉSIONNEL, OU QUAND DOIT-ON
PARLER DE RÉÉDUCATION PROLONGÉE ?
L’efficacité de la rééducation de l’aphasie au cours de la pre-
mière année n’est plus actuellement contestée. Une dizaine
d’études contrôlées prospectives randomisées confirment l’intérêt
de l’orthophonie précoce et prolongée dans l’année qui suit
l’accident vasculaire cérébral (1). Ainsi, une durée suffisante de
la rééducation effectuée par des professionnels apparaît être
une condition essentielle de cette efficacité. L’ampleur moyenne
des progrès liés à la rééducation a pu être évaluée au double de
l’évolution observée sous l’effet de la récupération spontanée (2).
* Service de rééducation neurologique,
laboratoire d’évaluation du handicap neurologique Tastet-Girard,
groupe hospitalier Pellegrin, CHU de Bordeaux.
I
■ Il n’existe pas de consensus sur la durée de la rééduca-
tion orthophonique pour aphasie vasculaire. Cependant,
l’orthophonie pratiquée pendant la première année a
clairement démontré son efficacité par rapport aux
effets liés à la récupération spontanée. Son effet est par-
ticulièrement net après le sixième mois. La rééducation
orthophonique prolongée au delà de la première année
peut se révéler utile dans les aphasies de gravité moyenne
ou sévère. Mais cette rééducation doit s’appuyer sur
des objectifs réalistes et des outils d’évaluation fonc-
tionnelle de la communication. De tels outils sont mal-
heureusement peu nombreux et mal connus des théra-
peutes. Des stages de rééducation intensive de
déficiences aphasiologiques spécifiques : manque du
mot, troubles du langage écrit, troubles de la syntaxe...
peuvent ainsi être proposés aux malades après une ana-
lyse précise des attentes et des besoins. Des thérapies
inspirées de la neuropsychologie cognitive ou de la
psychologie comportementale peuvent atténuer les
incapacités de communication et réduire le désavantage
psychosocial lié à l’aphasie plusieurs années après la
survenue de la lésion cérébrale.
POINTS FORTS
POINTS FORTS

MISE AU POINT
La Lettre du Neurologue - n° 3 - vol. IV - juin 2000
152
L’influence de la récupération spontanée postlésionnelle, dont
la durée varie selon les auteurs entre trois et six mois, est
évidemment un facteur méthodologique critique pour prouver
l’efficacité du traitement rééducatif en phase précoce ou semi-
précoce. Mais la poursuite de la rééducation au-delà de six
mois est également considérée comme un facteur déterminant
de l’amélioration et notamment pour les aphasies les plus
graves initialement (aphasies globales). Les changements sont
d’autant plus marqués que la quantité de traitement délivré est
importante (neuf à dix heures par semaine), en corrélation avec
la durée totale du traitement.
Finalement, l’approche méthodologique de l’efficacité de la
rééducation a souligné les effets observés au cours de la
première année. Au-delà, la littérature définit la période de
chronicité que l’on peut prendre comme référence pour parler
de rééducation prolongée ou tardive.
LA RÉÉDUCATION PROLONGÉE EST-ELLE EFFICACE ?
Une partie au moins des aphasiques par lésion vasculaire sem-
blent bien tirer parti d’une intervention orthophonique tardive.
Dans la période contemporaine, de nombreuses études de cas
individuels s’appuyant le plus souvent sur une analyse des
troubles inspirés de la neuropsychologie cognitive et une pro-
cédure thérapeutique de même inspiration montrent que, plu-
sieurs années après la survenue de l’aphasie, une amélioration
notable du déficit linguistique reste possible (3). Ces études
concernent essentiellement les troubles du langage écrit mais
aussi les séquelles agrammatiques et le manque du mot. Mais
ces travaux restent difficilement généralisables.
Très récemment, la méta-analyse de Robey (1) suggère une
efficacité du traitement en phase chronique, après le douzième
mois, avec une amélioration moyenne des symptômes de
l’ordre de 60 % sur l’ensemble des aphasiques. Les aphasies de
gravité moyenne ou sévère sont celles qui semblent retirer le
plus de bénéfice de cette rééducation prolongée. Pour les apha-
sies modérées, la difficulté tient à l’effet “plafond” des tests
conventionnels, alors même que des troubles invalidants
persistent, pouvant avoir un impact professionnel ou social et
être susceptibles de s’améliorer avec une rééducation prolongée.
À l’inverse, une modification d’une partie du test, sous
l’influence de la rééducation tardive d’une aphasie plus grave,
peut n’entraîner aucun bénéfice réel dans la vie de tous les
jours et ne constituer qu’une amélioration factice (4). Il est
donc indispensable d’appuyer toute décision de poursuite ou
d’interruption de la rééducation par une évaluation fonctionnelle
de la communication dans les échanges de la vie quotidienne.
Une bonne démonstration de l’efficacité de la rééducation tardive
est apportée par le travail de Brindley et al. (5),incluant des
patients présentant une aphasie de Broca, vus 18 à 130 mois
après la survenue de l’accident vasculaire. À distance de tout
effet lié à la récupération spontanée et dans une période de
stabilité psychologique et émotionnelle, le groupe de patients
ayant bénéficié d’une rééducation intensive (25 heures par
semaine) pendant une période de trois mois obtient une amélio-
ration significative non seulement des déficiences linguistiques
(troubles de la syntaxe, manque du mot) mais aussi des compé-
tences communicationnelles en échange verbal spontané (amor-
cer la conversation, poser des questions…). Mais si de tels
résultats sont conformes à notre expérience, un certain nombre
de questions restent en suspens. Comment, en effet, corréler
le niveau de “chronicité” et les capacités de récupération
tardive ? Quelle est la durée optimale du traitement intensif
et quel doit être le contenu du programme thérapeutique ? Quel
type (durée, rythme, contenu) de rééducation doit-on maintenir
après un programme intensif ?
Un autre problème, et non des moindres, est la gestion par
le médecin prescripteur comme par le thérapeute des attentes
du patient aphasique. Il est certain que la motivation très élevée
de nombre d’aphasiques pour reprendre à distance un programme
intensif doit s’accompagner d’une explication sur le réalisme
des attentes, risque de décompensation dépressive à l’arrêt du
programme et le désenchantement du retour au niveau d’une
thérapie plus conventionnelle. L’alternance, clairement expli-
quée de périodes intensives et plus allégées, semble à cet égard
souhaitable. Si de tels résultats plaident contre le principe de
la poursuite d’un traitement purement conventionnel au-delà
de la première année, la question d’une généralisation de
programmes intensifs applicables aux différentes formes
cliniques d’aphasie n’est pas actuellement réglée.
QUELLE CONDUITE PRATIQUE ?
POUR QUELS OBJECTIFS ?
La poursuite ou la reprise de la rééducation orthophonique
après un long délai d’évolution pose plusieurs problèmes
pratiques.
L’analyse de la demande : les attentes et les besoins
Le contexte dans lequel est formulée la demande de rééduca-
tion nous renseigne sur les motivations et les attentes du
patient. Lorsqu’il s’agit d’un aphasique déjà connu, dont on a
assuré la rééducation initiale, a-t-il identifié de nouveaux
besoins de communication, par exemple parce que sa situation
sociale s’est modifiée, ou considère-t-il que ses besoins actuels
ne sont pas satisfaits, que sa communication n’est pas efficace ?
A-t-il fait le deuil de son langage antérieur, ou espère-t-il encore
récupérer ? S’il s’agit d’un patient inconnu, quelle rééducation
a-t-il déjà suivie, que lui a-t-on dit, et qu’attend-il d’une reprise
de la rééducation ? Existe-t-il un changement de domicile, une
mésentente, un manque de confiance avec les thérapeutes
précédents ? Ou un déni de la stabilisation des troubles et de
leur état séquellaire ?
Et qui formule la demande : le patient ou son entourage familial ?
Le contrat d’objectifs
On ne peut pas faire de proposition concrète en réponse à ces
attentes sans actualiser le bilan de langage. On va donc rassem-
bler les données disponibles sur l’état antérieur et l’évolution
en rééducation, refaire un bilan précis et quantitatif du langage,

La Lettre du Neurologue - n° 3 - vol. IV - juin 2000 153
de la communication et des troubles cognitifs éventuellement
associés, et le comparer aux données antérieures. Les tests
standardisés et reproductibles : la version française du Boston
Diagnostic Aphasia Examination (6),le protocole Montréal-
Toulouse (7),le protocole de dénomination de Bachy-Lange-
dock (8) sont très utiles dans cette démarche. L’important est
de ne pas donner – ou de ne pas entretenir – de faux espoirs,
qui ne seraient pas confirmés par l’évolution, avec le risque de
déception et de dépression secondaire, tout en restant constructif.
On va donc, en fonction des résultats du bilan et en tenant
compte des besoins et du contexte de communication propre à
chaque patient, essayer de fixer des objectifs réalistes : si la
désintégration phonétique ou le manque du mot reste total, ou
l’aphasie globale, après un an d’évolution, il est peu probable
qu’une reprise ou une poursuite de rééducation transforme
radicalement la situation. En revanche, il est presque toujours
possible d’améliorer, ou au moins d’apprendre au patient
à exploiter au maximum ses capacités restantes en vue d’opti-
miser sa communication.
De façon schématique, en référence à la classification interna-
tionale des déficiences, incapacités et handicaps (CIDIH),
on va intervenir, chaque fois que c’est encore possible sur les
déficiences aphasiques et, simultanément, sur les incapacités de
communication qui en résultent ; dans le cas contraire, le tra-
vail fonctionnel sur la communication, l’aide à l’adaptation
sociale et le support psychologique représenteront l’essentiel
de la thérapie. C’est en ces termes, sous la forme d’un contrat
moral d’objectifs, que les propositions thérapeutiques devront
être formulées et expliquées au patient et à sa famille. Dans
certains cas, il est impossible de déterminer à l’avance si telle
ou telle déficience, tel ou tel symptôme, est encore accessible à
une rééducation spécifique. On est alors amené à proposer une
période probatoire de quelques mois, trois en général, de préfé-
rence à un rythme intensif, ou au moins soutenu, pour juger de
la réponse à la thérapie.
Rééducation centrée sur les déficiences résiduelles
Elle est difficile, car elle fait appel à des méthodes classiques
que le patient a déjà expérimentées longuement et dont il est
souvent lassé. L’art de l’orthophoniste consiste donc à varier
les tâches de langage proposées, en faisant aussi souvent que
possible appel à des techniques nouvelles pour remotiver
le patient, tout en gardant la rigueur d’une démarche scienti-
fique inspirée de la neuropsychologie cognitive : à partir des
connaissances sur l’organisation modulaire du langage chez
l’homme sain, on formule des hypothèses sur les processus
cognitifs encore capables de produire une activité neurolinguis-
tique et sur la façon de les mettre en jeu pour suppléer ceux qui
ne sont plus opérants. La rééducation de la production phono-
logique privilégie la thérapie mélodique et rythmée (9) et la
PACE (Promoting Aphasia Communication Effectiveness) (10),
qui améliore souvent l’incitation verbale et la dynamique de
l’expression en même temps qu’elle améliore la communica-
tion globale. Le contrôle des paraphasies et le traitement du
manque du mot nécessitent une analyse soigneuse du niveau où
se situe le trouble : déficit d’accès aux stocks lexicaux ou atteinte
directe de ces stocks ? Trouble de la sélection des unités phoné-
miques, défaut de leur insertion dans la matrice lexico-syn-
taxique en cours d’élaboration ou trouble “de sortie”, par
défaut de correspondance entre le programme sélectionné et les
capacités de production phonologique encore disponibles ?
L’absence de production d’un mot ou d’un son est-elle la
conséquence d’une atteinte directe des processus de production
ou d’une action d’autocensure d’un projet de production jugé
inadéquat ? Certains troubles de compréhension orale peuvent
retirer bénéfice de thérapies centrées sur la discrimination
phonémique (écoute de cassettes audio filtrées sur certaines
plages de fréquence) (11),alors que d’autres se montrent fran-
chement dépendants du contexte sémantique. Quant aux
troubles du langage écrit, ils représentent le domaine d’élection
des thérapies de réorganisation dérivées de la neuropsychologie
cognitive. Dans tous les cas, la même démarche doit être
suivie : se fixer des objectifs réalistes, axer la thérapie sur peu
de symptômes bien ciblés et bien analysés et préférer des
rythmes de thérapie intensifs sur des plages de temps relative-
ment brèves ; si possible, informer auparavant le médecin
conseil de la caisse d’assurance maladie du patient du programme
qu’on se propose d’entreprendre et des résultats attendus. Nous
pratiquons ainsi dans notre service des stages de réinduction
intensive de rééducation de l’aphasie pour des sujets soigneuse-
ment sélectionnés. Les stages durent en général trois semaines
et comportent au moins deux heures par jour d’orthophonie
individuelle et une heure de communication de groupe, ou trois
heures de thérapie individuelle. Ces stages sont ou non renou-
velés en fonction des résultats objectivement atteints,
et leur effet est prolongé par quelques mois de thérapie ortho-
phonique libérale, deux fois par semaine.
Rééducation centrée sur les incapacités
de communication (réadaptation)
et la réduction du désavantage psychosocial
Chez tous les aphasiques, le travail sur la communication dans
la vie sociale est indissociable de la rééducation orthophonique.
Le courant pragmatique s’est développé à partir de la constata-
tion déjà ancienne que “l’aphasique communique mieux qu’il
ne parle”. Des bilans de la communication de l’aphasie com-
mencent à être disponibles et aident à fixer les objectifs de la
rééducation. La PACE, précédemment évoquée, est la tech-
nique la plus classique : l’aphasique et le thérapeute doivent à
tour de rôle deviner une image cachée à partir des indications
que l’autre donne, par tous les modes de communication dispo-
nibles. L’aphasique est ainsi entraîné à développer son langage
écrit, ses mimiques et surtout son langage gestuel. Des situa-
tions de jeux de rôle, si possible par groupe de trois ou quatre
personnes, permettent aussi de recréer les conditions d’un
échange de la vie quotidienne et de travailler les postures,
les prises de parole, les gestes d’accompagnement, les renfor-
cements ou les ruptures. Le téléphone, dont l’usage est redou-

MISE AU POINT
La Lettre du Neurologue - n° 3 - vol. IV - juin 2000
154
table pour bien des aphasiques, peut être travaillé de la même
façon. Si le patient en accepte le principe, la communication socia-
le peut être testée et entraînée, en situation réelle, chez des com-
merçants proches du domicile ou du cabinet de l’orthophoniste.
Cette approche est motivante pour l’aphasique, car moins fasti-
dieuse que la rééducation technique, mais elle est parfois diffi-
cile sur le plan émotionnel, car l’aphasique se trouve confronté
à ses difficultés les plus pénibles à supporter. Le rôle de soutien
psychologique joué par l’orthophoniste et le médecin devient
alors très important, mais l’approche pragmatique des incapacités
de communication ne doit pas pour autant être assimilée à une
psychothérapie de soutien.
Dans une conception systémique des relations entre les
patients, les familles et les thérapeutes, ce rôle de soutien
devrait être étendu à la famille : partenaires principaux
et quotidiens de la communication de l’aphasique, le conjoint,
les enfants, les proches sont souvent en détresse et doivent rece-
voir autant d’explications sur l’aphasie que le patient lui-même.
Certains essais de thérapie familiale ont été rapportés, qui n’ont
évidemment pas modifié l’aphasie en tant que déficience mais
ont diminué de façon significative la souffrance de l’aidant.
D’autres auteurs essaient aussi de donner à l’entourage des
aphasiques atteints de très grandes réductions ou d’aphasie
totale un répertoire comportemental spécialisé pour lui
permettre de mieux comprendre les désirs du patient et de lui
servir d’aide, d’assistant de communication lorsqu’il est en
situation d’échec.
Le rôle irremplaçable des associations
De l’avis même des patients, rencontrer d’autres personnes
aphasiques, observer qu’elles vivent les mêmes difficultés dans
la société et, pour ceux qui ont peu de famille et peu d’amis,
avoir des occasions d’échanger, de communiquer, de nouer des
relations sociales est un grand réconfort moral face au fardeau
psychologique de l’aphasie. Regroupées en une fédération
nationale dynamique, des associations d’aphasiques sont appa-
rues un peu partout en France, et leur existence devrait être
mentionnée à tous les aphasiques. Il faut se garder d’une
démarche médicale (ou familiale) trop incitative, la décision de
prendre contact doit rester à l’entière initiative du patient lui-
même. Outre les rencontres amicales, certaines associations
organisent des ateliers plus directement ciblés sur la communi-
cation verbale : conversation, musique, théâtre, journal, infor-
matique, etc. Bien qu’il n’existe pas pour l’instant de données
chiffrées susceptibles de convaincre les médecins conseils,
nous sommes convaincus que ces activités dépassent un simple
rôle de soutien moral et ont un impact direct sur la communica-
tion des aphasiques. ■
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Robey R.R. A meta-analysis of clinical outcomes in the treatment of aphasia.
J. Speech Lang Hear Res 1998 ; 41 : 172-87.
2. Albert M.T. Treatment of aphasia. Arch Neurol 1998 ; 55 : 1417-9.
3. Buyng S. Sentence processing deficits : theory and therapy. Cognitive
Neuropsychology 1988 ; 5 : 629-76.
4. Sarno M.T. Acquired aphasia. Academic Press, San Diego 1981 ; 1 vol. : 537 p.
5. Brindley P., Copeland M., Demain C. Martyn P. A comparison of the speech of
ten chronic Broca’s aphasics following intensive and non-intensive periods of
therapy. Aphasiology 1989 ; 3, 8 : 695-707.
6. Mazaux J.M., Orgogozo J.M. Échelle d’évaluation de l’aphasie. EAP. Issy-les-
Moulineaux 1985.
7. Nespoulous J.L., Joanette Y., Lecours A.R. Protocole Montréal-Toulouse
MT 86. L’ortho-Édition Isbergues 1993.
8. Bachy-Langedock N. Batterie d’examen des troubles en dénomination. Editest
Bruxelles 1989.
9. Van Eeckhout Ph., Meillet-Haberer M., Pillon B. Apport de la mélodie et du ryth-
me dans quelques cas de réduction sévère du langage. Reed Orthoph 1979 ; I : 20-4.
10. Davis G.H., Wilcox M.J. Adult aphasia rehabilitation : applied pragmatics.
College-Hill Press Inc. San Diego 1985.
11. Darriet D., Pointreau A., Moly J.P. et al. Approche neuro-acoustique dans la
rééducation des troubles d’intégration auditive chez les cérébrolésés. Revue de
Neuropsychologie 1992 ; 2 : 459-60.
1. Parmi les propositions suivantes, une seule est juste.
A-L’aphasie vasculaire est définitivement stabilisée à la fin de
la première année postlésionnelle.
B-L’orthophonie pour aphasie vasculaire n’a pas d’effet supé-
rieur à la récupération spontanée postlésionnelle.
C-Les bilans usuels de langage pour aphasie n’explorent pas les
capacités fonctionnelles de communication.
D-Au delà de la première année, il est inutile de prescrire de la
rééducation orthophonique pour aphasie vasculaire.
E-Les thérapies inspirées de la neuropsychologie cognitive
s’adressent essentiellement à la dépression réactionnelle.
2. Sur quels critères doit-on justifier une rééducation ortho-
phonique prolongée pour aphasie vasculaire ?
A-La demande de l’entourage du malade ;
B-L’amélioration des tests à 2 bilans trimestriels successifs ;
C-Une atteinte du langage écrit accessible à une thérapie
d’inspiration cognitive ;
D-Une possibilité de communication alternative en cas
de réduction massive de l’expression orale ;
E - Un état dépressif sévère de l’aphasique.
AUTO-ÉVALUATION
AUTO-ÉVALUATION
Réponses : 1. C 2. B, C, D
1
/
4
100%