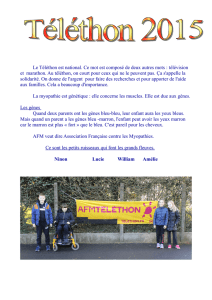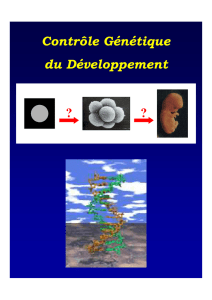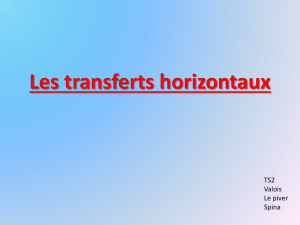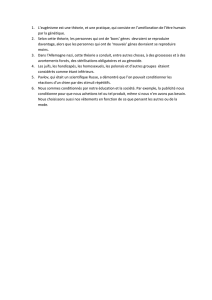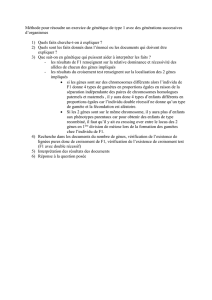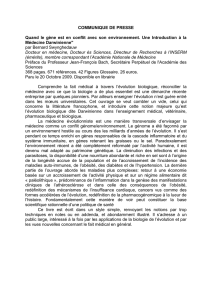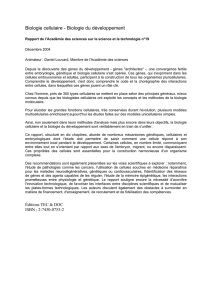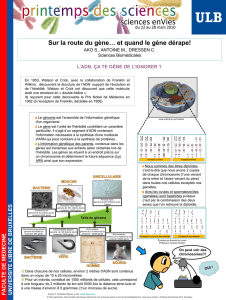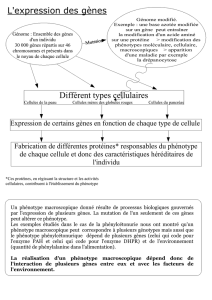Le vivant, unique et divers : un paradoxe pour l` étude de son

1
Le Vivant, unique et divers :
un paradoxe pour l’étude de son développement et de son évolution
Nicole Le Douarin,
Secrétaire perpétuelle
Académie des Sciences
26 novembre 2002
L’immense diversité des êtres vivants qui peuplent notre planète, leur adaptation remarquable aux
conditions de vie que le milieu leur impose ont, de tout temps, suscité l’émerveillement.
Elle coexiste avec une remarquable unité. On le sait, depuis qu’on se rendit compte au XIXème
siècle (en 1838 avec la formulation de la théorie cellulaire), que l’unité de base de tous les êtres
vivants est la cellule : tous se composent de cellules, naissent d’une cellule et descendent
probablement d’une même et unique cellule que l’on a baptisé de l’acronyme LUCA : Last
Universal Common Ancestor ou ultime ancêtre commun universel.
Cette image d’une grande unité s’est encore renforcée lorsque la génétique a révélé qu’un code
commun constitué à partir de quatre bases, contrôle la production de protéines faites de vingt acides
aminés, les mêmes pour tous !
Mais, ce que la biologie a aussi révélé c’est la stupéfiante variété de processus et d’interactions
dont dépendent l’existence des individus et la multiplicité des espèces.

2
Le constat qui s’impose est donc celui d’une incroyable complexité et diversité et les énigmes
qu ‘elles soulèvent constituent les défis de la Biologie contemporaine.
L’explication la plus immédiate de ce qu’on appelle aujourd’hui la Biodiversité a longtemps été
que les formes vivantes ont jailli telles que nous les voyons de l’imagination des Dieux.
Aristote, le premier grand naturaliste et grand observateur dont les écrits sont parvenus jusqu’à
nous distinguait, en dépit de la diversité, une continuité du monde vivant : la nature, selon lui, procède
“ des objets inanimés, aux plantes et aux animaux en une séquence ininterrompue ”.
Reprise par de nombreux auteurs, sa thèse fut à l’origine du concept de scala naturae ou
Grande Chaîne des Etres souvent représentée, à sa base, par des objets inanimés, à son sommet par
l’homme (voire des anges à forme humaine), alors qu’entre les deux étages extrêmes étaient rangés
les plantes et les animaux dans un ordre de complexité croissante.
Aristote était résolument fixiste. La graduation qu’il voyait dans le monde était de nature purement
statique. La hiérarchie des êtres qu’elle proposait reproduisait celle des valeurs, elles-mêmes
inscrites dans l’Harmonie de l’univers. La puissance de synthèse qui marquait cette vision n’a sans
doute pas été pour peu dans la prépondérance des positions anti-évolutionnistes au cours des 2000
ans qui ont suivi.
Il est intéressant de noter qu’en partant de données voisines de celles sur lesquelles s’appuyait
Aristote, les penseurs du XVIIIème siècle allaient plutôt défendre une position évolutionniste. En
effet, à la notion de Création s’est substituée progressivement l’idée d’une évolution continuelle de la
vie à l’origine même de la diversification des formes vivantes.
Cela tient aux conceptions différentes du monde dont se réclament respectivement les Anciens et
les Modernes. Alors que la civilisation de l’Antiquité valorise l’Eternel et s’attache à une hiérarchie
immuable, le siècle des Lumières croit au progrès de la raison, des techniques et des mœurs. Il
trouve sa justification dans l’idéal d’un futur qu’il faut inventer et réaliser.
Lamark fut le premier à proposer une théorie cohérente de l’évolution des espèces (qu’il appelait
d’ailleurs la transmutation). Les variations des conditions du milieu extérieur sont une
constatation objective. Les organismes, pour survivre, doivent s’y adapter par de nouvelles activités
physiologiques : d’où un usage accru de certaines capacités et, le cas échéant, le désinvestissement,

3
voire l’abandon de quelques autres. Ces efforts individuels induisent des changements
morphologiques et fonctionnels qui se transmettent à la descendance, grâce à l’hérédité des
caractères acquis. Ainsi, tout se passe comme si la volonté divine ou l’Harmonie de la nature, qui
présidait aux tableaux fixistes des espèces, se trouvait transposée dans l’effort fait par les individus
en vue de s’adapter. Cette percée géniale vers une reconstruction évolutionniste de l’histoire
naturelle doit encore beaucoup, on le voit, aux conceptions statiques antérieures. Elle apparaît
comme une projection, dans l’histoire inconsciente des espèces, des valeurs qui guident la volonté
rationnelle des hommes.
Une révolution majeure est intervenue avec Darwin puis les néodarwiniens pour qui les
changements affectant le patrimoine héréditaire des organismes sont le fruit du hasard. L’ordre de la
vie émerge de la rencontre contingente entre des mutations aléatoires et un environnement changeant.
Celui-ci intervient secondairement et d’une manière indirecte, par le jeu de la “ sélection naturelle ”
qui retient parmi ces variations celles dont la possession confère aux individus un avantage dans leur
capacité de se reproduire et donc de perpétuer ces innovations. Ainsi la sélection darwinienne se
présente comme un filtre à travers lequel ne passent et finalement ne survivent que celles des formes
produites au hasard, qui sont non seulement viables mais capables de s’adapter aux conditions du
milieu. Seules les mutations compatibles avec la survie des embryons et leur développement jusqu’au
stade adulte auront la chance d’être soumises aux forces de la sélection naturelle.
Développement et Evolution sont donc des sciences étroitement liées. Leurs interrelations
sont si grandes qu’a émergé récemment sinon une nouvelle discipline, du moins un nouveau chapitre
de la Biologie qu’avec le goût actuel pour les abréviations on appelle “ EVO-DEVO ”.
L’intrication étroite des mécanismes du développement embryonnaire et de ceux de l’évolution
des espèces était clairement apparue déjà au XIXème siècle, période de bouillonnement des idées
où se trouvent les racines de la biologie d’aujourd’hui.
Ainsi, la ressemblance frappante entre embryons d’espèces distinctes, comme la présence de
fentes branchiales chez les embryons de tous les vertébrés, même ceux qui n’en n’ont jamais l’usage
comme les mammifères, était considéré par Darwin comme un argument en faveur de l’évolution.
Dans les années 1860, le physiologiste allemand Ernst Haeckel, fervent admirateur de Darwin,
alla plus loin et formula sa “ théorie de la récapitulation ”. Chacun connaît sa formulation canonique :

4
“ l’ontogenèse récapitule la phylogenèse ”. Autrement dit, les stades précoces du développement
présentent, d’une manière accélérée, des formes semblables à celles qu’ont les adultes des espèces
qui sont à l’origine du groupe auquel appartient l’individu considéré. Le développement
embryonnaire est donc une répétition abrégée de l’évolution de l’espèce dont la mémoire a été
conservée par l’hérédité.
Aux critères morphologiques sur lesquels reposaient la classification des espèces, se sont ajoutés,
depuis l’avènement de la biologie moléculaire, d’autres moyens pour étudier la biodiversité. Ainsi la
comparaison des séquences de gènes appartenant au fonctionnement de base de la cellule et de ce
fait communs à tous les êtres vivants, constitue une méthode largement utilisée de nos jours. Elle met
en évidence les changements génétiques accumulés dans le génome et peut constituer une mesure du
temps passé depuis la divergence des espèces étudiées et permettre ainsi de reconstituer l’histoire
des espèces.
Depuis les années 1980, les recherches qui ont été entreprises pour connaître les bases
biochimiques de la diversification des êtres vivants ont abouti à des résultats largement inattendus :
là où on s’attendait à trouver des variations on a trouvé une extraordinaire conservation, une absence
de changement dans la fonction et la structure des mécanismes cellulaires , y compris ceux qui sont
impliqués dans la genèse des changements évolutifs. Ainsi, les mécanismes moléculaires qui président
à l’établissement du plan d’organisation de tous les métazoaires à symétrie bilatérale (les Bilateria)
reposent sur la mise en œuvre de gènes dont, non seulement la séquence et le rôle mais aussi
l’arrangement spatial au sein du génome sont étonnamment semblables dans des espèces aussi
éloignées qu’une mouche et une souris.
L’exemple le plus frappant est celui des gènes homéotiques ainsi appelés car, lorsqu’ils sont
mutés ils sont responsables du phénomène d’homéosis , qui n’est autre que la substitution d’une
partie du corps par une autre. Les premiers cas d’homéosis ont été décrits en 1894 par le généticien
anglais Bateson. Ainsi, chez le mutant Antennapedia de la Drosophile, les antennes sont remplacées
par des pattes. Chez certains autres mutants, les segments du thorax sont anormalement distribués
générant des mouches munies de 4 ailes au lieu de 2 à cause de la répétition du 2ème segment
thoracique qui se substitue au 3ème lui-même dépourvu d’aile.

5
Un début d’explication de ces curieuses mutations a été fourni tout d’abord par l’analyse
génétique approfondie accomplie à l’Institut Californien de Technologie, depuis 1947 jusque dans
les années 1970 par Edward Lewis.
Lewis a découvert que plusieurs gènes capables de provoquer des mutations homéotiques sont
présents dans le génome de la Drosophile où ils sont étroitement liés, alignés sur le même
chromosome et responsables chacun de la spécification d’une partie déterminée du corps de
l’insecte. Ces gènes agissent ensemble mais selon un ordre spatio-temporel fixé correspondant à la
fois à leur disposition sur le chromosome et au territoire embryonnaire où ils sont activés le long de
l’axe antéropostérieur de l’embryon. Une colinéarité spatiale et temporelle est ainsi établie entre
l’organisme en formation et cette infime partie du génome qui en commande l’ordonnance. Ce
phénomène est si frappant qu’il a amené certains auteurs à considérer cette ébauche virtuelle codée
dans le génome comme la matérialisation de l’homunculus imaginé par les Préformationistes des
XVII et XVIIIème siècles.
Découverts chez la Drosophile, les gènes homéotiques contiennent un domaine particulièrement
homogène dans la séquence nucléotidique appelée homeobox qui, traduite en protéine, génère un
homéodomaine qui se lie aux promoteurs d’autres gènes et contrôle ainsi leur propre
transcription.
L’homeobox et l’homéodomaine, découverts par Walter Gehring en Suisse (membre associé
étranger de notre Académie) et Mathew Scott aux Etats-Unis, sont donc le dénominateur commun
d’un ensemble de gènes contrôlant le développement assignant aux différentes régions du corps leur
identité et leur spécificité. On les a, pour cette raison, appelés “ gènes du développement ” ou gènes
Hox en se référant à la présence de l’homeobox.
Ces homologies entre différents gènes évoquaient l’hypothèse de Lewis selon laquelle la variété
des gènes homéotiques résultait de la duplication d’un petit nombre de gènes ancestraux.
L’hypothèse fut vérifiée avec éclat quand il apparut que la même séquence contenue dans le dernier
exon du gène Antennapedia se trouvait sous une forme très voisine dans d’autres gènes
homéotiques du complexe Hox de la Drosophile découverts par Lewis à partir de ses expériences
de génétique classique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%