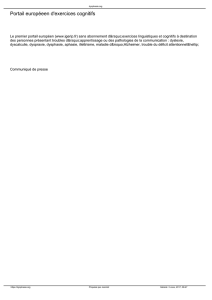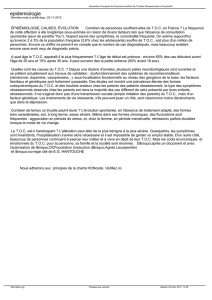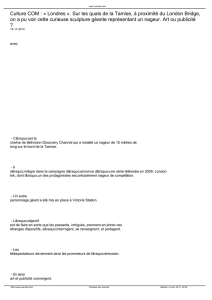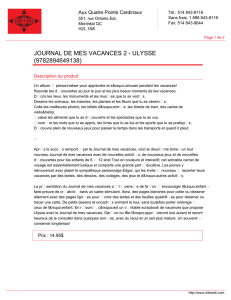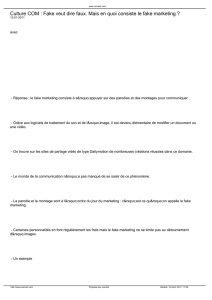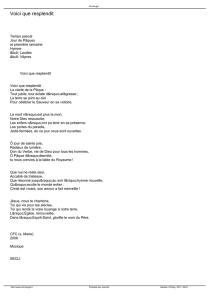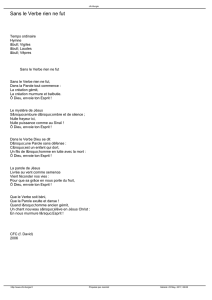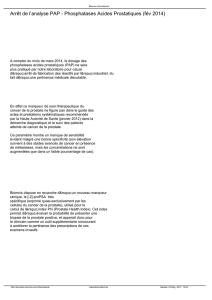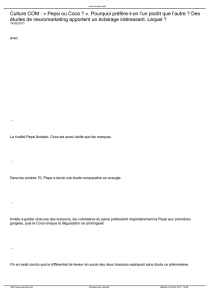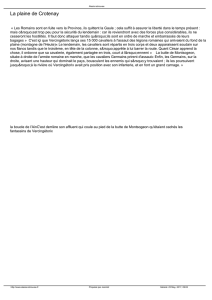Santé - mizania

Santé
17-08-2008
Dernière mise à jour : 10-05-2009
Santé 10 octobre Journée mondiale de la santé mentale.
Actus 2009 : Avril 2009 Le Ramed ne sera pas généralisé en 2009 comme prévu La
généralisation du Régime d’assistance médicale aux économiquement démunis (Ramed) n’aura pas
lieu en octobre 2009, comme il était initialement prévu. Et pour cause, l’expérience pilote lancée
officiellement en novembre 2008 dans la province de Tadla-Azilal devra faire l’objet d’une évaluation
avant son extension aux autres régions du Royaume. Le comité interministériel chargé du suivi du Ramed chargera
un cabinet d’expertise étranger sélectionné suite à un appel international de réaliser une étude. D’une
durée de 2 à 3 mois, estime-t-on, ce travail, qui doit commencer en septembre prochain, permettra d’évaluer
l’expérience pilote en vue de recommander, éventuellement, des correctifs à apporter.
Selon des sources proches du dossier, les aspects évalués dans le cadre de cette étude sont les critères de
sélection et d’identification de la population éligible au Ramed ainsi que les moyens matériels et humains
nécessaires à la généralisation du système de couverture médicale à l’ensemble du pays. Par ailleurs, les
experts devront aussi dire si la généralisation se fera de façon progressive ou pas. Tout cela pousse à constater que
les populations démunies des autres régions du pays devront attendre pour bénéficier de l’assistance
médicale, du fait que les conclusions de l’étude ne pourront pas être rendues avant décembre. Par ailleurs,
le calendrier de l’évaluation de l’expérience pilote ne manquera pas de décevoir le patronat qui avait
préconisé, préalablement à l’extension de l’AMO aux soins ambulatoires prévue pour octobre prochain,
la généralisation du Ramed, dans le souci d’éviter le détournement de l’assurance maladie, prévue
pour les salariés, au profit des économiquement démunis, ce qui risque d’avoir un impact sur sa pérennité.
Contactés par nos soins, certains patrons, notamment des assureurs, qui, rappelons-le, demandent un report de
l’extension de l’Amo, se disent conscients que «la décision finale revient aux pouvoirs publics, mais ils
doivent prendre les mesures nécessaires pour préserver l’équilibre du régime de la couverture médicale et
éviter d’éventuels dérapages pouvant compromettre l’Amo». 450 000 démunis identifiés à Tadla-
Azilal Répondant à cela, les pouvoirs publics soulignent qu’«il n’y a jamais eu de date butoir pour la
généralisation du Ramed et cette opération prendra le temps qu’il faudra et se fera selon la procédure retenue
par le comité interministériel chargé du suivi». Cette nouvelle est très mal accueillie dans le milieu syndical qui était
déjà, il faut le rappeler, contre un démarrage progressif. «A ce rythme, nous pensons que l’entrée du Ramed
s’étalera sur plusieurs années alors qu’il s’agit d’une urgence !» , déplorent les
représentants de plusieurs syndicats, joints au téléphone par La Vie éco, qui tiennent à préciser que la démarche
adoptée par les pouvoirs publics ne fait que défavoriser une tranche de la population marocaine par rapport à une
autre. Aujourd’hui, 30 000 personnes démunies bénéficient du Ramed dans la région de Tadla-Azilal où 450
000 démunis ont été identifiés depuis le démarrage de l’expérience pilote. On retiendra également,
d’après les dernières statistiques du ministère de la santé, que 5 699 cartes ont été distribuées (400 à 500
cartes par semaine), dont 5 296 à Béni-Mellal. Le premier bilan dans la région révèle que 2 984 patients ont déjà
bénéficié des soins dans les différents hôpitaux de la région. C’est l’hôpital de Béni-Mellal qui a
accueilli le plus grand nombre de patients avec 1 859 personnes contre 458 à Azilal, 288 à Fquih Bensalah et 379 à Kasba-
Tadla. Cette assistance médicale a nécessité, selon les statistiques du ministère de la santé, une enveloppe de 2,6
MDH. On rappellera qu’un budget de 18 MDH est alloué au lancement pilote du Ramed dans cette région où le
ministère de la santé a également renforcé les moyens et les infrastructures sanitaires. La région doit en effet
réaménager le centre de formation des carrières de santé et mettre en place deux centres de dialyse grâce à un
investissement de 10 MDH. Le ministère a également affecté 70 professionnels dans la région.
Rappelons qu’au niveau national, la population concernée par le Ramed s’élève, selon les dernières
estimations à 10 millions de personnes. Elle devrait bénéficier d’une prise en charge à hauteur de 90% des soins,
chirurgie et hospitalisation au sein du système de santé publique. AMO : 70% des Marocains n’ont pas
un médecin de famille 70% des assurés n’ont pas de médecin de famille, parmi ceux qui en ont, 65% vont
parfois consulter un autre médecin. Seuls 24% des professionnels de santé affirment l’existence d’un
suivi médical des assurés. Même le carnet de santé n’est pas intégré dans ce suivi. L’absence de
ce livret est expliquée par sa non-distribution ou encore l’impression qu’il est inutile. C’est ce qui
ressort du premier baromètre national de l’Anam (Agence nationale de l’assurance maladie) sur
l’accès aux soins et le suivi médical des assurés sociaux Cnops et CNSS, réalisé en 2008. Notons que
l’AMO couvre environ 34% de la population soit 10,5 millions de bénéficiaires, dont 6,5 millions auprès de la
Cnops et de la CNSS.
Déboursement, tarifs, procédures... motifs d’insatisfaction D’après l’enquête de
l’Anam, la principale difficulté dans l’accès aux soins est le déboursement direct élevé par les
assurés. Ils sont 31% à le penser. Seuls 6% des assurés trouvent que la part restant à charge de l’assuré (ticket
modérateur) est un autre obstacle à l’accès aux soins. La liste ne s’arrête pas là. La différence des tarifs
appliqués pour les consultations et les soins médicaux par rapport aux tarifs conventionnels, ainsi que la complexité
des procédures administratives pour les prises en charge figurent aussi parmi les motifs d’insatisfaction des
assurés. La prise en charge préalable des frais des soins par les organismes gestionnaires n’est utilisée que
pour 7% des prestations de soins rendues. L’Anam précise que le mode de financement des soins, le plus
courant, est le paiement direct en vue d’un remboursement, suivi du financement personnel sans
MIZANIA
https://www.mizania.com Propulsé par Joomla! Généré: 2 June, 2017, 22:28

remboursement. Les professionnels de santé estiment que le respect des tarifs nationaux de référence est important
pour les assurés sociaux.
Manque d’information Les assurés sont satisfaits de l’accueil au guichet des organismes
gestionnaires. En revanche, le principal besoin ressenti, tant par les assurés que par les professionnels de santé,
concerne l’information et la prévention des maladies. L’enquête révèle que les producteurs de soins
n’ont pas tous une bonne connaissance des prestations de l’assurance maladie et particulièrement des
modes de remboursement des médicaments. Les assurés, eux, ne connaissent pas la base de ce remboursement.
La principale force de l’AMO est la couverture des pathologies coûteuses. Le délai de remboursement des frais
engagés est jugé satisfaisant. Les Marocains préfèrent les spécialistes Les structures médicales sont
d’abord choisies pour leur spécialisation, puis ensuite la maladie à traiter, la qualité des soins ou encore les
conseils apportés par un médecin. Les assurés s’adressent plus directement à des médecins spécialistes (9
sur 10) qu’à des médecins généralistes (7 sur 10). 3 assurés sur 5 consultent la plupart du temps un
médecin différent. Près de 70% des producteurs de soins exerçant en structures hospitalières publiques ou privées et
44% de ceux exerçant en cabinet affirment que 70% des patients sont fidèles envers leur médecin. D’après
les producteurs de soins, les trois quarts des assurés sociaux AMO sont capables d’honorer leurs frais de
soins de santé. Ils sont 61% qui pensent que les prestations de l’assurance maladie ont eu un effet positif sur
l’accès de la population aux soins.
Ce baromètre établit un ensemble d’indicateurs qui évaluent l’accessibilité aux soins de santé des
assurés AMO et le suivi médical dont ils font l’objet. Objectif: relever les situations qui doivent être corrigées.
Le baromètre Anam est basé sur 2 enquêtes : auprès des assurés sociaux Cnops et CNSS et auprès des
producteurs et établissements de soins. Profils 72% des assurés CNSS ont un revenu net inférieur à 3.000 DH,
dont plus d’un tiers ont moins de 2.000 DH. Ce pourcentage n’est que de 28% pour les personnes
interrogées assurées à la Cnops qui ont aussi un revenu net inférieur à 3.000 DH. 89% vivent dans des appartements
ou des maisons marocaines et 83% ont au moins un enfant à charge. L’enquête a ciblé 64% d’hommes
et 36% de femmes. 82% sont actifs et 18% retraités. Il y a eu un échantillon représentatif de fonctionnaires (67%) et
de salariés du secteur privé (28%). La grande majorité des répondants de l’enquête bénéficie de
l’assurance maladie depuis au moins 2 ans. Suppression de la TVA sur les anticoncéraux : il faudra
patienter pour avoir les nouveaux prix La mesure a été adopté par le projet de loi de fiance 2009 : Plus de TVA
(7%) sur les médicaments anti-cancéreux et les produits traitant l’hépatite B et C. Côté prix rien n'a bougé.
Les raisons : - La direction du médicament attend toujours le retour des labos sur les prix tenant compte de la
suppression de la TVA - Une fois tous les prix validés, un arrêté du ministère de la santé fixant les nouveaux Prix
Public Maroc ( PPM) sera publié - Mais ce n'est pas fini, il faudra que les labos liquident tous les stocks existants
des médicaments concernés comportant l’ancien PPM.
Les gains pour le patient Un médicament coûtant 140 dirhams actuellement, affichera 130 dirhams après la
suppression de la TVA. Cela dit, le gain pour le patient pourrait être plus conséquent quand on sait que les
traitements anti-cancéreux coûtent entre 27 000 et 50 000 DH et ceux de l’hépatite 2 000 DH. Les prix de
ces traitements devraient connaître d’autres baisses d’ici 2011 puisqu’ils seront d’ici là, pour
ceux importés d’Europe, totalement exonérés des droits de douane quand il n’y a pas de génériques
fabriqués localement. Remboursement : la Cnops s’aligne enfin sur la tarification de l’Amo
C’est à partir d’août 2009 que la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (Cnops), en
charge des fonctionnaires, adoptera la tarification nationale de référence (TNR) mise en place suite à l’entrée en
vigueur de l’Assurance maladie obligatoire (Amo). Certes, l’alignement des tarifs se fait
conformément au principe de la progressivité de l’application du TNR, mais il est aussi édicté par la nécessité
de relever le niveau de la tarification pratiquée par la Cnops. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Amo,
cet organisme remboursait ses assurés sur la base d’un tarif (dit de responsabilité) arrêté à 15 DH pour la
consultation chez un généraliste et à 25 DH pour la consultation chez un spécialiste, soit largement en dessous des
pratiques du marché. Le tarif de responsabilité était appliqué, il faut le rappeler, à une liste limitative de prestations
médicales dont principalement la consultation de cardiologie, les soins et prothèse dentaire, les soins infirmiers
pratiqués par un infirmier ou une sage-femme, les actes pratiqués par un orthopédiste, un kinésithérapeute ou un
orthophoniste. Pour les autres prestations médicales, la Cnops avait continué d’appliquer ses propres tarifs.
Suite à l’entrée en vigueur de l’Amo en février 2006, les organismes gestionnaires (Cnops et CNSS) ont
signé des conventions nationales avec les producteurs de soins. C’est ainsi que les honoraires des praticiens
ont été fixés à 80 DH pour un généraliste et 150 DH pour un spécialiste.
La Cnops devant rembourser 80 % de la facture et ne pouvant, en raison de l’impact financier sur son
équilibre financier, appliquer immédiatement la TNR, la caisse avait obtenu de son conseil d’administration et
de l’Agence nationale de l’assurance maladie (Anam) l’autorisation d’appliquer un tarif de
transition afin de pouvoir passer, conformément à la loi 65-00 réglementant le nouveau régime de couverture médicale,
aux tarifs de référence. Ce qui lui fut accordé en mars 2007. Depuis et jusqu’au mois d’août prochain,
la Cnops rembourse ses adhérents sur la base de 40 DH pour la consultation chez un généraliste et de 60 DH pour
un spécialiste... Selon une étude réalisée par la caisse, l’incidence financière de l’application de la
TNR serait de 131 MDH. Des derniers chiffres communiqués, on révèle que la Cnops a liquidé, depuis le
démarrage de l’Amo en 2006, 12,9 millions de dossiers dont 2,5 millions en tiers payant et 10,4 millions en
soins ambulatoires. Ce qui a nécessité des paiements de l’ordre de 6,8 milliards de DH, dont 3,7 milliards en
tiers payant. Ses responsables tiennent à préciser que la TNR n’est pas toujours respectée par les praticiens
dont les honoraires dépassant, dans certains cas, les 80 et 150 DH fixés. Pour se défendre, le milieu médical
MIZANIA
https://www.mizania.com Propulsé par Joomla! Généré: 2 June, 2017, 22:28

avance, que les tarifs retenus ne correspondent pas à la réalité. Une problématique qui pourrait être dépassée avec
la révision de la tarification qui est actuellement à l’étude au niveau de l’Anam. Cigarette au
collège : état des lieux Ces dernières années, l’usage de la cigarette prend de l’ampleur, notamment
parmi les jeunes collégiens et lycéens aussi bien garçons que filles. Les responsables de la santé sont inquiets des
conséquences de cette situation sur les élèves. «Le tabac fait le lit de la consommation des drogues, particulièrement
chez les jeunes», souligne un médecin de la santé scolaire à Rabat. Ce dernier rappelle que le tabagisme et
l’usage de drogues sont parmi les causes principales de certains cancers. Un audit tabac a été lancé dans
un premier temps dans 5 régions du pays. Il s’agit de Fès-Boulemane, Marrakech-Tensift-El Haouz, Meknès-
Tafilelt, Rabat-Salé-Zemmour-Zaër et Souss-Massa-Draâ. Cette étude de terrain a été initiée par l’Association
Lalla Salma de lutte contre le cancer en partenariat avec les ministères de l’Education nationale et de la Santé
dans le cadre du projet «collèges, lycées et entreprises sans tabac». Selon les premiers résultats de cette étude,
lancée au début de l’année scolaire 2008/2009, la région de Rabat reste la zone la moins touchée avec le
taux de prévalence le plus faible enregistré qui est de 1%. La région du Souss vient en tête avec un taux de 3%
suivie de celle de Meknès avec 2,7%. Pour Rabat, cette étude a touché les élèves de la 1ère année du collège et
du lycée appartenant à 10 établissements scolaires dans les 4 provinces de la région. L’effectif global de cet
échantillon, d’un âge moyen de 15 ans, s’élève à 3.976 élèves avec un taux de participation de 98,10%.
Selon cette enquête, le nombre des élèves fumeurs est de 71 dont 15 filles. Ce qui donne un taux de prévalence
chez les garçons plus élevé, soit 3,2% contre 0,8% chez les filles. Mais on doit signaler que ces dernières
commencent à goûter à la cigarette à un âge précoce: 12,9 ans contre 13,5 ans chez les garçons. Cependant, ces derniers
fument plus de cigarettes, soit une moyenne de 8,4 unités par jour contre 6,2 chez les filles. Ce qui nécessite une
dépense quotidienne de l’ordre de 16 DH par jour. Les élèves interrogés sont très conscients des effets
néfastes du tabac sur leur santé (96%) et les parents ainsi que les médias restent les moyens de sensibilisation les
plus efficaces. 28 élèves ont pu arrêter de fumer et 77,6% ont l’intention de le faire dans le futur proche. On
retient aussi que 43,7% des élèves fumeurs ont au moins un frère ou une sœur qui fume. Pour les parents et les
amis, les taux sont respectivement de 46,5% et 60,6%. Les accouchements désormais gratuits dans tous les
hôpitaux publics Un nouveau pas vient d’être franchi pour la réduction de la mortalité maternelle et
néonatale. Depuis un mois, en effet, le ministère de la santé a instauré la gratuité des accouchements dans toutes les
structures sanitaires publiques du pays que sont les hôpitaux provinciaux et préfectoraux ainsi que les maisons
d’accouchement. Tous les actes liés à l’accouchement, que ce soit par voie basse ou par césarienne,
sont inclus dans cette gratuité. Il est à rappeler que les tarifs appliqués jusqu’alors dans le secteur public étaient
de 500DH pour un accouchement normal et 1 200 DH pour une césarienne. Selon le ministère de la santé, les
établissements de santé publique effectuent chaque année environ 400 000 accouchements sur les 650 000 qui ont
lieu. Près de 2 femmes sur 3 accouchent en fait dans les hôpitaux publics. Pour renforcer les kits
d’accouchement déjà disponibles dans les structures sanitaires, le ministère procédera à la distribution de
trousses complètes de césarienne. Par ailleurs, il s’attaquera à un autre aspect problématique de la prise en
charge des femmes enceintes en milieu rural : le transport qui les empêche très souvent d’accéder aux
hôpitaux. Des services d’aide médicale urgente (SAMU) obstétricaux seront mis en place pour assurer le
transport des mamans et des nouveaux-nés en difficulté vers les hôpitaux. Ce projet qui est en cours de finalisation
nécessitera un investissement de l’ordre de 60 MDH. Toujours pour élargir la couverture médicale, 66
communes urbaines et rurales se verront doter de nouvelles infrastructures d’accouchement équipées pour
accueillir les femmes enceintes ainsi que les nouveaux-nés. Les travaux de construction ont été annoncés par la
ministre de la santé, début mars. Ils seront entamés incessamment dans les villes de M’rirt, Demnate,
Tamesna, Tamansourt, Laâyoune et Imintanoute. Les unités compteront 45 lits chacune. D’autres
établissements ouvriront leurs portes dans les prochains jours à Berrechid, Guercif, Oulad Taïma et à Khemis Zemamra.
L’ensemble de ces investissements visent une amélioration de la couverture médicale afin que le taux de
femmes enceintes, aussi bien en milieu rural que dans les villes, bénéficiant d’une consultation prénatale et
d’un accouchement en milieu surveillé passe de 80% en 2009 à 90% en 2012. L’objectif du ministère
de la santé est de ramener le taux de mortalité maternelle de 227 décès pour 100 000 naissances à 50 pour 100 000
en 2012, et de baisser le taux de mortalité infantile de 40 décès pour 1 000 à 15 pour 1 000, à la même échéance.
Mars 2009 Greffe de cornée au Maroc : pour une facilitation des procédures d’importation du
greffon « Nous, les ophtalmologues du privé, vivons dans une impasse. Le législateur marocain nous donne le droit
de pratiquer la greffe de la cornée, mais nous interdit de la prélever d’un cadavre ou de l’importer. Et
cela nous empêche de répondre à une demande de plus en plus croissante», estime le Dr Abdellatif Badaoui,
président de la Société marocaine d’implantologie et de chirurgie réfractive (Samir), dont l’une des
priorités est la relance de la greffe de cornée au Maroc. C’est d’ailleurs le thème principal de son 4me
congrès qui a lieu les 20 et 21 mars à Casablanca. La Samir veut lancer un débat national en y conviant le ministère
de la santé, le législateur, les religieux, les ophtalmologues publics, privés et universitaires et les médias, car le
constat est alarmant. On dénombre chaque année 3 000 à 3 500 personnes malvoyantes ou aveugles et qui
n’ont pour seule chance de retrouver la vue qu’une greffe de cornée. «Nous voudrions que, dans un
premier lieu, la loi nous permette d’importer les cornées. Pour le moment, seul le Centre hospitalier
international Cheikh Zaid dispose de cette autorisation qui lui permet de réaliser 100 greffes par an. Mais cela ne
représente que 3 à 5% de la demande», précise le Dr Badaoui. De leur côté, les responsables du ministère de la santé
rétorquent que chaque centre agréé pour la greffe de cornée peut importer le greffon sur simple demande
d’autorisation faite au ministère de la santé. Une pareille demande reçoit généralement une réponse
favorable. Et pour illustrer une facette de la problématique de la greffe de cornée au Maroc, le Dr Badaoui,
MIZANIA
https://www.mizania.com Propulsé par Joomla! Généré: 2 June, 2017, 22:28

ophtalmologue depuis plus de 20 ans à Casablanca, évoque un exemple édifiant. Celui de dizaines de jeunes femmes
qui se présentent à une consultation d’ophtalmologie au Maroc, en implorant qu’on leur sauve les yeux
d’un kératocône qui leur coûterait la vue, et on leur propose d’aller se faire opérer en France ou en
Tunisie. Aujourd’hui, «nous avons les moyens techniques et les compétences humaines pour que cette
opération soit faite chez nous, il faudra que les autorités nous accompagnent en adoptant la loi et surtout en planifiant
et organisant des campagnes d’information sur les bénéfices du don d’organes et de tissus», souligne
le président de la Samir. La CNSS et la CNOPS doivent se désengager des prestations de soins au plus tard
en 2010 3 années après son lancement effectif, l’Assurance maladie obligatoire est en train de passer à un
palier supérieur en matière d’application de la loi. Ainsi, en plus de son extension aux soins ambulatoires, un
autre chantier reste ouvert, à savoir le désengagement des gestionnaires des régimes, en l’occurrence la Caisse
nationale de sécurité sociale (CNSS) et la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS), de
leurs activités de prestataires de soins. En effet, l’article 44 de la loi 65-00, portant code de l’Assurance
maladie obligatoire, accordait un délai de 3 ans à la CNSS pour se désengager de la gestion de ses 13 polycliniques
et à la CNOPS de se dessaisir de sa pharmacie. Mais, au préalable, les deux organismes doivent trouver des
gestionnaires pour ces activités. Ce qui n’est pas encore le cas aujourd’hui. Et c’est
d’ailleurs pour cette raison que les deux gestionnaires ont demandé une prolongation de 2 ans du délai
transitoire accordé par l’article 44 afin de mettre en place les nouveaux schémas de fonctionnement. Le délai,
pour les deux organismes, expire en 2010, auront-elles suffisamment de temps pour trouver de nouveaux
gestionnaires ? A la CNSS, où le chantier de la gestion déléguée des polycliniques est à l’arrêt depuis
quelques mois, on relance le dossier afin de le boucler avant août 2010. La Caisse prépare donc un 2ème appel
d’offres international sur la base d’une nouvelle vision du projet. Celle-ci a procédé à une restructuration
de ses unités de soins par le biais d’une spécialisation des sites et de l’élargissement de l’offre
des soins notamment en introduisant de nouvelles spécialités jusqu’ici inexistantes dans les polycliniques. Par
ailleurs, la CNSS a investi 100 millions de dirhams pour l’équipement des plateaux techniques des unités
sanitaires. Cette réorganisation a donné ses fruits puisque, selon les dernières statistiques, les polycliniques ont
enregistré en 2008 une croissance de 20% de leur activité par rapport à 2007. Et le chiffre d’affaires global a
atteint 400 millions de dirhams. La CNOPS envisage la mise en place d’une centrale d’achat
C’est pourquoi la CNSS exige aujourd’hui, contrairement à sa position lors du lancement du premier appel
d’offres, que l’opérateur médical soit adossé à un groupe financier. Elle souligne que plusieurs groupes
internationaux, pour la plupart en partenariat avec des financiers marocains, ont manifesté leur intérêt pour la gestion
déléguée des polycliniques. La majorité d’entre eux avaient soumissionné au premier appel d’offres
au terme duquel avait été retenu le groupe espagnol USP Hospitales qui, après plusieurs mois de négociations avec
la CNSS, s’est finalement désisté. Si la CNSS semble être bien avancée sur son dossier, la CNOPS, pour
sa part, est au stade de la réflexion afin de trouver, pour sa pharmacie, un schéma de gestion qui continuera à assurer
l’accès aux médicaments à ses assurés. Deux pistes sont aujourd’hui envisagées : mettre en place une
commission de gestion de la pharmacie ou alors d’une centrale d’achat regroupant les acheteurs
institutionnels publics, privés, civils ou militaires afin de pouvoir négocier des prix avantageux. Car le premier souci, dit-
on auprès de la CNOPS, est de continuer à acheter les médicaments à un prix accessible afin de ne pas mettre en
déséquilibre le régime. Aujourd’hui, la pharmacie bénéficie d’une réduction de 40% sur les prix des
médicaments. Les achats de la pharmacie ont atteint, en 2008, un montant de 356 millions de dirhams et portent
essentiellement sur les produits coûteux destinés au traitement des pathologies lourdes (cancer, hépatite, dialyse,
etc.). Les deux formules proposées seront étudiées au niveau de la CNOPS et discutées avec les pouvoirs publics
avant de trancher, sachant que la décision doit être prise avant août 2010, date d’expiration de la période de
grâce accordée à la CNOPS par son conseil d’administration en décembre 2008. Exercice de la
médecine: Ce qui va changer Le projet se fixe comme objectif d’adapter la loi au progrès de la pratique
médicale et aux profondes mutations du système de santé. Il s’agit aussi de rendre le système plus attractif
pour l’investissement national et étranger. D’ailleurs, sur ce registre, un verrou va sauter avec la
disposition relative à la libéralisation du capital des cliniques. aujourd’hui, la clinique doit appartenir à une
personne physique à condition qu’elle soit médecin et qu’elle en assure personnellement la direction
médicale. Demain, les choses vont changer. Ainsi, une entreprise de droit marocain, quel que soit le type (civil
lorsqu’il s’agit de professionnels, ou commerciale), pourra également posséder une clinique. Idem pour
toute autre personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif, comme une fondation ou une association.
Le texte comprend une disposition qui distingue la fonction de directeur médical chargé de l’organisation des
soins et celle de gestionnaire pouvant être non médecin. Dans le même élan, le projet supprime du champ des
cliniques les centres de thalassothérapie. Le Temps plein aménagé (TPA) n’est pas en reste. Cette
disposition est accordée aux médecins universitaires et aux professeurs chercheurs en vue de pratiquer dans le
privé des actes chirurgicaux et des interventions médicales à raison de 2 demi-journées par semaine. Dans la pratique,
certains l’utilisent abusivement, au point que des médecins spécialistes privés dénoncent cette «concurrence
déloyale». Le ministère de la Santé veut remettre de l’ordre dans la pratique du TPA. Donc, il maintient le
système tout en réservant cet «exercice exclusif dans une clinique universitaire relevant d’organismes à but non
lucratif comme l’hôpital Cheikh Zaïd de Rabat et Cheikh Khalifa de Casablanca». «En cas d’inexistence
d’une clinique universitaire, la pratique se fera intra-muros dans les conditions et suivant les modalités
définies par le ministère de la Santé». le projet de Yasmina Baddou compte introduire la possibilité de développer le
partenariat public/privé en matière de prestations de soins et de services. Les modalités seront définies par décret.
Le projet s’intéresse également au cabinet médical avec l’introduction de nouvelles modalités
MIZANIA
https://www.mizania.com Propulsé par Joomla! Généré: 2 June, 2017, 22:28

d’exercice en commun. En effet, le texte prévoit la constitution de cabinets de groupe et la possibilité donnée à
un médecin d’accepter la collaboration d’un confrère qui n’a pas d’adresse
professionnelle. Il accorde la possibilité de recourir à des médecins assistants en cas de maladie ou pour des besoins
de santé publique. C’est le cas de l’affluence de la population pendant les périodes estivales. La
période étant limitée à 3 mois. Il est à rappeler que le texte veut clarifier la notion de clinique: «On entend par clinique
au sens de la présente loi, quelle que soit sa dénomination ou le but lucratif ou non, tout établissement de santé
privé ayant pour objet d’assurer des prestations de diagnostic, de traitement ou de soins aux malades, blessés
et parturientes dont l’état de santé nécessite une prise en charge appropriée à leur état de santé dans le
cadre de l’hospitalisation y compris l’hôpital de jour». L’établissement assimilé à une clinique est
également redéfini. Il s’agit ainsi «des centres d’hémodialyse, de radiothérapie, de curiethérapie, de
chimiothérapie, de cathétérisme et tout autre établissement privé de santé qui reçoit des patients pour une période
supérieure ou égale à un jour et dont la liste est fixée par l’Administration». Dans certaines régions reculées
ou non attractives pour les médecins marocains, le recours à leurs homologues étrangers peut être la solution.
D’ailleurs, le projet introduit de nouvelles exigences et quelques assouplissements. Pour cela, il sera impératif
de lier le lieu d’exercice aux besoins du pays sur la base de la carte sanitaire et des schémas de l’offre
de soins. De même, il faudra ouvrir la possibilité d’installation aux étrangers ayant exercé dans un service
public, soit à titre bénévole ou dans le cadre d’un contrat de recrutement pendant une durée minimum de 3 ou 5
ans. Cette même possibilité sera donnée aux médecins étrangers nés au Maroc et ayant poursuivi et obtenu des
diplômes marocains. Le texte insiste sur l’obligation de souscrire à une assurance au Maroc. Pour le reste, il
maintient les conditions actuelles d’exercice de la médecine par les étrangers. Ces derniers doivent résider sur
le territoire national, ou être conjoints de citoyens marocains et n’avoir pas été condamnés au Maroc ou à
l’étranger pour l’un des faits touchant à la morale. Un hôpital Cheikh Zaïd à Casablanca
L’unité de Casablanca sera réalisée selon le même modèle que Cheikh Zaïd à Rabat. Cet ouvrage sera
implanté à Hay Hassani, près de l’ancien aéroport d’Anfa, sur une superficie de 65.000 mètres carrés.
L’enveloppe consacrée à la réalisation du projet s’élève à 100 millions de dollars, soit près de 860
millions de DH, un don des Emirats arabes unis. La Fondation Cheikh Khalifa, qui pilote cette opération, mise sur le
système de péréquation. En pratique, elle a réservé 10 millions de dollars pour réaliser des locaux commerciaux qui
doivent permettre d’alimenter financièrement la Fondation. Ces ressources serviront à subventionner les soins
dispensés aux démunis. L’hôpital aura, dans un premier temps, une capacité de 280 lits. Des possibilités
d’extension futures sont prévues. Le plateau technique comporte 13 salles d’opération. Selon le
professeur Charif Chefchaouni Al Mountassir, DG du centre hospitalier Ibn Sina et membre de la Fondation, le projet a
identifié 7 pôles d’excellence: cancérologie, pathologies cardiovasculaires et cérébrales, urgentologie, greffe
d’organes et prise en charge des brûlés. Le projet prévoit une école de médecine, avec 4 amphithéâtres
pour dispenser de la formation aux paramédicaux, aux infirmiers et aux techniciens de radiologie et de laboratoire.
Une formation continue au profit des médecins est également programmée. L’AMO étendue aux
soins ambulatoires C’est tranché. La CNSS élargira la couverture médicale à l’ambulatoire avec
l’exclusion des soins dentaires. La décision a été entérinée lundi 16 mars par son conseil
d’administration. Cette extension ne s’accompagnera pas d’une augmentation des taux de
cotisations. Et ce, même si dans les scénarios de la Caisse, la mise en place de cette formule implique une charge
supplémentaire de 0,14%. D’autant plus que les salariés qui bénéficient de l’article 114, disposant
d’une couverture privée, ne sont pas pris en compte. Le cas échéant, la CNSS va puiser dans les réserves
constituées et qui tourneraient autour de 5 milliards de dirhams. Du moins selon un responsable à la Caisse. Le conseil
d’administration s’est fixé le délai de 2012-2013 pour rediscuter d’une éventuelle couverture des
soins dentaires, le poste le plus coûteux dans les soins médicaux. Une décision qui devrait au préalable faire
l’objet d’une étude de l’Anam. L’accord du patronat est conditionné par deux
préalables: la mise en place d’un mécanisme de régulation et de contrôle au niveau de l’Agence
nationale de l’assurance maladie (ANAM) et la généralisation du Ramed. Dans le premier cas, la régulation
permettra de suivre de près le système pour prévenir aux éventuels déficits, et dans le deuxième, la généralisation
du Ramed évitera la fraude. Ce dernier dispositif devrait, en principe, être étendu début janvier 2010. Quant aux
décrets d’application de l’extension de l’AMO, ils pourraient être prêts fin 2009. Les textes
devant être validés par le Conseil de gouvernement et le Conseil des ministres avant leur publication au Bulletin
officiel. Autre élément ayant favorisé cet élargissement à l’ambulatoire, les dispositions contenues dans la
convention d’Agadir signée en 2005 par les partenaires. Celle-ci prévoit qu’une année après
l’entrée en vigueur de l’AMO, une étude doit être menée par l’Anam pour son extension. A la
CNSS, l’élargissement de la couverture de base aux soins ambulatoires s’accompagnera d’un
redimensionnement et d’une réorganisation des services. Il est également question d’une révision des
procédures de travail et de l’adaptation du système d’information. Tablant sur une accélération de la
consommation des prestations AMO, la Caisse compte réorganiser son contrôle médical. Pour cela, elle compte
acquérir un outil informatique et la mise en place d’une nouvelle organisation et de nouvelles procédures. Elle
prévoit aussi le recrutement d’une cinquantaine de nouveaux collaborateurs. L’Amo couvrira les soins
ambulatoires à partir d’octobre prochain Le coût moyen par dossier est fixé à 700 dirhams et augmentera de 5%
annuellement entre 2009-2013. Depuis le démarrage de l’Amo, la CNSS a dégagé un excédent annuel de
1,7 milliard Ce qui va changer : L’Amo avant l’extension à l’ambulatoire Couverture de 41
pathologies lourdes. Prise en charge de l’enfant âgé de moins de 12 ans. Suivi de la maternité. Taux de
remboursement à hauteur de 70 % lorsque les patients se soignent dans une clinique et 99% dans un hôpital.
MIZANIA
https://www.mizania.com Propulsé par Joomla! Généré: 2 June, 2017, 22:28
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%