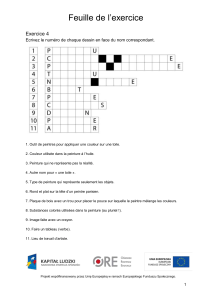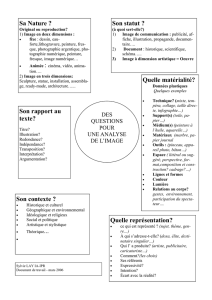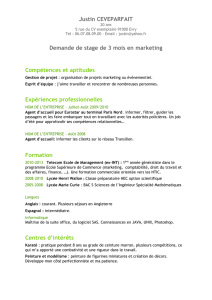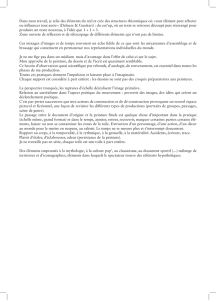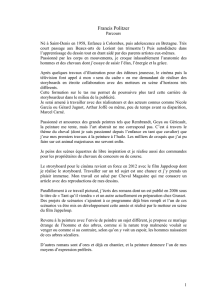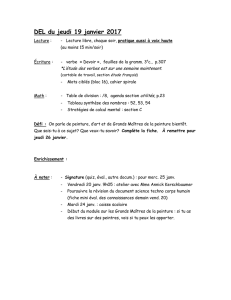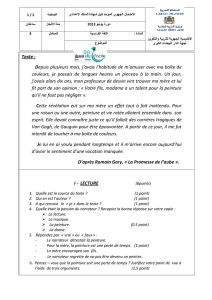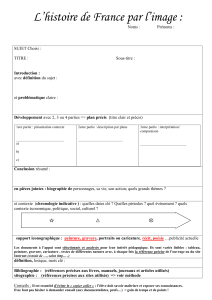Prélude Lettre à Daniel Arasse



ON N’Y ENTEND RIEN

Du même auteur :
L'escalier dans le cinéma d'Alfred Hitchcock.
Une dynamique de l'effroi, mars 2008.
L'escalier ou les fuites de l'espace.
Une structure plastique et musicale, novembre 2005.
© L’Harmattan, 2010
5-7, rue de l’École-polytechnique ; 75005 Paris
http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmatta[email protected]
ISBN : 978-2-296-13878-0
EAN : 9782296138780

Lydie Decobert
ON N’Y ENTEND RIEN
Répétitions
Essai sur la musicalité dans la peinture
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%