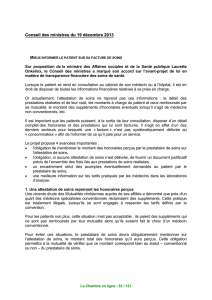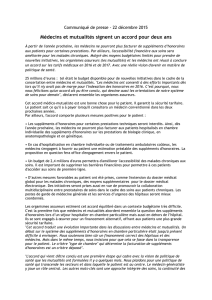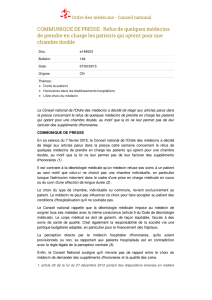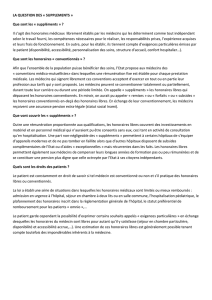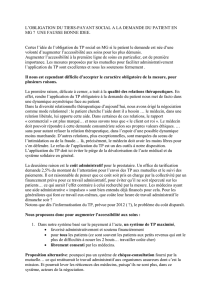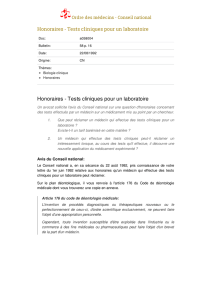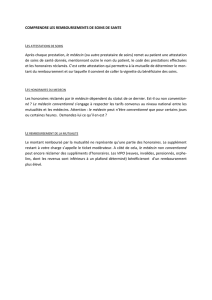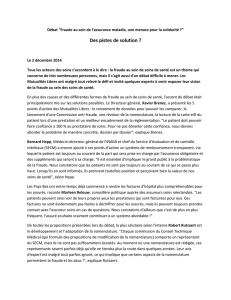Décembre 2013 - Mutualité chrétienne

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
Belgique
France
Norvège
Danemark
Allemagne
Royaume-Uni
OCDE
A l’occasion des 50 ans de l’assu-
rance maladie-invalidité obliga-
toire, la MC a voulu faire le point.
Depuis sa création en 1963, l’assu-
rance maladie-invalidité (AMI) a
beaucoup évolué: elle s’est pro-
gressivement étendue à toutes
les tranches de la population, a dû
faire face à différentes crises qui
ont remis son fonctionnement en
cause mais elle n'a jamais perdu
de vue son objectif : offrir des soins
de santé accessibles et de qualité
au plus grand nombre d'assurés
possible.
Financement des prestations de soins en Belgique
Evolution du nombre de lits pour 100 000
habitants 2000-2011 (OCDE)
Ambulatoire
COÛT DE LA PROCÉDURE FORFAIT/ALL IN BUDGET
Personnel Frais d'hébergement
Honoraires médicaux Infrastructure Frais inrmiers
Matériel médical Médicaments
Matériel à usage unique
Nomenclature BMF
Hospitalisation
MC-Informations
Analyses et points de vue
Périodique trimestriel de l’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes 254
décembre 2013
La
solidarité,
c’est bon pour la santé.
MUTUALITE
CHRETIENNE

2
Éditorial
Dans le cadre de notre série d'articles consacrés aux 50 ans
de l'AMI, nous nous penchons dans ce numéro sur le passé,
le présent et l'avenir de l'assurance soins de santé obligatoire,
et plus spéciquement sur la nomenclature des prestations
médicales, l'un de ses fondements. En raison de l'augmentation
croissante des coûts induite par le vieillissement de la
population, la recrudescence des maladies chroniques (un
Belge sur quatre aujourd'hui!), l’innovation technologique et
l'utilisation de techniques et de médications plus onéreuses, le
développement de la médecine prédictive et la multiplication
de campagnes de prévention coûteuses, les coûts du personnel
croissants ou les (trop?) grandes attentes du public, il existe
plus que jamais une nécessité de se doter d'une assurance
obligatoire nancièrement avantageuse et solidaire.
Cette augmentation des dépenses peut être partiellement
compensée par une meilleure rationalisation. Nous avons en
effet aujourd'hui encore trop d'hôpitaux et une concentration
des soins insufsante, un trop grand nombre de lits, une
consommation trop élevée de médicaments et de certains
examens techniques (coûteux), des différences de revenu
trop importantes entre les médecins, un nancement des
prestations trop élevé et des soins pas toujours effectués au
niveau le plus approprié. De nouvelles réformes, aussi bien au
niveau de la nomenclature, des prescriptions de médicaments,
du nancement des hôpitaux, de l'organisation de la première
ligne et des soins des seniors seront notamment nécessaires
an de pouvoir garantir l'accessibilité et la qualité de notre
assurance soins de santé.
La che-info aborde la réforme de l’intervention majorée à partir
du 1.1.2014 an d'améliorer l'accessibilité des soins aux groupes
les plus vulnérables. Comme il y a 50 ans, nous devrons rester
attentifs an de ne pas voir apparaitre une médecine à deux
vitesses. Même si un rapport de l'OCDE estime la contribution
personnelle du patient en Belgique à environ 25 %, ce qui
constituerait une menace à l'accessibilité, nous ne disposons
pas de chiffres précis dans ce domaine. La MC a donc réalisé
une étude an de connaître l’importance des suppléments que
paie un patient auprès d'un médecin spécialiste conventionné
et non conventionné. Il ressort d'une autre étude que nous avons
menée préalablement que le patient en Belgique est certes
satisfait de la qualité des soins de santé qui lui sont offerts,
mais qu'il n'a pas connaissance de ce qu'il doit payer à un
spécialiste ou à un dentiste et qu'il trouve parfois ces montants
trop élevés. 10 % des personnes interrogées disent s'être déjà
privées de soins de santé pour raisons nancières. L'étude que
nous vous présentons aujourd'hui nous apprend que la plupart
des médecins respectent les tarifs conventionnés et que même
une petite moitié des spécialistes non conventionnés s'y tient
également pour la facturation de leurs consultations. Hélas, il
y a également des spécialistes conventionnés qui demandent
en moyenne 9 EUR de supplément. Tous les patients ont un
intérêt à ce que le plus grand nombre possible de médecins
(et de préférence tous) soient conventionnés et à ce qu'ils
respectent les tarifs convenus. Pour les non-conventionnés, les
suppléments s'élèvent en moyenne à 13,5EUR, mais avec de
grandes disparités entre les spécialistes. An d'enn connaître
avec exactitude ce que doivent personnellement débourser le
patient et les mutualités en Belgique pour chaque consultation,
et pouvoir prendre ainsi les mesures éventuelles qui s'imposent,
il existe un besoin manifeste d'une plus grande transparence.
Les auteurs de l'étude concluent qu'en 50 ans, l'AMI et le
modèle de concertation ont apporté bien des éléments positifs.
Nous entendons poursuivre dans cette voie en continuant la
négociation d'accords an d'améliorer ce qui doit l'être et
garantir ainsi la continuité de soins de santé de qualité pour
les patients. Pour y parvenir, il serait appréciable qu'au terme
de la réforme de l'État, les mêmes parties prenantes dirigent de
façon analogue la politique des soins de santé dans les entités
fédérés et ce, dans l'intérêt des patients.
Michiel Callens
Directeur R&D
2MC-Informations 254 • décembre 2013

50 ans AMI
Passé, présent et futur de l’assurance maladie-
invalidité obligatoire
Naïma Regueras, Recherche et Développement
Résumé
A l’occasion des 50 ans de l’assurance maladie-invalidité obligatoire, la MC a voulu faire le point. Depuis sa
création en 1963, l’assurance maladie-invalidité (AMI) a beaucoup évolué: elle s’est progressivement étendue
à toutes les tranches de la population, a dû faire face à différentes crises qui ont remis son fonctionnement
en cause mais elle n'a jamais perdu de vue son objectif : offrir des soins de santé accessibles et de qualité
au plus grand nombre d'assurés possible.
Aujourd'hui encore, le contexte économique et politique de notre pays met notre système de Sécurité
Sociale à mal. Si nous savons depuis longtemps déjà que nous devrons trouver des solutions pour assurer
le nancement à long terme de ce système, la 6ème réforme de l'Etat amène aussi avec elle son lot de dés.
Dans cet article nous retraçons l'histoire de l'assurance maladie-invalidité et exposons les dés auxquels
elle fait face actuellement. Finalement, nous avons aussi voulu formuler des propositions quant à l'avenir
de l'assurance obligatoire car les dés seront nombreux : assurer un nancement à long terme de notre
système de soins, pouvoir offrir des soins abordables, accessibles et de qualité en veillant particulièrement
à la situation des plus vulnérables et adapter notre offre de soins aux besoins de personnes nécessitant de
plus en plus des soins de longue durée.
En effet, c’est le 28 décembre 1944 que le Sécurité Sociale voit
le jour et avec elle le Fonds National d’Assurance Maladie-
Invalidité ancêtre de l’actuel Institut National de l’Assurance
Maladie-Invalidité (INAMI). Historiquement, la Belgique, au
même titre que la France et les Pays-Bas, a construit son
système de protection sociale sur base du modèle bismarckien,
d’inuence allemande, qui diffère du modèle beveridgien
d’inuence britannique.
Quels sont les grands principes qui distinguent les deux
systèmes ? Dans les système d’inuence bismarckienne, le
nancement se fait largement par des cotisations sociales (des
employeurs et des travailleurs) proportionnelles au salaire.
De même, les allocations octroyées (allocation de chômage,
d’invalidité, etc.) sont proportionnelles à la rémunération
perdue. On induit ainsi une solidarité forte entre actifs et
inactifs, malades et bien-portants (tout un chacun participe
au nancement en fonction de ses moyens et reçoit une
indemnisation en fonction de sa perte). Concernant la gestion de
ce modèle, la logique adoptée est la suivante: puisque ce sont
les employeurs et les travailleurs qui nancent le système de
1. Introduction
L’assurance maladie-invalidité obligatoire fête cette année ces
50 ans d’existence. A l’instar des couples qui fêtent leur noces
d’or, l’heure du bilan est arrivée. Nous avons aujourd’hui vécu
assez longtemps avec elle pour pouvoir l’analyser avec recul et
apprendre aussi tant de nos erreurs que de ce que nous avons
accompli avec succès. Cependant, l’objet de cet article n’est
pas seulement de retracer l’histoire de l’assurance obligatoire
mais également de nous tourner vers l’avenir car, dans un
contexte qui est loin d’être rose, il est fondamental de pouvoir
offrir une perspective solide pour le futur de cette assurance.
2. Petit rappel historique
Bien que nous fêtions aujourd’hui les 50 ans de l’assurance
maladie obligatoire dans notre pays, l’histoire de sa création
ne commence pas au 9 août 1963. Si en Belgique, les débuts du
mouvement mutualiste et l’apparition des premières caisses de
secours mutuels datent de la n du 19ème siècle, c’est à la n de
la deuxième guerre mondiale que sera ofciellement créée la
Sécurité Sociale belge.
3
MC-Informations 254 • décembre 2013

protection sociale, ce sont eux-mêmes qui devront en assurer
la gestion. En Belgique, la Sécurité Sociale est donc co-gérée
par les employeurs (représenté par les syndicats d’employeurs)
et les salariés eux-mêmes (représentés par les syndicats des
travailleurs) dans un système de gestion paritaire. De la même
façon, les différentes branches de la Sécurité Sociale sont co-
gérées par tous les acteurs impliqués.
Au contraire, les systèmes d’inuence beveridgienne sont
quant à eux universels et se donnent pour mission d’assurer
une même protection minimale à tous les citoyens (tous le
monde reçoit la même chose). Ils prévoient des allocations
forfaitaires identiques pour tous. Le nancement se fait par
l’impôt, et le système est principalement et directement géré
par l’Etat (puisque c’est l’Etat qui nance, c’est l’Etat qui gère).
La Belgique s’étant construite autour de ce modèle de gestion
paritaire d’inspiration bismarckienne, c’est tout naturellement
que la gestion de l’Assurance Maladie-Invalidité fut coné
aux organismes assureurs ainsi qu’aux syndicats (travailleurs
et employeurs) et aux représentant des prestataires de soins
plutôt qu’à l’Etat. Dans ce contexte, de nombreux acteurs
considéraient qu’il convenait de coner l’organisation et la
gestion de cette nouvelle assurance aux mutualités qui avaient
le mérite de disposer d’un réseau bien distribué sur l’ensemble
du pays et d’une expérience non-négligeable dans le domaine.
Dans ce modèle, les besoins sociaux ne sont donc pas xés
‘aveuglément’ par le marché (libéralisme) ou par un appareil
d’état extensif (socialisme), mais il s’exprime sous forme de
dialogue au sein de la concertation sociale.
L’avantage d’un tel système est également qu’il permet
d’assurer une certaine continuité dans le temps. En effet,
dans les pays où le système de santé est intégralement géré
par l’Etat, l’orientation de la politique de santé peut basculer
rapidement au gré des changements dans la composition de
l’appareil dirigeant (gouvernement plus à droite ou à gauche)
sans que les acteurs de terrain aient leur mot à dire. Au
contraire, notre système a permis de maintenir une grande
stabilité en impliquant les partenaires de terrain durant les 65
ans d’existence de l’assurance maladie. Bien que les temps
aient changé et que la médecine ait évolué, les dés restent
les mêmes: comment pouvons-nous, en relation étroite avec
la population et ses besoins, garantir l’accès pour tous à des
soins de santé de qualité?
Mais pourquoi fêtons-nous alors les 50 ans de l’assurance
maladie-invalidité?
A sa création en 1944, l’AMI couvrait les risques de maladie
et d’invalidité des travailleurs salariés et de leur famille
uniquement. C’est la loi du 9 août 1963 (loi Leburton) qui
va scinder l’AMI en deux secteurs distincts : les soins de
santé et les indemnités, le tout chapeauté par un organisme
parastatal: l’Institut National de l’Assurance Maladie-Invalidité
et permettre d’élargir l’assurance soins de santé à toute la
population instaurant ainsi un système d’assurance maladie
obligatoire. Concernant le secteurs des indemnités, la priorité
était de garantir un revenu de remplacement aux travailleurs
salariés mis en incapacité pour cause de maladie ou d’accident.
C’est aussi dans le cadre de cette loi que sera instauré le statut
VIPO (veufs, invalides, pensionnés, orphelins) garantissant
une protection contre les risque de santé à ces tranches plus
vulnérables de la population.
La loi de 1963 introduisit également le système de négociations
d’accords entre les mutualités et les prestataires de soins
(accords médico-mutualistes). Tous les deux ans, les
représentants des mutualités (garantes de l’équilibre nancier
de l’assurance maladie) et des prestataires de soins se
réunissent pour xer le niveau des tarifs (ou honoraires) que
les prestataires de soins sont invités à pratiquer pour les deux
années qui suivent, le but étant de garantir la sécurité tarifaire
du patient et de pouvoir garder le budget de l’assurance
soins de santé sous contrôle. En effet, sans ces accords, les
prestataires de soins seraient entièrement libres de xer leurs
tarifs, ces derniers pouvant donc uctuer très fortement d’un
prestataire à l’autre ou d’une année à l’autre. De plus, l’accord
médico-mutualiste xe également le niveau des avantages
perçus par les prestataires si ceux-ci décident d’adhérer à
l’accord. Les tarifs xés par les dentistes sont xés dans un
autre accord mais suivant le même principe (accord dento-
mutualiste).
3. Les grandes évolutions depuis 50 ans
3.1 Les années 60 et l’élargissement de la couverture de
l’assurance maladie-invalidité
Chronologiquement, le champ d’application de l’assurance
soins de santé fut d’abord élargi aux indépendants, uniquement
pour les ‘gros risques’ en 1964 et pour les ‘petits risques’ en
2008 seulement ! En effet, ce n’est qu’en janvier 2008 que
l’assurance libre ‘petits risques’, couvrant les consultations
médicales, les soins dentaires, les soins paramédicaux et
les médicaments ambulatoires, a été intégrée au sein de
l’assurance maladie obligatoire. A ce moment-là, 80 % d’entre
eux étaient déjà couverts pour les petits risques grâce à une
souscription à une assurance facultative auprès de leur
mutualité. Cette intégration a permis à tous les indépendants
et leurs personnes à charge d’être couvert de sorte qu’il n’y
a plus de différence entre salariés et indépendants quant aux
soins de santé remboursés par l’assurance maladie obligatoire.
Les cotisations sociales que versent les indépendants à leur
caisse d’assurance sociale ont été adaptées pour intégrer ces
nouveaux droits.
Elle fut ensuite élargie successivement aux fonctionnaires
(1965), aux handicapés physiques (1967), aux handicapés
mentaux (1968), aux travailleurs domestiques (1969) et aux
membres du clergé et communautés religieuses (1969). Par son
extension aux «personnes non encore protégées » en 1969,
l’assurance soins de santé couvrit enn une très large partie
4MC-Informations 254 • décembre 2013

de la population. L’assurance indemnités d’incapacité de travail
obligatoire pour les indépendants verra elle le jour en 1971.
3.2 L’introduction de la quote-part personnelle en 1972
Dans les années 1970, l’impact des deux crises pétrolières
et la montée du chômage ont fait entrer le pays dans une
période d’austérité. Dans le secteur des soins de santé, il
fallait maximiser l’accès aux soins de qualité sous contrainte
de ressources budgétaires. C’est dans ce contexte qu’ont été
introduits les premiers tickets modérateurs ou quotes-parts
personnelles dans le coût des soins.
Le ticket modérateur est la différence entre le tarif ou l’honoraire
prévu par les conventions et ce qui est remboursé par la
mutualité pour les prestations chez le médecins, à l’hôpital,
pour les médicaments, etc. Le ticket modérateur peut varier
fortement d’une prestation à l’autre, entre les secteurs et selon
qu’une personne bénécie ou non d’une intervention majorée
de l’assurance maladie. Il s’agit donc d’une intervention
nancière directement à charge des patients.
L’objectif du ticket modérateur consiste à responsabiliser le
patient par rapport à sa consommation de soins et à éviter
qu’il « abuse du système ». Bien que différents système de
protection tels que l’intervention majorée et le maximum
à facturer aient été mis en place pour garantir un meilleur
accès aux soins de santé aux populations plus vulnérables,
on observe malheureusement que l’existence de tickets
modérateurs constitue un frein à l’accès aux soins pour toute
une série de personnes. Selon la dernière enquête réalisée par
la MC à l’occasion des 50 ans de l’assurance soins de santé,
11% des Belges doivent reporter des soins pour des raisons
nancières. Cela concerne principalement les personnes en
invalidité (31%), au chômage (28%) et des isolés avec enfants
(23%).
En conclusion, bien que l’intervention nancière du patient
permette de conscientiser celui-ci au coût des soins de santé,
elle ne peut avoir pour conséquence que certains groupes de
patients reportent des soins. Le système de santé doit donc
encore être amélioré en tenant compte de cette problématique.
3.3 Renforcement de l’accessibilité nancière en 1997
En Belgique, à partir de la n des années 90, des mesures
ont progressivement été introduites pour pallier au fait que
l’assurance soins de santé ne couvre que partiellement les
coûts en matière de santé (en moyenne 25 % des frais de soins
de santé restent à charge du patient), ce qui constitue une réel
problème pour les populations plus vulnérables, tant sur le plan
nancier que sur celui de la santé.
Ainsi, le statut VIPO permettant d’être mieux remboursé pour
la plupart des soins médicaux (hospitalisation, honoraires
médicaux, médicaments...) a-t-il été élargi en 1997 à de nouvelles
catégories de bénéciaires. Rebaptisé BIM (bénéciaire de
l’intervention majorée), ce statut a été complété, en 2007, par
Omnio, un statut permettant aux ménages à revenus modestes
de bénécier aussi des remboursements préférentiels. Dans la
même optique, le tiers payant (qui permet au patient de ne pas
devoir avancer les frais de santé à l’hôpital ou en pharmacie
et de payer uniquement sa quote-part) a été étendu aux
consultations et visites chez le médecin pour les patients à
faibles revenus (c’est le tiers payant social).
Par ailleurs, pour les malades chroniques et les ménages qui
accumulent des dépenses de soins de santé élevées, des
dispositifs ont également été mis sur pied tels que le maximum
à facturer et les interventions spéciques pour les malades
chroniques (forfait de soins, forfait d’incontinence...).
En outre, d’autres dispositifs prévoyant des avantages nanciers
pour le patient ont été mis en place tels que le dossier médical
global et les maisons médicales au forfait. On peut encore
citer les mesures prises dans le but de diminuer le prix des
médicaments, implants et prothèses tout comme celles visant
à limiter les suppléments facturés aux patients hospitalisés.
Enn, des mécanismes ont également été développés pour les
personnes qui ne bénécient pas de l’assurance soins de santé
telle que l’aide médicale urgente.
Malgré toutes ces mesures, de nombreuses études mettent
en évidence les difcultés rencontrées par certains ménages
à assumer nancièrement des soins de santé. L’accessibilité
nancière du système reste donc un dé important. Trois
mesures en cours d’élaboration entrent dans ce cadre : la
simplication de la réglementation relative à l’intervention
majorée (avec la création d’un statut unique pour début 2014),
l’instauration d’un statut de malades chroniques ouvrant
automatiquement au bénéce de certains droits spéciques
et l’élargissement du droit au tiers payant social, facilitant son
accès.
3.4 L’élargissement de l’AMI à tous les résidents en 1998
Dans tous les pays qui ont adopté le modèle bismarckien, la
sécurité sociale s’est peu à peu généralisée par l’extension
à des catégories de population initialement non protégées
(étudiants, travailleurs indépendants, personnes handicapées,
etc.). En Belgique, depuis le 1er janvier 1998, tous les résidents
ont accès au système d’assurance soins de santé. Aujourd’hui,
près de 99 % de la population est assurée. Les personnes non
assurées sont essentiellement les sans-papiers, les diplomates
ou encore les parlementaires européens.
5
MC-Informations 254 • décembre 2013
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
1
/
39
100%