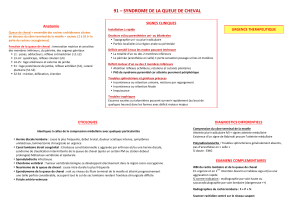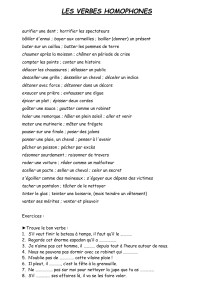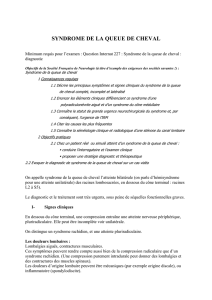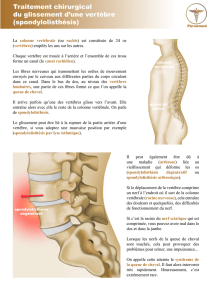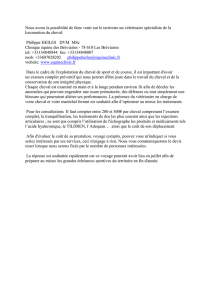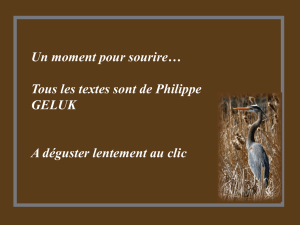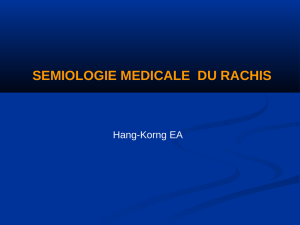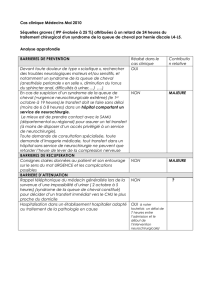u PDF
publicité
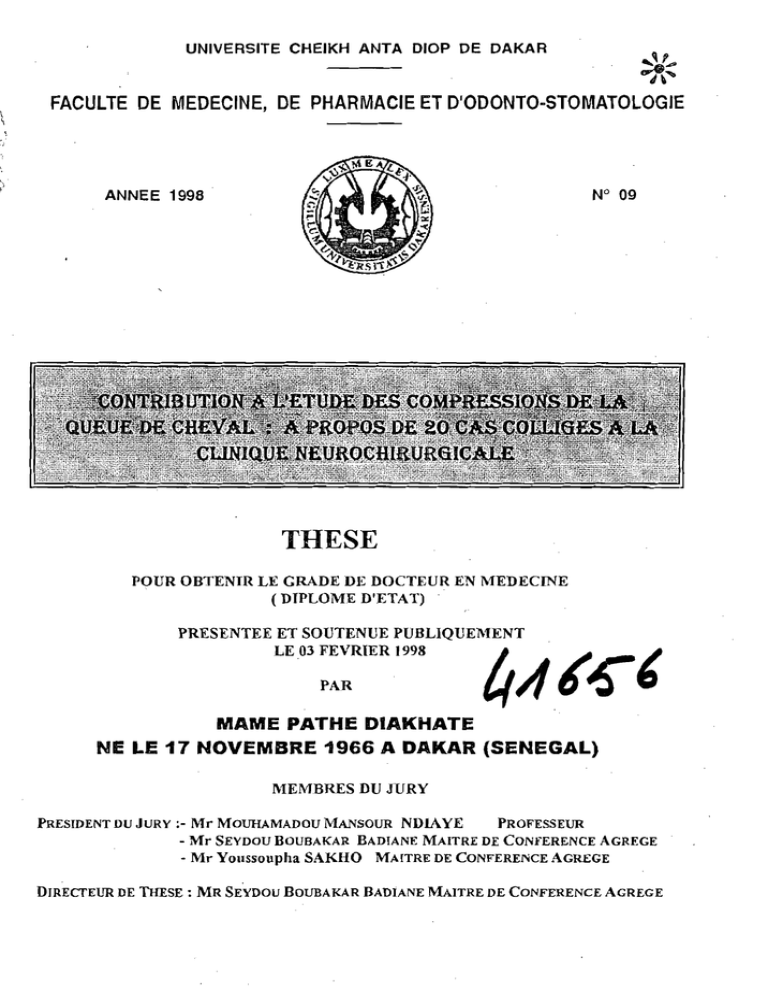
\
\
UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
...'4. PJ"I
~,
FACULTE DE MEDECINE, DE PHARMACIE ET D'ODONTO..STOMATOLOGIE
~.
,
ANNEE 1998
THESE
POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR EN MEDECINE
( DIPLOME D'ETAT)
PRESENTEE ET SOUTENUE PUBLIQUEMENT
LE03::RIERI998
4A(~'
MAME PATHE DIAKHATE
NE LE 17 NOVEMBRE 1966 A DAKAR (SENEGAL)
MEMBRES DU JURY
PRESIDENT DU JURY :- Mr MOUHAMADOU MANSOUR NDIAYE
PROFESSEUR
- Mr SEYDOU BOUBAKAR BADIANE MAITRE DE CONFERENCE AGREGE
- Mr YOllssoupha SAKHO MAITRE DE CONFERENCE AGREGE
DIRECTEUR DE THESE : MR SEYDOU BOUBAKAR BADIANE MAITRE DE CONFERENCE AGREGE
UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
FACULTE DE MEDICINE ET DE PHARMACIE
ET D'ODONTOLOGIE - STOMATOLOGIE
PERSONNEL
ENSEIGNANT
DOYEN
Pro René
NDOYE
1er ASSESSEUR
Pr Doudou
BA
2eme ASSESSEUR
Pr Papa Demba
NDIAYE
CISSE
CHEF DES SERVICES ADMINISTRATIFS : M. Assane
SECTION MEDECINE
PROFESSEURS TITULAIRES
=========================
M. José Marie
M. Mamadou
M. Sallif
M. FaHou
M. Fadel
M. Baye Assane
M. Lamine
M. Samba
11: M. El Hadji Malick
Mme Thérèse MOREIRA
M. Sémou
M. Mohamadou
M. Mamadou
M. Nicolas
M. Bassirou
M. Ibrahima Pierre
11: M. Madoune Robert
M. Mouhamadou Mansour
11:
Associé
AFOUTOU
BA
BADIANE
CISSE
DIADHIOU
DIAGNE
DIAKHATE
DIALLO
DIOP
DIOP
DIOUF
FALL
GUEYE
KUAKUVI
NDIAYE
NDIAYE
NDIAYE
NDIAYE
Histologie - Embryologie
Pédiatrie
Maladies Infectieuses
Physiologie
Gynécologie - Obstétrique
Urologie
Hématologie
Parasitologie
O. R. L.
Médecine Interne
Cardiologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Pédiatrie
Dermatologie
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
M. Papa Demba
'1< M. Mamadou
M. René
M. Abibou
§ M. Abdou
M. Mamadou
§ Mme Awa Marie
COLL
M.Seydina Issa Laye
M. Dédéou
M. Abdourahmane
M. Houssseyn Dembel
M. Moussa Lamine
'1< M. Cheikh Tidiane
M. Pape
M. Alassane
NDIAYE
NDOYE
NDOYE
SAMB
Sanokho
SARR
SECK
SEYE
SIMAGA
SOW
SOW
SOW
TOURE
TOURE
WADE
Anatomie Pathologique
Chirurgie Infantile
Biophysique
Bactériologie - Virologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Maladies Infectieuses
Orthopédie - Traumatologie
Chirurgie Génèrale
Médecine Préventive
Pédiatrie
Anatomie Chirurgie
Chirurgie Générale
Cancérologie
Ophtalmologie
(MAITRES DE CONFERENCES AGREGES]
'1<
'1<
'1<
M. Mamadou
M. Serigne Abdou
M. Moussa
M. Seydou Boubakar
M. Mohamed Diawo
M. Mamadou Diakhité
M. Moussa Fafa
M. Abdarahmane
M. Amadou Gallo
M. Babacar
M. El Hadji Ibrahima H.
M. Saïd Nourou
M. Raymond
M. Souvasin
M. Babacar
M.Ibrahima
Mme MameAwa
Mme Sylvie
SECK
M.Oumar
M. Serigne Magueye
M. Abdoul Almamy
M. Salvy Leandre
M. Victorino
M. Sai")' Leand re
M. Victorino
§ Détachement
* Associé
& Disponibilité
BA
BA
BADIANE
BADIANE
BAH
BALL
CISSE
DIA
DIOP
DIOP
DIOP
DIOP
DIOUF
DIOUF
FALL
FALL
FAYE
GASSAMA
GAYE
GUEYE
BANE
MARTIN
MENDES
MARTIN
MENDES
Urologie
Cardiologie
Radiologie
Neuro - Chirurgie
Gynécologie - Obstétrique
Dermatologie
Bactériologie - Virologie
Anatomie Chirurgie Générale
Neurologie
Psychiatrie
Orthopédie - Traumatologie
Médecine Interne II
O. R. L.
Orthopédie - Traumatologie
Chirurgie Infantile
Chirurgie Pédiatrique
Maladies Infectieuses
Maladies Infectieuses
Parasitologie
Urologie
Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Pédiatrie
Anatomie Pathologiq ue
M. Jean Charles
Mme Mbayang NIANG
& M. Mohamed Fadel
M. Mouhamadou
MOREAU
NDIAYE
NDIAYE
NDIAYE
M. Papa Amadou
* M. Youssoupha
M. Niama DIOP
Mme Bineta
KA
M. Moustapha
M. Birama
M. Mamadou Lamine
* M. Pape Salif
Mme Haby
SIGNATE
M.Oumar
M. Doudou
M. Meïssa
NDIAYE
SAKHO
SALL
SALL
SARR
SECK
SOW
SOW
SY
SYLLA
THIAM
TOURE
Gynécologie - Obstérique
Physiologie - Neurologie
Gastro Entérologie
Chirurgie Thoracique et Cardio
Vasculaire
Ophtalmologie
Neuro - Chirurgie
Biochimie Médicale
Anesthésie - Réanimation
Cardiologie
Pédopsychiatrie
Maladies Infectieuses
Malad ies Infectieuses
Pédiatire
Psychia trie
Hématologie
Biochimie Médicale
( CHARGE D'ENSEIGNEMENT]
* M. Claude
MOREIRA
Pédiatrie
( MAITRES ASSISTANT)
M. El Hadj i Amadou
M. Boubacar
M. El Hadj Souleymane
M. Jean Marie
* M. Michel
* M. Massar
M. Ibrahima Bara
M. Bernard Marcel
+ M. Alassane
M. Boucar
M. Saliou
M.Oumar
Mme Giséle
\VOTO
M. Abdoul
M. Abdoulaye
& M. Adama Bandiougou
Mme Coura
SEYE
§ Détachement
* Associé
& Disponibilité
+ En stage à l'extérieur
BA
CAMARA
CAMARA
DANGOU
DEVELOUX
DIAGNE
DIOP
DIOP
DIOUF
DIOUF
DIOUF
FAYE
GAYE
KANE
NDIAYE
NDIAYE
NDIAYE
Ophtalmologie
Pédiatrie
Orthopédie - Traumatologie
Anatomie Pathologique
Dermatologie
Neurologie
Cardiologie
Maladies Infectieuses
Gynécologie - Obstétriq ue
Médecine Interne
Pédiatrie
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Cardiologie
Anatomie Chirurgie Orthopédiq
Immunologie (Hématologie)
Ophtalmologie
+ M. Issa
NDIAYE
M. El Hadj
NIANG
M. Doudou
SARR
M. Amadou Makhtar
SECK
M. Gora
SECK
M. Ahmed Lyane
SOW
Mme Hassanatou
TOURE SOW
M. Cheickna
SYLLA
M. Alé
THIAM
O. R. L.
Radiologie
Psychiatrie
Psychiatrie
Physiologie
Bactériologie - Virologie
Biophysique
Urologie
Neurologie
ASSISTANTS DE FACULTE
ASSISTANTS DES SERVICES UNIVERSITAIRES DES HOPITAUX
M. Boubacar Samba
M. Abdoulaye Séga
M. Yémou
M. Dialo
M. Mamadou
M. Moctar
M. Saliou
Mme Marne Coumba GAYE
Mme Khadissatou SECK
M.Oumar
M. Lamine
M. El Hadji Alioune
M. Isma".la
M. Mamadou
M.Oumar
M. Abdoulaye
M. Ndéné Gaston
Mme Anta
TALL
M. Kamadore
M. Issa
Mme Arame
MBENGUE
DANKOKO
DIALLO
DIENG
DIOP
DIOP
DIOP
DIOP
FALL
FALL
FAYE
GUEYE
LO
MBAYE
MBODJ
NDOYE
SAMB
SARR
DIA
TOURE
WONE
GAYE
Médecine Préventine
Histologie - Em bryologie
Parasitologie
Bactériologie Virologie
Anatomie Organogénèse
Histologie Embryologie
Hématologie
Médecine Légale
Hématologie
Histologie Embryologie
Physiologie
Anatomie Organogénèse
Médecine Légale
Biophysique
Biophysique
Physiologie
Biochimie Médicale
Médecine Préventive
Médecine Préventive
Médecine Préventive
Physiologie
CHEFS DE CLINIQUE - ASSISTANTS
DES SERVICES UNIVERSITAIRES DES HOPITAUX
Mme Marième
GUEYE
+ M. Momar Codé
M. Moussa
+ En stage à l'extérieur
BA
BA
BA
Gynécologie - Obstétrique
Neuro - Chirurgie
Psychiatrie
M. Cheikh Ahmed Tidiane
Mme Mariama Safiétou KA
M. André Vauvert
Mme Elisabeth
FELLER
1< M. Ibrahima
M. Djibril
M. Saïdou
M. Ahmadou
M. Marne Thierno
M. Rudolph
Mme Sokhna
BA
M. Mamadou Lamine
Mme Elisabeth
M. Edouard Marcell.
M. Limamoulaye
1< M. El Hadj Fary
1< M. Mourtalla
M. Assane
1< M. Abdoul Aziz
DIACK
Mme Aminata
M. Mouhamadou
M. Amadou Koura
M. Ousmane
1< M. Cheikh Tidiane
M. Alain Khassim
M. Ndaraw
Mlle Paula Aïda
1< M. Abdou
M. Abdolilaye
M. lVIamadou
Mlle Anne Aurore
1<
1<
Mme Anna
Mme Fatou
M. El Hassane
M. Masserigne
M. Charles Mouhamed
M. Daouda
M. Mouhamadou Habib
M. Abdourahmane
M. Silly
Associé
CISSE
CISSE
DANSOKHO
DANSOKHO
DIAGNE
DIALLO
DIALLO
DEM
DIENG
DIOP
DIOP
DIOUF
DIOUF
GUEYE
HANE
KA
KA
KANE
KASSE
MBAYE
MBENGUE
NDAO
NDIAYE
NDOUR
NDOYE
NDOYE
NDOYE
NIANG
POUYE
SANGARE
SANKALE
SARR
SENE
smmE
SOUMARE
SOW
SOW
SY
TALL
TOURE
Gynécologie - Obstétrique
Médecine Interne II
Orthopédie - Traumatologie
Maladies Infectieuses
Pédiatrie
Gynécologie - Obstétrique
Médecine Interne 1
Cancérologie
Dermatologie
Stomatologie
Radiologie
Médecine Interne
Anesthésie - Réanimation
Neuro - Chirurgie
Cardiologie
Médecine Interne 1
Médecine Interne 1
Dermatologie
Cancérologie
Pédiatrie
Médecine Interne 1
Neurologie
Pédiatrie
Malad ies Infectieuses
Urologie
Neuro - Chirurgie
Ophtalmologie
Médecine Interne 1
Médecine Interne 1
Gynécologie - Obstétrique
Chirurgie Plastique et
Reconstructive
Médecine Interne II
Neurologie
Médecine Interne fi
Maladies Infectieuses
Orthopédie - Traumatologie
Psych ia trie
Orthopédie - Traumatologie
O. R. L.
Stomatologie
~ TTACHES CHEFS DE CLINIQUE)
M.Oumar
Mme Bineta DIOP
M. Saiba
Mme Pauline
M.Mor
BA
BADIANE
CISSOKHO
DIOUSSE
NDIAYE
[ATTACHES M. Néloum
Mlle Oumou
Pneumo phtisiologie
Anesthésie - Réanimation
Pneumophtisiologie
Dermatologie
Pneumophtisiologie
ASSISTANTS)
DJIMADOUM
SY
Histologie - Embryologie
Biochimie Médicale
SECTION PHARMACIE
===================:
PROFESSEURS TITlfLAIRES
M.
M.
* M.
M.
Doudou
Emmanuel
Babacar
Issa
*~M. Souleymane
* M. Oumar
BA
BASSENE
FAYE
LO
1\1BOUP
NDIR
Chimie Analytique et Toxicologie
Pharmacognosie et Botanique
Pharmacologie et Pharmacodynamie
Pharmacie Galénique
Bactériologie - Virologie
Parasitologie
[1\1AITRES DE CONFERENCES AGREGES)
M. Mamadou
M. Cheikh Saad Baouh
M. Mounirou
M. Balla Moussa
Mme Aïssatou
GAYE
Mme Aminata
SALL
M. Ali'lune
M. Pape Amadou
BADIANE
BOYE
CISS
DAFFE
DIALLO
DIALLO
DIEYE
DIOP
Chimie Thérapeutique
Bactériologie - Virologie
Toxicologie
Pharmacognosie
Bactériologie - Virologie
Physiologie - Pharmaceutiq ue
Immunologie
Biochimie Pharmaceutique
[ MAITRES ASSISTANTS)
M. Amadou
Mme Rita B.
Mme Matar
* Associé
DIOUF
Toxicologie
MONGONIERMA Pharmacognosie
SECK
Pharmacie Chim et Chimie Org.
(ASSISTANTS)
1<
1<
1<
Mlle Issa Bella
M. Aynina
M. Mounibé
Mlle Thérése
M. Amadou Moctar
M. y érim Mbagnick
M. Ahmédou Bamba K.
M.Djibril
M. Modo
M. Aly Coto
M. Augustin
M. Mamadou
Mme Ma-guette DEME SYLLA
Mme Philomène LOPEZ
M. Elimane Amadou
M.Oumar
M. Alassane
BAH
CISSE
DIARRA
DIENG
OlEYE
DIOP
FALL
FALL
LO
NDIAYE
NDIAYE
NDIAYE
NIANG
SALL
SY
THIOUNE
WELE
Parasitologie
Physique Pharmaceutique
Physique Pharmaceutique
Parasitologie
Pharmacologie et Pharmacodyna
Chimie Analytique
Pharmacie Galénique
Pharmacie Chim. & Chimie Org
Botanique
Physiologie Pharmaceutique
Physique Pharmaceutique
Pharmacologie
Biochimie Pharmaceutique
Biochimie Pharmaceutique
Chimie Générale et Minèrale
Pharmacie Galénique
Chimie Physique
(ATTACHES]
M. William
Mme Amie
THIAM
M. Mamadou
M. Mamadou
Mlle Edwige
'* Associé
DIATTA
FALL
FALL
SARR
GOMIS
Botanique
Chimie Analytique
Toxicologie
Physiologie Pharmaceutique
Pharmacognosie
SECTION CHIRURGIE DENTAIRE
PROFESSEURS TITULAIRES
=================
BA
NDIAYE
M.Ibrahima
Mme Ndioro
Pédodontie - Prévention
Odontologie Préventive et Sociale
( MAITRES DE CONFERENCES AGREGES)
1<
M. Boubacar
M. Papa Dem ba
Mme Charlotte
M. Malick
DIALLO
DIALLO
NDIAYE
SEMBENE
FATY
Chirurgie Buccale
Parodontologie
Chirurgie Buccale
Parodontologie
( MAITRES ASSISTANTS)
GAYE
KANE
YAM
Mlle Fatou
M. Abdou Wahab
M. Abdoul Azïz
Dentisterie Opératoire
Dentisterie Opératoire
Pédodontie
( ASSISTANTS DE FACULTE)
& Mme Christiane JOHNSON
Mme Aïssatou TAMBA
DIOP
Mme Khady
M. Daouda
1< M.Fallou
Mme Adam Awa Marie SECK
* M. Lambane
& Mme Affisatou NDOYE
Mme Fatou
& M. Libasse
& M. Mamadou Moustapha
* Associé
& Disponibilité
AGBOTON
BA
BA
CISSE
DIAGNE
DIALLO
DIENG
DIOP
DIOP
DIOP
GUEYE
Prothèse Dentaire
Pédodontie - Prévention
Orthopédie Dento - Faciale
Odontologie Préventive et Sociale
Orthopédie Dento - Faciale
Parodontologie
Prothèse Dentaire
Dentisterie Opératoire
Pédodontie - Prévention
Prothèse Dentaire
Prothèse Dentaire
'" M. Malick
Mme Paulette M. AGBOTON
M. Edmond
Mme Maye Ndave NDOYE
M. Paul Débé Amadou
'" M. Mohamed Talla
Mme Soukeye
DIA
M. Saïd Nour
MBAYE
MIGAN
NABHANE
NGOM
NIANG
SECK
TINE
TOURE
Dentisterie Opératoire
Prothèse Dentaire
Prothèse Dentaire
Parodontologie
Chirurgie Buccale
Prothèse Dentaire
Chirurgie Buccale
Prothèse Dentaire
(ATTACHES]
M. Abdou
M. Henri Michel
M. Babacar
M. Daouda
M. Malick
M. Cheikh Mouhamadou M.
M. El Hadj Babacar
M. Mohamed
Mme Fatoumata
DIOP
M. Babacar
il
Associé
BA
BENOIST
FAYE
FAYE
FAYE
LO
MBODJ
SARR
THIAW
TOURE
Chirurgie Buccale
Parodontologie
Odontologie Conservatrice Endodontie
Odontologie Préventive et Sociale
Pédodontie - Orthopédie
Odontologie Préventive et Sociale
Prothèse Dentaire
Odontologie Conservatrice Endodontie
Odontologie Conservatrice Endodontie
Odontologie Conservatrice Endodontie
JE DEDIE CE
T
VAIL A:
• A mon père THIERNO DIAKHATE
Tu as été l'artisan de ma réussite dans les études médicales.
• A ma mère NDEYE COMBA THIAM
Ton amour et ta compréhension m'ont beaucoup aider dans la vie.
Merci pour tout.
• A mes soeurs : NANCY et MARIE
Merci les filles.
• A tous mes frères
IBOU, HASSAN, MAMADOU, KHALY
• A mon frère ABOU et à sa femme HELENE amSI qu'à leurs
enfants COUMBA et THERESE.
• A mon frère OUSSEYNOU et à sa femme ROKHAYA
• A ma sœur NANCY et à son fils MAMADOU
• A ma sœur COUMBA et à son mari NDIAGA
• A tous mes oncles et tantes
• A tous mes cousins et cousines
• A tous mes neveux et nièces
• A mon AMY
Tu seras toujours mon AMY préférée
• A TATY BEATRICE et à son mari KADER DRABO ainsi qu'à
leurs enfants qui n'ont ménager aucun effort pour la bonne réussite de la
thèse.
• A T ANTIE FLORENCE et à sa fille
Merci pour tout.
• A mes amis : BABACAR FAYE, LAMINE CISSE et à sa
femme AISSATOU, l\1AMADOU BEYE.·
Le travail et ramitié ne sont pas incompatibles.
• A mes amis: DAOUDA DIENE, BASILE SENGHOR, ADAMA
FALL DJIBRIL KANE.
Je sais que vous serez toujours près de moi.
• A tous le personnel de la Neurologie et de la Neurochirurgie.
M IT E
ET J
E
A NOTRE PRESIDENT DU JURY
Monsieur le Professeur MOUHAMADOU MANSOUR NDIAYE
Vous nous faîtes un grand honneur en présidant notre thèse. La rigueur et
la clarté de votre enseignement nous ont toujours séduit.
Soyez en remercier.
A NOTRE DIRECTEUR DE THESE
Monsieur le Professeur SEYDOU BOUBAKAR BADIA.NE
Il nous est impossible de dire en quelques mots ce que nous vous devons.
Votre souci du travail bien fait, la chaleur de votre accueil font de vous un
modèle dont nous nous souviendrons toujours.
Vous avez su largement contribuer à la réalisation de ce travail, malgré les
nonlbreuses préoccupations.
Recevez nos sincères remercienlents.
A NOTRE MArTRE ET JUGE
Monsieur le Professeur YOUSSOUPHA SAKHO
Le plaisir que vous nous faîtes en siégeant parmi les membres de notre
jury est immense. Qu'il nous soit pern1is de vous témoigner notre
admiration et nos sincères remercien1ents.
.. Par délibération la Faculté a arrêté que les opmIOns emlses dans les
dissertations qui lui seront présentées, doivent être considérées comme propre à leurs
auteurs et quelle n'entend leur apporter aucune approbation ni improbation.
1
CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES
COMPRESSIONS DE LA QUEUE DE
CHEVAL
«A PROPOS DE 20 CAS COLLIGES »
A LA CLINIQUE NEUROCHIRURGICALE DE
FANN
2
PLAN
AI INTRODUCTION
page 6
BI ÉTUDE GÉNÉRt\LE
Page 8
Il ANATOMIE DESCRIPTIVE
page 9
1-1/ CONTENANT
A-l : RACHIS LOMBO-SACRE
A-2 : CANAL RACHIDIEN
A-3 : LES TROUS DE CONJUGAISON
A-4 : VASCULARISATION DU RACHIS
1-21 CONTENU
B-1 : LE CÔNE TER1J!INAL
B-2 : LES RACINES RACHIDIENNES
B-3 : LE LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN
III ANATOMIE FONCTIONNELLE
page 13
IIII PHYSIOLOGIE URODYNAMIQUE
page 15
III-I : LES CENTRES NERVEUX
III-2 : LE CONTRÔLE -NEUROLOGIQUE
IVI DIAGNOSTIC POSITIF
page 17
IV-1 : SYMPTOMATOLOGIE CLINIQUE
IV-2 : EXAMENS PARACLINIQUES
3
C/ NOTRE ÉTUDE
page 21
!! MALADES ET MFTHODES
II/NOS OBSF,RVATIONS
II!! RÉSULTATS
III-li ÉPIDÉMIOLOGIE
page 43
A-I : INCIDENCE
A-2: LE SEXE
A-3 : L'AGE
A-4 : ANTECEDENTS
111-2/ CLINIQUE
page 45
III-2-1 : DÉLAJ D'HOSPITALISATION
1II-2-2: LA PHASE DE DÉBUT
III-2-2-1 : Les Douleurs
III-2-2-2 : Les Paresthésies
III-2-2-3 : Les Troubles Moteurs
III-2-2-4 : Les Troubles Sphinctériens
III-2-3: LA PHASE D'ETAT
III-2-3-1 : Les Douleurs
III-2-3-2 : Les Paresthésies
III-2-3-3 : Les Troubles Moteurs
III2--3-4 : Les Troubles Du Tonus
III-2-3-5 : Les Troubles Trophiques
III-2-3-6 : Les Troubles De Réflexes
III-2-3-7 : Les Troubles Sensitifs Objectifs
III-2-3-S : Les Troubles Sphinctériens
III-2-3-9 : Autres Signes D'examen
4
111-3/ PARACLINIQUE
page 49
III-3-1 : Etude Cytochimique Du Lcr
III-3-2 : Radiographie Standard Du Rachis
1II-3-3 : La Myélographie
111-4/ ETIOLOGIES
III -5 / TRAITEMENT
page 51
III-4-1 : Le Traitement Médical
III-4-2 : Le Traitement Chirurgical
III-4-3 : Constations Opératoires
1II-4-4 : Analyses Post-Opératoires
!!1-61 ÉVOLUTION
page 53
III-5-0 : Mortalité
III-5-1 : Les Mauvais Résultats
III-5-2 : Les Résultats Moyens
III-5-3 : Les Bons Résultats
IV/ COMMENTAIRES
IV-l : DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES
IV-1-1 : La Fréquence
IV-I-2 : Le Sexe
IV-I-3 : L'age
IV-1-4 : Les Antécédents
IV-1-5 : La Profession
page 55
page 56
5
page 57
IV-2 : LA CLINIQUE
IV-2-1 : Le Début
IV-2-2 : La Phase D'Etat
IV-3: PARACLINIQUE
page 60
IV-3-1 : Etude Cytochimique Du L.C.R
IV-3-2 : Les Examens Radiologiques
IV-3-2-1 : La Radiographie Standard Du
Rachis
IV-3-2-2 : La Myélographie
IV-3-2-3 : La Tomodensitométrie Ou Scanner
IV-3-2-4 : L'imagerie Par Résonance
Magnétique
IV-4: ETIOLOGIES
page 63
IV-5 : LE TRAITEMENT
page 68
IV-5-1 : LE TRAITEMENT MEDICAL
IV-5-2 : LE TRAITEMENT CHJRlJRGICAL
IV-5-2-1 : LES CONDITIONS OPERATOIRES
IV-5-2-2 : L'ACTE CHIRURGICAL
IV-6 :ANATOMIE PATHOLOGIQUE
IV-7: EVOLUTION
IV-7 -1 : La Mortalité
IV-7-2 : Dans Le Suivi Post-Opératoire
V- CONCLUSIONS
page 76
VI- BIBLIOGRAPHIE
page 79
6
MOTS MIS EN ABREVIATION
ATCD
Antécédents
MID
=
Membre Inférieur droit
MIG
=
Membre Inférieur gauche
RCP
=
Réflexe cutané plantaire
ROT
=
Réflexe ostéotendineux
MI
LCR
Membre Inférieur
=
Liquide Céphalo-rachidien
RADIO =
Radiologie
Myélo
-
Myélographie
E.c.G
-
Electrocardiogramme
7
INTRODUCTION
La connaissance clinique des compressions de la queue de cheval a évolué au cours
des siècles pour trouver son apogée dans la seconde moitié du XIX siècle.
L'observation princeps est due à PETIT DUTAILLIS et ALAJOUANINE qui en
1925 rapportent le premier cas de compression de la queue de cheval guéri par
l'ablation d'une hernie dorsale. Par la suite FRENCH ET PAYNE rapportent en
1944, huit (8) cas de compression de la queue de cheval.
C'est à H.VERBIEST que revient le mérite d'avoir en 1949, rattaché au
rétrécissement du canal lombaire un certain nombre de troubles neurologiques
améliorés par la laminectomie décompressive.
En France GRAVELEAU et GurOT décrivent en 1964 la sémiologie de la
claudication intermittente sensitive de la queue de cheval.
Aux États Unis parmi de nombreux travaux, citons ceux d'EPSTEIN.
L'intérêt de l'étude des compressions de la queue de cheval réside non pas du fait
de sa fréquence relativement faible, mais surtout du fait de sa gravité et de ses
séquelles lourdes à types de : paraparesies, paraplégies et surtout de troubles
sphinctériens.
L'intérêt réside également du fait de sa multiplicité étiologique et enfin de son
retentissement sur la vie du malade et de son adaptation dans la société.
Une telle étude a déjà été menée à la clinique neurochinlrgicale de FANN en 1982
et portée sur «les compressions du cône terminal et de la queue du cheval».
Notre étude nous permettra non seulement de faire une analyse comparative avec
l'étude déjà menée mais également d'apporter notre contribution dans le diagnostic
et la prise en charge des compressions de la queue de cheval.
8
,
ETUDE
,
,
GENERALE
9
RAPPEL ANATOMIQUE
------------- o --------------
Il ANATOMIE DESCRIPTIVE
I~lI
CONTENANT
A-I LE R_ÂCHIS
LOMBO~SACRE
Le rachis lombo-sacré est constitué par l'empilement de :
- 5 vertèbres lombaires formant le rachis lombaire. Ces vertèbres sont
numérotées de LI à L5 et sont composées d'un corps vertébral qui est
plus volumineux que celui des autres vertèbres, d'une apophyse
épineuse aplatie et dirigée horizontalement.
Les trous de conjugaison sont relativement grands alors que le trou
Vertébral est relativement petit.
- Le Sacrum résulte de la soudure des 5 vertèbres sacrées et des
disques intervertébraux avec une face antérieure concave ou l'on note
4 paires
de trous sacrés pour la sortie des branches antérieures des
nerfs sacrés, une face post convexe, une face supérieure ou base qui
constitue la surface de contact pour le disque intervertébral et une
face inférieure ou sommet qui est appliquée contre le coccyx.
Sur chaque face latérale on voit la surface auriculaire qui s'articule
avec l'os iliaque.
- Les vertèbres coccygiennes qui sont au nombre de 4 à 6 vont se
souder pour former le coccyx.
- Les disques intervertébraux qui sont composés d'une partie
périphérique dure ou anneau fibreux et d'une partie centrale molle
encore appelée noyau gélatineux.
Ils agissent comme des coussinets élastiques dans lesquels les noyaux gélatineux
répartissent les pressions lors des mouvements de la colonne vertébrale. Les
disques intervertébraux sont tantôt comprimés, tantôt étirés d'un côté.
10
-
Les ligaments de la colonne vertébrale : Les 2 ligaments vertébraux
communs s'étendent en avant et en arrière des corps vertébraux et
renforcent ainsi la solidité de la colonne vertébrale notamment lors de
l'inclinaison en avant et en arrière.
Ces ligaments ont de ce fait 2 fonctions :
- permettent de limiter les mouvements de la colonne vertébrale
- protègent les disques intervertébraux.
A-2 : LE CANAL RACHIDIEN OU CANAL VERTjBRA.L
1/ LE CANAL LOMBAIRE: constitué en avant par les corps vertébraux et les
disques intervertébraux des vertèbres lombaires et en arrière par les arcs
postérieurs, les lames réunies par les ligaments jaunes, les apophyses épineuses
régulièrement imbriquées et articulées entre elles.
2/ LE CANAL SACRE: limité en avant par le corps du sacnlm, en arrière et sur les
cotés par la lame sacrée avec à chaque étage les orifices des trous sacrés antérieurs
et postérieurs.
A-3 : LES TROUS DE CONJUGAISON
Les trous de conjugaison ou foramen intervertébraux sont chargés de livrer
passage et de protéger les nerfs rachidiens et les vaisseaux vertébraux qui les
accompagnent.
Les trous de conjugaison sont pairs et symétriques à chaque niveau métamérique.
Ils sont limités :
- à leurs parties supérieures et inférieures par les pédicules
- à leurs parties antérieures par la moitié inférieure des corps vertébraux et la
face postérieure du disque intervertébral
- en arrière par l'articulation vertébrale postérieure, doublée sur sa face
antérieure par le ligament jaune.
Il
A-4: VASCULARISATION DU RACHIS.
11 ARTÈRES
Les corps vertébraux sont irrigués par deux groupes d'artérioles, d'une part des
rameaux directs des artères pariétales pour leur convexité, d'autre part les rameaux
des artères antérieures du canal vertébral pour leur face postérieure.
L'os postérieur reçoit des artérioles par ses 2 faces ~ de l'artère postérieure du
canal vertébral et des rameaux dorsaux des artères pariétales.
2/ VEINES
Il existe de grosses veines centrocorporéales horizontales qui se jettent à la face
postérieure des corps vertébraux dans le plexus veineuxantérointernes, puis
s'anastomosent par des rameaux radiaires avec les veines des plexus veineux
vertébraux externes.
1-2/ LE CONTENU
B-1/ LE CÔNE TERMINAL
Le cône terminal correspond à la partie terminale de la moelle épinière et elle est
située à la hauteur de la 2eme vertèbre lombaire. Elle est constituée en bas par les
racines de la queue de cheval.
B-2/ LES RACINES RACHIDIENNES
Les racines naissent de la moelle lombaire et du cône terminal. Elles se regroupent
pour former la queue de cheval et descendent verticalement, mais les plus externes
s'écartent obliquement en bas et en dehors.
Dans la région sacrée, les racines forment la «Patte d'Oie» et en sortent par les
trous sacrés antérieurs pour le rameau ventral et les trous sacrés postérieurs pour le
rameau dorsal.
Par le hiatus sortent les cinquièmes racines sacrées et les racines coccygiennes.
12
B-31 LE LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN
Le liquide cephalo rachidien est sécrété activement pour sa majeure partie au
niveau des pelotons vasculaires des plexus choroïdiens. Une fraction non
négligeable du LCR provient directement du parenchyme nerveux par voie
transventriculaire.
La circulation du LCR se fait à travers les ventricules pour arriver
aux méninges. La résorption est assurée essentiellement par les granulations de
«PACCmüNI »
III ANATOMIE FONCTIONNELLE
Chacune des racines que nous allons aborder ci-dessous comporte des fonctions
sensitives motrices et réflexes : Ainsi :
11 L2-L3-4 assurent
- L'innervation sensitive de la partie supero-externe de la fesse, de la face
externe de la cuisse, puis de sa face antérieure et enfin de la face interne.
- L2 correspondant plus particulièrement à la partie haute, L3 à la partie
moyenne et L4 à la partie basse, descendant ensuite à la face interne du
genou et à la face antero interne de la jambe, jusque dans la région de la
malléole interne et à la partie adjacente du cou de pied L'innervation
motrice du quadriceps (extension jambe) et le fonctionnement du réflexe
rotulien (surtout L4)
Parfois aussi L4 assure ou participe à l'innervation motrice du jambier antérieure
dans la loge antéroexterne de la jambe.
21 L5 assure:
- L'innervation sensitive d'une partie de la face postérieure de la cuisse, de
la face antéroexterne de la jambe, du coup de pied devant la malléole
externe, du dos du pied en direction du gros orteil et des orteils voisins.
- L'innervation motrice de la loge antéroexterne de lajambe
13
31 SI assure:
- L'innervation sensitive de la face postérieure de la cuisse, de la face
postérieure de la jambe, du bord externe du pied et de la plante du pied
dans ses 2/3 externes.
- L'innervation motrice de la loge postérieure de la jambe et le
fonctionnement du réflexe achiliéen
41 SI et S2 assurent:
- L'innervation motrice de la loge postérieure de la cuisse et de la
fesse
51 S2-S3-84-S5 assurent:
- L'innervation sensitive du pénis, des organes génitaux externes, de la
partie haute de la face interne de la cuisse, les fonctions sphinctériennes et
génitales (érection et éjaculation) et les réflexes anaux et bulbocaverneux.
1111 PHYSIOLOGIE URODYNAM'IQUE
L'innervation du système sphinctérien est complexe ; elle est à la fois
végétative (sympathique et parasympathique) et somatique (motricité
vo1ontaire).
III-II LES CENTRES NERVEUX
Ils sont situés au niveau de :
- la moelle dorso-Iombaire (DII-L2) pour le système sympathique a
et p qui conduit aux récepteurs p prédominants au niveau du détrusor,
et aux récepteurs a prédominants au niveau du trigone et du col
vésical par les nerfs hypogastriques.
- la moelle sacrée (S2 -S4) pour le système parasympathique qui
conduit aux récepteurs parasympathiques du détrusor par les nerfs
érecteurs et par le système somatique qui va innerver le sphincter strié
par les nerfs honteux internes.
Le remplissage de la vessie, la continence et la miction supposent une bonne
synergie vésicosphinctérienne.
14
III-l-l/ LORS DE LA PHASE DE REMPLISSAGE
Les fibres élastiques du détrusor se distendent sous l'int1uence des récepteurs
sympathiques
~
dont la stimulation entraîne un relâchement vésical. L'adaptation
du tonus urétral se fait grâce à 2 composantes essentielles:
-
une composante sympathique a dont la stimulation fenne le col vésical et
entraîne une contraction de la musculature lisse de l'urètre postérieur,
augmentant la pression à ce niveau.
-
une composante striée à dépendance rét1exe sympathique a et surtout
somatique (come antérieure de la moelle).
Le système sympathique assure essentiellement la continence.
Pendant cette phase de remplissage les voies sensitives remontent aux
centres cérébraux les infonnations correspondant aux besoins:
-
le premier correspondant à l'impression de réplétion vésicale
-
le deuxième a un besoin qui conduirait nonnalement à une miction
-
le troisième besoin «urgent» ou «impérieux », correspond à une légère
distension
du col vésical laissant passer quelques gouttes d'urine dans
l'urètre. La continence est alors obtenue par la contraction volontaire du
sphincter strié qui refoule l'urine dans la vessie et bloque un moment les
contractions vésicales pennettant, d'atteindre les conditions naturelles
possibles d'une miction.
15
III-I-2 / LORS DE LA MICTION
L'urètre se relâche, le tonus urétral lisse d'origine sympathique
sphincter strié s'ouvre volontairement.
Cl
chute, le
La commande corticale de la contraction du détrusor, sous la dépendance du
parasympathique se déclenche et sera maintenue de façon réflexe jusqu'à ce qu'il
n'y ait plus d'urine dans l'urètre afin d'assurer une vidange complète. A la fin de la
miction il y a contraction du sphincter strié avec relâchement du détrusoL Le
système parasympathique assure essentiellement la miction.
111-2 / LE CONTRÔLE NEUROLOGIQUE
Le contrôle neurologique va donc se faire à 2 niveaux:
- NIEDULLAIRE
- Centre principal S2-S3-S4 : d'où partent le parasympathique (nerfs ) et le
système somatique (nerfs honteux)
- Centre accessoire D II-L3 : d'où part le système sympathique 13 pour le
détrusor et Cl pour le col vésical (nerfs hypogastriques)
- Dans le cas des atteintes sacrées on a souvent une atteinte du centre sacré
de BUDGE avec une paralysie du détrusor et du sphincter strié.
- . ENCÉPHALIQUE :
- Centre cortical principal frontal et préfrontal : centre mictionnel volontaire
- Centres sous corticaux au niveau des noyaux gris: action surtout inhibitrice
de la miction
- Centre du tronc cérébral dont le plus important est le centre réflexe
assurant la contraction du détnlsor par l'intermédiaire du centre médullaire
sacrée.
- Centres cérébelleux qui sont une voie de passage coordonnant ces activités.
16
-
IVI DIAGNOSTIC POSITIF
Le diagnostic positif des compressions de la queue de cheval reposera sur les signes
cliniques et paracliniques.
IV-II SYMPTOMATOLOGIE CLINIQUE
On distingue 4 fonnes cliniques :
-
LA FORME GLOBALE qui sera constituée de :
- Troubles sensitifs subjectifs et objectifs à type de douleurs ou de paresthésie avec
.au maximum la classique «anesthésie en selle })
- Troubles moteurs à type de paraparésies, de paraplégie flasque à prédominance
distale
- Troubles réflexes: soit abolition ou diminution des réflexes rotuliens, achiléens,
anal et indifférence du réflexe cutané plantaire
- Troubles génitosphinctériens: difficulté ou impossibilité de l'érection, retard de
miction, incontinence ou rétention d'urine
- Troubles trophiques : soit amyotrophie, ou escarrhes
-
LA FORME BASSE SACRÉE: les troubles sont limités aux dernières
paires sacrées constituant le plexus honteux.
On peut y retrouver des douleurs, une anesthésie en selle ou des troubles
sphinctériens
- LA FORME MOYENNE LOMBO SACRÉE: Aux troubles de la forme
basse s'ajoute une atteinte du territoire sciatique et une abolition du réflexe
rotulien.
- HEMISYNDROME DE LA QUEUE DE CHEVAL
Il constitue souvent une forme de transition au syndrome de la queue de cheval. Il
est réalisé lors des atteintes très latérales avec des troubles ne concernant qu'un
côté.
17
IV-2 / EXAMENS PARACLINIQUES
- ÉTUDE DU LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN : Cette étude pourra
montrer en faveur d'une compression de la queue de cheval, l'existence d'une
d~ssociation albuminocytologique avec élévation isolée de la proteinorachie.
EPREUVE DE QUECKENSTEDT STOCKEY
Elle n'est plus pratiquée actuellement
-
EXAMENS RADIOLOGIQUES
Seront centrés sur la région suspecte et pourra montrer des renseignements décisifs
sur l'étiologie
- image de lyse osseuse ou même
d'e~fondrementvertébrale
d'une métastase
- agrandissements des trous de conjugaison par un neurinome
- image de spondylodiscite, d'arthrose, de condensation osseuse
-
LA MYÉLOGRAPHIE
C'est l'examen de choix utilisé pour le diagnostic des compressions.
Elle s'effectue chez un sujet en décubitus dorsal sur une table à bascule. Elle utilise
un produit de contraste hydrosoluble tel que le IOPAMIDOL (IOPAMIRON *)
introduit de préférence par voie haute sous occipitale, parfois par voie basse.
Les clichés seront pris par intervalle de temps.
Comme résultat elle pourra montrer ~ soit
- une petite encoche latérale
- soit un arrêt net cupulifonne témoin d'une compression intradurale et
extraméduHaire
18
- soit un arrêt irrégulier en bec de t1ûte témoin d'une compression extradurale
- soit une grosse moelle fusifonne témoin d'une compression intramédul1aire
-
soit un arrêt en dôme d'un neurinome ou d'un méningiome
-
LE MYELOSCANNER
La myélographie est souvent couplée au SCANNER et pennet d'avoir des
images plus précises.
Le scanner utilisé avec ou sans produit de contraste permettra de préciser le
siège et les limites de la compression, de faire des coupes tomographiques et
de donner des indications sur la nature de la compression
-
IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE
Elle est en voie de devenir l'examen de référence de première intention,
pennettant de visualiser de façon non invasive la moelle, les espaces sous
arachnoïdiens, le canal rachidien, le rachis.
f.lblJ~~. TOPDGR/\PHIE
IU\[)IClJlI\II~E DE
LA
Sr:NSIBILITE
-~._
...
.,
_.~
'
LES CENTRES DE COMMANOE
Centres {ronto-pariétaux
-------"fC-....,
0+
Centres hypolhalamiyues
Noyaux gris centraux
---·I----~__-H{<""3
0+
Centres du tronc cérébral
Q
----------~~
,•l
Centres cérébelleux
08
l
Détrusor
Trig0 nc u ----"'''<2'-...::......,...
Sphincter lisse ----.r-
~=::::.-'I
Sphincter strié - - - - t - Urètre
S2-S-1
SOIll;IIÎquc :
honteux internes
Figl/re.?
.13
..
---_.- ---
._._---------
CENTRE MÉDULLAIRE PRINCIPAL DE LA MICTI(;)N
........IH---4------- Moelle épinière
12c vertèbre dorsale - - - - 1 -
:\-----\----- Centre mictionnel de Buùge
1'" vcrt,:brc lomhaire - - ~--r-----
Ensemble des nerfs r<lchidiens
constituant la queue de cheval
.L,-----
L~---~
Sacru m -------,/-
Coupe de profil montrant le rapport entre le cône terminal ùe la moclle
épinière (avec le centre mictionnel). la queue de cheval et les vertèbres de 1<1
charnière dllr~ll-lo1\1baire.
Figllre J
...
.,
~
19
NOTRE
,
ETUDE
20
Il MALADES ET MÉTHODES
Il s'agit d'une étude rétrospective réalisée de 1983 à 1995 à partir de 20
o!Jservations de malades opérés de compressions de la queue de cheval dans le
Service de Neurochirurgie du CHU de FANN.
Ces différents dossiers ont été retenus panni ceux de 152 malades présentant une
compression médullaire non pottique et non traumatiques opérés en Neurochirurgie
durant la même période.
Les patients ont tous été hospitalisés en Neurochirurgie, la plupart d'entre eux ont
été adressés par le service de Neurologie du CHU de FANN et certains ont été
évacués de pays de la sous région (Mauritanie).
Tous les malades ont eu à bénéficier d'une:
- Exploration radiologique standard du rachis.
- Exploration neuro-radiologique en particulier de la myélographie
La tomodensitométrie et l'IRM n'ont pas été réalisées.
Dans tous les cas une intervention chirurgicale par voie postérieure à été
effectuée.
La plupart des malades ont été suivis en Neurochinlfgie avec un recul allant
de 3 mois à 4 ans.
21
PROTOCOLE N°l
DL 54 ans masculin
PIKINE TALLY BOUMACK PlIe n° 544 T
Retraite
ENTRÉE: le 27/02/89
DÉBUT: Remonterait à 5 mois environ marqué par des épisodes de lombalgies
aiguës à l'effort avec une claudication sensitivomotrice
Depuis 2 mois présente une légère impotence fonctionnelle du MID et une dysurie
A'TCD : - Traumatisme par chute de cheval
- Hypoaccousie bilatérale
EXAMEN : - Gibbosité lombaire douloureuse
- Cyphose lombaire
- Monoparesie du MID
- Rot abolis au MID et RCP indifférent
_.
Amyotrophie du quadriceps êtdes musCles de la loge
. antéroexteme du MID
- Troubles sphinctériens à type de dysurie
- Prostate augmentée de volume, régulière et indolore.
PARACLINIQUE : .Radio : tassement vertébral de L4 avec lyse osseuse
de L4-L5
. Sacco Arrêt net du produit de contraste en L3
TRAITEMENT: Incision médiane centrée sur L3. Ouverture de l'aponévrose et
écartement des masses musculaires.
Laminectomie de L3-L4 avec un os mité d'aspect sucré mouillé
Épineuses et lames de L5 lysées et remplacées par un magma tumoral engainant le
fourreau duraI. Une biopsie a été faite.
ANA-PAT" : Révèle un adenocarcinome peu différencié métastasé au l1lveau
vertébral confortant l'étiologie néoplasique suspectée.
ÉVOLUTION: On note une altération progressive de l'état général avec un
amaigrissement important. Le malade n'a plus été revu par la suite..
22
PROTOCOLE N°2
MW
63 ans masculin COLODING DÉPARTEMENT DE TAMBACOUNDA
Cultivateur
ENTRÉE : le 08/03/88
DÉBUT: Remonterait à 3 ans
lombosciatalgies
enViron marqué par des épisodes de
bilatérales. Puis depuis 6 mois,
apparition d'une légère
impotence fonctionnelle nécessitant un déplacement avec une canne.
EXAMEN: - Paraparesie
- Abolition du ROT aux 2MI
-
Troubles sphinctériens discrets à type de dysurie
PARACLINIQUE : Radio: tassement de L5 avec des osteophytes
.LCR : Liquide clair avec 1 élément /mm3
Albumine normal.
.Sacco : Canal lombaire rétréci + discopathie étagée et arrêt du
produit de contraste en L4.
TRAITEMENT: Incision médiane centrée sur L4. Ouverture de aponévrose et
écartement des masses musculaires.
Laminectomie de L3-L4 élargie
Fermeture plan par plan.
ETIOLOGIE: Canal lombaire étroit.
ÉVOLUTION: On note une bonne évolution du tableau clinique avec reprise de
la motricité au bout de 8 mois. Mais la persistance de troubles neurologiques
séquellaires, sphinctériens notamment (dysurie) après plus d'un an d'évolution a
motivé son orientation en urologie pour une meilleure prise en charge.
23
PROTOCOLE N°3
DN 55 ans masculin KE1JR SYLLA ARRONDISSEMENT NIAKHENE
ENTRÉE:
04/05/86
DÉBUT: Depuis environ 4 mois par des lombalgies bilatérales associées à des
épisodes de paresthésies et de buming foot.
Depuis 15 jours apparition d'une impotence fonctionnelle progressive, devenant
tôtale, associée à troubles sphinctériens.
EXAMEN: - Paraplégie flasque avec hypotonie musculaire
ROT abolis et Rep indifférents
Anesthésie en selle
Dysurie
AUTRES: - Lésions dermatologiques à type de tuméfaction dorsale indolore
fistulisée
P ARACLINIQUE : LCR : Dissociation albumino-cytologique avec:
- Albumine: 18g IL Cytologie: 36 éléments lymphocytaires
- Radio: Ostéosclérose condensante de Dl 0-D Il
- Myelo: Arrêt d'aspect frangé en LI évoquant une épiduite.
TRAITEMENT: . Incision verticale médiodorsale centrée sur D 12L1.Désinsertion musculoaponévrotique.
Laminectomie décompressive partielle du fourreau duraI, mais
gange inflammatoire et hémorragique imposant arrêt.
persistance d'une
ÉVOLUTION: Bonne évolution clinique avec reprise lente de la marche sous
traitement médical après un suivi de 7 mois suggérant une étiologie infectieuse.
ÉTIOLOGIE: L'étiologie d'un mycétome a été suspecté devant la profession,
l'existence des lésions dermatologiques et devant la réponse au traitement médical.
Le prélèvement effectué n' a pas été retrouvé dans le dossier.
24
PROTOCOLE N°4
AS 31 ans Féminin HLM Route de Dakar N°2 THIES
ENTRÉE: le 07/05/87
DÉBUT: Remonterait à 4 ans marqué par la survenue de lombalgies suite à un
coup reçu au niveau du rachis lombaire. On note la présence de douleur à type de
sciatique hyperalgique ayant nécessité une opération à Principal. Par la suite on
note apparition·depuis3 mois.
EXAMEN: - Paraparésie flasque des 2 MI
- Une abolition des ROT (rotuliens et achileens) et un RCP
indifférent bilatérale et symétrique
- Troubles sphinctériens: trouble de la miction - constipation
P ARACLINIQUE : .Radio : on note une ablation des lames épineuses au niveau
de L4 et L5témoin d'une opération antérieure.
1
. Myelo : Arrêt du produit de contraste d'aspect peigne en en L3-L4
TRAITEMENT: Incision médiane centrée sur L3-L4. Ouverture des aponévroses.
et désinsertion musculaire.
Laminectomie bilatérale de L3-L4
Ablation d'une volumineuse hernie médiane au niveau de l'espace
L4-L5 .
Fenneture plan par plan avec pose d'un drain
ÉTIOLOGIE: Hernie discale médiane.
ÉVOLUTION: On note une bonne évolution clinique, malgré une reprise de la
marche lente et progressive sur une durée de 1 an.
Quelques paresthésies ont été signalées ayant nécessite une vitaminotherapie B et
une rééducation.
26
PROTOCOLE N°6
MD 31 ans masculin QUARTIER KASNACK KAOLACK manœuvre
ENTRÉE : le 24/05/83
DÉBUT: Remonterait à 3 mois environ marqué par la survenue de
lombosciatalgies droite suite à un port de charge lourde. Puis secondairement on
note apparition de :
EXAMEN: - Paraparésie du MI droit
-
Abolition du réflexe achiléen droit
- Hemianesthesie droite et hypoesthesie tactile et douloureuse de la
- moitié droite de la verge et du scrotum
-
Troubles sphinctériens anal et génital à type d'impuissance
PARACLINIQUE :
,
-
LCR: 2 éléments /mm3
Albuminorrachie normale
- Radio: pincement de l'interligne L4-L5
- Myelo Arrêt du produit de contraste en L3-L5 et image de
hernie en L5-S 1
TRAITEMENT: Incision médio dorsale avec ouverture de aponévrose et
désinsertion musculaire.
Laminectomie de la vertèbre L5 suivie d'une ablation de la hernie discale L5-S 1 .
Fermeture plan par plan avec pose d'un drain
ETIOLOGIE. L'étiologie d'une hernie discale
ÉVOLUTION: L'évolution clinique est favorable après l'opération. Mais la
réapparition d'un hemisyndrome droit de la queue de cheval 3 mois après à
nécessité une réhospitalisation . Puis on note une stabilisation des troubles ceci
après un suivi d'un an..
27
PROTOCOLE N°7
MF 40 ans masculin SONACOS LINDIANE KAOLACK
ENTRÉE: le 24/02/94
DÉBUT: Remonterait à 15 jours marqué par la survenue brutale de douleurs
sacrées irradiant vers le MI gauche. Puis on note la survenue de :
EXAMEN : - Déficit moteur de MI du cote gauche à type de paraparesie
-
ROT abolis et RCP indifférent du côté gauche
- Hypoesthésie gauche
- Troubles sphinctériens ( dysurie + difficulté de la défécation)
PARACLINIQUE :
-
LCR: Cytologie: 3 éléments /mm3
Albuminorrachie 10gl1
-
Radio: normale
-
Myelo Arrêt complet du produit de contraste en L3-L4
TRAITEMENT: Incision médiane centré sur espace L3-L4 désinsertion
musculoaponevrotique.
Laminectomie de la partie deL3-L4. Discectomie d'une volumineuse hernie
discale ..
Fermeture plan par plan avec pose d'un drain.
ETIOLOGIE. L'étiologie d'une hernie discale médiane.
ÉVOLUTION: On note la persistance des douleurs après l'opération ayant
nécessité un traitement médical (antalgique - antiinflammatoire).Le malade a été
revu après 6 mois, 1 an et 2 ans avec une évolution toujours bonne.
28
PROTOCOLE N°S
MT 73 ans masculin Retraite
ENTRÉE: le 08/12/85
DÉBUT: Remonterait à 2 mois environ marqué par la survenu de lombalgies,
hyperalgiques, suivi peu après d'une impotence fonctionnelle des 2 MI.
ATCD: - traumatisme du rachis il y a 20 ans
- lombalgies chroniques
EXAMEN: -
Paraplégie flasque bilatérale, plus nette au MI droit
-
ROT aboli aux MI et RCP indifférent
-
Hypoesthésie des 2 MI
-
Troubles sphinctériens à type de rétention
- Assourdissement de BI au Foyer aortique
PARACLINIQUE : - Radio: arthrose lombaire
-
Myelo: arrêt du produit de contraste en L3-L4
- ECG: Début d'hypertrophie du ventricule gauche
TRAITEMENT: Incision médio dorsale centrée sur L3-L4. Désinsertion musculo
aponevrotique. Laminectomie décompressive de L4
Fermeture plan par plan
ETIOLOGIE. Canal lombaire étroit
ÉVOLUTION: Bonne évolution clinique après opération. La marche redevient
possible après un suivi de 8 mois avec disparition des troubles sphinctériens.
29
PROTOCOLE N°9
AN
62 ans masculin SICAP LIBERTE III VILLA 200 MEDECIN
ENTRÉE: le 08/06/87
DÉBUT: Remonterait à 3 mois marqué par des lombalgies hyperalgiques,
associées à des troubles de la marche et à installation d'une dysurie. On note une
marche à petit pas avec une boiterie à gauche.
ATCD: - Hospitalisé en 1979 pour accident de la circulation
- Hospitalisé en 1984 pour une lombosciatalgie de type L5
EXAMEN: -
Paraparésie
- Amyotrophie de la fesse gauche
- Abolition des achileens
- Troubles génitosphinctériens ( incontinence-constipationimpuissance)
PARACLINIQUE : - Radio: arthrose vertébrale en L5
- Myelo: arrêt du produit opaque en L4-L5
.TRAITEMENT : Incision médiane centrée sur l'espace L3-L4. Ouverture de
l'aponevrose et désinsertion musculaire. Laminectomie bilatérale en L5. On ne
retrouve pas de hernie, mais un étranglement du fourreau duraI par un canal
arthrosique nécessitant une foraminotomie .
Fermeture plan par plan avec pose d'un drain.
ETIOLOGIE. Canal lombaire étroit d'origine arthrosique
ÉVOLUTION: On note la persistance des troubles vésicosphinctériens pendant
3 mois, puis amélioration du tableau avec une disparition de ces troubles et une
reprise progressive de la marche après 7 mois de suivi sous kinésithérapie.
30
PROTOCOLE N°IO
BS
59 ans masculin KERABE Département de PODOR Arrondissement de
NDIOUM (ELEVElJR)
ENTRÉE: le 05/05/92
DÉBUT: Remonterait à 1 an environ marqué par la survenue intermittente
d'épisodes de lombosciatalgies bilatérales. Puis depuis 1 mois:
ATCD: - Traumatisme dorsolombaire il y a environ 1 an
EXAMEN: -
Paraparésie flasque
- ROT abolis et RCP indifférents
-
Hypoesthésie du lVilG .
P ARACLINIQUE : - LCR : Cytologie 2 éléments /mm3
Albumine normale
-
Radio: discarthrose LI-L2
- Myelo: arrêt du produit de contraste d'aspect peigné en regard de
L2-L3.
TRAITEMENT: - Incision médiane dorsale. Désinsertion musculaponevrotique
Laminectomie de L2 et L3 .. On se trouve devant une volumineuse hernie, dont on
fait la discectomie. Fenneture plan par plan
ETIOLOGIE. Hernie discale médiane
ÉVOLUTION: Bonne évolution du tableau clinique. Reprise progressive de la
marche au bout de 6 mois et sous kinésithérapie
31
PROTOCOLE N°II
MAB 59 ans masculin Rue Cx N SICAP Rue 10 VILLA 9544 Commerçant
ENTRÉE: le 17/06/93
DÉBUT: Apparition depuis 1 mois de paresthésie bilatérale à prédominance
gauche, des troubles de la marche et des troubles genito sphinctériens
EXAMEN : -
Déficit moteur du MI gauche avec amyotrophie distale
- Abolition du ROT à gauche et RCP indifférent
- Hypoesthésie en selle
- Incontinence et dysérection
PARACLINIQUE :- LCR cytologie et albuminorrachie normale
- Radio: arthrose lombaire
- Myelo: arrêt du produit de contraste en L l-L2
TRAITEMENT: Incision latero dorsale. Ouverture de l'aponevrose et
désinsertion musculaire. Laminectomie de LI et L2 . On ne retrouve pas de
hernie, ni de canal lombaire étroit; mais un aspect d'épidurite. Fermeture plan
par plan.
Oil fait un traitement médical par une antibiothérapie
ETIOLOGIE. Aucune étiologie retrouvée
ÉVOLUTION: On note une extension du déficit au MI droit quelques mois plus
tard ayant nécessité une réintervention. Par la suite on a une assez bonne évolution,
mais persistance des troubles sphinctériens ayant nécessité une orientation en
urologie pour une meilleure prise en charge..
32
PROTOCOLE N°12
MS 45 ans masculin MAURITANIE (Phannacie EL HILAL ATTAR)
ENTRÉE : le 26/07/93
DÉBUT : Remonte à 1 an marqué par des épisodes de lombalgies s'accentuant
progressivement. Plus depuis 1 mois on note:
EXAMEN : -
Déficit moteur du MI droit
- Abolition du ROT droit
- Hypoesthésie en selle
PARACLINIQUE : -
LCR: dissociation albuminocytologique
Cytologie: 3 éléments /mm3
Albumine : 12 g/l
- Radio: Spondylite L4
- Myelo: Refoulement du fourreau duraI en L4-L5
- Echopelvienne: kyste rétrovesical de nature inconnue
TRAITEMENT: Incision médio dorsale centrée sur l'espace L4-L5. Ouverture
de l'aponevrose et désinsertion des muscles. Laminectomie de L4 et L5.
Discectomie ramenant un important matériel détorioré
ETIOLOGIE. En fait inconnue
'.c
.
?
- In1ectIOn
- localisation secondaire?
_
ÉVOLUTION: Le malade a été exeaté après l'opération car ayant décidé de
rentrer. L'évolution n'a pu être apprécier. Il devrait bénéficiée d'une intervention
abdominale pour une exerese de la lésion retrovesicale non étiquetée.
33
PROTOCOLE N°l3
TG
42 ans masculin Parcelles Assainies Unité 5 N°119 Commerçant
ENTRÉE: le 05/04/95
DÉBUT: Il y a 5 mois environ par des épisodes de lombalgies bilatérales. Puis on
note l'apparition d'une claudication médullaire intermittente allant jusqu'à
l'apparition d'une impotence fonctionnelle absolue.
EXAMEN: - Paraparesie
- Areflexie rotulienne et achileenne bilatérale
- Hypoesthésie en selle
PARACLINIQUE:
LCR normale
- Radio: présence d'une arthrose lombaire étagée L2-L3-L4
Myelo : arrêt du produit de contraste en L3-L4
TRAITEMENT: Incision médiane. Ouverture de l'aponevrose et désinsertion
musculaire. On retrouve une volumineuse hernie, dont la discectomie ramène un
matériel important, associé à un canal lombaire étroit. Fermeture plan par plan
avec pose d'un drain.
ETIOLOGIE: Canal lombaire étroit + hen1Îe discale
ÉVOLUTION: Bonne évolution clinique avec une reprise progressive de la
marche sous kinésithérapie après un suivi d'un an environ.
34
PROTOCOLE N°14
M.ND 28 ans Masculin THIALAW Quartier NGUINTH TAKHIKAO (THIES)
Cultivateur
ENTRÉE: le 16/01/95
DÉBUT: Remonterait à 1 mois marqué par la survenue brutale de lombalgies
bilatérales hyperalgiques. Suivi 2 semaines plus tard de l'apparition d'une
impotence fonctionnelle des 2 MI.
ATCD: - Lépreux connu et traité
. EXAMEN : -
Paraparésie prédominant à G
- ROT abolis aux MI
- Pas de troubles sensitifs, ni sphinctériens
PARACLINIQUE : -
Radio normale
- Myelo: rétrécissement du fourreau duraI de L3-L5,
évocateur d'une pathologie épidurale.
TRAITEMENT: -
Incision médiane dorsale centrée au niveau L3-L4-L5.
Désinsertion musculoaponevrotique
Laminectomie de L3-L4 et L5 avec le
disque L5-S1 nécrose. Fermeture plan par plan.
Antibiothérapie
ETIOLOGIE. Epidurite infectieuse staphylococcique
ÉVOLUTION: Marquée secondairement par une suppuration de la plaie
opératoire ayant nécessité une reprise de l'opération et une antibiotherapie 1 mois
après la 1ere intervention. Par la suite on note une bonne évolution clinique avec
une reprise progressive de la marche après un suivi de 9 mois.
35
PROTOCOLE N°t5
lVIB N 64 ans Masculin YABO y ABO Arrondissement THIADIA YE (MBOUR)
Pêcheur
ENTRÉE: le 15/02/95
DÉBUT: Remonterait à 8 mois marqué par apparition de troubles
vésicosphinctériens (dysurie initiale suivi d'une incontinence) ayant nécessité une
orientation en urologie. Puis le malade consulté en neurochirurgie.
EXAMEN:
-
Paraparésie
-
Hypoesthésie tactile et douloureuse en selle.
-
Réflexe cutané plantaire et abdominal indifférent
-
Troubles sphinctériens (incontinence et constipation)
PARACLINIQUE : -
Radio: lombarthrose étagée avec scoliose lombaire et
empreinte discales au niveau de L3-L4-L5
eMyelo : Réduction du diamétre du fourreau duraI en regard des disques L3-L4-L5
et L5-S 1.
TRAITElVIENT : -
Incision médiane. Désinsertion musculoaponevrotique .
Laminectomie de L4-L5 associé à une foraminotomie bilatérale du faite d'une
hypoplasie des lames associée à une hypertrophie arthrosique des 2 articulaions
interapophysaires postérieures.
ETIOLOGIE. Canal lombaire étroit d'origine arthrosique .
ÉVOLUTION: On note la persistance des troubles sphinctériens ( dysurie) ayant
nécessité un traitement médical ( DITROPAN) . Puis le malade est suivi à titre
externe en urologie.
36
PROTOCOLE N°16
CB 48 ans masculin
ENTRÉE: le 05/1 0/84
DÉBUT: Remonterait à 2 mois marqué par des épisodes de lomboscialgies
bilatérales, suite à un traumatisme (balle de fusil)
EXAMEN : - Impotence fonctionnelle du MI gauche
- Hemianesthésie en selle à gauche
- ROT abolis
- Troubles sphinctériens à type incontinence
d'urine
PARACLINIQUE :- Radio nonnale
- Myelo: arrêt incomplet en regard de LI.
TRAITEMENT: Incision médiane dorsale centrée sur LI. Ouverture de
l'aponevrose. Désinsertion musculaire. Laminectomie de LI et L2. Ablation d'un
fragment de balle.
Fermeture plan par plan avec pose d'un drain.
ETIOLOGIE. Canal lombaire étroit
ÉVOLUTION: Marquée par l'apparition d'une légère impotence fonctionnelle
6 mois après l'opération. Mais après un suivi de 2 ans on note une disparition de
tous les signes.
37
PROTOCOLE N°17
MFG 33 ans Féminin III Rue BLANCHOT (DAKAR) Ménagère
ENTRÉE : le 13/05/85
DÉBUT: Remonterait à 1 mois environ marqué par la survenue de douleurs
lombaires. Puis:
EXAMEN : - Paraparèsie des 2 MI
-
Abolition des réflexes rotuliens et achileens
• Anesthésie en selle
-
Troubles sphinctériens (dysurie)
PARACLINIQUE : - LCR : Dissociation albuminocytologique
Cytologie : 4 éléments/mm3
Albumine : 13 g/l
-
Radio nonnale
-
Myelo: arrêt complet du produit de contraste en L4-L5.
TRAITEMENT: Incision dorsale, ouverture de l'aponevrose et désinsertion
musculaire. Laminectomie de L4 bilatérale. On tombe sur une hernie médiane dont
on fait ablation.
Fenneture plan par plan
ETIOLOGIE. Hernie discale médiane
ÉVOLUTION: Bonne évolution clinique avec reprise de la marche au bout de 2
mois avec disparition des troubles sphinctériens. Le malade est revu en consultation
externe pendant 1 an 1/2 avec toujours une évolution favorable.
38
PROTOCOLE N°I8
SB 43 ans Masculin III
ENTRÉE: le 09/12/85
DÉBUT: Remonterait à 1 mois Y2 marqué par la survenue d'épisodes de
lombasciatalgies Puis :
EXAMEN : -
Paraparèsie flascospasmodique
- ROT abolis aux 2 MI
- Anesthésie en selle
- Troubles sphinctériens à type incontinence d'urine
PARACLINIQUE : -
LCR : nonnale
- Radio: on note1a présence de géodes
- Myelo: arrêt du produit de contraste en L3-L4.
TRAITEMENT: Incision dorsale avec désinsertion musculo aponevrotique .
Laminectomie élargie de L2-L3-L4.Présence d'une hernie discale dont on fait
ablation.
Fenneture plan par plan avec pose d'un drain.
ETIOLOGIE. Hernie discale médiane
ÉVOLUTION: On note une reprise progressive de la marche au bout de 2 mois
avec une disparition des troubles sphinctériens. Le malade a été suivi pendant 1 an
sans apparition d'autre signes.
39
PROTOCOLE N°19
OB 52 ans Masculin Pikine Médina GOUNAS Retraité
ENTRÉE: le 17/04/87
DÉBUT: Remonterait à 2 mois marqué par la survenue de douleurs lombaires
résistant au traitement médical. Puis on note secondairement l'apparition d'une
impotence fonctionnelle.
ÈXAMEN : - Paraparésie
- ROT abolis
- Troubles génitosphinctériens à type d'incontinence d'urine et
d'éjaculation précoce
PARACLINIQUE: - Radio: canal lombaire étroit
- Myelo: pas de signe particulier.
TRAITEMENT: Incision médiane dorsale, ouverture de l' aponevrose et
désinsertion musculaire. LamineCtomie bilatérale de L5. On note la présence d'une
protrusion discale L5-S 1 dont on fait incision, associée à une foraminotomie
bilatérale.
ETIOLOGIE. Canal lombaire étroit + Hernie discale
ÉVOLUTION: Bonne évolution du tableau clinique après un délai de suivi de 8·
mOlS.
40
PROTOCOLE N°20
SF 65 ans Féminin YOFF DAGOUDANE SIC LABA NDIAYE Mareyeuse
ENTRÉE: le 17/07/90
DÉBUT: Remonterait à 1 mois marqué par la survenue d'épisodes de lombalgies
bilatérales Puis :
_.
EXAMEN : -
Paraparèsie
Anesthésie en selle
- Troubles sphinctériens à type dysurie
TOUCHER VAGINAL: Lésion du col de l'utérus. Mais une nature maligne a été
éliminée à l'institut du cancer.
P ARACLINIQUE
- Radio: lombarthrose étagée
- Myelo: compression extrinséque d'origine herniaire en
regard de L3-L4 et de L4-L5 avec arrêt du produit de
contraste par un canal lombaire étroit.
TRAITEMENT: Incision médiodorsale .Ouverture de l'aponévrose et
désinsertion musculaire. Laminectomie décompressive de L3-L4 et d'une partie de
L5. On ne retrouve pas de hernie discale, mais on pense à une arthrose lombaire..
Fermeture plan par plan avec pose d'un drain.
ETIOLOGIE. Canal lombaire étroit d'origine arthrosique
ÉVOLUTION: Persistance des troubles sphinctériens pendant 8 mois ayant
nécessité l'orientation du malade en urologie pour une prise en charge.
41
/
RESULTATS
42
111-1 EPIDEMIOLOGIE
A-l : Incidence
Sur les 152 cas de compressions médullaires non portiques et non traumatiques
opérés durant la période, nous avons recensé 20 cas de compressions de la queue de
cheval .
Ges 20 compressions se répartissent suivant diverses étiologies.
Les compressions de la queue de cheval représente 13,2% des compressions
médullaires non portiques, non traumatiques, durant notre période d'étude.
A-2: Le Sexe
Notre série comporte 17 hommes pour 03 femmes
A-3 : L'âge
La moyenne d'âge retrouvée est de 50 ans avec des extrêmes allant de 28 ans à 73
ans.
TABLEAU 2: REPARTITION SELON L'AGE ET LE SEXE
AGES EN ANNEE
M
T
F
0-10
0
0
0
11-20
0
0
0
21-30
1
0
1
31-40
1
2
3
41-50
5
0
5
51-60
6
0
6
61-70
3
1
4
71-80
1
0
1
43
A~4:
les Antécédents
Dans notre série 04 patients ont présenté des antécédents de traumatisme par
accidents de la circulation ou par chute.
Tous les autres malades ont présenté des antécédents de lombalgies ou de
lombosciatalgie.
I!I-2 CLINIQUE
1II-2-1 / LE DELAI D'HOSPITALISATION
Le délai d'hospitalisation a pu être apprécié chez tous nos patients. Il va de 4 mois
à 1 an avec une moyenne de 7 mois.
1II-2-2 / LA PHASE DE DEBUT
III~2~2~1
Les douleurs
,
Elles sont trouvées chez tous nos 20 malades
- les douleurs rachidiennes :
Nousles avons notées dans 11 cas à type de lombalgies chroniques.
~
les douleurs radiculaires
Elles étaient présentes dans 02 cas et étaient à type de névralgies sciatiques.
- les douleurs rachidiennes et radiculaires
Elles sont à type de lombosciatalgies et ont été retrouvées dans 06 cas.
1II-2-2-2/ Les Paresthésies
Elles sont notées dans 02 cas et sont à type de décharge électrique (01 cas) et de
burning foot (01 cas)
44
1II-2-2-3 / Les troubles moteurs
Nous les avons notés dans toute nos 20 observations et ils étaient inauguraux dans
02 cas.
~
Diminution de la force musculaire
Nous retrouvons une diminution de la force musculaire dans 02 cas.
~
Les troubles de la marche
Elles ont été retrouvées chez 05 de nos patients.
III-2-2-4/ Les troubles sphinctériens
Ils sont présents dans 04 cas et sont à type de dysurie (03 cas) et dans 01 cas on
retrouve un trouble de l'érection.
111-2-3/ LA PHASE D'ETAT
III-2-3-1- Les douleurs rachidiennes et radiculaires
Les douleurs à type de lombalgies sont retrouvées dans 01 cas.
1II-2-3-2 - Les paresthésies
On ne retrouve pas de cas de paresthésie à la phase d'état.
III-2-3-3- Les troubles moteurs
Nous les avons chez tous nos 20 malades et ils sont type de :
- Monoparésie dans 01 cas
-
Paraparésie dans 16 cas
-
Paraplégie dans 03 cas
III-2-3-4- Les troubles du tonus.
Dans toutes nos 20 observations, nous retrouvons un trouble du tonus, surtout à
type d'hypotomie.
45
1II-2-2-S- Les troubles trophiques
Ils sont retrouvés dans 03 cas et sont à type d'amyotrophie.
III~2~3~6..
-
Les troubles des réflexes
Les réflexes ostéotendineux :
Dans nos études les réflexes ostéotendineux étaient:
Présents : on note la présence des réflexes rotuliens dans 07 cas et ils étaient
normaux. Le réflexe achileen était normal dans 14 cas.
Absents: le réflexe rotulien était aboli dans 13 cas alors que le réflexe achileen
était aboli dans 06 cas.
- Autres réflexes
- Le réflexe cutané plantaire était présent et nonllal dans 12 cas, et indifférent dans
08 cas.
- Le réflexe cutané abdominal était absent dans 01 cas.
III-2-3-7 : Les troubles sensitifs objectifs
Ils sont observés dans 13 cas et sont à type
hypoesthésie : retrouvée dans 08 cas
Tactile et douloureuse: 02 cas.
Non décrite: 06 cas
Anesthésie : retrouvée dans 06 cas
02 cas d'héminathésie
04 cas d'anesthésies complète en selle
46
III-2-3-8 Les troublesgenito - sphincteriens
On retrouve des troubles genitosphinctériens dans 15 cas
et ils sont à type de : .
Trouble de miction : 01 cas
Constipation : 04 cas
Incontinence : 06 cas
Impuissance sexuelle: 03 cas
Rétention d'urine: 01cas
Dans les 06 autres cas nous avons des associations
dysurie + constipation: 03 cas
dysurie + rétention: 03 cas
III-2-3-9 Autres signes d'examen
une gibbosite lombaire est retrouvée dans 01 cas
- une prostate augmentée de volume et indolore est retrouvée dans 01 cas
- une lesion cutanée suspecte de mycétome est retrouvée 01 fois
111-3 PARACLINIQUE
. III-3-l/ ETUDE CYTOCHIMIQlJE DU LCR
L'étude cytochimique du LCR a été réalisée chez 09 de nos patients.
L'albuminorachie est normale dans les 06 cas. Elle est élevée dans 03 cas avec un
taux de 18 g/l dans une observation
Il existe une dissociation albuminocytologique dans 03 cas.
47
III-3-2/ LA RADIOGRAPHIE STANDARD DU RACHIS.
Des clichés du rachis lombaire.ont été réalisés avec des incidences de profil et
de seze.
Tous nos 20 malades ont eu une radiographie standard du rachis. Chez 02 d'entre
eux, les clichés ne sont pas retrouvés dans le dossier.
III-2-3-l/ Les Résultats pathologiques
Ils son notés dans 15 cas.
- Lésions d'ensemble
~
L'examen d'ensemble de la chamiére lombosacrée ne montre pas d'aspects
particuliers, sauf chez 01 de nos malades qui présente une
Cyphose lombaire.
- Lésions particulières Elles sont retrouvées chez 15 de nos patients et sont à· type
de:
* Lésions du corps vertébral
image de tassement du corps vertébral dans 02 cas
osteophytes dans 04 cas
osteoscleroses dans 03 cas
* Lésions du disque intervertébral
Image de pincement discal dans 02 cas
Image de discarthrose dans 02 cas
Image de spondylite dans 01 cas
* Lésions des pédicules
Image de lyse osseuse dans 01 cas
* Lésions des trous de conjugaison
On ne retrouve pas de lésion des trous de conjugaison.
48
III'"3'"3 LA MYELOGRAPHIE OU SACCORA.DICULOGRAPHIE
Tous nos 20 malades on eu à bénéficier de la myelographie. Il s'agit d'une
myelographie avec utilisation de produits de contraste.
Les produits anciennement utilisés étaient: le LlPIODOL et la METRlZAMIDE
(AMIPAQUE)
On utilise surtout aujourd'hui le IOPAMIDOL (lOPAMIRON)
III-3-3-l/ RESULTATS
. Dans notre étude nous avons relevé :
Résultats normaux:
La myélographie était nonnale dans 02 cas.
1
Résultats pathologiques:
Nous retrouvons des résultats pathologiques dans 18 as.
Un arrêt du produit de contraste dans Il cas
Un arrêt du produit de contraste en <dent de scie> dans 02 cas
Un arrêt du produit de contraste avec un aspect frangé dans 02 cas.
Un refoulement du fourreau duraI dans 01 cas
Un rétrécissement du fourreau duraI dans 02 cas.
111-4 ETIOLOGIES
La classification étiologique des compressions de la queue de cheval nous a pennis
de retrouver
49
TABLEAU 3 : CLASSIFICATION ETIOLOGIQUE DES· COMPRESSIONS
DE LA QUEUE DE CHEVAL.
CAUSE
NOMBRES DE CAS
Canal lombaire étroit
08
Hernie discale
06
Tumeur (adénocarcinome)
01
Epidurite
01
Parasitaire
01
Inconnue
02
111-5- TRAITEMENT
III-S-i Le traitement médical
Un traitement médical à base d'Antalgiques et d'Anti-inflammatoires a été mise en
œuvre chez tous nos malades avant opération.
III-S-2 Le Traitement chirurgical
Le traitement chirurgical a été effectué chez tous nos 20 malades avec un abord par
voie postérieure.
Une laminectomie a été réalisée chez tous les 20 patients avec ablation d'un arc
Postérieur (06 cas), de deux arcs postérieurs (10 cas) et de trois arcs postérieurs
(04cas).
50
Cette laminectomie a été élargie dans 02 cas pour enlever' une tumeur et une
hernie
discale volumineuse.
La laminectomie a permis de retrouver dans 06 cas une hernie discale et dans 01
cas l'existence d'une tumeur.
Dans les 13 autres cas la laminectomie a été surtout décompressive intéressant un
os mité d'aspect sucré mouillé (1 cas) , un os hypertrophique (3 cas) et
un os d'allure arthrosique avec une hypertrophie des lames et un rétrécissement du
canal lombaire dans 07cas.
Cette laminectomie est associée à :
une discectomie dans 06 cas
une foraminotomie dans 02 cas
une ablation d'un fragment de balle dans 01 cas
la laminectomie s'est compliquée d'une:
hémorragie due à l'existence d'une gangue inflammatoire et
hémorragique péridurale (dans 01 cas) et dans l'autre cas elle
est due à l'existence d'un tissus tumorale très hémorragique.
Infection: à type d'inflammation des beiges dans 03 cas et de
suppuration vraie dans 01 cas.
Le germe retrouvé après antibiogramme était un staphylocoque ayant nécessité une
antibiothérapie (OXACILLINE).
La fermeture de la peau a été réalisée plan par plan:
avec drainage (07 cas)
sans drainage (13 cas)
51
III,,4,,3 : CONSTATATIONS OPERATOIRES
L'examen préopératoire nous a permis de retrouver:
Une tumeur extradurale (01 cas) : elle est de consistance molle,
fiable. La tumeur a infiltré le tissus osseux et intéresse les corps
vertébraux de L4 et L5.
L'apophyse épineuse et les lames de L5 ont été détruite.
Une épidurite infectieuse On note la présence d'un pus épais et
jaunâtre dont l'examen bactériologique a mis en évidence par la
suite la présence d'un staphylocoque doré 2 fois sur 3.
Canal lombaire étroit: on a retrouvé un canal lombaire étroit
dans 06 de nos observations et elle était médiane 05 fois sur 06 et
volumineuse.
III-4-4- ANATOMIE PATHOLOGIQUE
Un seul examen anatomo-pathologique a été réalisé, car nous n'avons
retrouvé qu'une seule tumeur dans notre série.
L'examen de la tumeur extradurale au microscope révèle qu'il s'agit
d'un adénocarcinomie peu différencié, métastase au niveau vertébral,
d'origine prostatique probable.
52
III~5
- EVOLUTION
L'évolution post-opératoire n'a pu être appréciée chez 02 de nos
patients, le premier ayant décidé de rentrer en Mauritanie après
l'opération le second n'a pas été revu pour le suivi post opératoire.
Pour les autres malades de notre série, les résultats ont pu être
appréciés et classés après 3 mois à 4 ans de suivi.
Mauvais résultats : quand il existe une aggravation de l'état du patient.
Résultats moyens
: s'il y a une amélioration de l'état du patient
avec persistance de séquelles.
Bons résultats: sil s'agit de patients complètement guéris avec un
examen neurologique normal.
111·5.0 MORTALITE
Aucun cas de mortalité n'a été noté d~ns notre étude
111-5-1 LES MAUVAIS RESULTATS
Ils sont notés dans deux cas avec la présence d'une aggravation de l'état général
des patients.
111-5-2 LES RESULTATS MOYENS
On note des résultats moyens chez 07 de nos patients. Dans 06 cas les patients
présentent une persistance des troubles vésicosphinctériens à type de dysurie, de
retard de la miction, ou incontinence urinaire.
Dans 01 cas le patient présentait la persistance d'un paraparésie.
111-5-3 LES BONS RESULTATS
Ils sont notés dans Il de nos observations avec une reprise de la marche dans un
délais allant de 6 mois à l an et une disparition des troubles sensitifs et
vésicosphinctériens.
53
TABLEAU 4 : TABLEAU RECAPITULALTIF
DIAGNOSTIC
NOMBRE
DE RECUPERATION ETAT
ETIOLOGIQlJE
CAS
Canal lombaire
07
05
Hernie discale
06
06
Epidurite
02
01
01
01
AGGRAVATION
STATIONNAIRE
02
~
Il
1
Étroit
01
Infectieuse
Traumatisme
Adenocarcnome 01
Etiologie non
01
02
01
Retrouvée
Parasitaire
(mycétome)
01
01
01
54
COMMENTAIRES.
55
IV-l DONNEES ETIOLOGIQUES
IV-l-ll LA FREQUENCE
Les compressions de la queue de cheval représentent 13,2 % des compreSSIOns
médullaires non pottiques et non traumatiques, durant notre période d'étude. Ce
taux est plus élevé que celui retrouvé par ILLO (34 ) lors d'une étude précédente
et qui avait retrouvé une fréquence de Il,8%.
Selon EPSTEIN
(22) elle représente environ 10 à 15 % des compreSSIOns
médullaires.
Ce syndrome est cependant loin d'être rare, et nombreux sont les cas sans doute
méconnues eri raison de la discrétion des troubles et plus encore d'un certaine
méconnaissance de la symptomatologie.
IV- 1-2 1 LE SEXE
Nous avons retrouvé la nette prédominance masculine signalée par tous les auteurs
(17 hommes pour 03 femmes).
ILLO (34 ) dans sa série étudiée à DAKAR retrouve 3 femmes pour 18 hommes.
DELACAMBRE (18 ) dans son étude de 31 patients retrouve 25 hommes pou 6
femmes.
IV- 1- 31 L'AGE
Notre étude nous a pennis de remarquer que les symptômes apparaissent
tardivement. La moyenne d'âge retrouvée est de 50 ans avec des extrêmes allant de
28 à 70 ans.
ILLO (34 ) retrouve quand à lui une moyenne d'âge de 40 ans avec des extrêmes
56
allant de 7 à 70 ans.
Pour MANSUY et coll ( 44 ) les compressions de la queue de cheval surviennent
aux environ de 45 ans.
De même ARNAUX et con ( ) ont constaté dans leur étude, que la plupart des cas
s'observe entre 40 et 60 ans.
Nous n'avons pas retrouvé d'enfants dans notre étude.
ILLO (34) avait retrouvé 2 enfants de 7 et 12 ans dans son étude.
De même PAYE O. (49 ) retrouve 2 enfants dans son étude.
IV-1-4 LES ANTECEDENTS
Tous nos 20 patients ont présenté un passé lombalgique.
04 malades ont par ailleurs présenté des antécédents de traumatisme par accidents
de la circulation ou par chute.
Le même passé lombalgique avait été retrouvé par (34) dans son étude.
DELCAMBRE (18 ) retrouve des antécédents lombalgiques lors de son étude.
IV-l-S LA PROFESSION
Nous nous sommes rendus compte au cours de notre étude que la fréquence de
survenue des compressions de la queue de cheval, était plus important chez les
sujets dont la force ou la station debout prolongée, domine dans leur travail.
Cette même fréquence a été retrouvée par beaucoup d'auteurs, notamment (34-18).
IV - 2 CLINIQUE
Le délai d'hospitalisation va de 4 mois à 1 an avec une moyenne d'environ 7 mois.
Le délai d'hospitalisation est a peu prés le même que celui retrouvé par ILLO ( 34 )
dans son étude.
JOYEUX ( 38) dans sa thèse a trouvé une moyenne d'environ 30 mois, mais
surtout pour les neurinomes à forme algique pure.
57
Le délai d'hospitalisation est en général long et dépend donc de la précocité du
diagnostic.
IV-2-1 LE DEBUT
Le début est généralement progressif dans 80 % des cas avec des troubles sensitifs
subjectifs ( douleurs et paresthésies ) des troubles moteurs et des troubles
sphinctériens.
DELCAMBRE (18 ) dans son étude retrouve un début progressif des troubles dans
84 01<1 des cas.
De même un début progressif des troubles a été retrouvé par PEYSER et
collaborateurs ( 52 ) dans une série de 2 cas de compressions de la queue de cheval
par rupture d'un disque intervertébrale.
(34 ) retrouve un début progressif dans 80% des cas.
Classiquement les douleurs inaugurent la maladie et sont retrouvées chez
tous nos 20 malades.
Le syndrome rachidien est souvent présent à cette phase de début et précède
souvent la compression de la queue de cheval et est caractérisé par des douleurs à
type de lombalgies bien localisées et aggravées par l'effort et la station debout
prolongée.
PEYSER ( 52 ) retrouve un syndrome rachidien inaugural lors de son étude.
D'autres auteurs (34-18) retrouvent également la présence d'un syndrome rachidien
chez presque tous leurs malades.
LES PARESTHESIES: notre étude nous a pennis de remarquer que les
paresthésies étaient présentes à la phase du début de façon modulée. (34 ) dans
son étude retrouve les paresthésies surtout bilatérales et volontiers asymétrique.
58
RAVAULT (53 ) cité par DELCAMBRE avait également retrouvé des
paresthésies dans presque tous ces cas.
LES TROUBLES MOTEURS présents chez tous nos 20 malades sont
également retrouvés dans toutes les autres séries. PEYSER ( 52 ) dans son étude
portant sur les compressions de la queue de cheval par rupture d'une hernie discale,
retrouve des troubles moteurs dans tous ces cas. De même CONTAMIN et coll
(15) retrouvent des troubles moteurs.
Les troubles moteurs à cette phase de début sont rarement inauguraux et sont les
. plus souvent masqués par des signes sensitifs comme les douleurs qui apparaissent
en premIer.
LES TROUBLES SPHINCTERIENS
Notre étude nous a permis de remarquer que les troubles sphinctériens à ce stade de
début était soit inexistant soit très discret et se manifeste sous forme de dysurie ou
de troubles de l'érection.
Selon GRELLIER (29 ) les troubles sphinctériens sont exceptionnels à la phase de
début.
PEYSER (52) retrouve dans son étude quelques troubles sphinctériens à laphase de
début.
PAILLAS (46) cité par DELCAMBRE
(18) affinne que les troubles
génitosphinctériens à type d'impériosité mictionnelle ou de rétention d'urine
d'impuissance ou d'érection transitoire à la marche apparaissent plus rarement.
com AMIN et coll
( 15 ) retrouvent des troubles sphinctériens à la phase de début
dans leur étude portant sur l'association spondylarthrite ankylosante et syndrome
de la queue de cheval.
59
IV-2-2 LA PHASE D'ETAT
Elle correspond habituellement à la phase où le malade vient consulter.
Les troubles moteurs, réflexes et sphinctériens vont prendre le dessus sur la
douleur.
Notre étude nous a pennis de remarquer que du fait de la faiblesse des moyens
financiers; les malades ne venaient en consultation qu'à un stade assez avancé.
Presque tous nos malades présentaient une paraparésie flasque au moment du
diagnostic.
JOYEUX (38 ) à partir de son étude portant sur 16 cas de compressions de la queue
. de cheval par un neurinome, remarque que presque tous les diagnostics étaient
effectués à la-phase paralytique.
ILLüde même (34 ) retrouve dans son étude, que tous les diagnostics étaient
effectués à cette phase.
1
Les signes sensitifs objectifs à type d'hypoesthésie ou d'anesthésie en selle
ont été fréquemment retrouvés dans notre étude, alors que les signes subjectifs à
type de douleurs et de paresthésie étaient inexistants.
L'atteinte des réflexes ostéotendineux ( rotuliens et achiléens) était plus
.fréquente et ces réflexes étaient souvent abolis.
Ce qui rejoint les résultats de PEYSER (52 ) et de CONTAMIN ( 15)
Les troubles sphinctériens, après les troubles moteurs, étaient les plus
importants dans cette phase. Ils étaient à type de constipation, d'incontinence ou de
dysurie. L'importance de ces troubles sphinctériens, a été décrite par tous les
auteurs. Souvent compatible avec une vie active sociale au début de la maladie;
elles deviennent totales et invalidantes à la phase d'état selon CüNTAMIN (15 ).
JACOMET. C (37 ) retrouve ces mêmes troubles sphinctériens dans son étude
portant sur 07 cas de syndrome de la queue de cheval du au cytomégalovirus au
cours de l'infection à VIH.
60
IV-3 ETIOLOGIES
L'analyse de nos différentes étiologies nous a permis de remarquer, la
prédominance du canal lombaire étroit dans les étiologies de nos compressions de
la queue de cheval, suivi de peu par les hernies discales.
Ces 02 pathologies étant responsables à elles seules de prés de 70% des cas de
compressions de queue de cheval.
La décision d'exclure de nos étiologies tous les cas de compression de la queue de
cheval d'origine traumatique et surtout d'origine pottique, explique donc l'absence
dans notre série d'une des étiologies les plus fréquentes.
Une.autre particularité de nos étiologies, concerne l'étiologie tumorale. Il n'a été
retrouvé aucun cas de neurinomes ou de neurofibromes dans notre étude ; alors que
--- ----_-:.-dansl~dittérature,-les neurinomesconstituent-une part non négligeable dans les
causes de compression de la queue de cheval.
- En faisant une étude comparative avec la série de ILLO (34 ) à propos de
21 cas de compressions de la queue de cheval, on se rend compte qu'à peu prés les
mêmes étiologies sont retrouvées dans les 02 études.
TABLEAU 5 :CLASSIFICATION ETIOLOGIQUE SELON ILLO
NOMBRE DE CAS
CAUSES
Canal lombaire étroit
06
Hernie discale
04
Tumeurs : Ependymome
01
Neurinome
02
Epidurite
02
Spondylarthrite ankylosante
01
Filariose (suspicion)
02
Inconnue
03
61
Le même prédominance des 2 étiologies sus citées a été retrouvée, mais dans une
proportion inférieure (SO%).
Plusieurs auteurs ont eu a rapporté des cas de compression de la queue de cheval
avec plusieurs étiologies:
- HUBAULT. A ( 33 ) rapporte 48 cas de compressions de la queue de cheval par
des tumeurs, se répartissant :
Neurinomes : 31
Ependymomes : OS
Métastases osseuses: 03
Méningiomes : 02
Chordomes : 02
Réticulosarcome : 02
Tumeurs vasculaires : 02
Tératome : 01
- VERBIEST. H ( 61 ) décrit 01 cas de compression de la queue de cheval par un
canal lombaire étroit congénital.
- MANSUY.L et collaborateurs (44
) rapportent sur un étude de 10 cas de
compressions de la queue de cheval par une hernie discale, 06 cas de hernie L4-LS
et 04 cas de hernie L5-S1
":' De même PAILLAS et collaborateurs ( 47 ) rapportent 31 cas d e compression de
la queue de cheval par des hernies se répartissant en :
62
TABLEAU 6: REPARTITION DES HERNIES DISCALES
SIEGE
NOMBRE
Disque L5-S 1.
11
Disque L3-L4
06
Disque L4-L5
13
Disque L2-L3
01
. -:.ÇONTAMIN..et collaborateurs (15 ) ont rapporté un cas de compression de la
queue de cheval par une spondylarthrite ankylosante associée à une dilatation du
.
··C_
cul de
sac:lombair~gveclm
volumineux divérticule arachnoïdien .
- DELCANIBRE et collaborateurs
(18) rapportent quant à eux 31 cas de
compressions de la queue de cheval par un canal lombaire étroit congénital
dégénératif ou mixte se répartissant en :
TABLEAU 7 : CLASSIFICATION DES CANAUX LOMBAIRES ETROITS
TYPES
NOMBRE
Sténose
06 cas
Constitutionnelle
Sténose acquise
04 cas
(arthrose)
Sténose mixte :
21 cas
• Hernie discale
12 cas
• Spondylolisthesis
09 cas
63
Notre étude nous a pennis donc de remarquer que les compressions de la queue
de cheval étaient dues soit à :
Un canal lombaire étroit survenant surtout sur un terrain arthrosique connu
soit une hernie discale antérieure
Enfin soit à une tumeur lombaire
IV-4 PARACLINIQUE
IV-4-1 / ÉTUDE CYTOCHIMIQUE DU LCR
L'étude cytochimique du LCR nous a pennis de remarquer que lors des
compressions de la queue de cheval on avait surtout une hyperalbuminorrachie qui
parfois était associée à une dissociation albuminocytologique.
PAYE. 0 (49 ) dans sa thèse retrouve une hyperalbuminorrachie associée
à une dissociation albuminocytologique OS fois sur 06 neurinomes
intrarachidiens.
SOW (S7 ) dans son étude sur les méningiomes intrarachidiens au
Sénégal avait retrouvé une hyperalbuminorrachie dans 09 cas sur 16.
BOISERIE-LACROIX (9 ) à propos d'une étude portant sur 22 .
neurinomes et 18 méningiomes, trouve une hyperprotéinorrachie de 20,8
. g/l en moyenne pour les neurinomes et de 4,8 g/l pour les méningiomes
La dissociation albuminocytologique est souvent franche selon JOYEUX
(38 ). Cela n'a pas été le cas dans notre travail.
DELCAMBRE et collaborateurs ( 18 ) quant à eux ont remarqué que la
ponction lombaire était le plus souvent normale, parfois modéré.
64
JACOMET et collaborateurs (37 ) dans leur étude portant sur les
atteintes de la queue de cheval dues au cytomégalovirus au cours de
l'infection à VIH à propos de 07 observations, ont retrouvé dans le LCR
une pleiocytose à polynucléaire non altérés associée à une
hyperproteinorrachie.
IY/4-2 LES EXAMENS RADIOLOGIQUES
îV-4-2~fILAji~DIOGRAPHIESTANDARD DU RACHIS.
...
_-
--~
Elle a été réalisée chez tous nos patients et à permis de retrouver des lésions .
osseuses importantes intéressant aussi bien le corps vertébral ( tassement vertébral,
pincement discal),
les pédicules (lyse osseuse)
...---,.--.-,~
~,,---,_.,
-,-
.-'
."
,.
. . , ' .
On ne retrouve pas de lésions des trous de conjugaison.
PAYE. O( 49 ) dans sa thèse avait retrouvé des lésions osseuses
.importantes. Ces lésions étaient responsables au niveau lombo-sacré d'image
de lyse osseuse, de scalloping de géodes intracorporéales, de vertèbre borgne
et enfin d'aggrandissement es trous de conjugaison dus aux neurinomes.
DELCAMBRE et collaborateurs ( 18) retrouvent également ces images de
scalloping associée à une hypertrophie et une condensation de l'os adjacent.
Par contre ces derniers ont retrouvé des anomalies morphologiques et une
réduction des trous de conjugaison dans leur étude portant sur le canal lombaire
étroit.
LAOUlTI ( 40 ) dans sa thèse retrouve des lésions osseuses à types de
géodes intracorporéales d' ostécosléroses ou de tassement vertébral.
(34 ) avait remarqué que ces lésions pouvaient aller jusqu'à la disparition
de pédicule, réalisant la vertèbre borgne.
65
CONTAMIN. F (15 ) dans son étude portant sur l'association
spondylarthrite ankylosante et syndrome de la queue de cheval, retrouve des
images de pincement discal, de spondylite, de discarthrose.
Les trous de conjugaison étaient toujours libres.
IV-4-2- 2 : LA MYELOGRAPHIE
La myélographie ou injection d'un produit de contraste dans l'espace sous
arachnoidien, se fait soit par voie sous occipitale soit par voie lombaire avec
l'utilisation d'une table à bascule. La progression de la colonne opaque est survie
par la radioscopie et des clichés de face et de profil sont pris par intermittence.
Elle pennet de préciser le siège, les limites et d'orienter vers la nature de la
compression. Le niveau de l'arrêt indique celui de la compression.
La myélographie a cependant des limites.
Elle ne pennet pas d'analyser les parties molles paravertèbrales rendant
impossible un bilan d'extension intrarachidiens.
Une petite lésion très latérale peut être reconnue.
Le LIPIODOL longtemps utilisé, est aujourd'hui abandonné au profit du produit
hydrosolubles moins toxiques pour le système -nerveux central (IOPAMIDOL),
mais présentant plusieurs inconvénients.
C'est ainsi que certains auteurs cités par DILENGE (19 ) ont décrit des troubles
neurologiques liés à l'emploi du LIPIODOL :
Douleurs de type radiculaire (KRAUSS)
Paraplégies temporaires (MONIZ).
Graves troubles respiratoires (MC LAIRE - WARTENBERG)
Troubles plus ou moins grave de la mobilité, arachnoïdite
(PETIT-DUTAILLIS)
66
Dans notre série, la myélographie a presque toujours montré un arrêt du produit
de contraste, ce qui a permis de poser le diagnostic de compression de la queue de
cheval chez nos malades.
Cet arrêt du produit de contraste ne correspondait pas toujours avec le nIveau
cliniquement présumé de la lésion, mais correspondait au niveau de la tumeur mise
en évidence par l'intervention le plus souvent.
.. _ ,Nous rejoignons là les constatations de JACOBSON (35 )
IV -4-2·3 : LE MYELO-SCANNER
". -Couplée à la myélographie;- le scanner voit son intérêt augmenté.
Son apport
est surtout important dans le diagnostic des tumeurs intrarachidiennes.
Aucun
-- de nos malades n'a eu à bénéficier du Scanner.
-~-------_.---
.-
-'."
.
IV-4-2-4 : L'IMAGERIE PAR RESONNANCE MAGNETIQUE
Elle reste l'examen idéal, dans le diagnostic des compressions de la queue cheval.
Nos patients n'ont pas bénéficié de l'imagerie par résonance magnétique
nucléaire, non encore disponible dans notre pays.
IV-5 LE TRAITEMENT
IV-S-l : LE TRAITEMENT MEDICAL
Le traitement médical constitue la première étape de la pnse en charge
thérapeutique de ces compressions de la queue de cheval, notamment dans le cas
des hernies discales ou du canal lombaire étroit. Le plus souvent ce traitement
est à base d'antalgiques, d' anti-inflammatoires non stéroïdiens ou de
myorelaxant.
67
On retrouve dans la littérature quelque cas de compressions de la queue de
cheval ayant eu à bénéficier d'un traitement médical:
DELCAMBRE et collaborateurs (18 ) rapportent la cas de compressions de la
queue de cheval par un canal lombaire étroit ayant eu à bénéficier d'un
traitement médical, notamment:
Les antalgiques et les antiinflammatoires non stéroïdiens pouvant être
associés aux infiltrations locales de corticoïdes
Les infiltrations épidurales de corticoïdes pouvant entraîner une
amélioration franche et rapide de la symptomatologie fonctionnelle.
Dans notre étude nous n'avons pas eu à utiliser les infiltrations de corticoïdes. En
régIe générale les infiltrations de corticoïdes ne sont pas effectuées à la clinique
neurochirurgicale de Fann.
CROCCEL L (17
) et EVANS J.G (24 ) proposent les ganglioplégiques sous
fonne de Dibromure de Pentamethionum compte tenu de la théorie vasculaire de
ces troubles.
Les résultats retrouvés dans notre étude sont bons ( disparition ou diminution de la
symptomatologie fonctionnelle et amélioration du périmètre de marche et / ou des
signes neurologiques). Mais le recul moyen (10 ans) étant assez faible, ces résultats
sont encore à étudier.
IV -5-2 : LE TRAITEMENT CHIRURGICAL
L'efficacité du traitement selon FREREBEAU P ( 26) dépend d'une analyse
lésionnelle très exacte reposant sur des données radiographiques, qui va servir de
base au projet thérapeutique chinlrgical .
68
La laminectomie en représente le geste essentiel dont l'étendue en hauteur est
fonction de l'étendue de la sténose.
Tous nos malades ont eu a bénéficier d'un traitement chirurgical, notamment de la
laminectomie.
IV-5-2-1 : LES CONDITIONS OPERATOIRES
_.
L'acte chirurgical nécessite systématiquement un bilan préopératoire classique
(clinique et paraclinique) d'une anesthésie générale et d'un anesthésiste averti;
selon WORINGER (64 ) et de moyens modernes d'assistance respiratoire.
-La position opératoire à été la même pour tous nos malades: LE DECUBITUS
VENTRAL.
IV-5;.2 : L'ACTE CHIRURGICAL
La laminectomie en représente le geste essentiel et sera basée sur des données
cliniques et radiologiques.
Selon GASTON et collaborateurs ( 27) le recours large à la laminectomie
décompressive est avant tout indiqué dans les compressions postérieures exclusives
ou largement dominantes. Elle n'est pas logique par contre dans les lésions
antérieures, a fortiori s'il existe des troubles statiques du rachis
Cette laminectomie nous a pennis de mettre en évidence plusieurs étiologies
notamment:
• LE CANAL LOMBAIRE ETROIT
Plusieurs constatations opératoires morphologiques classiques ont été décrites au
cours du canal lombaire étroit. Il s'agit d'anomalies osseuses et disco-
li gamentaires.
69
-
AU NIVEAU OSSEUX :
On note une épaisseur anormale des lames accompagnée d'une réduction de leur
longueur mesurée depuis la base de l'apophyse épineuse jusqu'à l'apophyse
articulaire.
Il
en
découle
un
rapprochement
de
la
distance
séparant
l'articulation
intérapophysaire postérieure de l'apophyse épineuse avec une sagittalisation des
làmes.
On note également une saillie des facettes articulaires en dedans réduisant les
dimensions du canal, avec des pédicules brefs et des recéssus latéraux rétrécis.
-
AU NIVEAU DISCO-LIGAMENTAIRE
On note surtout à ce niveau une hypertrophie du ligament jaune qui devient
dur et scléreux associé à une protrusion discale.
Parfois on a une réduction de la graisse épidurale ou une formation de kystes
radiculaires qui peuvent s'y associer.
Dans le cas du canal lombaire étroit, le développement des moyens d'exploration a
permis de rationaliser le traitement chirurgical du canal lombaire étroit.
Le traitement est surtout" étiologique" de plus en plus et à la laminectomie qui
représente le geste essentiel sera souvent associé soit un recalibrage antérieur en
cas de sténose du récéssus latéral, soit une foraminotomie si la décompression au
niveau du canal radiculaire s'avère insuffisante.
• LA HERNIE DISCALE
Dans notre série nous avons eu dans 06 cas à faire une discectomie pour ablation de
la hernie discale souvent associée à ne protrusion discale.
L'exérese de la hernie discale a été effectuée facilement après une laminectomie
faite rapidement car la compression peut donner très rapidement des lésions
irréversibles des racines.
70
On n'a pas eu à noter de complications préopératoires.
• LA TUMEUR
L'exérese de la tumeur a été difficile à réaliser. Des complications dues à
l'existence d'une gangue inflammatoire et hémorragique péridurale et d'un tissus
tumorale très hémorragique nous a pousser à n'enlever qu'une partie de la tumeur.
• COMPLICATIONS PER-OPERATOIRE
Nous n'avons pas noté de complications per opératoires à part la tumeur intradurale
hémorragique dont on a pu faire une hémostase rigoureuse grâce à l'utilisation de la
coagulation bipolaire.
. L'absence de complications per opératoire- témoigne de la bonne prise en charge
des malades par le personnel médical et de sa bonne maîtrise des techniques
chirurgicales.
IV..6 :. ANATOMIE PAHTOLOGIQUE ..
Dans notre série portant sur 20 cas de compressions de la queue de cheval, 01- seul
cas de tumeur extradurale a été retrouvé.
Comme nous avons eu à le préciser lors des étiologies, aucun cas de neurinomes.
n'a é été retrouvé lors de notre étude.
Ceci ne doit pas nous pousser à penser que l'étiologie des neurinomes est rare.
En effet ILLO (34 ) dans sa thèse portant sur 21 cas de compressions de la
queue de cheval avait retrouvé 03 tumeurs dont l'examen anatomopathologique
avait retrouvé un ependymome et 02 neurinomes.
JOYEUX (38 ) dans sa thèse portant sur 100 cas de compressions de la queue de
cheval rapporte 26 cas de compression d'origine tumorale par des neurinomes.
BOISERIE LACROIX
(9) et collaborateurs quant à eux rapportent 1 cas de
compression de la queue de cheval par un neurinome à propos de 22 observations.
De notre étude et de la revue de la littérature il en ressort que l'étiologie tumorale
dans les compressions de la queue de cheval est de fréquence relativement faible.
71
PAYE. 0 ( 49 ) dans sa thèse portant sur les neurinomes et neurofibromes
intrarachidien n'avait trouvé qu'un cas de tumeur de la queue de cheval.
On peut donc penser que le fait de n'avoir pas retrouvé de neurinomes dans nos
étiologies n'est pas exceptionnel, du fait de la faiblesse de la fréquence de cette
étiologie.
IV -7 EVOLUTION
Le pronostic est fonction de l'âge du malade, de la nature de
l'obstacle, de son siège et de son volume et enfin de la précocité du
traitement, donc de l'état neurologique préopératoire.
Le traitement apparaît logiquement comme devant être préventif ou
très précoce étant donné l'importance des lésions.
IV-7-1 : LA MORTALITE
MORTALITE PRECOCE
Nous n'avons noté aucun cas de décès post opératoire dans notre série.
Ceci peut être mis en rapport avec le fait que l'intervention n'étant pas
particulièrement agressive, elle arrive a être bien supporter par le malade.
ROYCAMILLE et collaborateurs ( 54) dans leur étude portant sur 25 compressions
de la queue de cheval post traumatiques, ont noté 01 cas de mortalité précoce
DELCAMBRE (18 ) dans son étude portant sur 31 cas de canal lombaire étroit, ne
note aucun cas de mortalité précoce.
72
MORTALITE A DISTANCE
Dans notre série, nous n'avons relevé aucun cas de décès à distance.
Par contre 02 patients ayant eu une aggravation du tableau clinique après opération,
n'ont pas été revu par la suite.
Nous ne pouvons en déduire qu'ils sont morts.
IV-7-2: DANS LE SUIVI POST-OPERATOIRE
Le pronostic neurologique fonctionnel dépend en grande partie de l'intensité du
déficit neurologique préopératoire selon GASTON.A et collaborateurs (27 ).
Le diagnostic précoce est donc le seul garant de la récupération et de la guérison..
D'une manière générale, les résultats que nous avons obtenus dans notre série sont
bons:
02 patients ont présenté des mauvais résultats (observation N°l et 12). Dans
le 1er cas il s'agissait d'une métastases vertébrale d'un adenocarcinome et dans
l'autre cas aucune étiologie n'a été retrouvée.
L'altération de l'état général a été noté en post opératoire avec un amaigrissement,
une cachexie ....
07 patients ont présenté des résultats moyens avec amélioration des signes
moteurs, mais la persistance des troubles vésicosphinctériens après l'opération à
type de dysurie, d'incontinence urinaire; a nécessité une orientation en urologie
pour une meilleure prise en charge.
Les patients améliorés par l'opération sont au nombre de Il.
On note une guérison complète avec un examen neurologique normale. La reprise
de la marche s'est faite dans un délai de 6 mois à 1 an avec une disparition des
troubles vésicosphinctériens dans un délai de lanI12 à 2 ans.
Nous n'avons pas noté de récidive dans notre étude.
73
DELCAMBRE (18 ) dans son étude avait trouvé:
- 6 mauvais résultats avec persistance des troubles moteurs
-
2 résultats moyens avec un état stationnaire des troubles
13 bons résultats avec une récupération totale après l'opération
avec un recul de 1 an.
~.
ROYCAMILLE (54 ) retrouve:
1 malade décèdé
8 mauvais résultats avec une persistance des troubles neurologiques
15 malades ont récupéré après l'opération avec une reprise de la
marche et une disparition des troubles sphinctériens.
Il ressort de ces résultats que le traitement chirurgical des compressions de la queue
de cheval est souvent bien toléré par le malade avec une amélioration de la
symptomatologie clinique. Mais le plus souvent les troubles génitosphinctériens
continuent à persister nécessitant souvent une collaboration entre neurochirurgien
et urologues
Selon VERBIEST (60 ) cité par DELCAMBRE , la thérapeutique tant médical que
chirurgical, si elle améliore le plus souvent la symptomatologie fonctiolli1elle des
membres inférieurs; influence peu les lombalgies.
Les troubles moteurs et sensitifs superficiels sont exceptionnellement améliorés
avec une fréquence différente par l'intervention.
Les troubles de la sensibilité profonde et l'amyotrophie ne régressent jamais ; les
troubles genitosphinctériens et les réflexes ostéotendineux rarement, quelle que soit
la thérapeutique.
74
C O N C L U S IO N S
75
Les compressions de la queue de cheval représentent 13,2%) des cas de
compressions médullaires reçues à la clinique neurochirurgicale de l'hôpital de
FANN durant la période de notre étude allant de Mai 1983 à Décembre 1996. Ceci
en dehors de tous les cas de compressions médullaires d'origine traumatique et
surtout pottique qui représente l'une des étiologies les plus fréquentes au Sénégal.
La répartition par le sexe des différents cas de compressions de la
queue de cheval montre une nette prédominance masculine.
La répartition pour l'âge montre que la tranche d'âge de 30-70 ans est
la plus victime de cette pathologie. Un passé lombalgique a été retrouvé chez
tous nos- patients et il s'agit pour la plupart, d'individus appartenant aux circuits de
production du pays, donc de sujets potentiellement actifs.
Cette affection est le plus souvent une cause de reclassement
Professionnel.
Le délai d'hospitalisation est en moyenne de 7 mois ce qui constitue
souvent un handicap majeur à l'activité professionnelle du malade et donc aux
intérêts du pays.
Le début est généralement progressif dans 80% des cas de compressions
de la queue de cheval..
76
Les signes fonctionnels sont dominés par les douleurs rachidiennes à type
de
lombalgie chronique pouvant être isolées ou associées à des douleurs
radiculaires sous fonne de lomboscatalgies.
Parfois des paresthésies sont retrouvées.
Les signes physiques sont souvent discrets à cette période de début et se
manifestent surtout sous forme de faiblesse musculaire. Un examen clinique
particulièrement soigneux et complet est souvent nécessaire car les sigÏles· peuvent
passer facilement inaperçu.
Il s'agit d'une affection trop peu souvent diagnostiquée du fait soit de
La discrétion des troubles, soit d'une certaine méconnaissance de la
symptomatologie.
Les troubles sphinctériens sont rares à cette période.
La période d'état sera marqué par la survenue du tableau typique de.
Compression de la queue de cheval avec des troubles sensitifs majeurs à type
d'anesthésie en selle, de troubles moteurs à type de paraparésie flasque et parfois
de paraplégies et de troubles sphinctériens à type d'incontinence d'urine ou de
dysurie.
Elle correspond habituellement à la période ou le malade vient en
consultation, souvent du fait de la sous médicalisation des zones de provenance ou
de la faiblesse des moyens financiers de ce dernier.
77
Les étiologies sont dominées par le canal lombaire étroit et les hernies
discales représentant à elles seules 70% des cas de compressions de la queue de
cheval. Le faible apport de l'examen cytochimique du liquide céphalo-rachidien et
de la radiographie standard montre la modestie de ces examens en ce qui concerne
le diagnostic.
La myélographie demeure de ce fait notre examen le plus fiable quand au
diagnostic.
La laminectomie représente le geste essentiel du traitement et sera suivi soit
d'une ablation dehemie discale, soit d'une exérese de tumeur, soit d'une
discectomie ou d'une foraminotomie.
Notre étude nous a permis de faire en même temps une analyse comparative,
avec une autre étude déjà menée sur le sujet.
Au vu des différents résultats nous nous sommes rendus compte que 10 ans
après la première étude, les compressions de la queue de cheval était toujours aussi
fréquente, avec toujours les mêmes étiologies à peu prés.
Le traitement quant à lui a connu une avancée du fait d'une meilleure maîtrise
des techniques chirurgicales et des techniques de réanimation.
Avec l'avènement du scanner et surtout de la résonnance magnétique nucléaire à
Dakar, nous espérons qu'il sera dés lors possible de déterminer de façon exacte et
automatique la cause de la compression et d'en déterminer sa topographie.
La laminectomie n'en sera alors que plus facilitée ceci dans l'intérêt du malade.
78
B IB L IO G R A P H IE
79
1- AHMED E.B
• Schistosomiases de la moelle épinière, du cône médullaire et de la queue de
cheval
• Neurologie médicochirurgicale; 1977, Il, 17-33
2- AUBERT F et GUITARD P.
• L'essentiel médical de poche
• Ellipses édition, 1990, Paris
. 3- AUQUIER L, SIAUD J.R, GUIOT G, L'HERMITTE F.
• syndrome de la queue de cheval au cours de la spondylarthrite ankylosante .
Découverte opératoire d'une fusion entre la vertèbre et la dure mère dans le
cas rapporté.
Rev. Rhumatologie, 1974,41,733-737
4- BA M.C
• Le canal lombaire étroit: à propos de 64 cas opérés à la clinique
neurochirurgicale et 21 prélèvements autopsiques
• Thèse med. Dakar, 1992, 64, 121 pages
5- BABIN E , CAPESIUS P, MAITROT D.
• Signes radiologiques osseux des variétés morphologiques de canaux
lombaires étroits
• Ann. Radiologie, 1977,20 491-499
6- BETTALES A, KHALDI M, BEN RHOUMA T.
• Echinococcose vertèbro médullaire : A propos de 32 cas
• Neurochinlrgie, 1978, 24, 205-210
80
7-BIRD ALLAN V.
• Spinal cord complication of bilharziose
• South African Med Journal, 1965,39,158-162
8· BLIKRA G .
.. Intradural hemiated lumbar disc
• 1. Neurosurgery, 1969,31,676-679
9- BOISSERIE -LACROIX M ,KIEN P ET CAILLE J.M.
• L'imagerie des tumeurs intradurales et extramédullaires : les neurinomes et
les méningiomes.
• J. Neuroradiology,1987,14,66-81
10-
CAMBIER J , MASSON M, DEHEN H.
• Abrégé de neurologie
e
• Masson 6 édition, 1989
11-
CAPESIUS P, BABIN E.
• Exploration radiculo saccographique des canaux lombaires étroits
• Ann.Radiol., 1977,20,501-507
12-
CAUCHOIXJ, TAUSSIO G, NORDIN Y.
• Sciatique et syndrome de la queue de cheval par retrécissement du canal
rachidien après arthrodèse lombo-sacé postérieure
• Sem. hôpitaux de Paris, 1969,29,2023-2025
81
CHRISTIAENS JL ,BRICHARD C, ASSAKER R, LEJEUNE JP.
13-
• Le traitement chirurgical du canal lombaire étroit
• Rhumatologie, 1985, 36, 293-300
14-
COMPBELL JN, BLACK P, OSTROW P .
• Sarcoïde of the cauda équina
• Journal neurosurgery USA, 1977, 1et 2, 109-112
. 15-
CONTAMIN F, DOUBRERE JF, STRUZ PH, BAILLET P.
• Syndrome de la queue de cheval et spondylarthrite ankylosante
• Sem. hôpitaux, 1983,54,1401-1404
16- . COURT BROWN CM, MC MASTER MJ.
• Pseudarthrose: a late cause of paraparésis after scoliosis surgery
• 1. BüNE .l.T surgery USA, 1982,64,1246-1248
17-
CROCCEL L.
• La claudication intermittente sciatalgique
• Conc.Med, 1966,88,1771-1774
18-· DELCAMBRE B, LEROUX JL, SIAME JL, CHRISTIAENS JL.
• Le syndrome du canal lombaire étroit
• Lille médical, 1980, 25, 52-62
82
19-
DILENGE D, RUGGIERO G.
• La myélographie dans la pratique neurochirurgicale
• Rev. neurol, 1954,91,4,286-297
20-
EHNI G.
• Signifiance of the smalliumbar spinal canal. Cauda équina compression
syndrome due to spondylosis
• Neurosurgery, 1969,31, (5), 490-494
21-
EMC NEUROLOGIE
• Syndrome de la queue de cheval
• Neurologie l, 1975, 17-0440, F10
22-
EPSTEIN J A, EPSTEIN BS, LAVINE L.
• Nerve root compression associated with narrowing of the lumbar spinal canal
• J.Neurol. Neurosurgery Psychiat, 1962, 25, 165-176
23-EPSTEIN BS, EPSTEIN JA, LA VINE L.
• The effect of anatomie variations in the lumbar vertébral and spinal, in
the lumbar vertébral spinal canal; on cauda équina and nerve root
syndromes
• Am.J. ROENTGENOL, 1964, 91, 1055-1063
24-EVANS J.C.
• Neurologie intennittent claudication
• Brit. Med.J, 1964, 2, 985-987
83
25-FATORUSSO V, RITTER O.
• Vademecum clinique: du diagnostic au traitement
• Masson, 13é édition, 1993
26- FREREBEAU P, PRIVAT JN, BENEZECH J, VANVYVE M, GOMIS R.
• Le canal lombaire étroit arthrosique. Etude anatomoradiologique.
Considérations techniques
• Neurochirurgie 1977, 23, 389-400
27- GASTON A, DJINDJIAN M, NGUYEN JP, BRUGIERES P, LE BRAS F,
SUPPERVIELLS JL, CASTREC-CARPO A et MARSAULT C.
• Compressions médullo radiculaires vertébro-épidura1es non
traumatiques: intérêt de l'étude tomodensitométrique couplée à la
myélographie pour le bilan lésionnel et l'indication thérapeutique
• Neurochirurgie 1986,32,201-215
28- GRAVELEAU J, GUlOT G.
• Etroitesse congénitale du canal rachidien lombaire et syndrome de
claudication intermittente sensitivo motrice de la queue de cheval
• Presse médicale 1964, 72, 3343-3348
29- GRELLIER P, DUPLAY J, RISTORI S.
• Approche semiologique des méningiomes et des neurinomes rachidiens
• Sem. hôpitaux de Paris 1989,58, 18, 1109-1112
84
30-GRELLIER P, ROCHE JL, GRIFFET J, PAQUIS P.
• Canal lombaire étroit: étude du traitement chirurgical. A propos de 139
cas
• Neurochirurgie 1983,32,6,471-476
JI-GUEYE M, BADIANE S, NDIAYE IP, LAMOUCHE P.
• Le canal lombaire étroit: à propos de 27 cas opérés à la clinique
neurochirurgical du CHU de Dakar
• Dakar médical 1984,29,227-235
32- HEWLET RN.
• Histiocytosis X of the cauda équina
• Neurologie 1976, 26, 472-476
33- HUBAULTA.
• Le syndrome du canal lombaire étroit
• Rev. prat, 1971,21,1789-1904
34-ILLO AL M.
• Syndrome de la queue de cheval et du cône tenninal. A propos de 21 cas
• Thése med Dakar 1981,49
35-JACOBSON RE, GARGANO FP, ROSOMOFF HL.
• Transverse axial tomographie of the spine. Part l : axial anatomy of the
nonnallumbar spine.
• J neurosurgery, 1975,42,406-411
85
36- JACOBSON RE, GARGANO FP, ROSOMOFF HL.
• Transverse axial tomographie of the spine. Part II : the sténotic spinal canal
• J neurosurgery, 1975,42,412-419
37-JACOMET C, LEBRETTE MG, EL AMRANI N, MONFORT L.
• Atteinte du cône tenninal et de la queue de cheval due au
cytomégalovirns au cours de l'infection à VIH
• Presse med. 1995,24,527-530
38- JOYEUX O.
• Les neurinomes intrarachidiens. A propos de 100 observations
• Thèse med Lyon 1966, 162, 126 p
39-LANGUE JB.
• Contribution à l'étude du syndrome de la queue de cheval par
ostéoarthropathie vertèbrale tabetique
• Thése med Lyon, 1971, N°280
40-LAOUITI M.
• Neurinomes intrarachidiens. Etude de 70 cas
• Thèse med Paris VI, N°1591, 164 pages
41-LECOQ J et VAUTRAVERS P.
• Complications des manipulations vertébrales
• Ann. de réadaptation et de médecine physique 1995, 38 ,N°2, 84-87
86
42-LESPINE A.
• Le syndrome de la sténose du canal lombaire de VERBIEST
• Cah. Med, 1977,3,227-231
43- LUYENDIJK W et LINDEMAN J.
• Schistosomiasis mansoni of the spinal cord simulating an intramedullary
tumor
• Surgery neurol, USA 1975,4,457-480
44- MANSuY L, CHEVALIER J et KEKEH K.
• .Syndrome de la queue de cheval par hernie discale
• Sem. hôpitaux 1975,10,615
45- MASSARE C, BARD M, BUSSON J .
• Tomodensitométrie et pathologie rachidienne
• Rev. Rhum, 1979,46, 327-334
46- PAILLAS JE, BILLE J et LOUIS R.
• Syndrome de la queue de cheval par hernie discale
• Marseille. Med 1964,101,513-517
47-PAILLAS JE, RECORDIER AM, PELLET W, SERRATRICE G,
PERRAGUT JC.
• Le syndrome du canal lombaire étroit. A propos de 21 observations
• Rev. Med. 1971, 7, 109-128
87
48- PATTE REGIS.
• corticothérapie Compression médullaire lente sous prolongée
• Thèse Med FRA 1978, Paris VI
49- PAYE O.
• Les neurinomes et neurofibromes intrarachidiens au Sénégal. A propos de 12
cas colligés à la clinique de Neurochirurgie
• Thèse Med Dakar, 1995, N°48,
50- PELLETW.
• Les sténoses globales du canal lombaire
• Neurochirurgie 1978, 24, 5, 290-327
51- PETIT-DUTAILLIS D, ALAJOUANINE H.
• Compression de la queue de cheval par une tumeur du disque intervertèbral
• Bull et Mem de la Société Nationale de Chirurgie 1928, 55, 937-945
52- PEYSER E, MD et A HARARI.
• Intradural rupture of lumbar intervertèbral disk
• Surgery. Neurol, 1977, 8, 95-98
53-RAVAULT PP, LEJEUNE E, MAITREPIERRE J, BOUVIER M
• La claudication intermittente sciatalgique
• Lyon. Med, 1961, 206, 51-57
89
59- VARUGHESE G.
• Extradural extrusion of roots of the cauda équina
• J Bone. Joint and surgery 1954, 36b,230-237
60- VERBIEST H.
• Sur certaines formes rares de compression de la queue de cheval
• Maloine. Ed. Paris ,1949,161-174
61- VERBIEST H.
• Résult of surgieal treatment of idiopathie developmental sténosis of the
iumbar vertèbrai canaL A revlew of twenty seven years expérience
• JBonejoint and surgery 1977, 59b, 181-188
62- WENIG C.
• La hernie discale dorsale
• Deuts. med , 1973,98, 2483-2486
63- WILSON P.J.E.
• Cauda équina compression due to the intrathecal hemiation of an
intervertèbral disk
• Brit. J of surgery 1962, 40, 423-426
90
64- WOR INGE R E, BRO GLY G, SCH NEID ER J, GLO OR P.
• Anesthésie générale ou locale en neurochirurgie. Desa vanta ges de
faire
l'anéshésie générale en neurochirurgie et des réserves qu'il convient de
à son sujet d'après une expérience de 235 cas.
• Rev. neurol1950, 80, 5,451-462
65- ZIZA JM, KHA LIFA P, CHE VRO T A.
on
• Le canal lombaire étroit : valeur de la saccoradiculographie en positi
debout et limite du scanner
• Presse. med 1985, 14,3, 165-170
SERMENT D'HIPPOCRATE
" En présence des Maîtres de cette Ecole, de mes chers condisciples, je promets
et je jure d'être fidèle aux lois de l'Honneur et de la Probité dans l'exercice de la
Médecine.
Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et je n'exigerai jamais un salaire audessus de mon travail. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce
qui s'y passe ; ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon état ne servira
pas à corrompre les moeurs ni à favoriser le crime.
Respectueux et reconnaissant envers mes Maîtres, je rendrai à leurs enfants
l'instruction que j'ai reçue de leurs pères."
"Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.
Que je Sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque".
************************************