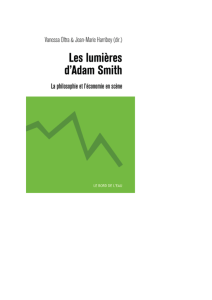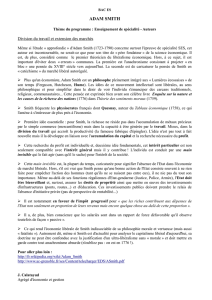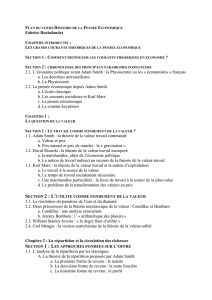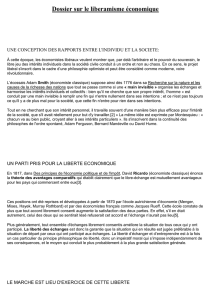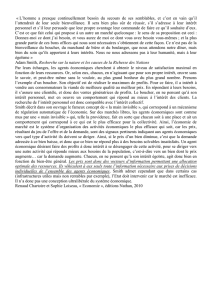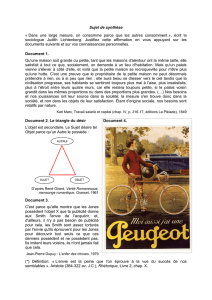Option Term - 3 - FD

Document 1 – Qui est Adam Smith ?
Adam Smith naît le 5 juin 1723 dans le petit village de Kirkcaldy en Ecosse. Son père, contrôleur des douanes, décède deux
mois avant sa naissance. C’est son oncle qui s’occupa de son éducation. A 14 ans, il est ainsi envoyé à l’université de philosophie de
Glasgow. Il poursuit ses études à Oxford puis retourne à Edimbourg entamer une carrière de professeur. Il y devient, aux côtés du
philosophe David Hume, professeur de logique puis professeur de philosophie morale. Il s’intéresse alors essentiellement, dans la
lignée de Hume, à la nature des sentiments humains. Son problème central est celui de la possibilité d’un intérêt personnel égoïste
cohabitant avec l’intérêt collectif, problème auquel il répondra notamment avec la théorie de la « main invisible » dans l’ouvrage :
En 1764, Adam Smith devient le précepteur du jeune Duc de Buccleuch et l’accompagne pour son Grand Tour en Europe
pendant 4 ans. Pendant ce voyage, il passera du temps à Toulouse où il rencontre Voltaire et d’Alembert, et à Paris où il rencontre les
premiers économistes de l’époque, c'est-à-dire les physiocrates Turgot et Quesnay. Il est ainsi en contact avec les plus célèbres
intellectuels français de l’époque. Dans les mêmes années 1760-1770, il observe de lui-même les transformations économiques qui
affleurent en France mais surtout au Royaume-Uni. C’est de ce voyage qu’on peut dater la problématique centrale d’Adam Smith :
Il répond à cette problématique avec l’ouvrage :
L’œuvre a un grand succès dès sa sortie et marque une génération d’hommes politiques et d’intellectuels. En 1778, Adam
Smith est nommé commissaire aux douanes, puis recteur de l’université de Glasgow de 1787 à 1789. Il passe les 12 dernières années
de sa vie aux côtés de sa mère, et décède en juillet 1790.
Document 2 – De la division du travail aux nouvelles machines (et non l’inverse) :
« Je ferai remarquer seulement qu'il semble que c'est à la division du travail qu'est originairement due l'invention de toutes
ces machines propres à abréger et à faciliter le travail. Quand l'attention d'un homme est toute dirigée vers un objet, il est bien plus
propre à découvrir les méthodes les plus promptes et les plus aisées pour l'atteindre, que lorsque cette attention embrasse une grande
variété de choses. Or, en conséquence de la division du travail, l'attention de chaque homme est naturellement fixée tout entière sur un
objet très simple. On doit donc naturellement attendre que quelqu'un de ceux qui sont employés à une branche séparée d'un ouvrage,
trouvera bientôt la méthode la plus courte et la plus facile de remplir sa tâche particulière, si la nature de cette tâche permet de
l'espérer. Une grande partie des machines employées dans ces manufactures où le travail est le plus subdivisé, ont été originairement
inventées par de simples ouvriers qui, naturellement, appliquaient toutes leurs pensées à trouver les moyens les plus courts et les plus
aisés de remplir la tâche particulière qui faisait leur seule occupation. […] Dans les premières machines à feu, il y avait un petit
garçon continuellement occupé à ouvrir et à fermer alternativement la communication entre la chaudière et le cylindre, suivant que le
piston montait ou descendait. L'un de ces petits garçons, qui avait envie de jouer avec ses camarades, observa qu'en mettant un cordon
au manche de la soupape qui ouvrait cette communication, et en attachant ce cordon à une autre partie de la machine, cette soupape
s'ouvrirait et se fermerait sans lui, et qu'il aurait la liberté de jouer tout à son aise. Ainsi, une des découvertes qui a le plus contribué à
perfectionner ces sortes de machines depuis leur invention, est due à un enfant qui ne cherchait qu'à s'épargner de la peine ».
A. Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Livre I, Chapitre 1, 1776
Question 1 : Expliquez le titre du document à partir du texte.
Question 2 : Montrez que la dernière phrase illustre le phénomène de la main invisible (vu en classe dans le chapitre 2 et qui porte sur
le rapport entre les intérêts personnels et l’intérêt général ou bien commun).
Document 3 – Adam Smith, humaniste autant qu’économiste :
Entretien avec Amartya Sen, prix Nobel d’économie 1998.
« Vous souvenez-vous de votre première lecture des Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations ? »
« Pendant ma scolarité en Inde, j'avais déjà conscience de l'importance des écrits d'Adam Smith, mais je n'ai vraiment été en
contact avec ses oeuvres originales que lors de ma première année universitaire, au Presidency College de Calcutta, à la fin de l'été
1951. J'avais alors 17 ans, et je fus enthousiasmé par les innovations pionnières apportées par Smith. […] Smith lui-même était
extrêmement critique sur les inégalités économiques et sociales, et sur les asymétries de la structure de classes qui séparait de façon
rigide les travailleurs des catégories privilégiées. Quand j'ai commencé à lire La Richesse des nations, j'ai découvert que Smith était
extrêmement préoccupé – et critique – au sujet du sort des pauvres, même au sein des sociétés prospères. J'ai été particulièrement ému
par la puissante analyse de Smith selon laquelle les riches réussissent mieux non pas parce qu'ils ont, en général, plus de talents que
les autres, mais parce qu'ils ont eu la chance de recevoir une meilleure éducation et parce que leur style de vie leur laisse du temps
libre et la possibilité de se cultiver.
« Voici un passage de Smith qui, lorsque je l'ai lu pour la première fois, en 1951, m'a bouleversé :
‘‘Les gens du peuple […] n'ont guère de temps de reste à mettre à leur éducation. Leurs parents peuvent à peine
suffire à leur entretien pendant l'enfance. Aussitôt qu'ils sont en état de travailler, il faut qu'ils s'adonnent à quelque
métier pour gagner leur subsistance. Ce métier est aussi, en général, si simple et si uniforme, qu'il donne très peu
d'exercice à leur intelligence ; tandis qu'en même temps leur travail est à la fois si dur et si constant, qu'il ne leur
laisse guère de loisir, encore moins de disposition, à s'appliquer, ni même à penser à autre chose’’.
Je vous cite cet extrait – tiré du chapitre 1 du livre V – non seulement parce que je l'ai relu récemment lorsque j'écrivais la
préface de la réédition – à l'occasion du 250
ème
anniversaire de sa parution, en 1759 – du premier livre de Smith, La Théorie des
sentiments moraux, mais aussi parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans la clairvoyance et la compassion que Smith révèle, et
qui me l'avait rendu très proche dans ma jeunesse. J'ai été particulièrement frappé par son empathie pour les autres, aussi éloignés de
lui soient-ils en termes de classe, de milieu ou de style de vie, extrêmement différents du sien. Tout au long de La Richesse des
nations, il déploie un fort sentiment de solidarité avec les exclus de la société. C'est une caractéristique dont j'ai constaté l'absence
dans la façon dont la littérature économique standard analyse les questions économiques.
Amartya Sen, Entretien, Le Monde, 16 octobre 2009

Document 4 – La division sociale du travail accompagne la division technique du travail :
« Observez, dans un pays civilisé et florissant, ce qu'est le mobilier d'un simple journalier ou du dernier des manœuvres, et
vous verrez que le nombre des gens dont l'industrie a concouru pour une part quelconque à lui fournir ce mobilier, est au-delà de tout
calcul possible. La veste de laine, par exemple, qui couvre ce journalier, toute grossière qu'elle paraît, est le produit du travail réuni
d'une innombrable multitude d'ouvriers. Le berger, celui qui a trié la laine, celui qui l'a peignée ou cardée, le teinturier, le fileur, le
tisserand, le foulonnier, celui qui adoucit, chardonne et unit le drap, tous ont mis une portion de leur industrie à l'achèvement de cette
oeuvre grossière. Combien, d'ailleurs, n'y a-t-il pas eu de marchands et de voituriers employés à transporter la matière à ces divers
ouvriers, qui souvent demeurent dans des endroits distants les uns des autres ! Que de commerce et de navigation mis en mouvement !
Que de constructeurs de vaisseaux, de matelots, d'ouvriers en voiles et en cordages, mis en oeuvre pour opérer le transport des
différentes drogues du teinturier, rapportées souvent des extrémités du monde ! Quelle variété de travail aussi pour produire les outils
du moindre de ces ouvriers ! Sans parler des machines les plus compliquées, comme le vaisseau du commerçant, le moulin du
foulonnier ou même le métier du tisserand, considérons seulement quelle multitude de travaux exige une des machines les plus
simples, les ciseaux avec lesquels le berger a coupé la laine. Il faut que le mineur, le constructeur du fourneau où le minerai a été
fondu, le bûcheron qui a coupé le bois de la charpente, le charbonnier qui a cuit le charbon consommé à la fonte, le briquetier, le
maçon, les ouvriers qui ont construit le fourneau, la construction du moulin de la forge, le forgeron, le coutelier, aient tous contribué,
par la réunion de leur industrie, à la production de cet outil ».
A. Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Livre I, Chapitre 1, 1776
Question 1 : Soulignez toutes les professions qu’on peut associer directement ou indirectement à la veste de laine du journalier
(personne qui est employée pour une journée).
Question 2 : Essayer d’imaginer toutes les professions qui ont contribué directement ou indirectement à la production du stylo qui
vous permet en ce moment d’écrire.
Question 3 : Peut-on parler dans les deux cas d’une division sociale du travail ? Que signifie alors ce terme ?
Document 5 – Externalisation et décomposition internationale des processus de production :
« ‘‘Ah, vous parlez du Meccobaï’’ m’a lancé avec désinvolture, lors d’un déjeuner, le consultant d’un cabinet de conseil en
management. ‘‘Le quoi ?’’, ai-je demandé, croyant entendre quelque expression russe. ‘‘Make or buy’’. En français : ‘‘fabriquer ou acheter’’.
‘‘Je vais vous expliquer. Prenez ce moulin à poivre’’ m’a-t-il dit en soupesant le banal petit objet, composé d’un flacon de verre, d’un
couvercle en aluminium et d’une manivelle de bois coiffée d’un bouchon décoratif. ‘‘Imaginez que nous arrivions dans l’entreprise qui le
fabrique. Pour chaque élément, chaque composant, nous posons au patron la même question : make or buy ? Nous lui demandons en fait s’il
est réellement vital pour lui de fabriquer dans son usine cette manivelle de bois, ce bouchon, ce couvercle d’aluminium et ce flacon […].
« Tout acheteur aguerri bombardé dans une entreprise de quelque secteur que ce soit peut détecter les processus qui pourraient être
réalisés moins cher ailleurs. On voit l’éditeur provençal Actes Sud faire imprimer des ouvrages en Thaïlande ou des grandes marques de
canapé confier la couture de leurs coussins à des ateliers du Maghreb. […] Autre illustration, le vélo vedette du groupe Décathlon, le modèle
‘‘B’Twin’’, le plus vendu au monde, et dont les centaines de pièces viennent de trente pays différents. […] Les cadres viennent à 70% de
Chine et de Taïwan, et à 30% du Portugal. Les éclairages et les garde-boue sont français, les jantes viennent de Belgique ou d’Espagne, les
dérailleurs sont fournis par une société américaine qui fait fabriquer en Irlande, les selles et les pédales arrivent d’Italie, les leviers de frein du
Portugal, et les pneus de Thaïlande. La Suisse, qui fournit des rayons haut de gamme, est l’un de ces pays ‘‘chers’’ qui profitent de leur forte
tradition cycliste ».
F. Benhamou, Le grand bazar mondial, 2005
Question type bac (corrigé) : En quoi la stratégie d’externalisation confirme-t-elle l’analyse d’Adam Smith.
On présente le problème. Qu’est-ce qu’on peut se poser comme question avec l’auteur, ici Smith, pour étudier un phénomène récent. On doit
donc rappeler ce que pense Smith. Selon Adam Smith, c’est la division du travail, causée par la propension des hommes à échanger, qui
permet des gains de productivité. De plus, l’extension des marchés accompagne une division du travail croissante, aussi bien technique que
sociale, qui contribue au bien commun par le mécanisme de la main invisible. Puis voir s’il n’y a pas une question qu’on peut en tirer. Dans
quelle mesure ces théories s’appliquent-t-elles aux pratiques des entreprises d’aujourd’hui ?
On présente d’abord ce que nous donne le texte étudié pour bien relier le texte à notre question générale issue de Smith. La pratique récente
des entreprises que présente Marc Chevallier dans un article d’Alternatives Economiques est celle de l’externalisation. On pense à définir vu
qu’il y a ici un terme technique. L’externalisation consiste pour une entreprise à donner à faire une partie de sa production par un producteur
externe, généralement nommé sous-traitant. Au lieu de produire, l’entreprise décide donc d’acheter un produit. On rappelle maintenant le
problème qu’on se pose. Est-ce que cette externalisation est bien une division technique et/ou sociale du travail au sens de Smith ?
On rentre ensuite dans le détail, en connaissant donc bien son cours. Premier constat, sur l’origine. Pour cela, il faut d’abord se demander si
elle a bien pour origine la propension des hommes à échanger. On constate tout d’abord qu’« à l’origine de la décision d’externaliser, il y a
toujours une volonté de réduire les coûts ». C’est donc de manière consciente que les entreprises cherchent les gains de productivité,
contrairement à ce que déclarait Smith dans les Recherches.
Deuxième constat, sur le fonctionnement. Pour autant, l’externalisation fonctionne bien comme la division du travail de Smith et a les mêmes
conséquences. Si l’entreprise décide d’externaliser, c’est qu’elle considère, entre autres, qu’un fournisseur est « spécialisé, bénéficie
d’économies d’échelle ». Le fournisseur dispose d’une assez bonne spécialisation pour pouvoir produire de grandes quantités pour un coût
unitaire faible. Il s’appuie ainsi sur une division technique du travail. De plus, cette spécialisation s’observe par exemple par des
« compétences spécifiques » coûteuses à mettre en œuvre par l’entreprise elle-même. De la même manière que, dans une tribu, on distingue
le rôle du chasseur du rôle du forgeron en fonction de leurs compétences, les entreprises modernes distinguent leur rôle dans la production.
On assiste ainsi à une division sociale du travail interfirme par le biais de l’externalisation.
Troisième constat. Sur les conséquences Rien n’interdit alors que cette externalisation puisse profiter à tous, comme l’explique Smith avec sa
théorie de la main invisible. Comme le dit Bernard Baudry dans Economie de la firme : « chaque entreprise, en concentrant ses ressources
sur les activités qu’elle maîtrise le mieux, fait profiter aux firmes avec lesquelles elle est en relation des progrès qu’elle réalise en termes de
coûts, de performance et de qualité ».
Dernier constat, sur le rapport entre taille des marchés et division du travail, vu qu’on a montré en quoi c’est bien une division du travail
qui est à l’œuvre : Si l’on s’en tient à l’analyse de Marc Chevallier, on constate enfin que l’externalisation tend de plus en plus à se
généraliser, et même à « perdurer, au contraire de beaucoup de modes managériales ». Etant donné que les cinquante dernières années ont vu
l’augmentation forte des échanges internationaux, et donc de la taille des marchés, on peut supposer que les deux phénomènes vont de pair.
On n’oublie pas de conclure. Ainsi le phénomène de l’externalisation semble-t-il bien correspondre, à quelques nuances près sur la question
de l’origine, à la théorie d’Adam Smith.
1
/
2
100%