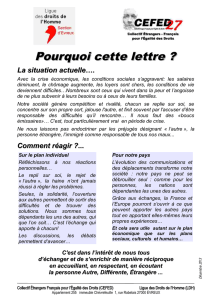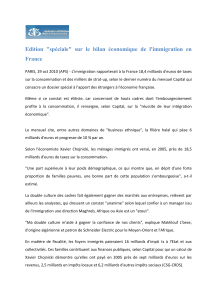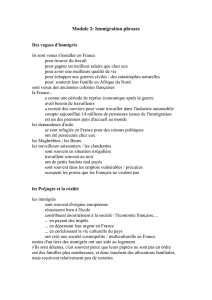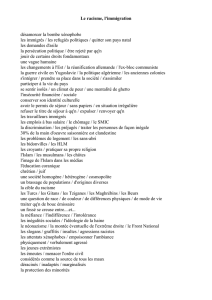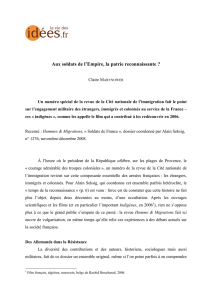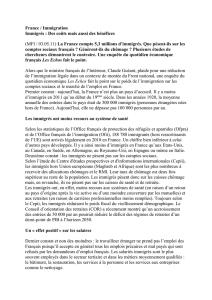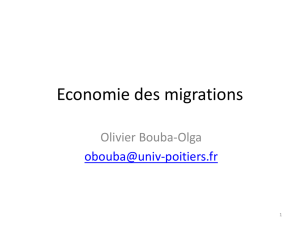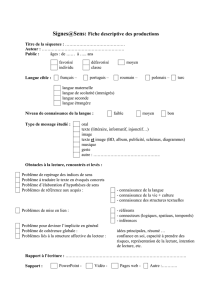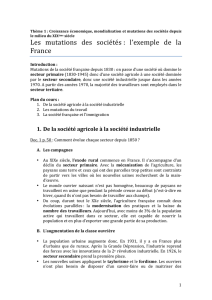Migrants dans l`ombre. Causes, dynamiques, politiques de l

Revue européenne des migrations
internationales
vol. 26 - n°2 | 2010
Numéro ouvert
Migrants dans l’ombre. Causes, dynamiques,
politiques de l’immigration irrégulière
Migrants in the Shadow. Causes, Dynamics, Policies of the Irregular Immigration
Migrantes en la sombra. Causas, dinámicas, políticas de la inmigración irregular
Maurizio Ambrosini
Édition électronique
URL : http://remi.revues.org/5113
DOI : 10.4000/remi.5113
ISSN : 1777-5418
Éditeur
Université de Poitiers
Édition imprimée
Date de publication : 1 septembre 2010
Pagination : 7-32
ISBN : 978-2-911627-55-2
ISSN : 0765-0752
Référence électronique
Maurizio Ambrosini, « Migrants dans l’ombre. Causes, dynamiques, politiques de l’immigration
irrégulière », Revue européenne des migrations internationales [En ligne], vol. 26 - n°2 | 2010, mis en ligne
le 01 septembre 2013, consulté le 30 septembre 2016. URL : http://remi.revues.org/5113 ; DOI :
10.4000/remi.5113
Ce document est un fac-similé de l'édition imprimée.
© Université de Poitiers

7Revue Européenne des Migrations Internationales, 2010 (26) 2 pp. 7-32
Migrants dans l’ombre
Causes, dynamiques, politiques de
l’immigration irrégulière
Maurizio AMBROSINI*1
L’immigration que l’on qualie d’« irrégulière » a représenté, ces dernières
années, un sujet sensible dans les sociétés d’accueil et un nœud très délicat
des politiques migratoires. Presque partout les opinions publiques demandent une répres-
sion plus stricte du phénomène, considéré comme porteur d’illégalité et de désordre
social, ce à quoi les gouvernements répondent en promettant une lutte plus déterminée
contre l’entrée et le séjour non autorisés, renforçant les contrôles aux frontières, augmen-
tant les efforts de coordination, déployant des technologies de plus en plus sophistiquées,
durcissant les sanctions à l’encontre des transgresseurs. Pourtant, le nombre d’immigrés
en situation irrégulière reste élevé. Malgré les difcultés de quantier avec précision une
population qui, par dénition, reste difcile à appréhender, dans l’Europe communautaire
les estimations oscillent entre 2,8 et 6 millions d’individus (Düvell, 2009). Et s’il y a eu
une diminution au cours des dernières années, celle-ci découle, en premier lieu, de l’entrée
dans l’Union des citoyens de pays de l’Europe Orientale qui auparavant contribuaient à
goner les statistiques concernant l’irrégularité et, en deuxième lieu, aux mesures de régu-
larisation, explicites ou masquées, promulguées par les différents gouvernements. Pour
les États-Unis, les chiffres sont encore plus frappants, oscillant entre 10 et 12 millions
d’individus, avec des estimations de plus de 500 000 cas supplémentaires chaque année
(Jasso et al., 2008).
Une autre estimation faisant référence aux seules entrées irrégulières dès l’année
2000 fait état, pour l’Europe, d’un volume compris entre 400 000 et 600 000 cas par an
en grande partie entrés sur le territoire par les frontières orientales par l’intermédiaire des
professional smugglers (Jandl, 2007) dont le rôle est de plus en plus important. Cependant,
la majorité des migrants en situation irrégulière ne traverse pas les frontières de façon
illégale et se compose plutôt d’overstayers entrés de façon régulière, souvent avec des
visas touristiques (De Haas, 2007).
* Docente di sociologia dei processi migratori, Dipartimento di Studi sociali e politici, Universita’
degli studi di Milano, via Conservatorio, 720122 Milano ; [email protected] 1

Maurizio AMBROSINI8
REMI 2010 (26) 2 pp. 7-32
Dans cet article, je me propose de répondre à trois questions : 1) Qu’est-ce que
l’immigration irrégulière et comment la dénit-on ? 2) Pourquoi persiste-t-elle, se repro-
duit-elle et se révèle-t-elle si difcile à éradiquer ? 3) Pourquoi les mesures de régulari-
sation, sous une forme ou l’autre, s’avèrent-elles récurrentes et difcilement évitables ?
Dans le même temps, j’essaierai de montrer, d’un point de vue théorique, comment une
explication du phénomène se doit de combiner des facteurs structuraux, principalement
économiques, ainsi que des facteurs liés à l’agency des protagonistes, c’est-à-dire les
migrants et leurs réseaux, et des facteurs qui ont à voir avec la construction sociale (et
politique) du thème de l’immigration irrégulière dans le cadre des sociétés d’accueil.
DÉFINIR L’IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE
L’immigration irrégulière est l’une de ces notions qui paraissent évidentes au
sens commun, mais qui se révèlent bien plus complexes et problématiques quand on les
soumet à une analyse plus approfondie. C’est seulement dans le cadre de l’interaction avec
un appareil normatif qu’un déplacement peut être déni d’« irrégulier ». L’hétérogénéité,
la complexité et l’évolution des normes rendent en outre souvent incertaine et contro-
versée la dénition des cas particuliers. De plus, il s’y ajoute une stigmatisation morale
répandue qui se reète dans l’utilisation du terme « clandestin » : un terme qui devrait
indiquer l’entrée frauduleuse, mais qui est en réalité utilisé couramment pour dénir tous
les immigrés en condition irrégulière.
Comme le remarque le rapport de l’Icmpd (2009), on peut distinguer quatre
aspects principaux de la légalité du statut d’un migrant : l’entrée, la permanence, la régula-
rité du statut occupationnel (l’immigré dispose-t-il d’un permis qui l’autorise à travailler ?)
et la nature de l’occupation, c’est-à-dire la conformité aux dispositions générales concer-
nant les contrats de travail (payement des impôts, des cotisations pour la sécurité sociale,
etc.). Une cinquième dimension, qui croise les précédentes et qui ne fait pas référence à
proprement parler à la régularité du statut, concerne la question de l’identication et de la
connaissance de l’immigré de la part des autorités compétentes : sur la base de celle-ci,
il y a des immigrés qui ne disposent pas d’une autorisation à la résidence, mais dont la
présence est néanmoins connue et tolérée.
Croisant ces dimensions, on obtient une matrice complexe, où l’immigré peut se
trouver en règle sous certains aspects, mais pas sous d’autres. Par exemple, aux États-Unis
et au Royaume-Uni, nombre d’immigrés en situation irrégulière au regard de l’autorisa-
tion de séjour obtiennent, de différentes façons, des numéros de sécurité sociale et payent
régulièrement leurs cotisations. En Allemagne et dans d’autres pays, les demandeurs
d’asile, dont la demande a été rejetée, mais qui ne peuvent pas être expulsés, obtiennent
un statut de « tolérance » qui autorise leur présence sur le territoire, nominalement et à titre
provisoire, mais qui est en réalité souvent prolongé pendant des années.
Du point de vue législatif aussi, les États de l’Union européenne – en limitant
notre propos à un contexte d’harmonisation juridique croissant – ne dénissent pas de
façon homogène le statut de résidence légale, suivant des acceptions plus restrictives dans
certains pays (Espagne, Portugal, Royaume-Uni, etc.) et plus libérales dans d’autres. Les

9Migrants dans l’ombre
REMI 2010 (26) 2 pp. 7-32
différences entre les lois sur l’immigration et sur le travail conduisent à leur tour à diffé-
rentes formes d’irrégularité entre les étrangers qui sont présents sur le territoire (Icmpd,
2009).
La distinction entre les vieux pays de l’Union, dont les citoyens jouissent d’une
pleine liberté de mouvement et d’accès au marché du travail ; les nouveaux pays, dont
les citoyens ont aujourd’hui un statut plus favorable, mais rencontrent encore des restric-
tions quant à l’emploi ; les pays développés extérieurs à l’Union, mais qui sont membres
de l’Ocde ; enn, ceux que l’on appelle les « pays tiers », les pays en réalité classiés
comme pauvres, sont une autre source de complexité qui nous renvoie au concept de
« stratication civique » proposé par Morris (2002). Les immigrés étrangers sont de plus
en plus différenciés du point de vue juridique et donc des droits dont ils peuvent jouir. Les
immigrés, résidents de longue durée, jouissent d’un statut plus sûr et de plus de droits par
rapport à ceux qui sont arrivés récemment, qui à leur tour sont en meilleure situation que
celle des immigrés admis comme travailleurs saisonniers. À la base de la hiérarchie, on
trouve les immigrés dont le séjour entre en conit avec les normes des sociétés de desti-
nation et qui échouent donc dans une situation d’irrégularité. La même amélioration de la
condition juridique et de la dotation de droits des immigrés autorisés au séjour a conduit à
un écart entre leur statut et celui des immigrés sans papiers (Sciortino, 2010).
Derrière ce scénario, il y a une question de construction politique des différences
et des frontières. L’immigration irrégulière a à faire avec le fonctionnement des États
modernes et avec leur appareil de contrôle du territoire. Au temps de la mondialisation, le
contrôle des frontières reste l’un des symboles principaux de la souveraineté nationale et
devient, a contrario, l’objet d’investissements plus importants que par le passé. Le passage
non autorisé des frontières et la résidence sur le territoire en l’absence des documents
demandés font l’objet d’une crainte sociale et politique grandissante en tant que dés à
la souveraineté de l’État. Les gouvernements ressentent le besoin de rassurer les citoyens
sur le fait que les frontières sont surveillées et les menaces d’intrusions de l’extérieur
efcacement combattues (Anderson, 2008). Les problèmes du terrorisme international,
du fonctionnement des systèmes de protection sociale, de la réglementation du marché du
travail, de l’identité socio-culturelle de la nation sont, tour à tour, évoqués pour justier
l’effort dans la surveillance des frontières.
Les immigrés en situation irrégulière sont donc ceux qui, par leurs déplacements,
installations, insertions dans le marché du travail, rentrent en opposition avec la réglemen-
tation de la mobilité humaine instituée par les États, elle-même hiérarchiquement diffé-
renciée selon les pays d’origine des candidats à l’entrée. L’action politico-normative a un
rôle décisif dans la constitution et dans la modication des catégories d’encadrement des
migrants, dans la restriction ou l’élargissement de leurs possibilités d’obtenir ou de garder
un statut de légalité, dans la dénition des opportunités de sortie de la situation inconfor-
table d’irrégulier. Il faut donc être conscient de la uidité et de la réversibilité des déni-
tions : le statut de résident légal peut être obtenu ou perdu de plusieurs façons, et l’irrégu-
larité de la condition juridique n’est pas une donnée de nature ou une marque indélébile :
« la migration régulière facilite la migration irrégulière à travers le fonctionne-
ment des réseaux migratoires [voir infra, n.d.r.], souvent, l’entrée régulière précède
le séjour irrégulier et nombre de migrants actuellement réguliers ont été irréguliers

Maurizio AMBROSINI10
REMI 2010 (26) 2 pp. 7-32
dans une phase de leur migration ou de leur séjour. Par conséquent, les migrants
réguliers et les migrants irréguliers tendent souvent à se déplacer vers les mêmes
destinations » (De Haas, 2007 : 3).
La même stigmatisation est appliquée de façon différente selon le genre, le rôle
économique, le contexte d’insertion des migrants en condition irrégulière. Par exemple,
en Italie et dans d’autres pays, les femmes impliquées dans des activités d’assistance à
domicile de personnes âgées en sont épargnées de fait dans la perception commune et dans
les rapports quotidiens. Le problème émerge quand elles doivent rentrer en contact avec
les services et les appareils publics.
Des considérations sociales concernant l’utilité ou le « mérite » des immigrés
(Cozzi, 2007) ou, au contraire, le danger qu’ils représentent ou leur nocivité pour le
paysage des villes rentrent en jeu aussi dans le cas des sans-papiers, conditionnant les
pratiques de contrôle, de rétention et de déportation. Tous les immigrés non autorisés ne
sont pas égaux, et ne sont pas traités de la même façon.
DEMANDE DE BRAS ET FERMETURES POLITIQUES
Les immigrés en condition irrégulière font l’objet de discours antinomiques. Ils
sont considérés d’une part comme des criminels dangereux, de l’autre comme les victimes
de tracs et d’exploitations (Anderson, 2008). Si l’on s’intéresse à la persistance du
phénomène, à sa dissémination dans une pluralité de formes, à la variété de ses modalités
d’insertion dans les sociétés d’accueil, on est en position de penser qu’il y a différentes
composantes causales en jeu. En nous réclamant d’une dichotomie sociologique classique,
nous pouvons afrmer que certaines d’entre elles renvoient à la structure économique et
politique, d’autres à l’initiative des acteurs (human agency). Il faut ajouter que l’accent mis
sur les jeux d’interaction avec la société d’accueil, dans lequel l’immigration irrégulière
est dénie, renvoie à une troisième approche : celle de la tradition phénoménologique.
La question de l’immigration irrégulière, et de son insertion dans les économies
des pays de destination, peut être considérée, en premier lieu, comme une conséquence
typique des tensions existantes entre demande de main-d’œuvre pour les tâches les moins
convoitées et les strictes restrictions politiques vis-à-vis de l’immigration légale pour des
raisons de travail.
L’Union européenne a déployé bien des efforts pour le renforcement des
contrôles et pour la coordination intergouvernementale de la répression de l’immigration
irrégulière2, par rapport aux efforts plus modestes et aux résultats encore plus modestes
obtenus sur le plan des politiques pour l’autorisation à l’entrée. Le discours institutionnel
européen de la dernière décennie a abordé le thème des nouvelles entrées en les situant aux
2 Financé par l’Union européenne à hauteur de 42 millions d’euros le système Frontex, promulgué
en 2005 pour coordonner la vigilance sur les frontières extérieures à l’Union, a produit en 2007,
163 903 rejets aux frontières européennes, dont la majeure partie en Grèce (73 000 cas aux fron-
tières terrestres) ; suivent l’Espagne (27 900), puis l’Italie (21 650), engagées surtout dans le
contrôle de l’immigration africaine.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%