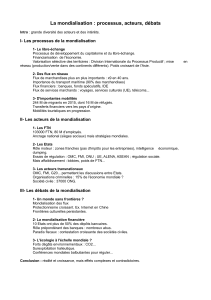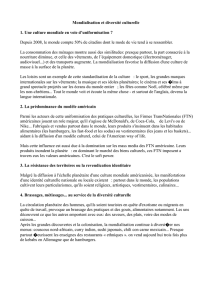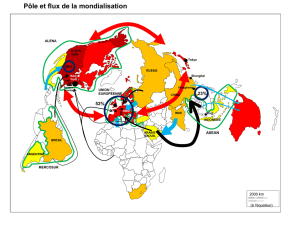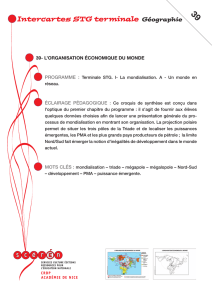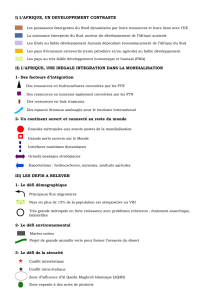la mondialisation en fonctionnement

M. PARCHEMIN – LYCÉE SAINT-EXUPÉRY – MARSEILLE – TERMINALE L-ES
LA MONDIALISATION EN FONCTIONNEMENT
Problématique
En quoi consiste le processus de mondialisation ?
Quels en sont les principaux acteurs et les principales manifestations ?
Plan
I – Etude de cas : En quoi le téléphone portable est-il un produit représentatif du processus de mondialisation ?
A – Le téléphone portable, un produit mondialisé
B – Apple : un exemple d'acteur inséré dans les réseaux de la mondialisation
C – Les territoires de l'iPhone
II – Un monde décloisonné et interdépendant, fonctionnant en réseaux
A – Les flux de marchandises
B – Les flux humains
C – Les flux immatériels de capitaux et d’information
III – Une libéralisation des échanges favorisée par différents acteurs mais également contestée
A – Organisations internationales et firmes transnationales au service de la mondialisation des échanges
B – Les États dépassés par la mondialisation ?
C – La mondialisation : un phénomène contesté
Croquis pouvant donner lieu à examen
Flux et réseaux de l’espace mondialisé
Schéma possibles pour illustrer une composition
L’iPhone, un produit mondialisé
L’asymétrie des flux dans le monde (p. 111 ou 122)
Les principaux acteurs de la mondialisation (p. 122)
Notions et vocabulaire
Flux matériels (humains, marchandises)
Flux immatériels (informations, capitaux)
Division internationale du travail (DIP)
Décomposition internationale du processus productif (DIPP)
Investissements directs à l’étranger (IDE)
Conteneurisation, hub
Altermondialisme, Démondialisation
Uniformisation culturelle
Acteurs
Firmes transnationales (FTN)
Organisation mondiale du commerce (OMC)
Fonds monétaire international (FMI)
Banque mondiale
États
Organisations non gouvernementales (ONG)
Organisation régionales
(UE, ALENA, ASEAN, MERCOSUR)
INTRODUCTION
Dès 1967, Marschall MacLuhan, intellectuel canadien spécialiste de la communication,
désignait le monde comme un « village global ». Depuis les années 1980, la mise en contact des
différents territoires du monde s’est accélérée mais si le monde connait aujourd’hui des flux
considérables, la mondialisation elle-même est un phénomène ancien. Entamé par les Grandes
Découvertes, continué par la colonisation européenne puis la diffusion de l’industrialisation, la
mondialisation ne se limite pas à une mise en contact des territoires par des flux de toutes natures
mais inclut dans sa définition une diffusion du monde de fonctionnement capitaliste à l’ensemble de
la planète. C’est cette libéralisation qui a favorisé la mobilité des hommes, des marchandises, des
services, des informations et des capitaux qui forment désormais des réseaux à l’échelle mondiale.
Ce phénomène a accompagné la forte croissance économique mondiale mais repose sur une double
logique d’inclusion/exclusion où centres d’impulsion et périphéries plus ou moins dominées se
distinguent : flux et acteurs favorisent certains territoires même si la multiplication des flux constitue
une chance pour tous dès lors qu’on en comprend le mode de fonctionnement.
Il nous revient donc de comprendre en quoi consiste le processus de mondialisation et nous
demandant notamment quels en sont les principaux acteurs et les principales manifestations.
L’étude d’un produit mondialisé nous permettra d’abord de comprendre concrètement les
principaux fonctionnement de la mondialisation puis expliqueront les différents flux qui parcours ce
monde décloisonné et interdépendant. Enfin, nous montrerons que la mondialisation repose surtout
sur une libéralisation des échanges organisée ou combattue par des acteurs.
1

M. PARCHEMIN – LYCÉE SAINT-EXUPÉRY – MARSEILLE – TERMINALE L-ES
I – Etude de cas : En quoi le téléphone portable est-il un produit représentatif du
processus de mondialisation (le cas de l'iPhone) ?
A – Le téléphone portable, un produit mondialisé
Le téléphone portable s’est rapidement répandu dans le monde, aussi bien dans les pays
développés que dans les pays en voie de développement. Dans les PMA, c’est un outil indispensable
d’ouverture et de développement car les réseaux classiques (téléphone fixe et Internet par cable)
sont très peu développés.
Ce sont d’ailleurs dans les pays les moins développés que les usages les plus originaux du
téléphone portable sont apparus (porte-monnaie virtuel par exemple).
→ Doc. 5 page 91 : suivi par sms des cours des produits agricoles et des mouvements des
troupeaux.
Le taux d’équipement est maximal en Amérique du Nord, en Europe occidentale, en Corée ou au
Japon mais la progression est très rapide dans les pays peu développés qui connaissent un « saut
technologique » (sans passer par le téléphone fixe).
Taux de pénétration moyen dans le monde 93 % (100 % en 2015)
en Europe occidentale 123 %
en Afrique 73 %
en Inde 63 %
Dès 2016, 50 % des téléphones portables seront des smartphones permettant l’accès à Internet
(mais certainement 80 % dès 2020).
B – Apple : un exemple d’acteur inséré dans les réseaux de la mondialisation
→ Doc. 6 page 92 : Le marché du téléphone portable est dominé par les entreprises des pays du
Nord tant pour les constructeurs que pour les opérateurs. Les sièges sociaux sont systématiquement
installés aux États-Unis (Apple, Motorola), en Europe (Nokia, Sony Ericsson) et en Asie orientale
(Samsung).
L’entreprise leader du secteur est actuellement Samsung (depuis 2011) mais Apple est l’entreprise
qui a renouvelé l’usage du téléphone portable en lançant son célèbre iPhone. L’innovation est au
cœur de la politique de l’entreprise même depuis sa création.
Rapide historique de l’entreprise :
–Steve Jobs et Steve Wozniak créent Apple en 1976 à Cupertino dans la Silicon Valley.
–En 1984, Apple innove en sortant le Macintosh, le premier ordinateur avec un souris et une
interface graphique, ce qui permettra l’accès du grand public à l’informatique
–Dans les années 1990, Apple est distancé par Microsoft qui écrase le marché de
l’informatique avec son système d’exploitation Windows.
–En 2001, l’invention de iPod (baladeur mp3) relance l’entreprise.
–En 2007, Apple sort son premier iPhone.
–En 2010, Apple innove à nouveau avec l’iPad qui lance la mode des tablettes.
Première capitalisation boursière au monde (472 milliards de dollars) devant Google (394 milliards)
et le pétrolier Exxon (388 milliards) et contre 154 milliards seulement pour Samsung.
2

M. PARCHEMIN – LYCÉE SAINT-EXUPÉRY – MARSEILLE – TERMINALE L-ES
Le succès économique repose certes sur la qualité de ses produits technologiques mais aussi :
–sur une image véhiculée par le design de ses produits et mis en scène dans les Apple Stores
des principales villes du monde
–une économie de l’offre où une nouvelle génération de chaque produit doit être proposée très
régulièrement afin de pousser à la consommation
–un renouvellement des pratiques d’achats dans le domaine culturel : iTunes et App Store font
figure de premiers supermarchés virtuels en ligne (environ 10 milliards de chiffre d’affaire en
2013 dont 30 % pour Apple et 70 % pour les développeurs).
Apple fait donc figure d’acteur intégré dans la mondialisation :
–participe à la mondialisation culturelle par ses produits
–privilégie les villes de l’archipel métropolitain mondial et plus précisément les trois pôles de
l’économie mondiale
–s’adapte à un monde multipolaire en ouvrant désormais des Apple Store dans les pays
émergents
–l’entreprise bénéficie pleinement de la division internationale du travail
C – Les territoires de l’iPhone
« Designed in California, Assembled in China ». Cette phrase inscrite derrière tous les produits Apple
symbolisent tout à fait la division internationale du travail caractérisée par le processus de
mondialisation.
Apple ne fabrique pas ses produits lui-même. Elle sous-traite auprès d’une entreprise taïwannaise
spécialisée qui assemble 40 % de la production électronique mondiale. Foxconn compte 1,3 millions
de salariés dont 1,2 en République populaire de Chine (dont 400 000 à Shenzhen) où la main
d’oeuvre est assez bon marché tout en étant disciplinée.
Apple via Foxconn profite donc de la division internationale du travail (DIT) qui consiste à attribuer
à différents pays des tâches spécialisées pour lesquelles ces pays sont plus performants. Apple obéit
à ce que l’on observe communément : conception dans un pays du Nord (fort potentiel d’innovation,
économies de services) et fabrication dans un pays du Sud (faible coût de la main d’oeuvre, faible
protection sociale).
Dans le cas de l’iPhone on peut même parler de décomposition internationale du processus
productif (DIPP) car la conception a lieu aux États-Unis et l’assemblage se fait en Chine mais la
production des pièces à haute technologie se fait dans différents pays du Nord et les matières
premières proviennent en général de pays en voie de développement. Un tel fonctionnement a
l’avantage d’exploiter le meilleur parti de chaque territoire mais peut être critiqué pour son coût
écologique.
→ Réalisation du schéma
Il est donc difficile de maintenir cette activité tout en conservant une bonne image à laquelle les
grandes marques occidentales sont très attachées : les conditions de travail critiquées, le gaspillage
de ressources naturelles causés par le renouvellement fréquent des modèles et le coût écologique
du transport et du traitement des appareils mis au rebut ne nuisent toutefois pas encore à
l’engouement des consommateurs pour les produits Apple.
3

M. PARCHEMIN – LYCÉE SAINT-EXUPÉRY – MARSEILLE – TERMINALE L-ES
II – Un monde décloisonné et interdépendant, fonctionnant en réseaux
A – Les flux de marchandises
● Les biens de consommation : carte page 99
Ils représentent 70 % des échanges mondiaux et les 2/3 de ces échanges se font entre les trois
pôles majeurs de l'économie mondiale.
● Les matières premières énergétiques et minières : carte doc. 1 page 107
Les hydrocarbures proviennent surtout du Moyen-Orient à destination de l'Europe, de l'Asie et de
l'Amérique ainsi que de la Russie à destination de l'Europe et de l'Asie orientale. Les contraste est
majeur entre des pôles émetteurs (Moyen-Orient, Russie) et des pôles consommateurs (Europe,
Asie orientale).
Les minerais proviennent des pays du Sud (où le coût d'extraction est plus faible) ou de pays s'étant
spécialisé dans cette activité en raison de ressources considérables (Australie, Russie). Les minerais
s'orientent majoritairement vers la Chine qui produit pour le reste du monde et vers les pays du Nord.
● Les matières premières agricoles : carte page 119
Contrairement aux idées reçues, les flux principaux sont Nord-Nord puis Nord-Sud. Cela s'explique
par l’existence d'une agriculture productiviste anciennement installée dans les pays du Nord. Les
États-Unis, l'UE, l'Australie et le Canada sont ainsi les plus gros exportateurs de céréales.
Les pays du Sud ont souvent des productions spécialisés dans laquelle ils sont leader mais dont ils
sont très dépendants (ex. Cacao pour la Côte d'Ivoire). Certains pays comme le Brésil sont un
élément essentiel pour le marché des pays agricoles (avec le soja, les oranges et la canne à sucre).
● Les flux illicites : drogues (500 milliards de dollars par an), armes, contrefaçons (ex. vêtements,
jouets, médicaments).
● Cette explosion des flux a été permise par la révolution des transports :
Repère page 100 et Doc. 3 page 101
La conteneurisation permet des gains de place, des gains de temps par l'usage de portiques
adaptés et une sécurisation du transport, ce qui aboutit finalement à une baisse considérable des
coûts de transport. Outre les porte-conteneurs d'autres navires spécialisés se sont développés
(pétroliers, méthaniers, vraquiers, etc.).
Les transports maritimes représentent ainsi 2/3 des échanges mondiaux en valeur mais ¾ du
tonnage. Les distances sont donc relativisées ce qui permet de bénéficier pleinement de la division
internationale du travail.
Les transports maritimes fonctionnent en réseaux : un certain nombre de ports font office de hubs
(déf. page 146) qui centralisent et redistribuent les flux et constituent de véritables plate-formes
multimodales (navires-train-camion) pour faciliter le transferts des conteneurs (voir la photo du port
de Singapour pages 78-79).
B – Les flux humains
Doc. 4 page 109 : On remarque que les flux intra-zones > flux entre zones
les migrations ente pays développées > flux Sud-Nord
Doc. 5 page 109 : Raisons de départ : familiales > économiques > politiques
4

M. PARCHEMIN – LYCÉE SAINT-EXUPÉRY – MARSEILLE – TERMINALE L-ES
● Les migrations économiques
200 millions de migrants légaux et 50 millions de clandestins
L e s flux Sud-Nord dépendant beaucoup des couples migratoires constituent en fonction de la
proximité mais surtout de l'histoire (colonisation, relations économiques) et des cultures (langues)
communes. Par exemple : Mexique-États-Unis, Maghreb-France, Turquie-Allemagne, Inde et
Pakistan-Royaume-Uni).
Ces flux concernent autant les diplômés que les non-diplômés. Aux États-Unis, la moitié des arrivées
est formée de diplômés (brain drain). On estime qu'un tiers des diplômés africains quittent le
continent pour un pays du Nord (fuite des cerveaux).
Les flux Sud-Sud s'orient vers les pays émergents ou les monarchies pétrolières du Golfe (où la
population immigrée peut atteindre 70 % de la population totale dans certains pays). Cette main
d'oeuvre est principalement masculine mais peut aussi concerner les femmes (ex. domestiques sri-
lankaises ou philippines au Moyen-Orient).
Les flux Nord-Nord concernent des travailleurs très qualifiés, souvent employés de FTN ou des
jeunes diplômés qui tentent un installation dans un autre pays.
Les conséquences de ces migrations économiques sont importantes pour les pays d'accueil où se
créent des réseaux de solidarités (diasporas) mais surtout dans les pays de départ. Dans beaucoup
de pays, un développement est permis par les remises migratoires, c'est-à-dire l'argent envoyé par
les émigrés. Dans les PMA, il s'agit même de la première source d'investissement !
Doc. 3 page 108 : Les remises représente plus de 300 milliards de dollars par ans (soit trois fois plus
que l'aide publique au développement). L'émigration contribue à une arrivée d'argent mais aussi une
circulation des idées et des modes de vie, d'où une meilleure considération pour les émigrés depuis
quelques temps alors qu'ils étaient souvent perçus négativement autrefois (accusation d'abandon,
ressentiment, envie ?).
● Les refugiés
On compte plus de 8 millions de réfugiés dans le monde. On peut distinguer :
–ceux qui fuient des conflits notamment des guerres civiles (ex. 48900 Syriens ont demandé
l'asile à un pays de l'UE en 2013)
–ceux qui fuient les persécutions politiques ou religieuses (ex. 37 900 Russes ont demandé
l'asile dans un pays de l'UE en 2013 et 13 000 Chinois aux États-Unis en 2013)
–les victimes de catastrophes naturelles
–les réfugiés climatiques obligés de partir en raison de la dégradation rapide de leur
environnement local (ex. désertification, déforestation, salinisation ou érosion des terres,
montée des océans).
Le développement, la diffusion des idées démocratiques et les efforts pour la résolution des conflits
d'une part ainsi que le changement climatique et ses conséquences d'autres part conduisent à
modifier la hiérarchie des causes de départ des réfugiés. Certains chiffres confirment que les
réfugiés environnementaux (deux dernières catégories) sont déjà plus nombreux que les réfugiés
politiques (les deux premières catégories).
Compte tenu de l'urgence des situations, les réfugiés s'installent toujours au plus près :
–dans le même pays en cas de catastrophe, de changement climatique ou de conflit local) : ils
ne sont donc pas comptabilisés dans les migrants internationaux
–dans un pays voisin (l'essentiel des flux Sud-Sud notamment en Afrique ou au Moyen-Orient)
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%