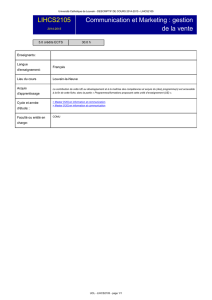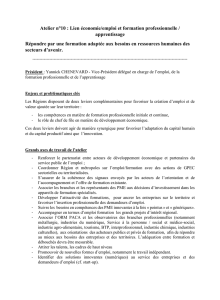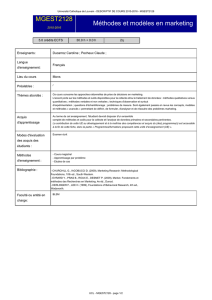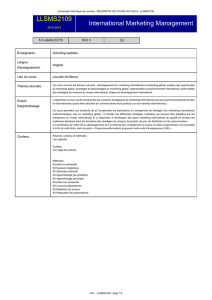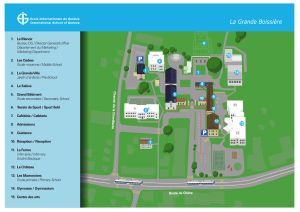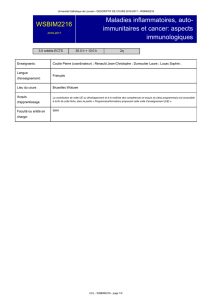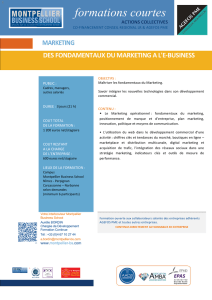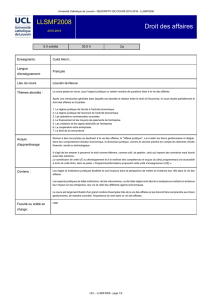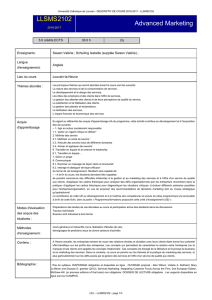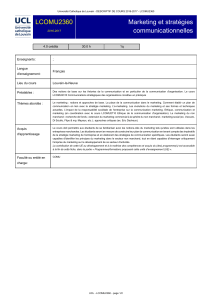working paper

Michel Ajzen, ILSM- CRECIS,
Université catholique de Louvain
Prof. François Pichault, HEC-LENTIC,
Université de Liège
Dr. Giseline Rondeaux, LENTIC,
Université de Liège
Prof. Laurent Taskin, ILSM-CRECIS,
Université catholique de Louvain
WORKING
PAPER
2014/08
Performance et Innovation en
PME: quelles relations pour
quelles mesures ? Proposition
d’une grille d’analyse et
application au cas des TPE et
PME wallonnes et bruxelloises
LOUVAIN SCHOOL OF MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE

Performance et Innovation en PME: quelles relations pour
quelles mesures ? Proposition d’une grille d’analyse et
application au cas des TPE et PME wallonnes et bruxelloises
Michel Ajzen, Louvain School of Management
Prof. François Pichault, HEC-LENTIC, Université de Liège
Dr. Giseline Rondeaux, LENTIC, Université de Liège
Prof. Laurent Taskin, Louvain School of Management
Summary
Cet article questionne la finalité performative économique dominante des pratiques de management et le lien de causalité établi
entre innovation et performance. Partant du constat qu’en sciences de gestion, les politiques de management auraient toutes, pour
ambition ultime, de contribuer à la performance de l’entreprise et que la capacité d’innovation d’une entreprise serait une
condition sine qua non de cette performance, cet article montre que (i) ces deux notions font référence à des contenus disparates ;
(ii) la performance est principalement mesurée par des indicateurs distanciés (financiers) ; (iii) la nature de l’interdépendance
entre innovation et performance n’est pas univoque dans la littérature actuelle. Capitalisant sur la diversité des caractérisations de
la performance et de l’innovation, dans la perspective d’enrichir la compréhension de ces notions, et adoptant une démarche
agnostique n’établissant aucun lien a priori entre les notions de performance et d’innovation, cet article propose une grille
d’indicateurs permettant la caractérisation de l’innovation (au travers d’indices factuels, déclaratifs, relatifs et indirects) et de la
performance (socio-organisationnelle, productive, environnementale et financière) des organisations, dans une démarche de dé-
naturalisation. La présentation des résultats de l’enquête réalisée auprès de 433 TPE et PME wallonnes et bruxelloise permet
d’opérationnaliser cette évaluation enrichie de l’innovation et de la performance et alimente une discussion critique sur les liens
établis entre ces notions.
Keywords: Performance, innovation, PME
Louvain School of Management
Working Paper Series
Editor : Prof. Jean Vanderdonckt
(president-[email protected])
Corresponding author :
Prof. Laurent Taskin
Center for Excellence CRECIS
Louvain School of Management / Campus Louvain-la-Neuve (L2.01.04)
Université catholique de Louvain
Place des Doyens, 1
B-1348 Louvain-la-Neuve, BELGIUM
Email : laurent.taskin@uclouvain.be
The papers in the WP series have undergone only limited review and may be updated, corrected or withdrawn
without changing numbering. Please contact the corresponding author directly for any comments or questions
regarding the paper.
President-ilsm@uclouvain.be, ILSM, UCL, 1 Place des Doyens, B-1348 Louvain-la-Neuve, BELGIUM
www.uclouvain.be/ilsm and www.uclouvain.be/lsm_WP

Louvain(School(of(Management(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((HEC6ULg(Ecole(de(Management(
Working(paper(series(
(
Document(de(travail(–(Ne(citer(qu’avec(l’accord(des(auteurs(
1(
Performance et Innovation en PME: quelles relations pour quelles mesures ?
Proposition d’une grille d’analyse et application au cas des TPE et PME wallonnes et bruxelloises*
AJZEN MICHELa
Louvain School of Management , Université catholique de Louvain
1 place des doyens B-1348, Louvain-la-Neuve, BELGIUM
michel.ajzen@uclouvain.be
Prof. FRANCOIS PICHAULTb
HEC, Université de Liège
Boulevard du Rectorat, 19 - B 51 4000 Sart Tilman Belgique
Dr. GISELINE RONDEAUXc
LENTIC, Université de Liège
Boulevard du Rectorat, 19 - B 51 4000 Sart Tilman Belgique
Prof. LAURENT TASKINd
Louvain School of Management , Université catholique de Louvain
1 place des doyens B-1348, Louvain-la-Neuve, BELGIUM
laurent.taskin@uclouvain.be
Abstract
Cet article questionne la finalité performative économique dominante des pratiques de management et le lien de causalité
établi entre innovation et performance. Partant du constat qu’en sciences de gestion, les politiques de management auraient
toutes, pour ambition ultime, de contribuer à la performance de l’entreprise et que la capacité d’innovation d’une entreprise
serait une condition sine qua non de cette performance, cet article montre que (i) ces deux notions font référence à des
contenus disparates ; (ii) la performance est principalement mesurée par des indicateurs distanciés (financiers) ; (iii) la nature
de l’interdépendance entre innovation et performance n’est pas univoque dans la littérature actuelle. Capitalisant sur la
diversité des caractérisations de la performance et de l’innovation, dans la perspective d’enrichir la compréhension de ces
notions, et adoptant une démarche agnostique n’établissant aucun lien a priori entre les notions de performance et
d’innovation, cet article propose une grille d’indicateurs permettant la caractérisation de l’innovation (au travers d’indices
factuels, déclaratifs, relatifs et indirects) et de la performance (socio-organisationnelle, productive, environnementale et
financière) des organisations, dans une démarche de dé-naturalisation. La présentation des résultats de l’enquête réalisée
auprès de 433 TPE et PME wallonnes et bruxelloise permet d’opérationnaliser cette évaluation enrichie de l’innovation et de
la performance et alimente une discussion critique sur les liens établis entre ces notions.
Mots-clés : Performance, innovation, PME
* Cette publication est tirée d’une recherche portant sur l’étude des liens entre les pratiques de GRH et
l’innovation et la performance des PME/TPE wallonnes et bruxelloises, financée par Acerta.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
a Chercheur à la Louvain School of Management Research Institute - Center for Research in Entrepreneurial Change and Innovative
Strategies (CRECIS) de l’Université catholique de Louvain
b Professeur à HEC-Université de Liège et Directeur du Lentic
c Docteure en sciences de gestion au LENTIC, Université de Liège(
d Professeur à la Louvain School of Management et ILSM, Université catholique de Louvain(
(

Louvain(School(of(Management(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((HEC6ULg(Ecole(de(Management(
Working(paper(series(
(
Document(de(travail(–(Ne(citer(qu’avec(l’accord(des(auteurs(
2(
1. Introduction
L’ambition de cet article est de contribuer à enrichir la caractérisation des concepts de performance et
d’innovation dans la recherche sur les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et sur les Très Petites Entreprises
(TPE). Les notions de performance et d’innovation, et plus encore les relations de causalité entre elles, font
l’objet de débats (Ledent et al., 2002 ; De Winne et Sels, 2010 ; Freel, 2000 ; Miles et Snow, 1984) dont la
vivacité témoigne aussi de la prégnance de ces dimensions dans la caractérisation de la finalité de la gestion des
entreprises. La nature de ces variables et les relations qu’elles entretiennent entre elles étant considérées comme
« allant de soi ». A cette forme de naturalisation, nous voulons opposer une vision élargie de la performance
(sociale, environnementale, p.ex.) et de l’innovation (aussi relative), rendant mieux compte de la diversité des
finalités de la gestion des entreprises et contribuant par-là à l’opérationnalisation d’une vision plus sociétalement
responsable du management.
Tout d’abord, certains auteurs mettent en avant un lien de cause à effet entre ces deux dimensions (Geroski et
Machin, 1992 ; Chaston, 1997 ; Ledent et al., 2002): l’innovation serait alors un déterminant de la performance
qui l’influencerait de manière positive (De Winne et Sels, 2010 ; Liouville et Bayad, 1998) ou négative (Simon
et al., 2002). Ensuite, d’autres auteurs estiment qu’il s’agirait plutôt d’une relation « d’indépendance » : les
entreprises performantes ne se caractérisent pas forcément par un degré élevé d’innovation, et vice versa
(Lallement et Wisnia-Well, 2007 ; Freel, 2000). Enfin, d’autres chercheurs s’inscrivent dans une approche
contingente et considèrent plutôt une « approche d’inclusion » où l’innovation serait un des critères de mesure de
la performance (Schuler et Jackson, 1987 ; Kochan et Barocci, 1985 ; Miles et Snow, 1984 ; Fombrun et al.,
1984 ; Youndt et al., 1996) .
Dans cet article, nous choisissons d’adopter une approche « agnostique » qui vise à étudier ces concepts,
indépendamment l’un de l’autre. Le choix de cette démarche semble se justifier par le manque de consensus
autour des définitions et des liens conceptuels. Ainsi, nous proposons tout d’abord d’éclaircir le débat et
d’approfondir, successivement les définitions de performance et d’innovation, en vue de les caractériser. L’étude
de ces dimensions au sein des TPE et PME wallonnes et bruxelloises permet d’opérationnaliser notre grille de
mesure intégratrice et la caractérisation englobante de ces deux construits. L’analyse des résultats nous amène
finalement à discuter les liens entre performance et innovation et à ouvrir quelques pistes de recherche futures.
2. L’étude de la performance en gestion
A l’image de ce que Gilbert et Charpentier (2004) affirment, il existe une «conceptualisation plurielle de la
performance ». Ainsi, ils considèrent que la performance serait un «(…) mot-éponge ou mot-valise (…), qui
recouvre des notions dont le sens est très largement contextuel et autorise des interprétations nombreuses »
(pp.48-50). En effet, dans de très nombreux cas, les chercheurs en sciences de gestion qualifient la performance
dans l’entreprise de sociale, de financière ou encore, d’environnementale (voir notamment Allouche et al., 2004 ;
Fabi et al., 2006 ; Ducrou, 2008). Dès lors, il serait plus judicieux de parler des performances plutôt que de la
performance de l’entreprise. Au terme de la revue de littérature à laquelle nous nous sommes adonnés, onze
types de performance peuvent être identifiés: sociale (Dohou et Berland, 2008; Fabi et al., 2006; Baggio et al.,
2006; Frimousse et al., 2006; Allouche et al., 2004; Igalens et Gond, 2003; Decock et Good, 2001; Liouville et
Bayad, 1998; Savall et Zardet, 1989; Carroll, 1979), organisationnelle (Dany et Hatt, 2007; Poissonnier et
Drillon, 2008; Arcand et al., 2004; Morin et Savoie, 2002; Chandler et McEvoy, 2000; Liouville et Bayad, 1998;
Chaston, 1997; Morin, Savoie et Beaudin, 1994), sociétale (Ducrou, 2008), opérationnelle (Fabi et al., 2006;
Sels et al., 2003), environnementale (Ducrou, 2008; Dohou et Berland, 2007), économique (Merck et Sutter,
2009; Ducrou, 2008; Savall et Zardet, 1989), croissance (Fabi et al., 2006), financière (Bnouni, 2011; Zeribi et
Boussoura, 2007; Fabi et al., 2006; Allouche et Laroche, 2005; Sels et al., 2003; Griffin et Mahon, 1997),
comptable et boursière (Bughin et Colot, 2008; Allouche et al., 2004.), humaine, commerciale et productive
(Allouche et al., 2004; Barrette et Carrière, 2003) et globale ou non-qualifiée (Benamar, 2010; Tocher et
Rutherford, 2009; Merck et Sutter, 2008; Poissonnier et Drillon, 2008; Dohou et Berland, 2007; Upon et
Seaman, 2006; Neely et al., 2002; Miloud, 2001; Spanos et Lioukas, 2001; Delery et Doty, 1996). Cette dernière
forme de performance pose la question de la relation entre les différentes formes de performances qualifiées et
une hypothétique performance globale, que nous ne traiterons pas ici.
Par ailleurs, l’examen de la littérature rend compte de la difficulté contextuelle qui réside dans l’exercice de
définition des performances. Ainsi, comme pour la grande majorité des auteurs, nous proposons de partir du
postulat que la définition de chaque performance ne peut se faire qu’à travers ses indicateurs et l’occurrence de
ceux-ci. En effet, son caractère polysémique transforme l’exercice de définition en une tentative de
caractérisation de celle(s)-ci passant par l’analyse des indicateurs qui la (les) représente(nt).

Louvain(School(of(Management(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((HEC6ULg(Ecole(de(Management(
Working(paper(series(
(
Document(de(travail(–(Ne(citer(qu’avec(l’accord(des(auteurs(
3(
2.1. Des performances de l’entreprise aux indicateurs de mesure
En définissant la performance globale, certains auteurs détaillent en fait, des dimensions auxquelles
appartiennent les indicateurs, sans pour autant les nommer. Ainsi, certains l’abordent d’un point de vue plutôt
financier (Miloud, 2001 ; Delery et Doty, 1996 ; Tocher et Rutherford, 2009 ; Carlson et al., 2006 ; Merck et
Sutter, 2008), alors que d’autres la considèrent sous l’angle social ou organisationnel (Dohou et Berland, 2007).
En ce qui concerne Poissonnier et Drillon (2008), ils proposent même d’étudier, à la lumière du prisme de la
performance (Neely et al., 2002), les pratiques de GRH qui ont un effet sur cette dernière. Par conséquent,
l’examen des indicateurs qui définissent la performance globale permet d’observer l’importance du caractère
économique ou financier qui laisse supposer que parler de performance dans l’entreprise, revient à traiter de ses
capacités et de ses résultats financiers. En effet, bien que d’autres ont une visée sociétale, sociale, voire
environnementale, force est de constater que la majorité de ces indicateurs tentent de vérifier ou d’évaluer un ou
des résultats quantifiables (outputs).
Toutefois, la multitude de dimensions combinée au manque de consensus autour de leurs caractérisations et de
leurs qualifications amène beaucoup d’ambiguïté dans l’approche du concept de performance. En effet, comme
le Tableau 1 le suggère, certains indicateurs ont été relevés dans des types de performances à priori différentes
(au moins par leur qualification). Citons, par exemple, le taux d’absentéisme que l’on retrouve dans les
performances globale, sociale et opérationnelle ou encore le climat social/de travail dans l’entreprise, qui trouve
sa place dans les performances sociale, organisationnelle et sociétale. Par ailleurs, d’autres indicateurs ne sont
pas nommés à l’identique mais leur contenu est identique. C’est le cas, par exemple, de certaines normes
environnementales ou sociales. A l’inverse, certains sont antinomiques et relèvent davantage de l’appréciation,
comme le respect des normes sociales, des codes de conduite et des réglementations internes à l’entreprise.
Performance
Indicateurs
Auteurs
Globale
Rentabilité financière
Rentabilité économique
Benamar, 2010;
Tocher et
Rutherford, 2009;
Merck et Sutter,
2008; Poissonnier et
Drillon, 2008;
Dohou et Berland,
2007; Upon et
Seaman, 2006;
Neely et al., 2002;
Miloud, 2001;
Spanos et Lioukas,
2001; Delery et
Doty, 1996
REAE (résultat d’exploitation sur
actifs d’exploitation)
RPPT (résultat reporté +
réserves sur passif total)
PERTE/BIL (Pertes fiscales
reportées sur total du bilan)
Liquidités immédiates
Liquidités au sens large
Liquidités au sens strict
VDAC (valeurs disponibles sur
actifs circulants restreints)
FESCEAE (encours de
fabrication, stocks de produits
finis et
commandes en cours sur actifs
circulants d’exploitation)
FOPAT (Fonds propres sur passif
total)
FOPCAP (Fonds propres sur
capitaux permanents)
AFAT (actifs fixes sur actif total)
IMCAF (Immobilisations
corporelles sur actifs fixes)
CAPAF (capitaux permanents sur
actifs fixes)
FOPAF (fonds propres sur
actifs fixes)
Logarithme retour sur ventes
Evolution des ventes
Valeur actualisée nette
Valeur économique créée
Cash-flow
Part de marché
Guide SD 21000
Chiffre d'affaires
Norme ISO 26000
Balanced Scorecard
Triple Bottom Line
Reporting GRI
Niveau de satisfaction
Turnover
Motifs des départs
Niveau des plaintes
Pertinence/qualité des formations proposées
Etat des lieux des forces de travail
Niveau d'accident
Inventaire des compétences
Coûts du personnel
Part du salaire variable
Niveau d'évaluation remplies
Résultats de la politique de diversité
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%