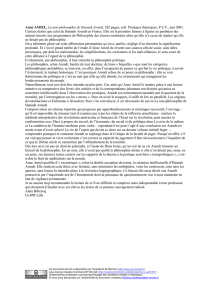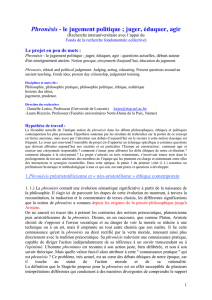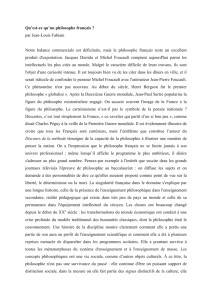Subjectivations politiques et économie des savoirs

N°5 – Mai 2013
ISSN : 2031-4973 - eISSN : 2031-4981
Publication en ligne sur
http://popups.ulg.ac.be/dissensus/
http://www.philopol.ulg.ac.be
Subjectivations politiques et économie des savoirs
(Coordination : Th. Bolmain et G. Cormann)
Grégory Cormann : « La politique d’après : subjectivations et politisations post-althussériennes.
Quelques réflexions introductives autour d’un programme de recherche matérialiste » p. 2
Thomas Bolmain : « Politique, savoir, subjectivation. Recherche sur la question du sujet dans la
philosophie politique française contemporaine » p. 7
Livio Boni : « L’impasse de l’être comme passe du sujet : figures de la subjectivation chez Alain Badiou »
p. 50
Andrea Cavazzini :« Le sujet rôde toujours ou comment la dialectique hégélienne peut déplacer les
montagnes » p. 64
David Amalric et Benjamin Faure : « Réappropriation des savoirs et subjectivations politiques : Jacques
Rancière après Mai 68 » p. 75
Marco Rampazzo-Bazzan : « Anschlag. Interlude subversif. Pour une carte du mouvement étudiant
allemand des années '60 » p. 90
Guillaume Sibertin-Blanc : « Généalogie, topique, symptomatologie de la subjectivation politique :
questions-programme pour un concept politique de minorité » p. 101
Sophie Bourgault: « Prolegomena to a rehabilitation of Platonic moderation » p. 122
François Charbonneau : « Comment lire Essai sur la révolution d’Hannah Arendt ? » p. 144
Oriane Petteni : « L’argot dans les discours hugolien et célinien. Une lecture symptômale des apories du
concept de fraternité » p. 171
Fabio Bruschi : « Le transindividuel dans la genèse des groupes sociaux » p. 192
Yves Citton, Laurent Demoulin, Antoine Janvier et François Provenzano : « Exploitation, interprétation,
scénarisation. Entretien avec Yves Citton » p. 209
André Tosel : Recension de Isabelle Garo,
Foucault
,
Deleuze
&
Althusser
.
La
politique
dans
la
philosophie
, Paris, Demopolis, 2011, 417 p., 21 euros. p. 240

– Revue de philosophie politique de l’ULg – N°5 – Mai 2013 – p. 2
Subjectivations politiques et économie des savoirs
(Coordination : Th. Bolmain et G. Cormann)
Grégory Cormann : « La politique d’après :
subjectivations et politisations post-althussériennes.
Quelques réflexions introductives autour d’un
programme de recherche matérialiste »
Le présent dossier « Économie des savoirs et subjectivations politiques » publie
pour l’essentiel les textes de la table ronde, organisée à Liège en février 2010, autour
du livre de Stéphane Legrand et Guillaume Sibertin-Blanc,
Esquisse d’une contribution
à la critique de l’économie des savoirs
(Le Clou dans le Fer, 2009). De façon plus
générale, cette table ronde était l’occasion de connaître plus précisément, de
se frotter
au travail collectif de recherche du Groupe de Recherches Matérialistes (GRM),
développé notamment dans le cadre de son Séminaire à l’École Normale Supérieure.
Se frotter à un programme de recherches, ce n’est pas seulement identifier une
certaine familiarité dans des manières de faire ou de penser la recherche ; c’est
soulever des problèmes qui sont des « problèmes à la fois d’existence, d’institution et
de pensée », selon la formule de Foucault dans « Pour en finir avec le mensonge », que
les auteurs reproduisent au début de leur petit volume d’intervention. Sans atteindre
l’intensité des débats qui ont agité l’université française dans les mêmes années, il
convient de mettre cette table ronde, consacrée
grosso modo
à la question du sujet
dans les philosophies post-althussériennes, en relation critique avec certaines des
« réformes » mises en œuvre dans l’université belge.
Après la réforme des programmes d’enseignement dans le cadre du Décret Bologne,
l’année 2009 à l’Université de Liège avait en effet été marquée par des réformes de
grande ampleur concernant l’organisation, le financement et l’évaluation de la
recherche. Le « Projet pour l’ULg », rendu public en mai 2009 par les Autorités
académiques, reposait sur la volonté de séparer les flux d’enseignement et de
recherche afin de pouvoir mieux apprécier les investissements financiers en termes de
recherche. Cette réforme confirmait ainsi le constat de S. Legrand et de G. Sibertin-

– Grégory Cormann : « La politique d’après : subjectivations et politisations post-
althussériennes. Quelques réflexions introductives autour d’un programme de recherche matérialiste » –
p. 3
Blanc que la coupure entre université et société, souvent regrettée, s’entretenait de la
répétition de cette coupure au sein de l’institution universitaire dans le découplage
entre recherche et enseignement. Au-delà de l’affirmation complaisante d’un
enseignement universitaire fondé sur la recherche, une telle réforme, fût-ce à son
corps dépendant et par-dessus le marché, répétait une nouvelle fois la coupure par
laquelle l’enseignement à l’université se limite souvent à ne proposer aux étudiants
qu’une consommation improductive, c’est-à-dire à tenir les étudiants éloignés de tout
« travail utile », selon une autre formule foucaldienne tirée du même texte, autrement
dit encore de tout travail qui puisse s’inscrire dans le cycle production-circulation-
consommation (productive) de la recherche. Quant à la réforme des procédures
d’évaluation du Fonds National de la Recherche Scientifique, elle visait tout
simplement, au nom de l’objectivité, à retirer aux chercheurs locaux tout pouvoir
d’appréciation de la politique de recherche à mener en Communauté française de
Belgique.
Ce qui était donc en jeu dans cette rencontre avec le Groupe de Recherches
Matérialistes, autour du programme d’une « épistémologie matérialiste », ne pouvait
donc en rien se limiter à une réunion de chercheurs universitaires. Il s’agissait, d’une
part, de dépasser expérimentalement le partage Enseignement/Recherche que
l’université s’efforce de reproduire aussi sûrement qu’elle affirme le contraire : le
séminaire avec le GRM, malgré les limites d’une première expérimentation, était à cet
égard aussi l’aboutissement d’un travail mené cette année-là avec les étudiants de
notre master en philosophie. Un séminaire préparatoire s’était en effet donné pour
tâche de lire de près l’
Esquisse d’une contribution à la critique de l’économie des
savoirs
en interrogeant le concept de
sujet
qui y était implicitement mais décisivement
mobilisé. Après d’autres expériences d’enseignement, l’organisation d’un tel séminaire
apparaissait comme une façon d’articuler l’enseignement et la recherche, c’est-à-dire
de donner du sens à l’exigence de la formation et de la recherche universitaires
d’envisager les savoirs dans leur « caractère hypothétique et provisoire » (Foucault), au
sens précisément où une communauté a quelque chose à faire de ces savoirs et s’en
donne les moyens. Ce qui était du même coup en jeu n’était rien d’autre que la mise
en cause de la « coupure prédéfinie du politique et du non-politique » – qui est la
coupure en dernière instance –, c’est-à-dire la mise en cause du partage
a priori
entre
sujet productif et sujet improductif. Dans les termes du (dernier) Foucault, l’article
d’ouverture de Thomas Bolmain définit le
sujet productif
par « un certain rapport,
signalé par un affect (l’"intolérable"), à une transformation de l’expérience, elle-même
vecteur d’une transformation de sa propre expérience » ; bref, il s’agit d’une
« expérience-limite de soi » où nous sommes « déporté(s) par un affect aux limites de
ce qui est habituellement pensable ».

– Revue de philosophie politique de l’ULg – N°5 – Mai 2013 – p. 4
La
politisation
désigne précisément cette expérience-limite, entre
désubjectivation
et
resubjectivation
, que le présent dossier cherche à saisir, dans sa nécessité politique,
dans une postérité
a priori
paradoxale d’Althusser chez Alain Badiou, Jacques Rancière
et Étienne Balibar. Pour ces auteurs, en effet, il n’est pas possible de penser la
politique « en l’absence d’un véritable concept de sujet » : toute politique est une
« politique du subjectif » (Balibar) qui circonscrit une certaine expérience portée par un
individu, caractérisé comme corps vivant, vie psychique et parole. Toujours à la suite
d’É. Balibar, Th. Bolmain propose de prolonger, en direction d’une
politique de la
finitude
, cette réappropriation de la philosophie althussérienne. De même en effet qu’il
est possible de trouver l’article « Freud et Lacan », les linéaments d’une « pensée des
modes de constitution de la subjectivité », qui ne se limite pas à la figure du sujet
assujetti, de même il est possible de s’appuyer sur l’affirmation d’Althusser que
« l’idéologie persévérerait dans une société sans classe » pour établir la nécessité de
« penser ce qui vient après la politisation ». À y bien regarder, tel est bien la question
qu’abordent, selon leurs moyens propres, l’ensemble des contributions du dossier :
penser positivement la finitude de tout effort de politisation de notre expérience, c’est-
à-dire la nécessité d’assumer l’inscription – l’institution – matérielle et symbolique du
« déplacement [du] politique et du non-politique » (« politisation »).
Dans leurs articles sur A. Badiou, Livio Boni et Andrea Cavazzini soutiennent l’un
comme l’autre, après Lacan, et contre Heidegger, la thèse selon laquelle le sujet
moderne est en réalité depuis Descartes un « sujet divisé ». Ils rappellent de la sorte
l’importance générale de Lacan (et, à travers lui, de Hegel) pour (comprendre) les
pensées de la subjectivation post-althussériennes. Ainsi le sujet ne doit-il pas être
considéré comme identité à soi, mais comme le « processus même du déploiement de
la contradiction », selon la formule d’A. Cavazzini. Le sujet est négativité, destruction,
exception ou soustraction. Dans le même temps, il s’agit de penser ce que L. Boni
appelle un « sursaut de subjectivation ». Pour lui, le sujet badiousien doit se
comprendre par analogie avec le processus de la cure analytique, au terme de laquelle
le sujet est amené à assumer une identité désormais reconnue comme imaginaire. De
telles affirmations font ainsi signe vers quelque chose comme une
logique du
« traumatisme sans trauma »
permettant de soutenir une
fidélité à soi
qui ne soit pas
d’ordre fantasmatique, une fidélité de second degré, que L. Boni nomme, d’une autre
belle formule, une « fidélité extravertie, capable d’incorporer le sujet à quelque chose
qui le dé-passe, constituant ainsi un nouveau lieu. »
Pour A. Cavazzini, « la question de ce qui vient
après
la dés-objectivation » rejoue la
scène originaire – et l’aporie – de la philosophie, lorsqu’il s’agit pour le philosophe de
retourner dans la caverne
. Autrement dit, la question de la vérité et du savoir est
« inséparable » d’une « mise-en-commun » ; elle est inséparable de la formation d’une

– Grégory Cormann : « La politique d’après : subjectivations et politisations post-
althussériennes. Quelques réflexions introductives autour d’un programme de recherche matérialiste » –
p. 5
communauté « par-delà les formes données de l’assujettissement ». On comprend que
c’est le
présupposé de l’égalité de tous
qui « empêche d’en rester au pur négatif ou au
nihilisme ». En écho, David Amalric et Benjamin Faure s’intéressent à la façon dont le
parcours intellectuel de J. Rancière après 1968 visait à conjurer un tel danger de
nihilisme : « le risque d’une politique nihiliste ou consensuelle […] ; ou au contraire le
risque d’un pur détachement, hors de toute division sociale, sans prétention à
transformer la société dans son ensemble, sans unité transversale des luttes. » C’est
contre la figure du maître savant, on le sait, que J. Rancière a pris ses distances par
rapport à Althusser. Portant son attention vers la parole et vers les voix ouvrières, il a
ainsi tracé moins le portrait d’un sujet qui « fait le vide », selon une formule qui hante
le dossier, qu’un sujet qui est « toujours trop de choses » dès lors qu’il commence à
dire
, c’est-à-dire dès qu’il se prête à une « appropriation sauvage du savoir » par un
« sourd travail de réappropriation des institutions, des pratiques et des mots ».1
Pour conclure le dossier, les articles de Marco Rampazzo Bazzan et de Guillaume
Sibertin-Blanc montrent comment la généalogie des concepts politiques peut ouvrir des
« espaces de réflexivité » (M. Bazzan) entre une conjoncture politique donnée et notre
actualité. Dans un texte d’introduction au séminaire du GRM sur les luttes étudiantes
en Allemagne dans les années 60, M. Bazzan s’attache à « dés-objectiver », c’est-à-dire
à rendre à ses virtualités, le jugement que l’on porte habituellement sur l’inéluctable
évolution de ces luttes vers le terrorisme. Il s’agit de désamorcer l’hypothèse de
« l’escalade », afin de pouvoir « construire des analogies avec notre actualité » –
« reprendre un fil coupé » –, et d’« analyser le vecteur d’une phase pré-révolutionnaire ».
Pour cela, l’article étudie avec beaucoup de finesse les significations multiples du titre,
Anschlag
, de la revue du groupe
Subversive Aktion
, dont Rudi Dutschke était un des
leaders au début des années 1960. Il identifie une ambiguïté de départ entre le sens
d’
Anschlag
comme placard, affiche ou slogan (c’est-à-dire action de sensibilisation ou
activation de l’opinion publique) et
Anschlag
comme attentat (c’est-à-dire comme action
terroriste). Il s’agit certes de comprendre « comment une ligne de fuite peut devenir
une ligne de mort », mais à la condition de « saisir son espace d’intelligibilité à travers
l’analyse de significations surdéterminées », à la condition de se donner les moyens de
comprendre comment des énoncés ont pu changer de sens dans un contexte de conflit
et de répression.
1Il n’est pas possible de reproduire ici dans le détail le contexte dans lequel D. Amalric et B. Faure ont
construit cette lecture « réappropriatrice » de J. Rancière. Je rappelle simplement que c’est dans le
cadre de l’organisation de séminaires d’élèves à l’ENS, comme instrument de lutte contre la réforme de
l’enseignement supérieur en France, qu’ils ont développé avec d’autres une méthode égalitaire
d’écriture et de traduction collectives des savoirs. Au fond, ce qui compte dans leur rapport à Rancière,
c’est « la manière dont une conjoncture politique et historique précise s’inscrit dans une pensée […]
qui se veut radicale ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
1
/
247
100%