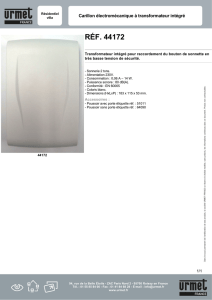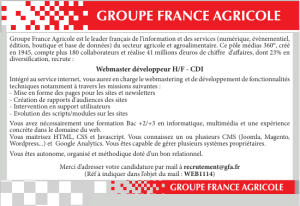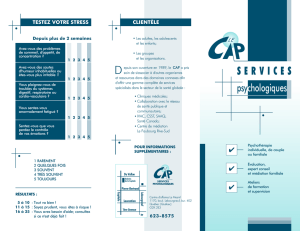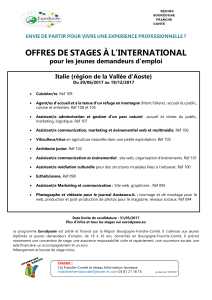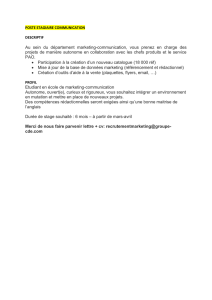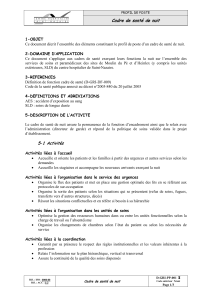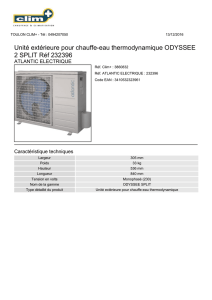Images, regards et miroir

Images, regards et miroir
Regards sur le handicap
Définition M. Calvez 1994 Liminalité :
"L'existence de discontinuités dans le tissu social et dans les trajectoires biographiques des individus
oblige à ménager des passages d'une situation sociale à une autre qui présentent des caractéristiques
formelles identiques. Chaque séquence de passage se caractérise par une succession de trois stades, la
séparation, le seuil et l'agrégation ; à chaque stade correspondent des rites particuliers qui permettent le
changement de statut de l'individu. La phase de seuil caractérise le moment où l'individu a perdu un
premier statut et n'a pas encore acquis le second. Cette situation liminaire est une condition essentielle et
nécessaire du passage car, en annulant les marques d'un statut antérieur, elle rend possible l'acquisition
de l'autre statut. L'individu se trouve alors dans une situation spéciale pendant un temps plus ou moins
long : il flotte entre deux mondes. C'est cette marginalité que recouvre le concept de liminalité."
Bibliographie
Le concept de handicap et son évolution
Le handicap et les institutions : évolution des politiques sociales
Etudes et recherches psychosociologiques sur le handicap
Représentations du handicap dans la société
La famille et le handicap
Représentations du handicap chez les professionnels
Image du handicap dans les médias et la littérature
Actualité : l'OMS a adopté le 21 mai 2001, la nouvelle "Classification internationale du
fonctionnement, du handicap et de la santé", disponible en français sur le site de l'OMS :
http://www.who.int/icidh
Actualité : Plan en faveur des personnes handicapées
Plan d’actions présenté par Ségolène Royal Ministre déléguée à la famille et à l’enfance, 18 juillet 2001,
en particulier :
chapitre 1. Changer le regard sur les personnes en situation de handicap
chapitre 13. Un programme d’actions pour changer le regard sur les personnes en situation de handicap
Le concept de handicap et son évolution :
BERAUD CAQUELIN (H.) / DERIVRY PLARD (M.)
Le handicap, une notion complexe en construction, in : L'enfance handicapée en France, Paris :
Hachette, 1999, 21-61, réf. bibl.

Après quelques données historiques sur la construction du handicap, en particulier sur l'évolution du
vocabulaire entourant la notion de handicap, les auteurs s'attardent sur la loi de 1975 qui oriente
véritablement les politiques sociales du handicap en France vers une institutionnalisation du handicap,
donnant un statut social aux personnes handicapées et reconnaissant le domaine médico-social avec la
création des Commissions Départementales d'Education Spéciale (CDES) et étudient les propositions de
révision de cette loi. Puis ils présentent la Classification Internationale des Handicaps avec sa genèse,
ses principes et les enjeux de sa révision. Les auteurs terminent par une réflexion sur une connaissance
statistique encore insuffisante sur le handicap et la dépendance. (Ouvrage à la cote SAN 5.5 LAN).
CALVEZ (Marcel)
La liminalité comme cadre d'analyse du handicap, Prévenir, 2000/07-12, n° 39, 83-89. 21 réf.
L'analyse du handicap en termes de liminalité cherche à rendre compte du handicap comme une
situation qui échappe à la fois aux statuts sociaux et aux classifications culturelles en vigueur. L'article
présente les recherches sur lesquelles repose cette approche. Il esquisse des pistes de recherche sur les
tensions que génère la situation de marge, en particulier dans le domaine du dépistage anténatal. (R.A.).
CHAPIREAU (François)
Les enjeux sociaux de la classification internationale des handicaps, Prévenir, 2000/07-12, n° 39,
27-34. 11 réf.
La classification internationale des handicaps (CIH) est en cours de révision. Les débats de spécialistes
sont nombreux et vifs. Comment y discerner ce qui aura des conséquences générales et ce qui ne
concerne que quelques experts ? Plus précisément ; y a-t-il des enjeux sociaux et quels sont-ils ? La
présentation de la classification et de ses usages montre que les enjeux sociaux ont d'emblée été au coeur
du projet et de sa mise en oeuvre. La révision proposée par l'Organisation Mondiale de la Santé va bien
au-delà de simples aménagements techniques et exprime des débats sociaux d'une grande actualité.
L'influence prédominante de certaines conceptions nord-américaines peut conduire à des difficultés pour
les politiques européennes de solidarité. (R.A.).
CHAPIREAU (François)
L'enfance handicapée et les classifications, in : L'enfance handicapée en France, Paris : Hachette,
1999, 131-155,10 réf.
Les classifications dans le domaine de l'enfance handicapée ont beaucoup évolué avec le temps. Leurs
transformations successives expriment les débats scientifiques et l'évolution des mentalités. L'intérêt de
leur étude dépasse le domaine des spécialistes. Elles sont en relation avec les choix de politiques d'aides
et de soins. Elles sont au carrefour d'enjeux concrets pour la vie ordinaire des enfants concernés, pour
leurs familles, et pour les professionnels qui s'efforcent de les aider. En caractérisant une personne par
un seul trait, on opère simultanément un classement des personnes, sans s'interroger sur l'implication
sous-jacente : à tout moment, il y aurait une adéquation possible entre une personne et un établissement
ou un service. L'auteur aborde les classifications desjeunes inadaptés en 1946, la classification des
enfants inadaptés de 1956, le classement des personnes handicapées dans la loi de 1975, puis la
classification de l'OMS. Il décrit les applications administratives de la CIH, montre commentles
politiques sont cloisonnées par le classement des personnes, et apporte sa réflexion sur les classifications
et l'évolution des mentalités, ainsi que l'avenir éventuel des classifications vers la participation sociale.
(Ouvrage à la cote SAN 5.5 LAN).

Des débats récents sur la nature et l'origine de handicap COOK (Jon)
Le handicap est culture, Prévenir, 2000/07-12, n° 39, 61-70. 26 réf.
ont opposé un modèle de causalité linéaire d'inspiration médicale et s'appliquant à l'individu, à un
modèle où la société est considérée comme génératrice du handicap au travers de mécanismes
d'interprétation et d'exclusion. Les programmes de lutte contre l'exclusion auraient donc des ciblages
différents dans les deux cas, le premier modèle préconisant des programmes de réparation et de
réadaptation individualisée, le second des réformes au niveau de la société entière. Un regard
d'anthropologue a tendance à considérer ces deux approches comme des exemples de constructions
sociales et culturelles, au même titre que le concept du handicap est construit par les groupes sociaux
locaux. Pour promouvoir des programmes appropriés en faveur des personnes handicapées, il serait
donc plus logique d'observer la façon dont le handicap est construit localement, et de bâtir des projets
adaptés aux besoins locaux, au lieu de tenter d'appliquer des schémas universels à des populations très
diverses. (R.A.).
DENORMANDIE (Philippe)
La maîtrise des handicaps, Gestions hospitalières, 2001/03, n° 404, 170-179.
La maîtrise des handicaps est un vaste sujet, les handicaps pouvant intéresser différents domaines :
sensoriel, psychique, physique, mental ou associés. La maîtrise des handicaps nécessite de comprendre
la constitution des handicaps et les actions à réaliser pour prévenir le handicap. L'auteur, responsable de
la Mission handicap à l'AP-HP étudie successivement : la notion même de handicap et le nombre de
personnes concernées en France ; les différentes étapes qui constituent la mise en oeuvre d'une situation
de handicap pour un individu ; les solutions qui permettent de maîtriser les facteurs intervenant lors de
ces différentes étapes ; l'évolution du handicap chez un individu et la maîtrise du handicap dans le
temps. (Extrait de l'intro.).
GARDOU (Charles)
Handicap, conformité et situation de seuil, Prévenir, 2000/07-12, n° 39, 71-82. 38 réf.
Dans une démarche de nature anthropologique, celle-là même qui fonde l'ensemble de ses travaux,
l'auteur s'interroge sur la réalité vécue par les personnes handicapées au sein de notre société. Il dénonce
d'abord certaines approches qui ont en commun de nier la spécificité du handicap et, par phénomène
d'amalgame, de l'assimiler à une déviance. Afin de faciliter, d'une part, l'accès à la compréhension de la
situation de handicap et d'impulser, d'autre part, d'autres comportements sociaux et éducatifs, il propose
un cadre conceptuel, prenant appui sur les rites de passage, et en particulier sur la notion de seuil. Il
montre que l'état de suspension sociale, dit de liminalité, transitoire pour les initiés dans les rites de
passage, est souvent permanente chez les personnes atteintes de déficiences et en fait des gens du seuil.
Vouées au manque de place, par incompréhension, peur, abandon ou rejet, elles sont maintenues dans
une position indéterminée, un ailleurs, un nulle part, un espace d'errance, une zone où leur acceptation et
leur reconnaissance demeurent toujours équivoques. Il souligne enfin le rôle premier de la communauté
d'appartenance, à même de permettre ou d'empêcher le passage, d'abréger ou de pérenniser l'exil social
de certains de ses membres, victimes du hasard d'une naissance ou d'une vie. (R.A.).
GATEAUX MENNECIER (Jacqueline)
Le handicap : l'ordre des choses, in : L'enfance handicapée en France, Paris : Hachette, 1999, 157-
190, réf. 3p.

La réflexion de l'auteur vise à faire apparaître les conditions de possibilité du champ de l'enfance
inadaptée, ce dispositif complexe qu'on appellera les institutions de gestion de l'écart à la norme scolaire
et sociale, et les conditions de production des configurations symboliques relatives à l'inadaptation et au
handicap. L'analyse sera centrée sur ses principaux maillons constitutifs : l'enseignement spécial, avec la
loi de 1909, les institutions judiciaires et médico-pédagogiques structurées législativement dans les
années 40-50, les institutions du handicap avec la loi de 1975 sur l'intégration scolaire. (Tiré de l'intro.).
(Ouvrage à la cote SAN 5.5 LAN).
GIAMI (A.)
Du handicap comme objet dans l'étude des représentations du handicap, Sciences sociales et santé,
1994/03, vol. 12, n° 1, 31-60. réf. 4p.
Cet article est consacré à la question du statut de l'objet représenté dans l'étude des représentations du
handicap, et à une analyse de la notion de handicap considérée elle-même comme représentation d'un
ensemble de phénomènes. Peut-on traiter des représentations du handicap alors que le terme de handicap
apparaît comme la représentation "floue" d'un ensemble de phénomènes dont l'histoire nous montre
qu'ils ne relèvent pas exclusivement du champ de la santé ou de l'action sociale ? La notion de handicap,
telle qu'elle apparaît dans différents corpus, fonctionne comme une représentation marquée par les
tensions, des contradictions et un flou comparables à celui qui est repéré à propos de la construction du
stimulus dans les enquêtes d'attitudes et dans les recherches sur les représentations. (Résumé d'auteurs).
HAMONET (Claude)
Analyse critique de la notion de handicap, Gérontologie et société, 1993, n° 65, 58-66. réf. bibl.
Dans cet article, l'auteur définit la notion de handicap. Il décrit d'abord ce qu'a été la représentation du
handicap dans les différentes sociétés, puis l'histoire du terme "handicap" dans la langue française.
Enfin, il propose de relier Classification des handicaps et des maladies permettant ainsi un lien entre
biologique, médical et social.
HAMONET (C.) / MAGALHAES (T.)
DE JOUVENCEL (M.), collab. / GAGNON (L.), collab.
A propos du handicap : langage médical ou langage social ?, Journal de réadaptation médicale,
2001/09, vol. 21, n° 3, 100-109, ann. 21 réf.
Le corps médical et les travailleurs sociaux ont bien des difficultés à se comprendre. Ils parlent des
langages différents. Le handicap est un terrain de discussions en commun. La question qui est posée est
essentielle : faut-il utiliser des termes empruntés à la médecine ou bien au langage social pour parler du
handicap et des personnes handicapées ? Il existe, aujourd'hui, une très grande confusion qui ne sera
certainement pas améliorée par les propositions de l'OMS. Pour mieux comprendre, il faut remonter à la
genèse de la langue médicale. Elle est issue de la botanique avec François Boissier de Sauvages,
inventeur d'un dispositif d'étiquetage des maladies qui permet, grâce à des tableaux de symptômes et de
signes, d'arriver au diagnostic. Ce système est directement issu des classifications des botanistes. Pour
éviter ce discours confus et improductif, les auteurs proposent un nouveau système d'identification et de
mesure du handicap. Il est en quatre dimensions, la "subjectivité", étant une dimension essentielle
puisque c'est ce que pense la personne handicapée de son état. Une mesure quantifiée individuelle est
possible par l'utilisation de "l'handicapomètre" ou "grille SIMH" qui est l'application du dispositif
d'identification. (R.A.).

LUCAS (Rémy)
Pour une analyse du concept de handicap, Le Valentin Haüy [On-line], 2000/01-03, n° 57, 7 réf.
[15.06.2001] <URL : http://www.avh.asso.fr/> Association Valentin Haüy
Si les définitions ne manquent pas et paraissent claires pour cerner la notion de handicap, elles se
révèlent très souvent incomplètes dans la pratique. Nous aborderons dans cet article la classification
internationale des handicaps élaborée par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), l’approche
proposée par l’université de Créteil, la conception québécoise, avant d’évoquer les définitions ayant
inspiré le cadre juridique français. (R.A.).
MARZOUKI (Moncef)
Handicap : les limites du concept sont-elles encore négociables ?, Prévenir, 2000/07-12, n° 39, 23-
25.
Les limites posées au concept de handicap ne sont pas neutres. Elles portent les marques visibles du
conflit qui oppose les professionnels de santé au monde associatif, les militants de l'intégration sociale
aux partisans du tout organique. L'illettrisme et la pauvreté sont des handicaps, même s'ils ne sont pas
d'origine biologique. (Résumé de la rédaction).
MICHELET (André) / WOODILL (Gary)
STIKER (Henri-Jacques), préf.
Le handicap dit mental : le fait social, le diagnostic, le traitement, Paris : Delachaux et Niestlé, 1993,
302p. réf. 13p.
Synthèse des grands courants de pensée concernant le handicap mental. Chacune des parties aborde la
déficience mentale sous ses aspects essentiels : social, psychologique, curatif, précise les origines de
l'idée du handicap mental, examine son évolution et présente les hypothèses et les solutions les plus
actuelles.
Cote : SAN 5.5.2 MIC
MORVAN (Jean-Sébastien)
Handicap de l'enfant, enfant du handicap : perspectives psychodynamiques, in : L'enfance
handicapée en France, Paris : Hachette, 1999, 191-223, réf. 2p.
Essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de la situation de handicap chez les enfants
implique trois conditions minimales. En premier lieu, il apparaît nécessaire de repérer, ne serait-ce que
par les sommets, ce qu'ont été historiquement les représentations et les attitudes vis-à-vis du handicap.
En second lieu, il importe de convenir de ce que les mots peuvent signifier et recouvrir. Puis il est
essentiel de préciser le cadre à partir duquel cette démarche de compréhension pourrait être tentée. A
partir de là, une présentation et une analyse des mouvements et réactions qui sont mobilisés dans la
confrontation au handicap deviennent possibles. Il ne s'agit pas de dresser un tableau descriptif et
exhaustif de la situation de handicap mais d'essayer de l'intérieur, de comprendre les jeux et les enjeux
des confrontations auxquelles elle conduit tant au plan de la réalité que de l'imaginaire. (Extrait du
texte). (Ouvrage classé à la cote SAN 5.5 LAN).
ROSSIGNOL (Christian)
La classification internationale des altérations corporelles, invalidités et handicaps : approche
linguistique d'un débat terminologique, Prévenir, 2000/07-12, n° 39, 35-47. 19 réf.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%