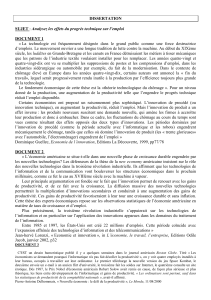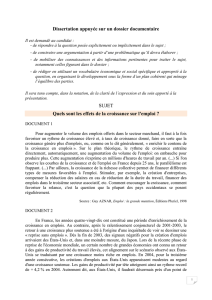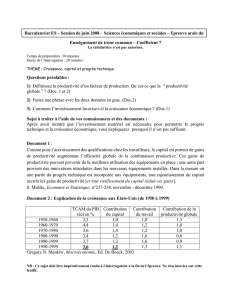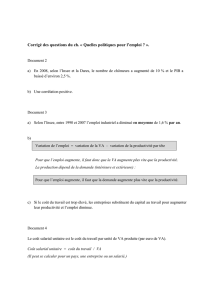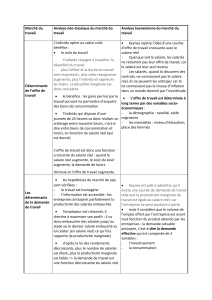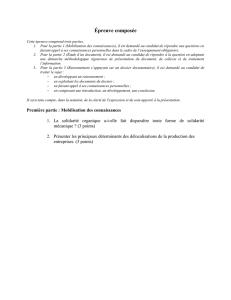Economie de l`Education 2007-2008.
publicité

ECOLE SUPERIEURE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION NOTRE DAME DE L’EGLISE (ESAG – NDE) UNITE DE FORMATION EN MASTER PROFESSIONNEL ADMINISTRATION DES AFFAIRE (UFMP-AF) ECONOMIE DE L’EDUCATION Par Pr.Moustapha Kassé www.mkasse.com Année universitaire 2011/2012 1 Introduction MASTER PROFESSIONNEL : La matière grise est la locomotive du progrès Joseph Ki-Zerbo Il est aujourd’hui admis qu’un système éducatif accessible au plus grand nombre est un moyen efficace pour assurer la croissance économique par la formation, la création de nouvelles qualifications. Un rapide survol de la pensée économique laisse apparaître un certain nombre de thèmes de réflexion que nous classerons en deux groupes. Le premier se détermine autour du thème majeur du capital humain : l’éducation est un capital, qu’il convient d’évaluer et auquel on peut associer des coûts, des gains et donc une rentabilité ; mais il est clair que l’unanimité n’est pas parfaite sur ce point et que d’autres approches complémentaires ou concurrentes sont envisageables. Le second groupe thématique est beaucoup plus disparate, chacun des thèmes n’ayant en fait été, dans la plupart des cas, qu’effleuré. On y recense : les divers effets de l’éducation sur la croissance, le progrès économique, les comportements individuels, etc. ; le rôle important de l’origine sociale des individus dans leurs comportements éducatifs ; l’intervention (souhaitée ou non) de l’Etat dans le domaine éducatif ; les problèmes posés par l’organisation et le fonctionnement du système éducatif. En fait, nous disposons là l’essentiel des thèmes de réflexion qui constituent le champ de l’analyse contemporaine de l’économie de l’éducation et qui, pour plus de clarté, peuvent s’articuler sur quatre axes principaux : la demande d’éducation, l’offre d’éducation, l’impact de l’éducation et la politique éducative. Au total, l’analyse économique confère aujourd’hui une importance très grande aux ressources humaines. Dans ce sens deux phénomènes peuvent être observés : d’abord la théorie du capital humain, ensuite l’apport de l’éducation au développement tels que révélés dans deux rapports l’un de l’OCDE et l’autre de la Banque mondiale. C’est pourquoi cet enseignement comprendra deux composantes : une composante théorique relative au lien entre éducation et développement ; une seconde composante composée du repérage de quelques évaluations pratiques relatives au lien entre la croissance et les ressources humaines, aux coûts et à la rentabilité de l’investissement en éducation. 2 Chapitre 1 : La notion de capital humain et son importance. Les notions du capital humain et de rendement de ce capital permettent d’interpréter le différentiel de revenus salariaux et la perte de cohérence entre la progression du revenu national et celle des facteurs conventionnels y contribuant. En assimilant l’éducation à un investissement, tout accès gratuit au savoir est exclu. L’éducation, en tant qu’in put, est donc limitée à ses expressions monétaires tandis que sa contribution à l’output est évaluée en termes de gains ou de pertes. Les dépenses expliquent en effet les différences individuelles et catégorielles de salaire réel et une partie de l’accroissement du revenu national. La théorie du capital humain s’appuie sur une série de faits. Les études les plus récentes distinguent les programmes de formation et sont plus soucieuses d’analyser la relation entre la formation et l’emploi. L’école doit certes se montrer réceptive au monde de travail, la tendance est alors à charger l’école de la préparation à un nombre toujours plus grand de personnes. Dans la présente revue de littérature, il sera question, après avoir souligné le fondement de la théorie du capital humain, de s’interroger sur la rentabilité de l’éducation et de l’enseignement supérieur en particulier, à travers une critique des choix méthodologiques, les différents facteurs déterminant le niveau de rentabilité. Nous évoquerons enfin quelques grandes tendances sur les travaux de rentabilité. SECTION1 : Définition de l’éducation dans une économique. perspective I/ Signification du concept global d’économie de l’éducation. L’éducation est comprise comme toute action de formation portant principalement sur les enfants et les adolescents et de manière croissante sur les adultes et qui a pour résultat l’ensemble des habiletés intellectuelles ou manuelles. Cela permet de distinguer deux types d’éducation : l’éducation formelle qui se réfère à toute activité délibérée de formation contribuant au développement des facultés intellectuelles et à l’acquisition de connaissance générale ou spécialisée, y compris celle conduisant à l’obtention d’une compétence ; l’éducation informelle qui regroupe des formations non formelles influençant les attitudes, les comportements, les modes de pensée et les connaissances. C’est par excellence, l’éducation diffusée par le milieu. II/ Signification et portée du concept de capital humain 3 Le concept de capital humain est fréquemment utilisé en économie depuis une trentaine d’années au moins (par exemple SCHULTZ, 1961, BECKER, 1964) ; certains le font remonter aux travaux d’ADAM SMITH au XVIIIe siècle. Le concept insiste fortement sur l’importance du facteur humain dans les économies fondées sur les connaissances et les compétences. Le capital humain peut se définir de nombreuses manières. En économie de l’éducation, on le définit comme « les connaissances, qualifications, compétences et autres qualités personnelles possédées par un individu intéressant l’activité économique ». Le capital humain constitue donc un bien matériel qui peut faire progresser et soutenir la productivité, l’innovation et l’employablité. Il peut croître, se réduire ou devenir inutile. Il subit différentes influences et provient de différentes origines, notamment, mais pas seulement d’un apprentissage organisé sous la forme de l’éducation et de la formation. Les quatre éléments (connaissances, qualifications, compétences et autres qualités personnelles) peuvent contribuer à ses missions sociales et démocratiques, et dans une certaine mesure culturelle et personnelle. Si le capital humain suppose que l’on mette l’accent sur la sphère économique, la distance peut être faible entre la politique et les pratiques visant à accroître ce capital et celles qui sont orientées vers d’autres fins. La mesure du capital humain ne concerne pas seulement le niveau éducatif. Les mesures du capital humain fondées sur le nombre d’années d’études effectuées et le niveau de scolarité ainsi que le différentiel de rémunération existant en faveur de ceux qui ont bénéficié davantage d’enseignement sont loin d’être suffisantes, si l’on adopte une définition large des qualifications et autres compétences des individus. L’investissement dans le capital humain procure donc des avantages aux individus, aux entreprises et aux sociétés. Ces avantages peuvent être de nature économique et prendre la forme d’un supplément de gains, de productivité ou de croissance économique. L’investissement en capital humain fournit également un vaste éventail d’avantages qui ne sont pas d’ordre économique, notamment accroissement de la cohésion sociale, une diminution de la délinquance et une amélioration de l’état sanitaire. SECTION 2 : Intérêt et rôle stratégique de la théorie du capital humain. L’une des grandes découvertes de l’analyse économique contemporaine est relative à la théorie du capital humain à partir des recherches de trois auteurs : Schultz en 1983, G. Becker, Romer en 1986 et en particulier Lucas en 1988. Toutes ces recherches évaluent l’impact de l’éducation et de la formation sur la croissance économique et le développement. L’investissement dans le capital humain est au cœur des stratégies mises en œuvre par de nombreux pays pour promouvoir la prospérité économique, l’emploi et la cohésion sociale. Les individus, les organisations et les nations sont de plus en plus conscients qu’un haut niveau de connaissances et de compétences est essentiel pour leur sécurité et leur réussite. L’accord sur ces principes a suscité sur le plan politique aussi bien que social de nouvelles attentes concernant la réalisation d’objectifs économiques 4 et sociaux ambitieux, grâce à un investissement accru dans le capital humain. Cependant les investissements ne seront productifs que s’ils sont bien adaptés à leurs objectifs. La nécessité de politiques cohérentes pour encourager les personnes de tous âges à se former tout au long de leur vie est reconnue bien au delà des ministères de l’éducation, jusqu’au niveau politique le plus élevé. Telle la mise en accord du conseil des ministres de l’OCDE (1997) sur « l’urgence de mettre en œuvre des stratégies efficaces de formation tout au long de la vie pour tous, de renforcer les capacités des individus à s’adapter et à acquérir des qualifications et des compétences nouvelles ». Pour améliorer la cohésion social, notamment en s’attaquant au chômage, les ministres du travail ont également souligné qu’il était important de se préoccuper des besoins de ceux qui en raison de l’insuffisance de leurs connaissances et de leurs qualifications ne peuvent pas participer pleinement à une économie fondée sur le savoir et qui ont des possibilités d’apprentissage à vie extrêmement limitées. Les enjeux sont très importants : « un chômage élevé et persistant, ainsi que de faibles rémunérations affectant une part importante de la population en âge de travailler constituent une menace pour le tissu social si ces problèmes ne sont pas résolus efficacement et à court terme ». C’est pourquoi dans des domaines très variés, de grands espoirs se fondent sur l’investissement dans le capital humain pour permettre d’atteindre les objectifs économiques et sociaux essentiels. Ils intéressent des pays, des entreprises et les individus qui luttent pour ne pas être exclus d’une compétition intense dans laquelle les connaissances et les compétences sont essentielles, mais ils concernent également des stratégies pour surmonter le chômage et promouvoir la cohésion sociale. Etant donné que le capital humain est associé à un ensemble complexe d’attentes et d’objectifs, il est important de considérer la diversité des éléments qui le caractérisent, ainsi que l’hétérogénéité des investissements et de leurs résultats potentiels. Il est maintenant acquis que le niveau de développement d’un pays est étroitement lié à son niveau d’instruction au point même d’en dépendre. L’éducation est un facteur d’efficacité qui élève la productivité des travailleurs et contribue de cette manière à augmenter la production. L’éducation est ainsi associée aux autres facteurs traditionnels (capital et travail) pour expliquer les performances et les contreperformances théoriques. Diverses études ont essayé de tester et de quantifier l’impact de l’éducation sur la croissance économique. Pour cela il y a deux (2) points : l’impact global de l’éducation sur la croissance. Par deux méthodes différentes d’évaluation, DENISON (1961) et SCHULTZ (1962) ont abouti à des résultats similaires. Ainsi DENISON calcule que 23% de la croissance des Etats-Unis entre 1930-1960 était imputable à l’accroissement de l’éducation. SCHULTZ par sa méthode du taux de rendement, est arrivé lui aussi à la même conclusion que l’éducation contribue pour une bonne part à la croissance américaine. les effets indirects de l’éducation sur la croissance économique. Les effets indirects de l’éducation sur la croissance économique s’articulent autour de deux points essentiels : d’une part ils se manifestent par des externalités positives que l’éducation engendre et d’autre part la liaison entre l’éducation 5 et les autres types de ressources humaines à savoir : la santé, la nutrition, la pauvreté, la fécondité etc. SECTION3 : Premier aperçu sur la théorie du capital humain Le concept de capital humain a été façonné par les travaux d’économistes fondateurs comme Shultz (1961) et Becker (1975). Le point de départ de ce courant de recherche consistait à s’interroger sur le rendement d’un investissement en éducation pour un individu donné (Guillard et Roussel, 2010). Le capital humain d’un individu se définit donc surtout par les connaissances et compétences que ce dernier maîtrise. Ces connaissances et compétences se sont accumulées tout au long de la scolarité, au cours des diverses formations suivies et à l’occasion des expériences vécues (Fuente et Ciccone, 2002). Le concept de capital humain soutien que les compétences des individus ont une valeur économique, quelles peuvent être appréhendées comme un capital à part entière et faire l’objet d’actions d’investissement dans l’optique d’en attendre un retour (en l’occurrence, une augmentation du capital initial). Le capital humain est composé des connaissances théoriques et pratiques acquise par le bais de la formation initiale et continue, mais aussi de l’expérience acquise et des investissements en santé qui contribuent au bien être des populations. I/ Capital humain et différentiel de salaire L’innovation apportée par cette théorie repose sur l’hypothèse selon laquelle les différences entre les salaires correspondent à celles des niveaux de productivité de ses salariés, découlant des différences de niveau de capital humain accumulé par le biais d’investissement. La théorie du capital humain tente alors d’expliquer les différences de salaires, mais aussi l’existence du chômage à travers cette perception du travail comme un facteur hétérogène. Ainsi, l’insuffisance de l’accumulation en capital humain serait à l’origine du chômage. Face à ce type de chômage dû manifestement à une inadéquation ponctuelle entre l’offre et la demande de qualification, la solution serait individuelle puisqu’il conviendrait à chaque individu de compléter sa formation ou ses qualifications pour être conforme à l’offre d’emploi. Les individus investissent en eux même par l’éducation et la formation ; la rentabilité de cet investissement réside l’inégalité des rémunérations. En ce sens, la théorie du capital humain est une analyse explicative de la dispersion des salaires. En effet, puisque le coût d’acquisition de la formation devra être compensé par la rémunération future escomptée, l’inégalité des rémunérations correspond aux différences de capital humain (Duthil, 2008). II/ Capital humain et croissance D’autres économistes ont privilégié l’impact au niveau macroéconomique de l’augmentation du stock de capital humain dans une économie donnée (Guillard et 6 Roussel, 2010). Le capital humain est ainsi perçu comme un facteur endogène de la croissance et du développement au même titre que les infrastructures de transport et de communication. Il est un déterminant de la productivité d’une économie (Romer, 1989; Foray, 2000). De ce fait, certains économistes soutiennent que le niveau du capital humain peut influer sur la croissance de l’économie. D’après Lucas (1988), la croissance du capital humain peut être envisagée de deux façons : Une croissance intentionnelle qui nécessite la mise en œuvre de facteurs de production de capital humain. Une croissance par apprentissage ou « accidentelle ». Dans chacune de ces deux situations, l’augmentation du capital humain influe sur l’emploi et le revenu. Lucas (1988) avait montré que les disparités internationales de niveaux et de taux de croissance du revenu national peuvent être expliquées par les différences de niveaux et d’évolution du capital humain par tête dans les différents pays. C’est ainsi que plus les individus vivent dans un milieu propice aux échanges d’informations et donc du capital humain, plus l’efficacité individuelle et collective se renforce et plus la croissance se renforce. Il en conclut qu’il ne pourra pas y avoir une tendance à l’égalisation des niveaux du capital humain entre les nations, ce qui explique la disparité les écarts de niveaux de revenu et de développement (Duthil, 2008). Aussi, contrairement au modèle néoclassique qui prédit la convergence des revenus par tête, le modèle de Lucas soutient un accroissement des disparités dans le temps du fait que l’accumulation du capital humain est plus rapide dans les pays développés. III/ Fragilité des fondements théoriques La théorie du capital humain comporte cependant certaines limites. Le concept entier repose sur l’hypothèse selon laquelle les différences entre les salaires correspondent à celles des niveaux de productivité de ses salariés. Ces écarts de productivité entre les salariés résultent des différences de niveau de capital humain qu’ils ont accumulé par le biais d’investissement (Guillard et Roussel, 2010). Ainsi, le capital humain est considéré comme un facteur de production qui permet de rendre compte de la productivité des salariés. Dès lors, la causalité suivante peut être mise en évidence : l’investissement en éducation permet de développer le stock de capital humain d’un salarié, qui entraîne une hausse de sa productivité. Cette dernière a pour conséquence une hausse des salaires. Ainsi, plus un individu accumule des qualifications, plus il devrait avoir une rémunération plus élevée. On mesure la fragilité du raisonnement néoclassique en termes de capital humain dès lors que l’on prend conscience des nombreuses « imperfections » caractérisant le fonctionnement du marché du travail (réglementation, coûts de transaction élevés, asymétrie d’information, etc.). En conséquence, étant donné les imperfections du marché du travail, il apparaît clairement que l’hypothèse selon laquelle les salariés sont rémunérés selon leur productivité marginale est difficilement soutenable. Par la suite, beaucoup d’économistes ont tenté de vérifier empiriquement la théorie du capital humain en testant le lien entre niveau de salaire et de formation. Les 7 résultats obtenus ont pu être décevants pour plusieurs raisons, qui sont liées notamment aux comportements discriminatoires venant des employeurs (les études de salaire révèlent des écarts entre homme et femme), mais aussi à la segmentation du marché. Cependant, la théorie du capital humain offre un cadre conceptuel solide aux recherches. En outre, les propositions issues de la théorie du capital humain au sujet des rémunérations sont confirmées, c’est-à-dire non falsifiées, par la grande majorité des travaux empiriques : le salaire croît avec le niveau de formation et le rendement de l’investissement en éducation est décroissant. Cependant, les indicateurs retenus pour mesurer le capital humain n’expliquent que 20 à 50% de la variance des salaires (Guillard et Roussel, 2010). SECTION4 : L’économie de l’éducation dans la littérature économique actuelle : brève revue de la littérature. Les Classiques ont été les premiers à s’intéresser à l’économie de l’éducation : Adam Smith, Malthus et J. S. Mill Marx, Marshal et Walsh Les contemporains ont été cités plus haut, notamment les théoriciens de la croissance endogène comme Romer et Lucas. Concernant les recherches sur l’économie de l’éducation en Afrique, elles sont assez limitées. Certains travaux émergent menés par Psacharopoulos (1973), Lévy Garboua et Mingat (1979), F. Orivel, Rossignol, Glasmann et Beauvialat, A. Diagne et Daffé. La Banque mondiale (1982) a aussi mené des études remarquables sur les investissements dans le domaine éducatif. Mais, c’est sur la Côte d’Ivoire que les recherches sont plus nombreuses et certainement plus vigoureuses. 8 Chapitre 2 : La demande individuelle d’éducation Le concept de demande en économie renvoi à un lien entre les quantités demandées de biens ou services et les goûts et préférences des individus ou du groupe sous une contrainte budgétaire dépendant des prix de ces biens et des revenus, pourvus par les consommateurs. Cette notion de demande trouve une place en économie de l’éducation. Le concept de demande en économie renvoie à un lien entre les quantités demandées de biens et les goûts et préférences des individus ou du groupe sous une contrainte budgétaire dépendant des prix des biens et des revenus, pourvus par les consommateurs. De même, cette notion de demande trouve sa place en éducation. En effet, l’éducation qui est un bien non seulement économique mais aussi publique est demandée en fonction des préférences et des revenus des demandeurs que sont l’Etat, les collectivités locales, les ménages et les individus. Il est intéressant de souligner que quelque soit le type de demandeur (Etat, collectivités locales, ménages, individus), l’individu reste la personne qui au bout du compte est le bénéficiaire directe de l’éducation, en ce qu’il est non seulement le détenteur du capital humain mais aussi le bénéficiaire des avantages sociaux. Cependant, les autres types de demandeurs ne sont que des bénéficiaires indirectes dans la mesure où eux ne profitent que des externalités (productivité des travailleurs) de la formation de l’individu, ce dans le meilleur des cas et dans le pire des cas ils peuvent être victimes d’une fuite de cerveaux. De façon plus singulière, nous allons étudier le cas de la demande d’éducation sénégalaise. Dans son ensemble, le système éducatif est composé des demandeurs se trouvant dans les enseignements préscolaire, élémentaire, moyen, secondaire et supérieur. A l’exception du cycle préscolaire, les autres cycles comptent en leur sein des formations générales et techniques avec une plus grande demande dans l’enseignement général. Par ailleurs, le cycle élémentaire est le plus dominant sur le plan des effectifs, pendant que les enseignements les moins représentatifs sont respectivement le préscolaire et le supérieur. A titre d’illustration, au cours des quatre premières années de la décennie « 1990 », au Sénégal par exemple, l’enseignement primaire représentait en moyenne 736 409 élèves contre 135 716 (moyen), 50 534 (secondaire), 21 652 (supérieur), 17 265 (préscolaire) soit respectivement 76,5 % ; 14,11 % ; 5,25 % ; 2,25 % et 1,75 %. SECTION 1 : Les déterminants de la demande individuelle. En ce qui concerne la demande d’éducation, il est essentiel d’éviter dès le départ toute confusion à ce sujet. Ce sont les individus (ou leur famille) qui sont fondamentalement les demandeurs, qui souhaitent acquérir un certain niveau de connaissances (une certaine formation, un certain diplôme, une certaine expérience). Les entreprises, et plus généralement les employeurs, demandent une main d’œuvre qualifiée, c’est à dire les services que cette main d’œuvre est susceptible de lui apporter 9 grâce à son éducation. Elle ne demande pas directement de l’éducation (sauf à la limite, en matière de formation continue). La demande des individus se manifeste aussi bien par les queues à l’entrée des universités que les demandes réitérées d’implantation de collèges ou de lycées ou « d’antennes » universitaires sur tout le territoire, que par la prolongation généralisée des études. Il conviendra alors de s’interroger sur les motivations et la logique de cette demande. Le cœur de l’analyse reposera sur la notion fondamentale de capital humain, ce qui ne nous interdira pas d’envisager des approches concurrentes ou complémentaires et d’élargir l’analyse. Face à cette demande, il est clair qu’il existe une offre qu’au moins dans une première approche, on peut assimiler au système éducatif au sens large. Ce système ne peut être purement et simplement assimilé à un système productif ordinaire. Son caractère non marchand et la nature même de ses activités, imposent une analyse spécifique qui permette en particulier d’en proposer une évaluation des performances et des principes de fonctionnement. Tel sera l’objet principal de la seconde partie, qui abordera aussi le problème de l’offre sous l’angle individuel, dans la mesure où il est parfaitement concevable de considérer l’individu comme le producteur de son capital intellectuel. Un des enseignements majeur de la théorie de la demande d’éducation est que cette dernière a un impact (direct ou indirect) sur les qualifications individuelles et donc sur le marché du travail. Dès lors, il convient de s’interroger sur la relation effective entre les formations et le système d’emploi. Mais ce n’est pas pour autant le seul impact que l’éducation exerce sur le plan économique. Un élargissement de l’analyse s’impose tant au niveau micro-économique qu’au niveau macro-économique. En définitive, les déterminants de la demande sont de trois ordres : le facteur démographique les déterminants économiques les taux de rendement privé de l’investissement en éducation. SECTION 2 : Evaluation de la rentabilité et du rendement de l’investissement éducatif. Si on considère l’investissement en éducation réalisé par un individu ou une collectivité, la décision devrait être fondée sur la notion de rentabilité ou de taux de rendement de l’investissement qui se base sur deux évaluations bien connues : la méthode du taux interne de rendement la méthode de la valeur actuelle. I/ La méthode du taux de rendement Il repose sur l’hypothèse que l’éducation est un investissement. N’est retenu comme avantage que le supplément de production ou de revenu qui est comparé aux coûts. Ce taux sert à plusieurs usages et est calculé selon divers points de vue privé, social et public. L’écart entre le taux de rendement social et privé vient de diverses interventions publiques. 10 a- Taux de rendement privé (RP) Le taux de rendement privé mesure la relation entre les coûts et les avantages de l’éducation pour un individu. Il ne tient compte que des coûts et des bénéfices pour l’étudiant. Il confronte dans notre cas la somme des différences de gains entre les 2 niveaux comparés sur l’ensemble de la vie active et la somme des manques à gagner, les frais d’inscription et les dépenses de fourniture liées à la formation. Le taux de rendement privé est l’un des facteurs qui déterminent la demande individuelle d’éducation. b- Taux de rendement social (RS) Le taux de rendement social mesure la relation entre tous les coûts sociaux qui doivent être supportés par la société dans son ensemble et les avantages qui doivent lui revenir. C’est le résultat de la comparaison de la valeur de l’ensemble des ressources engagées et du supplément de production. On peut y faire référence pour décider si la société doit modifier son effort en éducation ou modifier la répartition des ressources entre les différents niveaux d’enseignement, il est plus avantageux d’investir quand le taux de rendement social est élevé. Les taux de rendement sociaux comme privés sont tous deux des outils importants pour évaluer l’investissement. Le tableau suivant résume les principaux éléments à la base du calcul des taux de rendement privé social et public de l’éducation. Tableau : Coûts et bénéfices de l’éducation retenus dans le calcul du taux de rendement TAUX SOCIAL PRIVE PUBLIC AGENTS La collectivité L’étudiant Le gouvernement Coûts Coût direct Droit de scolarité Subvention (Cd) (Cs) (Co) aux établissements Coûts Coûts supplémentaires supplémentaires Manques à gagner Manques à gagner Impôt net d’impôt manque à gagner Moins aide à sur le Aide à l’étudiant l’étudiant Bénéfices Supplément gains (brut) de Supplément gains de Impôt sur supplément le de gains Sources. C. LEMELIN (1998) 11 II/ La méthode de la valeur actuelle On peut se référer au critère de valeur actuelle nette (VAN) ou au taux de rendement quand on analyse l’éducation. La valeur actuelle nette (VAN) est la différence entre la valeur escomptée des avantages futurs A(t) et le coût Ct de l’investissement. A(t) VAN = ------------------ - Ct (1 + i )j Si les coûts couvrent plusieurs périodes, il faut aussi calculer la valeur actuelle des coûts. Ce critère donne naissance à une règle d’investissement en éducation la règle de la valeur actuelle nette. Il faut donner suite à un projet d’investissement si la VAN est positive, c’est à dire si la valeur escomptée des avantages est supérieure au coût. Le deuxième critère est le taux de rendement interne qui est le taux d’escompte rendant égaux le coût et la valeur actuelle des bénéfices. On lui rattache une autre règle d’investissement, la règle du taux de rendement ; il vaut la peine d’investir quand le taux de rendement est supérieur au taux d’intérêt de référence. Cette règle permet aussi d’arrêter la liste des projets rentables. Quand on peut faire varier l’investissement et que le taux de rendement est décroissant à la marge, il faut l’augmenter jusqu’à ce que le taux de rendement marginal devienne égal au taux d’intérêt de référence. Les deux règles mènent habituellement à la même solution. L’avantage majeur justifiant l’utilisation du taux de rendement est qu’il n’est pas utile dans le cadre de l’analyse avantage coût de construire une hypothèse quelconque à propos du taux d’intérêt ou d’actualisation qui représente le coût d’opportunité du capital dans l’économie et qui doit donc être utilisé pour évaluer la rentabilité d’investissement. Les rapports coûts – avantages et la valeur actuelle nette ne peuvent être utilisés sans que soit sélectionné un taux d’actualisation au départ si bien que les valeurs des critères ne dépendent que du choix du taux d’actualisation. La comparaison du projet d’investissement est souvent plus éloquente lorsque l’on considère le taux de rendement. III/ Calcul du taux de rendement privé de l’éducation Les taux de rendement privés sont calculés à partir des coûts et rendement marginaux relevant directement de l’étudiant ou de la famille. C’est le taux d’actualisation qui égalise la valeur actuelle des gains nets et le coût de l’investissement. En résumé En prenant l’exemple initial c’est-à-dire la comparaison maîtrise-licence, on peut évaluer la valeur actuelle des flux de revenus correspondant à la licence soit : 12 T VL 1 t 1(1i) t Lt où i est le taux d’actualisation choisi arbitrairement pour le calcul. Puis on évaluera la valeur actuelle correspondante à la maîtrise, soit : T VM 1 t 1(1i) t Mt de laquelle il convient de soustraire les coûts directs (Do). Dès lors la valeur actuelle nette sera : VN=VM - D0 -VL Soit : T VN Mt L t t 1 (1i) t D0L0 Notons qu’en utilisant cette méthode, le coût d’opportunité (Lo) est introduite automatiquement ; en l’ajoutant aux coûts directs, Do, on retrouve évidemment le coût total Co. Si l’on envisage le calcul de la valeur actuelle nette d ’un diplôme se préparant sur N années, on obtiendra : VN R t N Ct t t t N 1(1i) t 1(1i) T IV/ Quelques résultats de travaux Plusieurs travaux et analyses effectués sur l’évaluation des coûts et les avantages de l’investissement en capital humain, permettent de mesurer le niveau d’incertitude dans les calculs de taux de rendement. Les différences de revenus observées aux divers âges constituent une première représentation des coûts et bénéfices de l’éducation. Elles sont grossières, particulièrement en ce qui a trait aux 13 coûts. Une preuve est que les étudiants ne renoncent pas à tout revenu de travail pendant leurs études : l’année scolaire ne dure que huit ou neuf mois et la plupart profite des vacances estivales pour travailler. Théoriquement, c’est la valeur du temps consacré aux études qu’il faut estimer ; les heures de temps libre ou de loisir ont aussi une valeur. Selon PARSONS (1974) les étudiants universitaires empiètent sur leurs heures de loisir et le coût du temps est sous-estimé si l’on ne considère que le revenu de travail. Cependant, LAZEAR (1977) estime que l’étude comprime le salaire des étudiants, à cause du manque de flexibilité de leur horaire, et qu’ainsi leur taux de rémunération est relativement bas. De la même manière, MILOT et ORIVEL (1980) feront du temps de loisir pendant les études un des avantages des études universitaires en France. Pour FREIDEN et LEIMER (1981), on surestime souvent le manque à gagner habituellement considéré comme coût, surtout si le profil de référence est calculé pour ceux qui travaillent à temps plein toute l’année, car tous les jeunes qui ont quitté l’école ne le font pas et beaucoup d’étudiants travaillent à temps partiel pendant leurs études. BERHMAN et BIRDSALL (1983n 1984, 1987), quant à eux constatent que trop souvent, les choix méthodologiques usuels biaisent à la hausse le taux de rendement, on ne tient pas compte entre autre, des abandons et redoublement, ni de la qualité de l’éducation. Les travaux menés par LACROIX, ROBILLARD, LEMELIN (1978) et LACROIX VAILLANCOURT (1980), ont montré qu’en plus de la scolarité et de l’expérience, la filière est un facteur important du revenu. La spécialisation dans certaines filières mène à des gains plus élevés que d’autres. Les disparités des gains par filière ont été l’objet de multiples interprétations. On pourrait les traduire en disparité de rentabilité. L’existence de barrière à l’entrée dans les filières explique en partie la différence de gains. Ces barrières visent souvent à assurer des avantages aux étudiants appartenant à cette filière, ce qui entraîne inévitablement des coûts. D’après ces auteurs, le manque à gagner, du fait des aptitudes des étudiants inscrits dans les filières menant à un plus grand succès professionnel, sont probablement plus élevés Le manque à gagner varie également selon les filières. Les programmes ont une durée et un degré de difficultés différents selon les filières. Ceux qui mènent à un grand succès professionnel sont souvent plus longs et plus exigeants. Le manque à gagner étant la principale composante du coût et les avantages étant donnés par la différence de gains, le changement dans le taux de rendement tient principalement à la modification des revenus relatifs. Le taux de rendement des études universitaires sera d’autant plus élevé que les écarts de revenus sont grands et que la demande des diplômes universitaires est forte et l’offre faible, relativement à la demande et l’offre des travailleurs moins scolarisés. L’analyse des disparités de revenus selon la scolarité est-elle d’une importance principale pour comprendre l’évolution de la rentabilité de l’éducation. Soulignons aussi que toutes les filières ne comportent pas les mêmes avantages pécuniaires. Certaines filières comme la science économique mènent à l’exercice d’une profession indépendante. Il faut alors tenir compte de la rémunération du capital possédé par le travailleur, des avantages annexes du risque, du nombre d’heures de travail, qui explique une part de disparité de revenu. Il est probable qu’il soit recherché 14 par les travailleurs plus scolarisés car ce sont des biens normaux, davantage demandés quand le revenu augmente. De plus, les avantages annexes n’étant pas toujours imposables et l’impôt sur le revenu étant plus progressif, il constitue une part plus grande de la compensation totale. Quelques travaux empiriques suggèrent que leur valeur augmente avec le niveau d’études (DUNCAN, 1976 ; LUCAS, 1977). Les aspects non pécuniaires importeraient aussi davantage aux travailleurs plus instruits dans leurs choix de carrières (MATHIAS, 1989). Ne pas les inclure mène donc à sous-estimer le taux de rendement de l’éducation, surtout le taux de rendement privé si les travailleurs sont prêts à renoncer à des gains pour les obtenir. Compte tenu de ces nombreuses différences, le taux de rendement faisait référence à un ordre d’enseignement est donc de portée limitée. Toutes les disparités de revenu ne pourraient pas se traduire directement en disparité de taux de rendement. Procéder à des études désagrégées, par filière, paraît plus appropriée, le calcul de divers coûts et avantages plus précis. En définitive, on ne devrait pas placer trop de confiance dans les estimations numériques des taux de rendement qui, dans certains cas, sont basées sur des données inadéquates ou peuvent ne pas prendre en compte le gaspillage, le chômage ou l’influence d’autres facteurs qui interviennent dans la détermination des bénéfices. Elle peut donc constituer un guide inadapté dans le cas où on envisage des changements majeurs dans le niveau ou la structure de l’investissement. Malgré ces critiques, du fait du degré élevé de l’imprécision numérique, l’analyse avantages – coûts représente un outil essentiel de l’évaluation et du choix des projets alternatifs. SECTION 3 : Efficacité d’un système éducatif L’éducation ou la formation est comparable à un processus de production où les élèves (étudiants) ayant terminé un cycle sont les produits finis ; les redoublants, les produits semi-fini c’est-à-dire ceux qui abandonnent ou sont exclus sont les ratés. Ce système de production particulier, par la nature de ses produits (capital humain) est comparable au système de production classique dans la mesure où l’objectif du producteur (Etat, collectivités locales et secteur privé) serait de : maximiser sa production sous contrainte des coûts de production ; minimiser ses coûts de production sous la contrainte d’un certain niveau de production. L’efficacité du système est évaluée par rapport : aux ressources consacrées à l’éducation ; aux sorties en nombre et en qualité de ses diplômés ou non diplômés ; et à leur insertion dans le monde du travail en vue d’un emploi salarié ou non salarié, suffisamment rémunéré pour supporter les coûts à la charge de l’Etat et des ménages. 15 I/ L’efficacité interne du système éducatif La qualité de l’éducation réside dans sa capacité de faire atteindre à ses destinataires les objectifs d’acquisition de connaissance qu’elle s’est donné dans différents curricula. Nous parlons dans ce cas d’efficacité interne. Il est souvent délicat de parler de qualité de façon objective dans le domaine de l’éducation. Le problème vient du fait que les mesures objectives du niveau des élèves sont fortement biaisées. Ces lacunes dans l’information nous amènent à utiliser deux types d’indicateurs plus faciles à mesurer : la propension à redoubler ou à abandonner d’une part, le nombre d’années-élèves ou d’années-étudiants d’autre part. Redoublements et abandons La production du système éducatif est affectée par trois sortes de déperditions ; ainsi nous pouvons distinguer : le redoublement qui est le fait de faire reprendre à un élève, la totalité des enseignements requis au cours d’une année, l’année d’après ; il y a abandon lorsqu’un élève quitte volontairement le système éducatif et n’y revient plus ; l’exclusion est un abandon particulier en ce sens que l’élève qui en est victime pour des motifs académiques ou disciplinaires, est invité à sortir du système éducatif. A chaque type de déperdition correspond à un ratio qui est en quelque sorte un indicateur d’efficacité. Nombre de diplômes pour un effectif initial de 1000 étudiants Cet indicateur, comme son nom l’indique est le nombre de diplômés à la fin d’un cycle dans une cohorte de 1000 étudiants au départ. Pour un effectif donné d’étudiants, inscrits en 1ère année d’un cycle, en moyenne 82 pour 1000 terminent le cycle avec succès (avec un diplôme) à l’UCAD. Ce faible ratio cache cependant des disparités bien que la caractéristique commune des facultés soit qu’aucune d’entre elles n’est capable de transformer la moitié du flux entrant en diplômés au terme d’un cycle. A l’UCAD par exemple, les meilleurs rendements sont obtenus dans les Facultés de Médecine, de Pharmacie et de Chirurgie dentaire avec respectivement 333, 258 et 434 pour mille. Dans les autres facultés, les rendements sont encore plus catastrophiques. Le fait que les responsabilités de l’éducation soient traditionnellement partagées entre plusieurs ministères (Education nationale, Enseignement technique et professionnel, Enseignement supérieur, Promotion humaine) n’a pas manqué d’entraver l’efficacité interne du système éducatif au Sénégal. Chaque ministère gérant sa part du budget de manière autonome, il était par conséquent très difficile d’éliminer le cloisonnement entre différents ministères qui rendait très difficile la mobilité du personnel enseignant. L’insuffisance de coordination entre les différents ministères, le contexte de très forte contrainte budgétaire pour des raisons d’ajustement structurel 16 et la croissance continue de la population scolarisable avaient rendu les réformes difficiles à mettre en œuvre. L’efficacité du système éducatif suppose aussi que tous les enfants de toutes les régions, de tous les milieux socio-économiques et des deux sexes aient les mêmes chances d’accès à tous les niveaux d’enseignement. Cette approche de l’efficacité interne paraît plutôt éthique mais la littérature de l’éducation souligne les inégalités d’accès à tous les niveaux d’enseignement comme un phénomène de gaspillage important des ressources humaines dans les pays en voie de développement. II / L’efficacité externe du système éducatif La seconde dimension de la qualité du système éducatif s’intéresse à la capacité de celui-ci d’adapter le niveau et le type de compétence de ses sortants aux besoins du marché du travail du moment : nous parlons alors d’efficacité externe qui, en d’autres termes, cherche à vérifier les attentes de la société des individus de leur système éducatif. Les données statistiques qui permettraient d’évaluer la qualité externe du système éducatif sénégalais sont plus lacunaires que celles qui existent pour apprécier la qualité interne. 17 Chapitre 3 : Analyse d’ensemble de la contribution de l’éducation à la croissance économique. Ce chapitre sera divisé en deux sections. Dans une première section, nous ferons une revue de la littérature traitant du lien entre éducation et croissance économique et dans une deuxième section, nous allons estimer la contribution de l’éducation à la croissance économique par la Méthode des M.C.O. SECTION 1 : Les fondements théoriques de la relation éducation-croissance économique La littérature sur la relation éducation-croissance est très fournie. La théorie du capital humain en est la théorie centrale. L’une de ses prédictions majeures est que l’éducation entraîne la croissance économique d’un pays. Cette prédiction acquiert le rang de postulat dès l’instant qu’elle a su résister aux attaques dont elle a été l’objet. Sur cette base, le problème qui se pose à la théorie économique est comment l’éducation contribue-t-elle à la croissance économique ? Cette théorie du capital humain postule que c’est par le biais de l’amélioration de la productivité des travailleurs que l’éducation contribue à la croissance économique. Cette contribution peut aussi se faire de manière indirecte par les externalités positives engendrées par l’éducation et par d’autres types de ressources humaines comme la santé, la pauvreté, la nutrition, la fécondité, etc. via l’éducation. I/ Les relations éducation-développement La prise en compte de l’éducation en tant que facteur important de la croissance dans les questions de développement, ne date pas d’aujourd’hui. L’histoire de la pensée économique montre que Adam SMITH fut l’un des premiers auteurs de son époque à s’interroger sur la valeur intrinsèque de l’homme. Adam SMITH (1779) dans « La richesse des nations… » écrivait sur la première page que la cause principale du bienêtre des individus réside dans l’intelligence, l’habileté et le discernement (ability, dexterity and judgment) avec lequel tout travail est effectué. Mais le débat fut véritablement lancé dans les années 1960 où les économistes ont commencé à s’interroger sur l’intérêt économique (pour la société) de l’éducation. Quelles peuvent être les implications économiques de l’éducation pour les individus qui la reçoivent et les nations qui le mettent en œuvre ? C’est à cette question que des efforts de réponse, sous la forme « d’une théorisation systématique » (Logossah, 1994), vont voir le jour et donner naissance à la théorie du capital humain. 18 II/ Le concept de capital humain et ses implications économiques L’on a constaté que certaines activités économiques ont un impact immédiat sur le bien-être de l’homme, alors que d’autres produisent des effets différés. En exemple, si assister à un concert public ou aller à la plage peuvent procurer des satisfactions immédiates à leurs bénéficiaires, aller à l’école ou apprendre un métier exercent quant à eux des effets plus retardés et différés sur le bien-être des individus qui le reçoivent. Car dans ce dernier cas, il faut du temps pour voir les fruits de ces activités généralement des mois, des années voire même des décennies. C’est sous cet angle que, investir des efforts, sous toutes ses formes, en faveur de l’éducation, a été considéré par Pierre Gravot (1993) comme un capital (au sens économique du terme) capable d’améliorer la productivité des travailleurs. Mais il faut dire que la notion du capital humain, dans sa conception développementaliste, a bien évolué. A l’origine, le capital humain n’était appréhendé que pour ces effets individuels, mais non collectifs (Saks, 994). Autrement dit, l’éducation ne profite qu’à l’individu qui la reçoit. Ce qui a conduit un certain nombre d’auteurs à soutenir que la société n’a pas intérêt à investir dans la formation des individus. L’homme investit en lui-même pour des motifs personnels de profit et non pour accroître la richesse de la nation ou l’entreprise (A. Marshall). Ce n’est que bien après que l’idée que l’éducation contribue effectivement à la croissance économique fut admise. Mais là n’est as le problème essentiel. Si l’éducation contribue réellement à la croissance économique, la question que l’on est en droit de se poser est de savoir quels sont les canaux par lesquels se joue cette contribution. L’impact de l’éducation sur la croissance économique et le développement n’est plus à démontrer. Plusieurs études théoriques et empiriques (que nous présenteront plus tard) consacrées à cette question inondent la littérature économique de ces dernières années. Ce que Bowman a qualifié de « révolution dans la pensée économique de l’investissement dans l’homme ». Selon la théorie traditionnelle du capital humain, c’est par le biais de l’amélioration de la productivité des travailleurs que l’éducation contribue à la croissance économique. Cette relation selon Beker (1964), résulte de ce que la formation, qu’elle soit générale ou spécifique à une tâche, affecte positivement la productivité des individus en améliorant leurs compétences et connaissance générales, en leur procurant des qualifications directement ou potentiellement applicables au processus de production. En améliorant la qualification et la dextérité des travailleurs, l’éducation crée un ensemble de facteurs au processus de production. Elle permet notamment à l’économie, selon Gravot (1993), de disposer de main d’œuvre qualifiée surtout dans le domaine scientifique et technique. L’Etat, par ses investissements éducatifs doit pouvoir en tirer les avantages à moins au moyen terme du fait de la capacité productive des citoyens qui s’en trouve ainsi renforcée. Il augmente de cette manière toutes ses possibilités de retrouver le chemin d’une croissance soutenue, condition nécessaire au développement. Les expériences dans ce domaine ne manquent pas. L’histoire de la pensée économique a montré que ce sont les 19 pays qui ont le plus investi dans le capital humain qui ont connu le degré de développement économique le plus élevé. Lorsqu’on regarde les faits et les chiffres, on constate que le Japon, la Corée, la Suisse… doivent leur extraordinaire développement à la qualité de leurs ressources humaines. Les nouveaux pays industrialisés ont investi au moins 10 % de leur PNB dans la recherche et développement. Les études consacrées aux « tigres » de l’Asie du Sud-Est sont unanimes pour reconnaître que ce sont les énormes investissements consentis dans le domaine de l’éducation, à la fin des années 1950 et au cours des années 1960, qui sont à la base de la croissance rapide enregistrée par ces pays ces dernières années. Il ressort de ces quelques observations empiriques, que l’éducation est un facteur moteur et déterminant de la croissance économique et qu’à ce titre, son implication dans les politiques de développement ne doit souffrir d’aucune légèreté. Selon Augustine Oyowe (Le courrier septembre, octobre 1996) « tout ce dont un pays a besoin pour réussir sur la plan économique est une main d’œuvre relativement qualifiée et une certaine quantité de capital physique ou de ressources naturelles. Or, l’Afrique subsaharienne dispose de ressources naturelles suffisantes. C’est l’autre élément de l’équation, à savoir une main d’œuvre relativement formée qui lui fait cruellement défaut ». On voit que l’éducation est un facteur d’efficacité qui élève la productivité des travailleurs et contribue de cette manière à augmenter la production. L’éducation est ainsi associée aux autres facteurs traditionnels (capital et travail) pour expliquer les performances et les contres performances. Pour attester de la validité de tous ces développements théoriques, diverses études ont essayé de tester et de quantifier l’impact de l’éducation sur la croissance économique. III/ L’impact global de l’éducation sur la croissance économique : Analyses empiriques Les premières tentatives de vérifications empiriques de l’effet de l’éducation sur la croissance économique datent des années 1960 avec les travaux pionniers de Sehultz (1961) et Denison (1962). Ces études ont suscité un regain d’intérêt de la théorie de la croissance, alors qu’on croyait déjà achevées ces recherches avec les travaux de Solow. E, effet, selon la théorie traditionnelle de la croissance à la Slow, la croissance économique est le résultat de la combinaison des facteurs capital et travail. Or les tentatives de désagréger la croissance de la production en parts imputables au capital et au travail, ont laissé apparaître l’existence d’un résidu inexpliqué (Psacharopoulos et Woodhall, 1988). C’est en recherchant ce que cachait ce résidu que les chercheurs ont pu se rendre compte qu’il est imputable aux effets bénéfiques de l’éducation. Par deux méthodes d’évaluation différentes mais équivalentes, Denison (1961) et Schultz (1962) ont abouti à des résultats bien similaires. Denison calcule que 23 % de la croissance des Etats-Unis entre 1930 et 1960, était imputable à l’accroissement de l’éducation de la force du travail. Schultz (1963), par sa méthode du taux de rendement, est arrivé lui aussi à la même conclusion que l’éducation contribue pour une bonne part à la croissance américaine. 20 A la suite de ces deux auteurs, d’autres études vont être menées et appliquées à d’autres pays pour des périodes différentes. Les résultats, même s’ils sont assez disparates, attestent cependant de l’effet réel de l’éducation sur l’activité économique. Une liaison que l’on qualifie de significativement positive. Tableau 1.3 : Estimation de la contribution de l’éducation à la croissance économique des pays développés. Pays développés Etats-Unis Canada R.F.A Grande-Bretagne Belgique Japon France Parts de l’éducation en % 23 25 2 12 14 3,3 10 Auteurs Denison ----Psacharopoulos Carré et al. Source : A partir de Logossah, in économie et prévision, n° 116-1994-5 Tableau: Estimation de la contribution de l’éducation à la croissance économique des pays sousdéveloppés Pays en développement Argentine Mexique Brésil Ghana Nigeria Parts de l’éducation en % 16 0,8 3,3 23,2 16 Auteurs Nadiri (1972) --Psacharopoulos Carré et al. (1988) --- Source : A partir de Logossah, in économie et prévision, n° 116-1994-5 L’observation qu’il convient de faire l’examen de ces tableaux, c’est qu’il y a des différences relativement notables dans les taux de croissance entre les pays développés (P.D) et les pays sous développés (P.V.D). Ces différences ne détruisent en rien les prédictions de la théorie du capital humain. Elles traduisent plutôt une réalité : la faible couverture scolaire et la baisse du rendement interne et externe de l’éducation. Si les Etats-Unis tirent 23 % de leur croissance de l’éducation, cela est la conséquence des investissements réalisés dans ce domaine. Le niveau de développement d’un pays est étroitement lié à son niveau d’instruction au point même d’en dépendre. Plus le niveau d’éducation d’un peuple est élevé, plus il y a de chance que ce pays soit développé. La question que l’on peut se poser est de savoir quel est le niveau d’études à partir duquel on peut raisonnablement parler d’un impact de l’éducation sur la croissance ? Il n’est pas évident de répondre à une telle question, car la réponse varie d’un secteur d’activité à un autre. Toutefois, des études empiriques ont montré que quatre années d’enseignement élémentaire font progresser la productivité d’un agriculteur dans les P.V.D de 8,7 % en moyenne. 21 Horowitz et Sherman (1980) en étudiant les performance des techniciens des chantiers navales aux Etats-Unis, ont pu montrer que les équipes de travail ayant un niveau d’éducation moyen plus élevé améliorant plus leur productivité que celles dont le niveau de formation moyen est moindre. IV/ Les effets indirects de l’éducation sur la croissance économique Les effets indirects de l’éducation sur la croissance économique s’articulent autour de deux points essentiels, d’une part ils se manifestent par les externalités positives que l’éducation engendre et d’autre part la liaison entre l’éducation et les autres types de ressources humaines à savoir : la santé, la nutrition, la pauvreté, la fécondité, etc. Externalités positives engendrées par l’éducation L’éducation d’un individu peut exercer une influence sur le comportement d’autres individus ou plus généralement sur l’environnement (au sens large de l’individu). En d’autres termes, l’éducation est génératrice d’externalités dont la personne éduquée est l’émettrice et les autres individus les bénéficiaires. Par exemple, l’éducation est génératrice de revenus ou avantages indirects chaque fois que l’éducation d’un individu donné améliore en termes économiques la situation d’un ou de plusieurs autres individus ou le produit économique de la collectivité dans son ensemble. Externalités et environnement immédiat L’éducation du père ou de la mère, leur emploi ou leur lieu de résidence rejaillit sur la cellule familiale et particulièrement sur les enfants, leurs études et plus généralement leurs activités et leurs compétences. Autrement dit, il n’est pas nécessaire que les parents s’impliquent concrètement dans l’éducation de leurs enfants, leur seule présence et comportements suffisent à engendrer cet effet bénéfique. La seconde sphère est le milieu de travail. Il est vraisemblable que le niveau d’éducation d’un individu rejaillit sur ses collègues qui profitent gratuitement » de son savoir-faire, des ses conseils, de son sens de l’organisation. Ils peuvent en retirer une meilleure efficacité, éventuellement des revenus plus élevés. Externalités et environnement collectif Les effets à ce niveau sont évidemment plus diffus et résultent d’une somme de comportements individuels. C’est plutôt l’effet du niveau d’éducation moyen de la population qui est en jeu. Dans cette perspective, et en reprenant la même démarche, nous pouvons repérer trois sphères d’influence : - Il est en général admis qu’un niveau d’éducation élevé favorise la démocratie et le développement des procédures de choix liées à ce régime ; on peut aussi supposer que la stabilité politique et institutionnelle en sera favorisée. 22 - A un niveau très général, on estime que l’éducation est un facteur de cohésion sociale, augmentant la solidarité. Il en résulte un développement des institutions sociales : sécurité sociale, système d’allocation chômage, système judiciaire et bien entendu, système éducatif lui-même. Tous ces éléments qui viennent d’être énumérés sont susceptibles de favoriser la croissance économique dans tout pays dans lequel ils se trouvent. L’éducation favorise globalement le fonctionnement des marchés. Sur le marché des biens, le consommateur « éduqué » aura un comportement de recherche d’informations plus efficaces. Pour le marché des capitaux, outre ce comportement de recherche permanente d’informations efficaces, l’agent économique scolarisé est mieux à même d’atténuer les risques de défaillance des emprunteurs. Le niveau d’éducation a une influence sur la mobilité, l’adaptabilité et l’information des offreurs de travail. Parmi les externalités positives que peuvent engendrer l’éducation, il y a la prédisposition au progrès technique de la part des individus qui en sont bénéficiaires, mais aussi une diffusion des innovations et de ce progrès technique à travers les générations. Cette capacité dans la diffusion des innovations est de nos jours un élément déterminant dans la compétitivité qui est devenue sans frontière avec la mondialisation. V/ Relation entre éducation et autres types de ressources humaines L’éducation peut engendrer la croissance économique par l’intermédiaire d’autres ressources humaines comme la santé, la nutrition, la fécondité, etc. L’analyse des relations entre l’instruction de la mère d’une part, la fécondité, la morbidité et l’état nutritionnel des enfants montre la contribution indirecte de l’éducation à la croissance économique d’un pays (EDS, 1986) L’éducation peut influencer la croissance par l’intermédiaire d’une réduction de la fécondité. L’enquête démographique et sociale de 1986 fait ressortir que le nombre d’enfants désiré par les femmes sénégalaises qui sont allées à l’école primaire est en moyenne de 5,6 et de 4,5 pour celles qui ne sont jamais allées à l’école. Cela se traduit dans les naissances effectives, puisque l’indice synthétique de fécondité des femmes ayant reçu une éducation secondaire était de 3,8 contre 6,6 pour l’ensemble des femmes. Le lien entre réduction de la fécondité et la croissance est certes moins évident : si l’on constate une forte corrélation entre ces deux variables, la causalité est loin d’être établie. Néanmoins, dans un pays comme le Sénégal qui souffre d’une importante détérioration de son environnement naturel, liée en partie à la forte pression sur les terres cultivables, et qui connaît des taux chômage élevés, en particulier dans les villes, un ralentissement de la croissance démographique peut être un des moyens de sortir du piège de la pauvreté. Des parents instruits ont tendance à privilégier la qualité de leurs enfants à leur nombre. Ce comportement a pour conséquence une stabilisation du taux de croissance naturelle de la population, une jeunesse plus apte à recevoir une instruction et à long terme des citoyens bien dotés en capital humain. C’est en effet ce qui faisait dire à la Banque mondiale (1980) « Donner de l’instruction aux filles, même si celles-ci ne doivent jamais entrer sur le marché du travail, pourrait bien être l’un des meilleurs 23 investissements qui soient dans la croissance économique d’un pays et de son bien-être social. En réalité, ces éléments (éducation, nutrition, fécondité …) forment une trame ininterrompue dont les relations démultiplient les effets positifs de l’éducation sur la croissance économique. La maladie peut avoir beaucoup d’effets sur la production ou la croissance économique. - soit elle affaiblit la productivité marginale du travail en affectant les capacités physiques et intellectuelles ; - soit elle accroît les ressources publiques affectées aux politiques de ressources humaines (c’est le cas actuel du Sida). L’éducation facilite la prévention ou la lutte contre certaines maladies. Les travailleurs instruits sont peu exposés au risque de maladie, par conséquent, ils sont plus disponibles au travail. Comme on le voit, des preuves empiriques de la relation positive entre niveau d’alphabétisation et niveau de développement sont de plus en plus nombreuses. Il apparaît ainsi très clairement, selon le point de vue d’Andréa Giovanni, qu’investir en ressources humaines et particulièrement dans le capital humain, relève « d’une saine politique de développement ». Les analyses ci-dessus sont l’objet de nombreuses critiques. Certaines de ces critiques se sont déployées dans le sens de les améliorer, tandis que d’autres tendent à les détruire. SECTION 2 : L’apport des théories de la croissance endogène On peut considérer les dépenses d’éducation, de santé et de formation comme des facteurs de croissance en ce qu’elles accélèrent l’accumulation de capital humain. Les théories de la croissance endogène mettent ainsi en exergue le rôle économique de l’Etat. Celui-ci est en effet l’agent le plus habilité pour réaliser ce type de dépenses qui jouent un rôle important dans le processus de croissance endogène. L’intérêt primaire de l’investissement public en capital humain est qu’il permet d’accroître la productivité sociale. Si l’on admet en effet qu’une meilleure formation, théorique ou pratique, augmente l’efficience productive de l’individu, les effets externes du type « learning-by-doing » qui découlent de son activité permettent alors d’accroître la productivité des agents qui le côtoient. Ainsi l’échelle globale, plus le stock de capital humain disponible est élevé, plus la production par tête est importante. Des tests empiriques menés par LOCKEED et alii (1980) à partir de données relatives à des données relatives à des pays en développement ont montré que quatre années d’enseignement élémentaire permettent d’accroître la productivité d’un agriculteur de 8,7 % en moyenne. En outre puisque l’éducation est un moyen privilégié d’accumulation du capital humain, les dépenses publiques effectuées, en sa faveur apportent alors une contribution essentielle au processus de croissance endogène. D’ailleurs, l’importance accordée à l’éducation est telle que des modèles ont été élaborés qui font exclusivement 24 de cette activité une source de croissance auto-entretenue. Dans ce type de modèle, la constance des rendements d’échelle est assurée par l’effet direct du niveau d’éducation sur la productivité des travailleurs. La croissance des rendements au niveau macroscopique découle des externalités qu’engendre le niveau d’éducation. Par ailleurs des travaux économiques soulignent le rôle essentiel que jouent les dépenses d’éducation sur le processus de croissance. DENILSON (1962) estime que la croissance économique des Etats-Unis entre 1930 et 1960 est due pour 23 % à l’accroissement du niveau d’éducation de la force de travail. Les travaux de NADIRI (1972) chiffrent cette contribution de l’éducation à 0,8 % pour le Mexique et 3,3 % pour le Brésil. BARRO (1991) montre que pour un niveau donné de Produit Intérieur Brut par tête en 1960, les pays à fort taux de scolarisation ont enregistré un taux de croissance plus élevé que celui des pays à faible taux de scolarisation. Ainsi on comprend difficilement qu’au moment où l’importance des dépenses publiques d’éducation de formation dans le processus de croissance est fortement soulignée par les nouvelles théories de la croissance, que des pays en développement sous ajustement structurel s’évertuent à restreindre la progression de ces types de dépenses. Certes à court terme, une telle politique est prompte à rétablir l’équilibre des finances publiques de ces pays. Mais la croissance économique qui s’amorce péniblement depuis peu dans certains de ces pays risque de n’être point durable. Dans une perspective de croissance endogène, cet essoufflement de la croissance devrait résulter de la décroissance des rendements marginaux du capital humain. SECTION 3 : La remise en cause de la relation-croissance économique. Les critiques relatives à la relation éducation-croissance portent d’une part sur les études empiriques et d’autre part sur la théorie du capital humain. I/ Critiques relatives aux études empiriques Les estimations de ces différents auteurs reposent sur des hypothèses théoriques nombreuses et variées qui ont été contestées. En particulier, on fait l’hypothèse que les gains des différents groupes de travailleurs sont une mesure de leur contribution à la production, que les gains les plus élevés des travailleurs éduqués sont le reflet de leur productivité accrue, et donc de leur contribution à la croissance économique ; et que la relation entre les inputs et l’output est assez simple, et peut être analysée à partir d’une fonction de production agrégée. La Banque mondiale et Kicks (1980) ont fait une étude utilisant les techniques économétriques pour relier les inputs à l’output de l’éducation. Cette étude a de nouveau montré le lien entre l’éducation et la croissance de la production certes, mais elle ne prouve pas que l’inverse est vrai ; c’est à dire que les pays qui ont des niveaux élevés de développement de leurs ressources humaines connaîtront de ce fait une croissance économique plus rapide. C’est ce qui faisait dire à John Vaizey « l’éducation n’est pas le « sésame ouvre-toi de la croissance » ; car s’il l’était les Indes et l’Egypte seraient 25 beaucoup plus riches qu’elles ne le sont, surtout depuis que l’Egypte a bien plus de diplômés que l’Angleterre ». Le fait que les pays riches ont des taux d’alphabétisation plus élevés et dépensent plus en matière d’éducation que les pays pauvres peut signifier que l’éducation aide les pays à devenir riches, mais il peut signifier aussi que les pays riches peuvent se permettre de dépenser plus en matière d’éducation. II/ La remise en cause de la théorie du capital humain La relation éducation-productivité a été remise en cause de diverses manières : la théorie du filtre, la segmentation du marché du travail, l’inflation des diplômes et les imperfections du marché du travail. La théorie du filtre La théorie du filtre a été formellement élaborée par Kenneth Arrow, Taubman et Wales. Les hypothèses montrent que la relation positive entre salaire et éducation est exacte et observable dans presque toutes les sociétés mais l’explication ne vient pas de l’amélioration de la productivité que confère l’éducation. En réalité, dit cette hypothèse, l’origine de cette relation positive est l’incapacité de l’employeur à déterminer les capacités productives naturelles de l’individu, ce qui l’amène à considérer l’éducation comme un filtre efficace pour sélectionner les travailleurs. Devant l’indisponibilité de l’information relative aux caractéristiques productives du demandeur d’emploi (offreur de travail), l’employeur réserve en priorité les emplois les mieux rémunérés aux travailleurs les plus éduqués, parce que les considérant comme étant plus productifs. C’est donc la capacité naturelle génétique du travailleur qui lui permet d’acquérir un niveau de productivité plus élevé. L’éducation permet tout simplement de renforcer les caractéristiques nécessaires au milieu du travail que sont la discipline, la rigueur, l’obéissance, etc. L’hypothèse de la segmentation du marché du travail Selon l’hypothèse de la segmentation du marché du travail, le salaire est déterminé par le type de marché de travail. L’éducation ne permet que de choisir les segments d’emploi les plus rémunérateurs. Dans un segment du marché du travail moins rémunérateur, l’on a du mal à en sortir quel que soit la productivité que le travailleur démontrera. Les réponses à cette objection viennent du fait que l’on remarque dans les sociétés avancées, une mobilité dans l’emploi surtout dans le même secteur d’activité. Cette mobilité proviendra essentiellement de la productivité que l’on aura démontrée. La deuxième observation, c’est que, l’on constate que dans le secteur essentiellement privé, les individus auront tendance à recevoir un salaire lié à leur productivité. Sinon l’information sur le marché du travail leur permettra de démissionner et d’acquérir un autre emploi. 26 Par contre, si l’employeur a tendance à payer au-dessus de cette productivité marginale, il fera faillite à moyen ou long terme. Donc la productivité n’est pas forcément liée à la segmentation du marché. La baisse de la profitabilité dans le temps et le phénomène de chômage des diplômés. L’éducation est un bien qui est recherché en soit sur la marché du travail et n’est pas liée forcément à la productivité. L’existence de diplômés chômeurs tendrait à remettre en cause l’amélioration de la productivité liée à l’éducation, laquelle devrait permettre à l’individu d’avoir un revenu salarial, du moins de s’auto-employer. La réponse à cette objection est qu’il peut exister des chômeurs volontaires qui ne sont pas prêts à accepter le taux de salaire prévu sur le marché du travail. Ces imperfections peuvent aussi être dues aux réglementations provenant des syndicats ou de l’Etat. Ainsi l’existence d’un minimum salarial a tendance à bloquer l’emploi dans certains secteurs. L’inflexibilité du salaire à la baisse empêche également le recrutement des diplômés. La contribution de l’éducation à la croissance est encore plus forte si on prend en compte les complémentarités entre l’éducation et d’autres formes de ressources humaines. Les ressources humaines, comme la littérature économique nous le fait constater, constituent une source importante de croissance économique et de développement des nations. Ceci est rappelé par les nouvelles théories de la « croissance endogène » rappelant ainsi les premiers travaux de Odd AUKRUST dans les années 30 et 40. L’analyse économique moderne, surtout depuis les PAS a permis de faire comprendre que les ressources humaines, l’éducation en particulier jouent un rôle important dans la réduction de la pauvreté mais surtout dans la résolution des problèmes d’équité dans toute société. En effet, l’efficacité économique qui recommande un investissement dans les secteurs dits traditionnellement productifs est désormais corrigée par le souci d’équité qui porte sur la résolution des problèmes sociaux que la seule efficacité ne réussit pas à résoudre. Sans nul doute, des efforts sont faits en faveur de l’éducation par le Sénégal (chapitre précédent) ; il reste à se demander ce qu’il gagne en contre-partie et de tenter de l’évaluer. 27 Chapitre 3 additif : Etude de cas : mesure de la contribution de l’éducation à la croissance économique du Sénégal. Dans ce chapitre, nous essayerons de mesurer la contribution de l’éducation à la croissance économique du Sénégal à partir des déterminants traditionnels de la croissance (le stock de capital et le stock de main d’œuvre) élargis aux variables éducatives (les effectifs scolaires). A cet effet, par l’approche de Solow, nous procéderons successivement à deux tests empiriques classiques de la contribution de l’éducation à la croissance économique. Le premier va agréger les effectifs de l’élémentaire, du secondaire et du supérieur pour en faire une seule variable explicative (variable éducative). Dans le second, nous considérons l’effectif de chaque niveau d’enseignement comme une variable explicative à part entière. Les résultats obtenus nous permettront éventuellement de dégager les enseignements à tirer de la relation entre la croissance économique et l’éducation au Sénégal. Dans cette seconde section, nous présenterons le cadre d’analyse de l’étude et les résultats empiriques, puis nous allons procéder aux commentaires des résultats obtenus. SECTION 1 : Cadre d’analyse et résultats empiriques I/ Cadre analytique Pour mesurer la contribution de l’éducation à la croissance économique du Sénégal, deux méthodes sont possibles : - la méthode coût-bénéfice : elle se fonde sur la théorie du capital humain, elle prend en compte à la fois les coûts et les avantages de l’éducation. - la méthode des ressources humaines : elle considère exclusivement les avantages de l’éducation. Dans cette étude, nous privilégierons la seconde méthode, car elle apparaît plus facile que l’autre compte tenu des informations dont nous pourrons disposer pour traiter un tel sujet. Ainsi, nous avons retenu la période 1972-1995, période pour laquelle nous disposons de données pour toutes les variables explicatives du PIB réel et le PIB réel lui-même. Nous allons utiliser exactement la même démarche que celle que J. YAO YAO (1993) a utilisé dans le cadre d’une étude portant sur la détermination de la contribution de l’éducation à la croissance économique en Côte d’Ivoire ; pays ayant des traits 28 caractéristiques communs avec le nôtre (même zone linguistique et monétaire et même système éducatif). Cependant, il faut signaler que le modèle de YAO Yao J. n’est rien d’autre que celui de Denison dans lequel il a incorporé des variables éducatives en termes d’effectifs scolaires. Toutes les équations ont été estimées par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) à l’aide du logiciel TSP, version 6.52. Toutes les variables ont été introduites en termes réels. Les données utilisées dans cette étude proviennent de différentes sources. La principale source est le World tables de la Banque mondiale d’où nous avons pu collecter les informations statistiques concernant le PIB, le stock de main d’œuvre. L’information concernant le stock de capital nous provient du CREA tandis que celle concernant les effectifs scolaires nous provient de la Direction de la Statistique (Statistiques Scolaires et Situation Economique du Sénégal). Les hypothèses du modèle : H1 : Le stock de capital est un facteur qui influence positivement le produit national a1 > 0 et b1 > 0 H2 : Le stock de main d’œuvre influence positivement le produit national a2 > 0 et b2 > 0 H3: La variable scolaire influence positivement le produit national a3 > 0, b3 > 0, b4 > 0 et b 3 > 0 Nous partons d’une fonction de production de type Cobb-Douglas PIBR = f(CAP, MO, EFF) = ACAP 1 MO2 EFF3 LogPIBR = a0 + a1Log CAP + a2 LogMO + a3LogEFF Avec PIBR : PIB réel CAP : Stock de capital réel MO : Stock de main d’œuvre EFF : l’effectif scolaire total (tous les degrés d’éducation confondus) Ai : l’élasticité de l’output par rapport au facteur i Dans une deuxième situation, nous allons distinguer les différents degrés d’éducation : à savoir l’élémentaire, le secondaire et le supérieur LogPIBR=b0 + b1LogCAP + b2Log MO + b3 LOgEFFI + b4LogEFF2 + b5 LOgEFF3 Où EFF : Collectif dans l’enseignement primaire EFF2 : effectif dans l’enseignement secondaire EFF3 : effectif dans l’enseignement supérieur Bi : élasticité de l’output par rapport au facteur i II/ Résultats empiriques 29 Nous allons analyser les résultats empiriques faisant état de la contribution de l’éducation à la croissance. Tableau: Estimation de la fonction de production à partir de ses déterminants traditionnels (le capital et la main d’œuvre) et de l’effectif scolaire global (effectif primaire, secondaire et supérieur) Variables LogCAP LogMO LogEFF a0 Coefficients en % 1.412 -1.585 6.104 -8.172 T-Statistique 2.7178251 -0.4163987 3.6569657 -2.1872198 2-Tall SIG 0.013 0.682 0.002 0.041 R² = 0.965727 R² Ajusté = 0.960586 DW = 1.771010 F-statistique = 187.8482 Nous pouvons noter que les résultats du test sont globalement satisfaisants d’après la valeur du coefficient de détermination de la régression. Le coefficient de détermination est égal à 0.97. Cela signifie que le modèle retenu explique à 97% la relation entre le produit national d’une part et le stock de capital. Nous pouvons aussi ajouter que le test de Durbin Watson est satisfaisant ; ce qui suppose une indépendance des erreurs. Pris isolément, tous les coefficients sont significatifs sauf celui de la maind’œuvre. Le signe négatif du coefficient de la main – d’œuvre peut s’expliquer par les problèmes liés à la mesure de cette variable ou encore par le fait que les données statistiques ne représentent pas correctement cette variable. Nous pouvons conclure que l’éducation a une influence positive sur la croissance économique du Sénégal de manière significative, confirmant ainsi les théories du capital humain et de la croissance endogène. D’après ces résultats empiriques nous pouvons dire que l’éducation contribue à 60% à la formation du PIB réel au Sénégal sur la période 1972 – 1975. C’est à dire lorsque les effectifs scolaires augmentent d’une unité, toutes choses égales par ailleurs, le produit National augmente de 0.06 unité. Tableau: Estimation de la formation de production à partir de ses déterminants traditionnels et des effectifs du primaires, du secondaire et du supérieur Variables LogCAP LogMO LogEFF1 LogEFF2 LogEFF3 Bo Coefficients en % 1.190 7.673 -2.394 4.101 -1.771 -1.771 T-Statistique 1.743 0.776 -0.068 1.862 -0.98884 -1.456 2-Tall SIG 0.0097 0.447 0.946 0.076 0.482 0.163 R² = 0.97 30 R² - Ajusté = 0.96 DW = 1.935 F-statistique =116065 Cette deuxième régression montre encore que le modèle est également globalement significatif. En ce qui concerne les coefficients, seuls ceux qui sont relatifs au capital et aux effectifs à l’école secondaire sont significatifs. D’après ces résultats empiriques, nous pouvons conclure que seule l’éducation au niveau secondaire a une influence positive sur la croissance économique du Sénégal. SECTION 2 : Appréciation des résultats empiriques Dans cette dernière section nous essaierons d’identifier les obstacles qui semblent rendre peu importante la contribution de l’éducation de manière globale (tous les niveaux confondus) sur le PIB et ensuite, nous commenterons les effets de chaque niveau d’éducation sur le PIB. I/ Effets de l’éducation sur PIB A la lumière de ce modèle, l’élasticité du PIB part à la part consacrée à l’éducation (30% en moyenne) dans les dépenses publiques de l’Etat ou dans le PIB (5% en moyenne) dans les dépenses publiques de l’Etat ou dans le PIB (5% en moyenne) (section 1 du premier chapitre). Comment pouvons-nous expliquer cette faiblesse de l’influence de l’éducation (d’une manière globale) sur la croissance économique du Sénégal ? Au Sénégal, l’éducation n’a pas d’effets sur le développement du secteur agricole qui concentre pourtant à peu prés 70% de la population active. L’aversion des individus éduqués pour les activités agricoles peut être la cause majeure de l’absence d’effets de l’éducation sur la croissance économique pourrait aussi se justifier par l’inadéquation du profil des diplômés, en l’occurrence ceux de l’enseignement supérieur aux besoins de développement. II/ L’aversion agricoles des individus scolarisés pour les activités L’argument que nous pourrions utiliser est l’étude faite sur la Côte d’Ivoire par Gurgand (1993) et dont les conclusions restent valables pour tous les pays d’Afrique subsaharienne. Cette étude révèle que les individus éduqués ont une propension beaucoup plus élevée que les autres à ne pas s’engager dans l’agriculture. Les jeunes adultes éduqués visent des emplois dans le secteur formel, de préférence dans la fonction publique qui de nos jours réduit de plus en plus ses effectifs. Souvent, ils préfèrent être « chômeurs » plutôt d’embrasser l’agriculture ou s’ils se lancent dans des activités agricoles, ils agiront en tant qu’aide familial agricole, et par conséquent, n’auront pas beaucoup d’influence sur les choix de l’unité de production. 31 Une cause de la faible propension des individus scolarisés à s’engager dans l’agriculture réside dans les distorsions constatées sur le prix de certaines denrées alimentaires et sur les revenus. Ces distorsions se conjuguent pour réduire, toutes choses égales par ailleurs, les revenus des agriculteurs par rapport au revenu moyen et pour gonfler les revenus d’autres professions dont les salaires ne sont pas déterminés par la productivité de leurs titulaires (fonction publique). Dans l’après guerre, les syndicalistes, les hommes politiques et les intellectuels Sénégalais ont lutté pour l’égalité de traitement avec la métropole. En 1950, le Président Lamine GUEYE, alors député du Sénégal au parlement français, introduit une loi qui accorde aux fonctionnaires l’égalité des traitements et des conditions de travail (Jean-Claude BERTHELEMY et al 1997). Au lendemain de l’indépendance la détermination des salaires des fonctionnaires avait été influencée par le niveau des salaires observé alors dans l’ancienne métropole. Les nouvelles grilles introduites par les autorités chargées d’administrer le pays devenu indépendant s’inspirèrent naturellement de ce qui existait déjà. En réalité, ces nouvelles autorités émergeaient pour l’essentiel de cet embryon de fonction publique laissé par la puissance coloniale, et il leur était difficile de réduire de façon drastique les salaires en vigueur dont les premières bénéficiaient. Au Sénégal, le salaire moyen dans la fonction publique représentait plus de dix fois le revenu national par tête avant la dévaluation et plus de huit fois après la dévaluation (voir tableau ci-dessus). La conséquence immédiate de cette mesure est de rendre extrêmement attrayantes les carrières de la fonction publique, à tel point que les jeunes adultes éduqués se déterminent des activités agricoles. Tableau 4.3 : Evolution du salaire moyen dans la fonction publique sur revenu moyen par tête de 1993 à 1995. 1993 1994 1995 MSFP en milliards 132.3 148.8 157.5 RN/Tête(FCFA) 194036 251951 279768 EMFP 6599 66217 66004 SMFP/(RN/Tête) 10.17 8.91 8.53 Source : Nos calculs à partir de : -DPS -CREA BADJI Marie Suzane « La privation des entreprises au Sénégal et finances publiques « Mémoire de DEA, FASEG, UCAD, Juillet 1997. MSFP : Masse Salariale dans la Fonction Publique RN : Revenu National EMFP : Emploi dans ma Fonction Publique SMFP : Salaire Moyen dans la Fonction Publique. Du côté des prix, la faible productivité des activités agricoles a été favorisée par ce que l’on a appelé les urban biased policies. Il s’agissait de politiques qui favorisaient les urbains au détriment des ruraux. Ces politiques suivies ont favorisé 32 l’accès des urbains à des biens alimentaires importés peu coûteux en particulier le riz et le blé (du dumping mondial, programmes d’aide alimentaire). Au même moment, les produits locaux tels que l’arachide étaient achetés aux producteurs à un prix nettement inférieur à leurs cours mondiaux et quelques fois taxés sous prétexte de constituer des budgets publics en déficit. Ces politiques ont pour conséquence de modifier les goûts des consommateurs urbains des clients naturels des agriculteurs, en faveur de biens de consommation, le riz, et le pain, pour lesquels nos agriculteurs n’ont souvent d’avantages comparatifs. L’abandon de ces politiques est la seule condition de l’existence d’une relation « éducation-production agricole » en Afrique (Gurgand 1993). L’agriculture. Par conséquent, la révolution verte n’a pu voir le jour comme il l’a été en Asie, car les interlocuteurs (agriculteurs analphabètes) des rares agents de vulgarisation, même s’ils ne sont pas hostiles au modernisme, sont incapables de maîtriser parfaitement les nouvelles techniques agricoles. 33 CHAPITRE 4 : Economie de l’Education et relation avec la théorie de recherche d’emploi SECTION 1 : Les théories de l’emploi et l’Education Parmi les éléments expliquant le chômage, on retient l’imparfaite information des agents économiques. Les théories de la recherche d'emploi caractérisent les comportements de recherche. Elles restent également dans le cadre pur d’un fonctionnement de type néoclassique du marché du travail. Le chômage volontaire est alors la conséquence d'une information imparfaite sur le marché du travail. Les phénomènes liés à la mobilité professionnelle comme les transitions de l'emploi vers l'emploi, de l'emploi vers le chômage, du chômage vers l'emploi et la prospection d'emploi peuvent expliquer, au moins partiellement, l'existence de taux de chômage élevés et persistants (Balsan et al, 1995). Ainsi, la recherche d’un emploi correspond à un processus d’acquisition d’informations. D’une part, l’offreur de travail doit faire face à un arbitrage : la recherche d’un emploi à un taux de salaire qui le satisfait, et les coûts de recherche liés. Face à ces coûts, l’offreur doit rechercher, parmi les offres d’emploi et de salaire, le gain monétaire le plus élevé ou le plus satisfaisant pour lui (Duthil, 2008). D’autre part, le demandeur de travail s’expose aussi à des coûts liés à l’embauche, en cherchant à optimiser cette dernière. Ce processus d’acquisition d’information permet de définir, pour ce qui concerne le travailleur, le taux de salaire maximal qu’il peut espérer atteindre. Taux de salaire et temps de recherche. W Wo Temps Cette figure met en exergue la relation croissante entre le temps de recherche et le taux de salaire. Au début le travailleur accepte un salaire minimum dit salaire de 34 réservation. Avec le temps et au fur et à mesure de l’acquisition de l’information, le travailleur élève ses prétentions salariales. Si la théorie de la recherche d’emploi permet de permet d’aborder le problème de la durée du chômage, mais aussi celui de la dispersion de la durée de chômage entre différentes catégories d’offreur de travail, elle essuie également plusieurs critiques. La plus virulente réside dans la fragilité de l’hypothèse selon laquelle le travailleur augmente ses chances de trouver un meilleur emploi avec le temps. Or, de nombreuses études ont montré que l’allongement de la durée de chômage est un handicap pour la réinsertion des chômeurs. SECTION 2. Les politiques de l’emploi Les politiques de l’emploi visent à corriger les contradictions du marché du travail. Bien vrai que ce dernier peu être en situation de plein emploi, les politiques de l'emploi sont souvent assimilées aux politiques de lutte contre le chômage. 1. Les aspects théoriques Dans la théorie économique, on oppose notamment les politiques de l'emploi d'inspiration keynésienne et celles d'inspiration libérale, en partant fondamentalement du diagnostic de la situation du marché du travail. Pour les keynésiens, le chômage est dû à une insuffisance de la demande tandis que les capacités de production sont sous-employées, alors des politiques macroéconomiques pourront viser à soutenir la croissance (politiques actives de relance, par exemple). Ce sont des politiques de relance qui viseront essentiellement à soutenir la demande effective. En effet, dans le modèle keynésien, on a : Y + M = C + I + G + X, Où (C + I + G) représente la demande effective. Pour les keynésiens, l’insuffisance de cette demande effective serait à l’origine du ralentissement de l’économie et du sous emploi des capacités de production. Ce sont donc essentiellement des « politiques de la demande » qui pourront résorber efficacement le chômage. Le mécanisme keynésien peut se résumer ainsi : Croissance du pouvoir d’achat => Croissance de la demande => Croissance de l’emploi. Pour les classiques, le chômage est plutôt d'origine structurelle, (par exemple la structure des prix relatifs serait mauvaise pour la compétitivité des entreprises et les règles du jeu politique bloqueraient un peu cette situation). Il conviendrait alors de lutter contre ces rigidités par des politiques visant à alléger les contraintes autres que la concurrence qui pèsent sur l'entreprise (par exemple, en favorisant plus de flexibilité sur le marché du travail). Mais les politiques de l'emploi libérales peuvent inclure aussi les politiques visant à améliorer le capital humain comme autre source de compétitivité de l'appareil productif (politiques de meilleure formation). Ce sont donc essentiellement des « politiques de l'offre ». 35 2. Enjeux et évolution des politiques de l’emploi 2.1. Les politiques publiques pour l’emploi A la suite des chocs pétroliers et face à la mondialisation de plus en plus poussée, les mécanismes keynésiens ont commencé à s’enrayer, cédant aux ajustements classiques. En effet, en économie ouverte, la croissance n’est pas automatiquement facteur d’augmentation de l’emploi car les facteurs de production mobilisés pour répondre à la demande peuvent venir de l’extérieur. Les politiques publiques de lutte contre le chômage ont de multiples objectifs comme : La diminution ou la stabilisation du nombre de chômeurs ; L’augmentation du nombre de postes de travail offerts par les entreprises ou l’administration ; L’augmentation du niveau de formation des offreurs de travail en améliorant le niveau de formation ; La lutte contre l’exclusion. Autant dire que ces mesures restent toujours, de manière concrète, l’apanage des pays développés. La difficulté d’obtention de statistiques fiables dues à l’importance du secteur informel, mais aussi la multitude des problèmes liés au sous-développement ont fait que les politiques sociales pour l’emploi n’ont pas connu un déploiement à la hauteur des enjeux qu’elles impliquent dans les pays en développement et sont difficilement quantifiables. Le tableau suivant montre quelques de lutte contre le chômage. Mesures de lutte contre le chômage Mesures Objectifs Population L’abaissement du coût Favoriser l’embauche, Les jeunes salarial (subvention) notamment des jeunes, par une baisse du salaire direct ou des cotisations Les mesures Faciliter la rencontre Tous les permettant une meilleure entre l’offre et la demande de chômeurs organisation des marchés travail par multiplication des services public et privés à l’emploi La création d’emplois Donner une qualification Les jeunes temporaires publics ou professionnelle aux jeunes leur associatifs permettant de mieux s’insérer dans le marché du travail L’incitation à l’autoFaciliter l’installation Les chômeurs, emploi d’entreprises individuelles par les jeunes des mesures organisationnelles et des aides administratives dans leur gestion 36 L’indemnisation chômeurs des Fournir un revenu de remplacement pour un temps limité Les chômeurs Source : Duthil, 2008 Cependant, l’évaluation économique de ces mesures est très délicate, du fait qu’il est difficile de distinguer les effets directs sur le marché du travail des évolutions qui se seraient produites sans elles. De plus, certaines mesures qui ciblent une catégorie de la population (les jeunes) peuvent avoir des effets négatifs (comme la précipitation à la retraite de la population âgée ou la restriction de leur possibilité d’embauche). L’évaluation sociale des mesures de politique de l’emploi est encore plus ardue puisque ces dernières sont souvent mises en œuvre pour atténuer les tensions sociales qui pourraient naitre de la montée du chômage (Duthil, 2008). 2.1. La jeunesse africaine et les défis du chômage Le contexte du chômage en Afrique, de par sa spécificité, mérite une analyse différente du marché du travail. En effet la population africaine est caractérisée par sa grande jeunesse. Du coup, ces derniers sont les plus touchés par le chômage. Ainsi, aux déterminants traditionnels du chômage s’ajoutent des facteurs sociologiques qui deviennent indissociables à l’explication de la montée du chômage de masse qui frappe les villes africaines. La poussée démographique, mais aussi l’urbanisation rapide constituent autant de distorsions du marché du travail appelant à l’exploration de mesure, pas forcément différentes, mais mieux adaptées. La forte présence du secteur informel en constitue la manifestation la plus fragrante, qui est en quelque sorte une réponse du marché. Face à un déficit évident de l’offre d’emploi, le secteur informel est le refuge de différents acteurs, quelque soit le niveau de formation. La théorie du capital humain s’en sort fortement bouleversée, l’investissement en capital humain ne garantissant pas un retour sur investissement satisfaisant. Dans un environnement ou les jeunes risquent d’atteindre l’âge de la retraite sans jamais travailler, la recherche de solutions adéquates pour l’emploi des jeunes est plus que cruciale. Bien vrai que l’extrême jeunesse de la population constitue un atout, mais elle peu s’avérer être une bombe sociale si des mesures nécessaires ne sont pas prises. La plus importante serait de décentraliser les villes africaines qui croulent sous le poids de l’exode rural et d’inciter les jeunes à exploiter le potentiel rural par la création d’exploitation modernes dans les campagnes. Cette expérience est mise en œuvre au Sénégal à travers le Plan REVA (Retour vers l’agriculture), avec des résultats mitigés. Bien sur, les mesures de lutte contre le chômage citées plus haut ne sont pas à exclure. Cependant, il faudra privilégier les mesures de proximité, comme la création de structures dédiées à l’emploi de jeunes pour favoriser leur suivi dans le cadre de l’autoemploi. 37 Chapitre 5 : Les politiques éducatives en Afrique de la crise aux reformes SECTION1 : Le diagnostic des systèmes éducatifs. Le diagnostic des faibles performances du système éducatif apparaît à travers des problèmes qui suivent : une couverture scolaire largement inachevée une éducation aux coûts élevés avec des effets d’éviction une efficacité sociale douteuse évaluée à partir des taux de rendement et l’inadéquation formation-emploi. Il est important, à ce niveau, de bien évaluer l’impact des PAS sur l’éducation. SECTION2 : Les nouvelles options en matière de politiques éducatives. Après 40 ans d’expansion ininterrompue, l’institution universitaire subit partout une crise profonde. Cette crise est particulièrement ressentie en Afrique. En effet, à la suite de la transformation de leur système politique et économique, les pays africains ont été incapables d’adapter l’enseignement supérieur à leurs nouveaux besoins. Dans la quasi totalité des pays africains, l’enseignement supérieur a connu un essor considérable des effectifs, au moment même où la dette extérieure augmentait démesurément, entraînant une aggravation des problèmes sociaux. Dans les années 1980, l’investissement au titre des problèmes sociaux (et donc les sommes consacrées à l’éducation) a été réduit de manière drastique, à la suite des Programmes d’Ajustement Structurel. Selon les statistiques de l’UNESCO, entre 1970 et 1988, le nombre d’étudiants a été multiplié par huit en Afrique subsaharienne. Il est clair, cependant, que la progression quantitative ne constitue pas la seule tendance significative de l’évolution de l’enseignement supérieur de ces dernières décennies en Afrique. La nécessité d’assurer et d’améliorer la qualité de l’enseignement et d’en apprécier la pertinence et l’efficacité occupe une place non négligeable. Certains indicateurs, tels que le nombre élevé de redoublants dans les universités, l’allongement du séjour à l’université, le taux des abandons en cours d’études, le coût élevé des services et l’incapacité des diplômés à accéder ou à s’adapter au marché du travail, révèlent l’importance de ces aspects. Il apparaît que la crise se manifeste de diverses manières : Contraintes liées aux ressources : les universités africaines manquent sérieusement de moyens de financement suffisantes par rapport à leurs populations estudiantines et aux méthodes de fonctionnement actuelles. Pendant les années 1980, les dépenses au titre de l’enseignement supérieur en Afrique ont diminué en passant de 0,72% à 0,5% du PNB (Ziderman et 38 Albrecht, 1995). Dans de nombreux pays africains, une part très élevée du financement de l’enseignement supérieur est dépensée non pas pour l’instruction, mais pour le bien être des étudiants, leur hébergement et leur restauration ; Insuffisance du personnel : dans de nombreuses universités africaines, la dotation en personnel enseignant a été compromise par l’exode massif du personnel vers d’autres secteurs de l’économie (ou d’autres pays), la détérioration des salaires réels, l’insuffisance de logements et de moyens de transports et un niveau de vie généralement en baisse. La plupart des enseignants de l’université essaient de cumuler deux ou trois emplois à la fois (parfois même plus) ; Détérioration des infrastructures : dans la plupart des universités africaines, on note des effectifs pléthoriques, un manque d’entretien et une baisse des ressources disponibles pour l’acquisition d’ouvrages, de revues et d’équipement ; Inefficacités internes : elles se manifestent par des facteurs suivants : Les ratios enseignant / étudiants très faibles ; Le personnel non enseignant en surnombre ; Les taux élevés d’abandons et de redoublement des étudiants ; Les faibles taux de diplômés etc.… Inefficacités externes : elles se manifestent par une inadéquation entre l’offre et la demande de travail (main d’œuvre qualifiée). L’enseignement supérieur en Afrique met l’accent sur le secteur formel et l’emploi salarié alors que le marché est dominé par le secteur informel ; Baisse des résultats de recherche : au cours de la dernière décennie, les résultats de la recherche ont baissé en Afrique, étant donné que le climat économique marqué par la crise ne permettait plus de maintenir les efforts de recherche nationale. Cette situation de crise est survenue dans un contexte où l’Etat est presque partout, la principale source de financement des universités. Quelles sont, dans ces conditions, les perspectives d’avenir des universités africaines ? Il est important de saisir les questions de fonds qui se posent aux universités africaines aujourd’hui. D’abord la pertinence : Rôle de l’enseignement supérieur dans la société, démocratisation, besoin de diversification, relations avec l’entreprise et responsabilités à l’égard du système d’éducation dans son ensemble, etc. Ensuite la qualité : réformes et innovations préconisées, formation à distance, interdisciplinarité et éducation des adultes, planification et développement des ressources, organisation des programmes et compétences des enseignants. La mise en place d’une université africaine de qualité implique, entre autres choses : un ordre de priorités et la détermination de son apport à l’édification de la société ; l’adaptation des programmes d’études et le développement de la recherche. 39 Dans un contexte de mondialisation, on assiste au développement de l’enseignement à distance, de la formation multimédia, mais surtout à la délocalisation de la formation donnant lieu au phénomène de la co-diplomation mettant ainsi en relation différentes universités qui ''co-gèrent'' des filières de formation technique et technologique. De ce fait, cet impératif de la mondialisation commande aux universités africaines l’alignement sur des normes d’organisation et de fonctionnement qui garantissent la compétence, la qualité et l’efficacité de l’enseignement supérieur. L’université africaine est obligée de s’ajuster à la norme internationale, afin de garantir non seulement sa survie, comme pôle de formation et de recherche, mais aussi d’assurer ses nouvelles missions entre autres, la production d’un savoir capable de contribuer au développement économique social, politique et culturel et de s’imposer sur un marché mondial de très haute compétition. En effet, la compétition mondiale qui s’organise demeure essentiellement centrée sur les industries de la matière grise. L’avantage compétitif, comme d’ailleurs l’avantage construit est distribué en fonction de la qualité des ressources humaines. D’où l’impérieuse nécessité de revitaliser les espaces universitaires africains. A partir de quels instruments et avec quels moyens ? En définitive la sortie de la crise actuelle des systèmes éducatifs devrait passer par son une véritable reconstruction de l’ensemble du système. Les solutions pourraient alors passer par 1) La redéfinition des missions des universités autour de quatre idées maîtresses : modernité et excellence développement de la culture technologique formation professionnelle et formation permanente ouverture et coopération. 2) La réalisation d’une sélection-orientation qui garantisse aux étudiants une formation adaptée aux exigences de la vie professionnelle, comme pour leur assurer de meilleures chances de débouchés 3) La recherche de nouvelles ressources financières suffisantes mais surtout diversifiées 4) L’organisation de la participation des étudiants dans toutes les instances délibératives et de décision SECTION3 : Le système LMD : à l’origine était le Rapport J.Attali Le système LMD est le résultat des travaux d’un Groupe de travail nommé par Claude Allégre et présidé par Jacques ATTALI. Ce Rapport mérite une lecture attentive en vue d’en tirer tous les enseignements au moment où toutes nos Universités semblent s’orienter vers l’organisation systématique du Système qui en est issu. 40 I/ Résumé du Rapport Attali 1) « Le système d'enseignement supérieur français, miroir de la complexité de la société, a su, pour l'essentiel, répondre à la croissance très rapide de la demande d'éducation du pays. Cependant, même s'il ne peut être tenu pour responsable des lacunes de l'enseignement secondaire, il est devenu, avec le temps, confus, bureaucratique et inégalitaire : un enfant scolarisé en primaire dans une banlieue défavorisée n'a pratiquement plus aucune chance d'accéder à une très grande école. Si une telle évolution se poursuivait, une part importante de la population ne pourrait plus rejoindre les élites du pays ; les conséquences pour l'unité nationale en seraient très graves. » 2) « Confronté à la révolution des technologies de l'information et des conditions de travail, à la diversification des trajectoires professionnelles, aux exigences de la formation en permanence, au bouleversement des savoirs et de la façon d'apprendre, à la mutation des relations entre l'Etat, les entreprises et la société, à l'unification européenne, l'enseignement supérieur doit revoir d'urgence ses objectifs et simplifier son organisation. Ces réformes déterminent l'élévation du niveau de qualification des Français, dont dépend le niveau de vie de la France ». 3) « A la différence de la situation qui prévalait il y a peu encore, la première mission des universités et des grandes écoles n'est plus le recrutement des cadres de l'Etat, qui n'est plus au centre de la vie économique et industrielle, mais de servir les étudiants, de donner à chacun d'eux, quel que soit son milieu d'origine, toutes les chances de trouver son domaine d'excellence, de se préparer aux métiers d'aprèsdemain et de faire progresser le savoir ». 4) « Tout étudiant devra être assuré de pouvoir quitter l'enseignement supérieur avec un diplôme à valeur professionnelle, s'il est prêt à accomplir les efforts nécessaires pour en obtenir un. De plus, chacun devra pouvoir revenir vers l'université tout au long de sa vie, après un premier diplôme, pour atteindre, s'il le mérite, un niveau équivalent au moins à Bac+3. » 5) « Les établissements d'enseignement supérieur devront former un système plus homogène, dans des ensembles géographiquement cohérents, mettant en commun leurs moyens et disposant d'une réelle autonomie. En contrepartie, ils devront faire l'objet d'une évaluation plus systématique, plus ouverte, plus créatrice de droits et de devoirs. « 6) « La préparation à la vie professionnelle doit devenir l'un des axes majeurs du projet pédagogique de tout établissement d'enseignement supérieur. Sans que soient supprimés les actuels diplômes professionnels d'une durée de deux ans, les niveaux pertinents de sortie seront à trois ans, avec la licence, après des études menées principalement en groupes à effectifs réduits ; à cinq ans avec une Nouvelle Maîtrise faite d'enseignement, de stages et de recherche ; et à huit ans avec le doctorat, ouvrant particulièrement la voie aux carrières de l'enseignement supérieur, de la recherche et aux grands corps de l'Etat (qui ne seront plus réservés aux élèves des grandes écoles). Ces niveaux de qualification nouveaux devront être reconnus et valorisés dans les conventions collectives. Le statut des enseignants devra être amendé pour leur permettre plus de mobilité et en particulier de participer à la création 41 d'entreprises innovantes fondées sur le résultat de leurs recherches, sans nécessairement devoir abandonner définitivement leur statut de fonctionnaire. Les grandes écoles devront, pour continuer de former un vivier de très haut niveau, développer leurs activités de recherche et s'ouvrir davantage aux étudiants venus de l'enseignement technique et de l'étranger. Aucun cursus ne se terminera plus par une impasse. La formation continue devra devenir une règle absolument générale. L'élévation du niveau de qualification des Français doit devenir le principal objectif d'une politique économique et sociale de la France. » 7) « Pour que l'enseignement supérieur français conserve ainsi une place de premier plan dans la compétition mondiale, la nation devra lui consacrer des moyens croissants et mieux utilisés. Elle devra aussi identifier les domaines, aussi nombreux que possible, dans lesquels le système de recherche français peut et doit rester au tout premier rang mondial et leur donner tous les moyens de s'épanouir. Simultanément, il faudra s'assurer que les réformes préconisées ici soient harmonisées avec celles que commencent à entreprendre, dans des directions voisines, les autres pays d'Europe. Cela pourrait être, à l'initiative de la France, un des grands chantiers de l'Union européenne pour la prochaine décennie. » 8) « Si ce rapport, après d'autres, était relégué sur quelque étagère, si une réforme majeure de l'enseignement supérieur n'était pas entreprise rapidement et durablement, le pays perdrait toute chance d'utiliser au mieux le formidable potentiel de sa jeunesse et, peu à peu, glisserait sur la pente d'un irréversible déclin. » 9) « Ces propositions devront être longuement expliquées et débattues pour devenir, au-delà de tout clivage politique, une priorité, une urgence, une évidence nationale ». II/ Les appréciations critiques de l’auteur : l’Université peu préparée à la modernisation.Un ensemble de 10 critiques sont formulées à l’endroit du système universitaire. 1) L'orientation est inexistante. Capable de recevoir des masses croissantes d'étudiants, l'université n'a jamais eu les moyens d'orienter ces étudiants, arrivant sans avoir été informés pendant leurs études secondaires des études supérieures les mieux adaptées à leurs capacités. Les conseillers d'orientation dans les lycées sont beaucoup trop peu nombreux, et les moyens dont ils disposent très insuffisants. Il n'est pas encore possible de trouver sur Internet un site faisant une présentation complète des choix qu'un étudiant peut avoir à faire, des questions qu'il se pose sur les débouchés, sur la compatibilité des divers cursus, les possibilités de passage d'un système à l'autre. En conséquence les étudiants les mieux orientés sont ceux qui peuvent bénéficier d'informations particulières fournies par leur environnement familial : le niveau culturel des parents est une des variables clés de la réussite des études supérieures. 2) L'échec en premier cycle général, (diplôme d'enseignement universitaire général ou DEUG) est considérable, sans qu'on puisse en faire porter l'essentiel de la responsabilité au système d'enseignement supérieur proprement dit. La durée moyenne d'études y est de 2,7 ans ; seuls 28,4 % des étudiants obtiennent leur diplôme en deux 42 ans. Quelque 40 % des étudiants n'obtiennent pas leur DEUG, même après trois, voire quatre ans d'études. 34 % des étudiants abandonnent ces études au bout d'un an dont 26 % sortent alors de l'université sans aucun diplôme. Pour ces jeunes, le passage par l'enseignement supérieur ne conduit qu'à retarder l'entrée dans la vie active et débouche sur la précarité. De plus, l'échec universitaire touche surtout les étudiants venus des milieux les moins favorisés : 50 % des bacheliers technologiques, pour l'essentiel venus des milieux défavorisés, n'obtiennent aucun diplôme d'enseignement supérieur ; 15 % seulement d'entre eux obtiennent une licence après quatre ans d'études, contre 50 % des bacheliers issus de l'enseignement général. Et cette inégalité s'aggrave ensuite : au troisième cycle on trouve 47 % d'étudiants venus des professions libérales et classes supérieures contre 7 % d'ouvriers. Alors que les proportions sont de 30 % environ d'enfants de cadres et 15 % d'enfants d'ouvriers en premier cycle. La gravité de l'inégalité se mesure au fait que les enfants d'ouvriers représentent, en 1993, 37 % de leurs classes d’âge. 3) Le DEUG ne correspond à aucune finalité professionnelle, à la différence du DUT ou du BTS, autres diplômes en deux ans aux débouchés reconnus. 4) La qualité de l'enseignement dispensé n'est pas toujours irréprochable. On peut le voir à deux signes, l'un portant sur l'activité des enseignants, l'autre sur le coût global par élève. 5) L'insertion professionnelle des diplômés des universités est lente et incertaine. Même si cette situation a été récemment améliorée dans plusieurs domaines, l'université n'assure qu'inégalement les débouchés de ses diplômés. D'une part, la fonction publique ne peut plus, aujourd'hui, leur procurer des débouchés suffisants. D'autre part, les responsables des ressources humaines des entreprises connaissent souvent mal les diplômes des deuxièmes cycles universitaires, méconnus par la plupart des conventions collectives 6) La recherche universitaire n'est pas non plus (ni dans tous les secteurs ni dans toutes les universités ou centres de recherche) à la hauteur de ce dont le pays a besoin. Faute de cohérence dans les programmes, de renouveau des personnels, de moyens financiers et matériels suffisants et de liens assez étroits avec les innovations technologiques et industrielles des entreprises, la recherche universitaire souffre de lacunes. 7) La formation en permanence, nécessité de plus en plus évidente, n'est assurée qu'à 3 % par les universités, alors que celles-ci disposent d'éminents pédagogues et de locaux parfois considérables, partiellement ou totalement inutilisés pendant de vastes plages de temps. 8) Les personnels techniques, essentiels au bon fonctionnement des universités, manquent souvent cruellement 9) Le gouvernement des universités est trop souvent inefficace. Le président de l'université - élu par les trois conseils en charge de la vie universitaire, dont la loi de 1984 avait défini la composition et le rôle - dispose en principe du pouvoir exécutif et de l'autorité sur l'ensemble du personnel administratif. Mais en pratique, son rôle effectif 43 est très limité. Les unités de formation et de recherche, héritières des anciennes facultés, jalouses d'une indépendance que la loi ne leur reconnaît plus ; 10) Enfin, l'évaluation des universités, par l'actuel comité national d'évaluation, même si elle constitue un grand progrès par rapport à la situation précédente, n'est ni assez rapide, ni assez transparente. Elle n'est en général suivie d'aucune décision budgétaire ni d'aucune réforme. En quoi nous pouvons nous retrouver dans cette sévère évaluation de l’Université française ? Existe –t-il une identité de situation ? Quel degré de validité du champ des critiques ? III/ La nouvelle structure proposée des réformes Les principes qui doivent gouverner les réformes sont de 4 ordres : - A terme, les diplômes et les cursus de tous les établissements d'enseignement supérieur devront devenir cohérents. Chaque étudiant pourra passer d'un établissement à l'autre et tous pourront être comparés. En outre, les établissements devront être rassemblés dans des ensembles géographiquement homogènes - Un système décentralisé et contractualisé. Les relations entre l'Etat, les universités et les grandes écoles seront définies dans le cadre d'un projet d'établissement et de contrats quadriennaux. L'Etat prendra des engagements financiers suffisamment conséquents pour permettre aux établissements de mener à bien un véritable projet de développement - L'évaluation sera universitaire. - la contrepartie naturelle de l'autonomie Les instances de décision universitaires devront pouvoir assurer aux meilleurs des niveaux de rémunération beaucoup plus attractifs qu'aujourd'hui. Au vu de ce qui précède, le découpage actuel de l'enseignement universitaire en trois cycles n'a plus de sens : il ne permet pas de dégager des niveaux scientifiquement et professionnellement adéquats, de servir les objectifs dégagés plus haut ni d'assurer la meilleure harmonisation entre universités et grandes écoles. Deux principes seront essentiels : - Aucun cursus ne doit déboucher sur une impasse. - Tout nouveau diplôme devra obtenir sa reconnaissance dans les négociations collectives. On devra aller vers des cursus plus clairs, mettant l'accent sur les meilleurs diplômes, et par ailleurs conformes à ce qui se dessine dans d'autres pays du continent. 44 La distinction centrale sera entre deux niveaux de qualification, sanctionnés l'un et l'autre par de véritables diplômes professionnels : l'un à trois ans ; l'autre à cinq ou huit ans (3 / 5 ou 8). Cette réforme n'aura pas pour effet d'introduire des rigidités supplémentaires ni d'allonger les études, mais au contraire de simplifier les cursus et d'organiser des niveaux de référence facilitant l'insertion professionnelle. 45 CONCLUSION De tout ce qui précède nous voyons l’utilité de l’éducation pour l’individu et pour toute une nation. Elle est à la base de tout développement. Il y a lieu alors de la considérer comme de l’investissement. La question de rentabilité doit être examinée avec beaucoup de soins. Les formations à rendement négatif montrent que les gains monétaires seuls ne rendent pas compte de la rémunération de ces professions qui connaissent des formes de gratification non monétaires. De plus la demande à leur égard se maintient car les investissements éducatifs sont réalisés par les parents animés par d’autres motifs que la rentabilisation de leur avance. Autrement dit le bénéfice d’un investissement en capital humain ne va pas intégralement dans le salaire. Les avantages tirés de l’éducation sont énormes. Certains aspects sont difficilement estimables du fait de leurs caractères non pécuniaires. Les taux de rentabilité ne reflètent toujours pas la réalité mais ils constituent des indicateurs pour des analystes et pour les décideurs. < BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 46 1) Banque mondiale (1988) : L’éducation en Afrique sub-saharienne : pour une stratégie d’ajustement de revitalisation et d’expansion 2) Banque mondiale (1987) : Le financement de l’éducation dans les pays en voie de développement. 3) BEKER Gary (1993): Human capital, Third Edition, University de Chicago Press 4) BERTHELEMY et SECK: La croissance économique au Sénégal, OCDE,1997 5) COMGS Philip (1967) : La crise mondiale de l’éducation, UNESCO 6) DELORS J.( 1993) : L’éducation u trésor est caché dedans, Edt. Odile Jacob 7) De VREYER P : La demande d’éducation en Côte d’Ivoire, Revue d’Economie du Développement n)3, Sept. 1993 8) GAYE DAFFE et A. DIAGNE : rendement interne et coût d’un diplômé de l’UCAD, FASEG/CREA, juin 1994 9) GRAVOT Pierre (1993) : Economie de l’éducation, Edit. Economica 10) KINVI D. LOGOSSAH : Capital humain et croissance économique: une revue de la littérature Economie et Prévision n°116, 1994 11) KI-ZERBO (1990) : Eduquer ou périr : impasses et perspectives africaines, UNESCO 12) AUKRUST,Odd (1959) : Investissement et croissance, Revue de la mesure de la productivité n°16, ocde 13) AUKRUST O.et Juul BJERKE (1959) : Real capital and Econmic growth in Norway1900-1956, Cambridge 14) Levy GARBOUA et Louis MINGAT : Les taux de rendement de l’éducation 15) ORIVEL,F. : Education primaire et croissance en Afrique sub-saharienne : les conditions d’une relation efficace, Revue d’Econo. Du développement, 1/1995 16) PSACHAROPOULOS (1988) : L’éducation pour le développement : une analyse des choix d’investissement, Economica. 17) SCHULTZ Théodore(1983) : Il n’est de richesse que d’hommes, Economie sans rivages 18) SCHULTZ Théodore : “Some observations on the allocation of resources in hight education”, Université de Chicago 1960, “Investment in man” (1959) 19) VAIZEY John (1962) : Economie de l’éducation, Edtions ouvrières, 20) YAO YAO Joseph : Ressources humaines, développement et croissance en Côte d’Ivoire, CIRES, Abidjan 1995 47 48