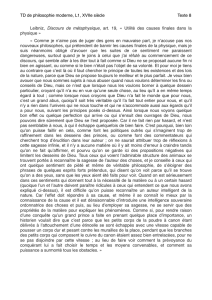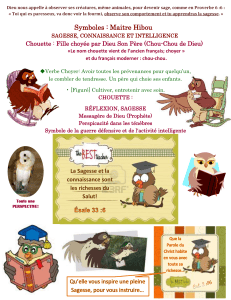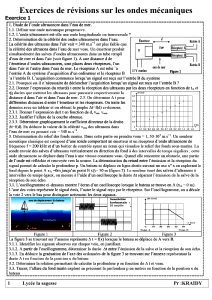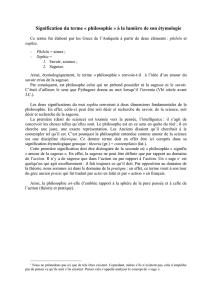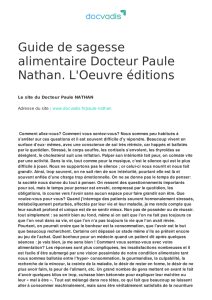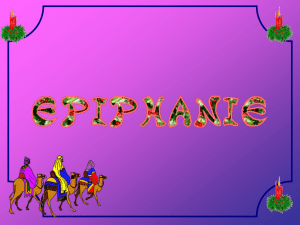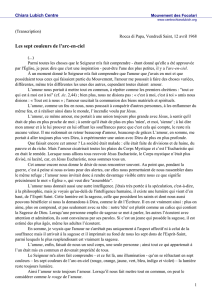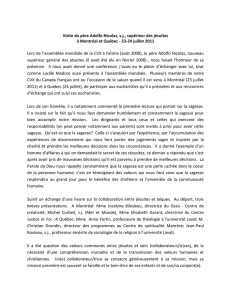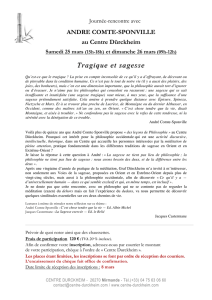CNED

Colloque international sur: l'économie de la connaissance Pr. Hireche Aissa
Novembre 2005
32
La gestion par la sagesse :
Un concept à creuser
Pr Dr Aissa HIRECHE
Résumé:
Les modes de gestion se bousculent et se substituent les uns aux autres à une
vitesse de plus en plus grande. De nos jours, on n'a pas le temps de maîtriser un mode
de gestion et d'en évaluer les contours qu'un autre mode fait déjà surface. Le dernier en
date est la gestion par la sagesse qui n'a cependant pas suscité l'intérêt qu'il mérite. A
l'aide de ce mode de gestion, on pourrait pourtant poser autrement les questions
fondamentales de la motivation, de la communication et, notamment, du leadership. On
pourrait aussi aboutir à une autre perception des conflits dans l'organisation et de leur
résolution.
Sans avoir la prétention, ni même l'ambition, de toucher à tous ces points, la
présente communication tente plutôt de susciter un tant soit peu l'intérêt à l'égard de ce
concept qui reste vraiment à … creuser.
La gestion par la sagesse : Un concept à creuser
Depuis les premiers travaux sur la gestion moderne dont les Français accordent
la paternité à Henri Fayol et les Américains à Frederik Taylor, la perception de
l’activité des organisations n’a cessé de changer et elle a, de ce fait, connu une grande
évolution. Du mode de gestion qui ne s’intéressait qu’aux opérations à celui qui fait des
hommes le point de départ de toute réussite ou échec, le chemin parcouru est long.
Ce qui mérite d’être retenu, cependant, c’est que plus la gestion, en tant que
science, prend de l’âge, plus elle se moralise. Des modèles autocratiques à la
taylorienne où l’homme ne différait pratiquement pas des machines et des matières
premières, on a vu venir, grâce à l’association de la psychologie puis de la sociologie,
ceux plus humains qui prenaient en considération les motivations de l’individu et son
appartenance informelle. Plus tard, même les connaissances furent intégrées comme
critère, non seulement d’évaluation, mais surtout, de gestion. C’est à partir de ce
moment que l’on s’est mis à parler de gestion des connaissances et de gestion par les
compétences. Or, et alors que ce dernier concept n’est pas encore bien « assis » dans les
esprits des gens, un autre concept fait son apparition et qui, de prime à bord, semble
très intéressant. Assez, du moins, pour mériter une attention particulière. Il s’agit de la
gestion par la sagesse
i
.

La gestion par la sagesse :Un concept à creuser
Faculté Des Sciences Economiques et de Gestion – Université de Biskra
33
Sagesse et gestion par la sagesse
Soulignons de suite que le terme « sagesse » ne doit pas être pris ici dans le sens
plutôt passif de « prudence » ou de réticence devant le risque, car il s’agit en réalité de
l’autre sagesse, celle qui résulte d’un stade avancé des connaissances et d’un niveau
fort élevé dans l’abord des choses et des phénomènes.
En d’autres termes, il s’agit de la « sophia » grecque, celle des philosophes,
celle qui procure la sérénité dans la réflexion et la justesse dans l’action. Cette sagesse
dont se dégage la force de l’assurance. Mais surtout cette force sereine qui infléchit le
raisonnement des autres ainsi que leur comportement.
Pour Platon, la sagesse est d’abord ce pouvoir d’agir sur les autres pour les
rendre meilleurs et l’on comprend ainsi qu’il s’agit d’une qualité qui n’est pas le propre
de tous les hommes. Bien que forgée, au fil du temps, par les expériences personnelles
dans la quête d’une amélioration permanente de la connaissance, la sagesse ne peut
toutefois être recherchée là où il n’y a pas de maturité, un autre concept qui mérite
d’être défini, mais disons simplement qu’il n’est pas question ici de maturité physique,
généralement confondue d’ailleurs avec le seuil de la majorité, mais plutôt de celle
morale. Et c’est pour cela que la sagesse ne peut être dissociée de la probité, de la
pudeur, de l’éthique, et de toutes ces vertus qui font la grandeur des hommes.
A lui seul, le fait d’avoir osé un lien entre la gestion et la sagesse est déjà un fait
hautement intéressant, et rien que pour cela, la démarche mérite beaucoup de
considération.
Si, en plus, l’introduction du concept de la sagesse dans le monde de la gestion
se fait de manière à donner à cette dernière une nouvelle dimension qui consiste à
entrouvrir une opportunité de plus sur la connaissance plus poussée des capacités et du
comportement des hommes, cela ne peut susciter que de l'adhésion.
Aussi, on ne peut qu’être étonné qu’un pareil concept soit passé inaperçu par les
chercheurs et les gestionnaires et que les écrits à ce propos se compteraient presque,
pour reprendre le cliché consacré, sur les doigts d’une seule main. Mais en quoi
consiste la gestion par la sagesse ?
Il est difficile de trouver encore une définition à ce concept, mais nous pouvons
avancer, à ce stade déjà et sans trop de risques que, gérer par la sagesse c’est agir sur
le comportement des collègues, des collaborateurs et des subalternes, afin de le
transformer positivement.
Gestion par la sagesse et motivation
A partir de la précédente définition, la question qui pourrait être soulevée est
celle qui relative à un éventuel amalgame. En effet, et du moment que la motivation des
hommes – qu’ils soient collègues, collaborateurs ou subalternes – consiste en
l’orientation de leur comportement, quelle différence y aurait-il alors entre la gestion
par la sagesse et la motivation ?

Colloque international sur: l'économie de la connaissance Pr. Hireche Aissa
Novembre 2005
34
En réalité, et malgré les ressemblances superficielles, les différences entre les
deux concepts sont aussi nombreuses que variées, et, en ce qui suit, nous en retenons
les plus importantes.
En tant que processus visant à influencer les hommes de manière à en obtenir
un comportement donné, la motivation se caractérise par son aspect ponctuel, aussi
bien sur le plan des attentes que sur celui des résultats, en ce sens qu’elle est liée à un
objectif précis, inscrit dans le temps et dans l’espace. La gestion par la sagesse, par
contre, ne s’arrête pas à un objectif déterminé. S’étalant bien au-delà, elle transcende
les buts et les finalités de l’organisation car elle vise à procurer un comportement qui
s’inscrit dans la durée. Si la motivation ressemble à une clé qui sert à ouvrir une porte,
la gestion par la sagesse ressemblerait plutôt à un passe partout qui permet d’ouvrir
toute une série de portes.
Le caractère ponctuel de la motivation constitue une raison à un affaiblissement
du comportement obtenu après la réalisation de l’objectif. La gestion par la sagesse
conduit, par contre, à l’obtention d’un comportement qui se renforce avec le temps. La
seconde différence consiste donc en la réversibilité du résultat dans un cas et son
irréversibilité dans l’autre.
Par ailleurs, et parce que la motivation provoquée chez les hommes ne s’obtient
que par la réponse à un besoin précis, indifféremment du type et du niveau, elle ne peut
survivre au besoin en question. Ce qui n’est pas le cas pour la sagesse obtenue qui,
dissociée de tout besoin, survit à toutes les raisons qui l’ont provoquée.
En plus, et au-delà de tout ce qui les sépare, la gestion par la sagesse représente
un mode de gestion alors que la motivation n’est qu’une simple technique de gestion.
La différence est de taille.
Si l’on part du principe que la sagesse a pour effet de procurer à son homme une
certaine distance par rapport aux décisions qu’il est appelé à prendre, distance
découlant de la maturité, qui réduit les erreurs de passion et d’entrain et qui assure un
minimum de sérénité, il n’est pas alors erroné de soutenir que la gestion par la sagesse
est un mode qui réduit considérablement les risques de précipitation et les erreurs
d’appréciation. Si, à cela, on ajoute l’implication dans les actions et la nature
particulière de l’attitude face à la tâche, la gestion par la sagesse se révèle d’une
extrême utilité pour les organisations, quelqu’en soit la nature et quelqu’en soit la taille.
Il est certaines conditions qui président à l’instauration de la gestion par la
sagesse, néanmoins, la plus importante consiste en le fait que les responsables, à tous
les niveaux de gestion, se doivent de « se montrer prêts à apprendre et reconnaître qu'ils
ne sont pas maîtres de tout »
ii
car cette « attitude de sagesse »
iii
« est essentielle dans
toute organisation en évolution »
iv
.
La sagesse et l'autorité
La gestion par la sagesse nécessite que les managers fassent preuve de sagesse.
L’autorité d’un responsable ne se mesure point aux choses qu’il connaît, aux
diplômes qu’il peut étaler ou aux expériences qu’il peut faire valoir. D'ailleurs, parmi

La gestion par la sagesse :Un concept à creuser
Faculté Des Sciences Economiques et de Gestion – Université de Biskra
35
les sources d'autorité enseignées, l'exemple et la compétence sont les seules sources à
dépendre directement de l'individu alors que les autres (légitimité, pouvoir de
coercition et pouvoir de gratification) dépendent du poste lui-même.
Le manager peut donner l'exemple par sa modestie vis-à-vis de ses collègues et
de ses subalternes, par sa capacité d'écoute, par sa hauteur de vue etc. Elle se mesure à
l’exemple qu’il donne. Or, l’une des manières d’exprimer cet exemple consiste
justement à reconnaître ses propres limites et à faire preuve de lucidité et de réalisme.
Or qui, mieux que la sagesse peut conférer la lucidité et le réalisme au manager?
La hauteur de vue que procure la sagesse et la distance qu'elle assure confèrent
au manager une objectivité et une confiance en soi à même de permettre une autorité
sinon incontestable, du moins difficile à contester.
Souvent, sans l'attitude de sagesse de la part du manager, « les employés
subalternes se sentent obligés de répondre par l'affirmative »
v
, non pas « de peur
d'avoir l'air incompétent »
vi
comme le soulignent certains, mais plutôt pour ne pas
avoir à gesticuler vainement devant des non voyants. Ce comportement produit des
effets négatifs sur un autre plan. Les subalternes ayant, en général, tendance à puiser
leur modèle de gestion chez leurs responsables directs, le comportement transmis aux
autres ne les aidera point à être sages. En principe, et pour une bonne gestion, « les
relations fructueuses entre les gestionnaires et leurs collègues reposent sur l'inspiration
bien dosée qui émane de la sagesse »
vii
.
De ce qui précède, et pour une deuxième définition, on peut dire que la gestion
par la sagesse consiste en la transformation du comportement des collègues,
collaborateurs et subalternes en leur transmettant la hauteur des vue et l’humilité.
Mais cela demeure malheureusement encore insuffisant car trop vague.
Sagesse et connaissance
En réalité, il ne peut y avoir de gestion par la sagesse sans une bonne
connaissance de la gestion, non pas pour le plaisir de la connaissance elle-même, mais
plutôt parce que c’est à partir de cette connaissance que se forge ce que l’on appelle
communément la philosophie de gestion. Il ne s’agit pas croire qu’on est bon
gestionnaire pour le devenir. Et il s’agit moins de le faire croire aux autres car nulle
philosophie de gestion ne peut prendre pied sur des illusions. Ceci d’une part, d’autre
part lorsque le leader manque de formation en gestion, ses subalternes et ses collègues
se rendent vite compte de cette lacune. Or, et sachant que les compétences constituent
l’une des véritables sources d’autorité, on voit mal quel type d’autorité aurait un leader
moins compétent que son groupe. Par ailleurs, et cela a été signalé plus haut, là où il y a
insuffisance de connaissances, il ne peut y avoir de sagesse. De là, on peut déjà tirer la
conclusion que la sagesse dans les organisations est relative, en ce sens qu’elle se
manifeste par son aspect social contingent. Autrement dit, la sagesse ne devient
bénéfique à la gestion qu’avec une connaissance de cette dernière, sinon elle restera
sagesse, mais ailleurs que dans les organisations.
La philosophie de gestion prenant pied sur le système de valeurs de l’individu,
elle ne peu négliger l’apport de la science de gestion elle-même. L’un des pères de
l’école du processus de gestion donnait, dans d’autres circonstances et pour d’autres
démonstrations, l’exemple du médecin qui, sans l’aspect scientifique de la médecine,

Colloque international sur: l'économie de la connaissance Pr. Hireche Aissa
Novembre 2005
36
ne serait pas meilleur qu’un simple guérisseur. Et nous pensons que cet exemple est fort
approprié ici.
La sagesse donnant une hauteur de vue aux choses et aux phénomènes, il est
clair que l’appréciation de la situation de l’organisation est, à tous points de vue,
beaucoup plus proche de la réalité, qu’elle est plus sereine et que, par conséquent, les
décisions prises ne peuvent être qu’appropriées.
Parce que la sagesse transcende les divergences d’intérêt d’individus et de
groupes ainsi que les caprices d’humeur, non seulement elle aide à mieux résoudre les
conflits mais elle contribue à les réduire considérablement. En effet, lorsqu’on a su
insuffler aux hommes les hautes valeurs et le comportement adéquat, leurs rapports aux
risques et aux problèmes, y compris les conflits, deviennent plus sereins et leur
réaction, plus sensée, contribue pour une large part à une résolution convenable.
Ils sont nombreux les gestionnaires qui ne voient pas venir les conflits ou qui
« évitent de les voir venir » pour s’auto convaincre d’une pseudo efficacité dans la
gestion de leur organisation, et pour se prouver à eux-mêmes qu’ils se sont
convenablement « acquittés de leur obligation de faire preuve de diligence
raisonnable »
viii
ignorant que, par cette attitude, « comme l'enfant recroquevillé sous ses
couvertures, ils répriment l'intuition que de véritables problèmes sont imminents »
ix
.
Face à ce comportement, même la formation et les stages de mentoring ne peuvent pas
être très efficaces et seule la sagesse peut avoir des effets. Voilà, encore, un aspect qui
souligne l’intérêt de la gestion par la sagesse.
Une autre condition s’impose à l’adoption de ce mode de gestion. Les hommes
auxquels on projette de transmettre cette sagesse dans la gestion doivent
nécessairement jouir d’un niveau respectable de connaissances. Il ne s’agit pas de celles
sanctionnées par un diplôme quelconque (bien qu’elles soient les bienvenues
lorsqu’elles sont réelles), mais de celles qui provoquent la prédisposition à recevoir, à
donner, à conjuguer l’immédiat au lointain, le simple au complexe, l’individu au
groupe, la modestie à l’autorité, la fermeté à l’équité et, surtout, le savoir à l’humilité,
car n’oublions pas que la sagesse est une valeur sociale et que, dans l’organisation, il
importe peu que le gestionnaire se considère, ou pas, dotée d’une certaine sagesse, ce
qui importe c’est plutôt ce que voient en lui ses collègues, ses collaborateurs et ses
subalternes car, tout comme le leader dont la véritable valeur est celle perçue par son
groupe, le véritable statut du gestionnaire, est celui que lui accordent ses hommes.
La gestion par la sagesse semble donc offrir un mode fort convenable pour
mener à bien les affaires des organisations de toutes sortes. Une question mérite,
toutefois, d’être posée. Elle n’est pas des moindres. Quel est de degré de réalisme de ce
mode de gestion ? Ou, en d’autres termes, peut-on réellement aspirer à voir un jour se
développer ce mode dans les organisations ?
La réponse n’est pas facile car, autant nous adhérons à ce mode, autant il nous
semble plus utopique que réaliste. Non pas que la sagesse serait incapable de gérer ou
que la gestion serait difficile à couler dans le moule de la sagesse, mais plutôt parce
que, prise dans son sens plein, la sagesse n’irait pas à la gestion. Elle refuserait de
franchir les portes des organisations. Les hommes sages, combien même accepteraient-
ils de tenter l’expérience, ce qui est déjà beaucoup, ne peuvent se soumettre aux jeux,
 6
6
1
/
6
100%