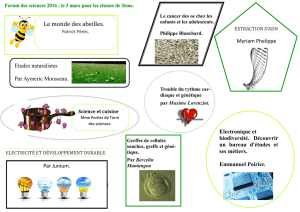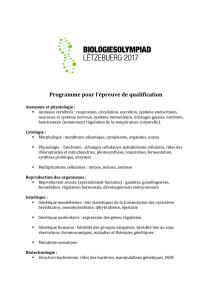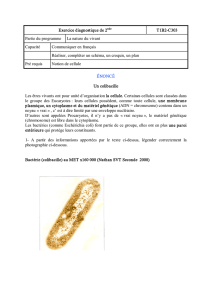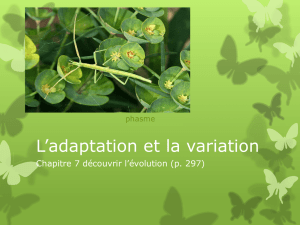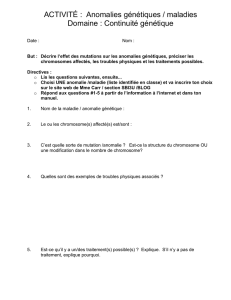La dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale

La dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale
La dystrophie musculaire Facio-Scapulo-Humérale (FSH) est aussi appelée
myopathie de Landouzy-Dejerine.
Quelle est la fréquence de la maladie ?
Une personne sur 20 000 est atteinte. La fréquence est sans doute sous estimée, la
maladie étant parfois non ou tardivement détectée.
Quelle est son origine ? Quel est son mode de transmission ?
Maladie génétique dont le mécanisme moléculaire reste encore hypothétique,
l’anomalie génétique est située sur le bras court du chromosome 4 (4q35). Dans
cette région génique, il existe une petite séquence d’ADN répétée de 10 à 100 fois
chez les personnes non atteintes, nommée D4 Z4. Chez le patient atteint d’une FSH,
une partie des répétitions est perdue, « délétée », et cette séquence est répétée
moins de 10 fois. Cette délétion varie beaucoup d’une famille à l’autre. Bien qu’elle
soit la même au sein d’une famille, les signes cliniques peuvent être variables.
La FSH atteint aussi bien les hommes que les femmes avec 50 % de risque
statistique de transmettre à la descendance la mutation (transmission dominante
autosomique). Environ 30 % des porteurs n’auraient pas d’expression clinique
(pénétrance incomplète). Le conseil génétique et le diagnostic prénatal restent
difficiles.
Quels sont les symptômes ?
Faiblesse et atrophie progressive des muscles du visage (difficultés à souffler, siffler,
yeux entre-ouverts pendant le sommeil…), des épaules (décollement des omoplates,
difficultés à élever et maintenir les bras au-dessus de l’horizontale, à se coiffer, à
porter des objets lourds). Les muscles de la ceinture pelvienne sont souvent touchés
(bascule du bassin en avant, démarche dandinante, difficultés à monter les
escaliers). L’atteinte est souvent asymétrique. Une atteinte auditive discrète et la
présence d’anomalies rétiniennes à l’examen ophtalmologique sont rares.
Quelle est son évolution ?
Les symptômes débutent à un âge variable (entre 3 et 50 ans, habituellement chez
les adolescents). Le diagnostic est souvent retardé, la gêne étant mineure au début
et pouvant être considérée longtemps par le patient lui-même comme banale
d’autant qu’elle est lentement progressive. Le pronostic est habituellement lié aux
incapacités fonctionnelles sans modification de l’espérance de vie.

Comment confirme-t-on le diagnostic ?
Le diagnostic a longtemps reposé sur la clinique (myopathie de l’adulte jeune
comportant outre une atteinte des ceintures volontiers asymétrique, une atteinte
faciale d’évolution lente), sur les données familiales (atteinte de plusieurs
générations), sur l’électromyogramme (signes myogènes non spécifiques plus
évocateurs par leur localisation). L’augmentation modérée et inconstante des
enzymes musculaires (CK) n’est pas un élément déterminant. Actuellement, la
confirmation du diagnostic évoqué sur l’examen clinique repose non pas sur la
biopsie musculaire mais sur l’analyse génétique sur prélèvement sanguin, mettant en
évidence la délétion responsable au niveau du chromosome.
Quelle surveillance et quelle prise en charge thérapeutique ?
La prise en charge multidisciplinaire et notamment les conseils d’un médecin de
rééducation et la kinésithérapie sont essentiels. Le suivi par une équipe
pluridisciplinaire sera plus ou moins espacé en fonction des symptômes et de
l’évolution. Les indications chirurgicales, notamment la fixation de l’omoplate
(omopexie), restent exceptionnelles et délicates. Certains conseils (chaussures
montantes facilitant la marche, larmes artificielles prévenant les conséquences de
l’inocclusion palpébrale pendant le sommeil) peuvent être utiles. Des appareillages et
aides techniques peuvent être nécessaires. L’aménagement ergonomique du
domicile, du poste de travail peuvent compenser les incapacités motrices.
L’accompagnement psychologique, des patients et de leur famille, est souvent
indispensable.
Une surveillance cardiorespiratoire doit être proposée (épreuves fonctionnelles
respiratoires, gaz du sang, ECG…) et adaptée à l’âge et aux constatations. La
surveillance respiratoire sera la plus importante car il n’y a pas de problème
cardiaque en général. Des précautions sont indispensables à prendre comme dans
toute myopathie, en cas d’anesthésie générale.
Une demande de prise en charge à 100 % des soins médicaux, une carte « maladie
neuromusculaire », les coordonnées des associations seront remises aux patients.
Un conseil génétique des patients et des membres de sa famille peut être proposé.
Texte rédigé par le Centre Maladies Neuromusculaires Rares Rhône-Alpes.
Version du 13/09/2010.
1
/
2
100%