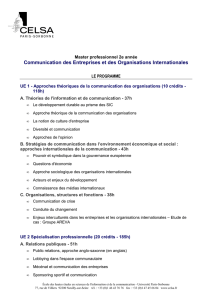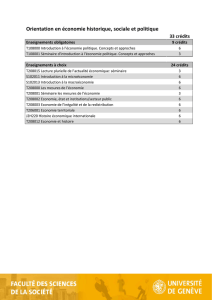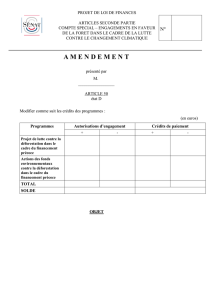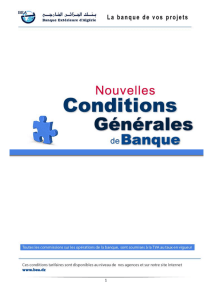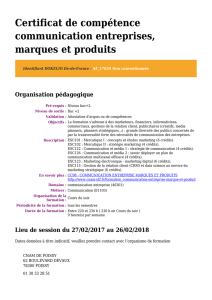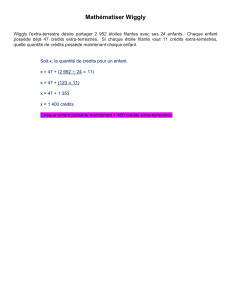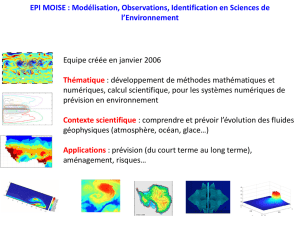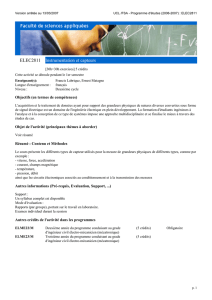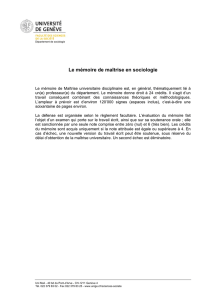Annexes budgétaires

PLR 2013 - EXTRAIT DU RAP DE LA MISSION :
ÉCONOMIE
Version du 20/05/2014 à 19:06:55
PROGRAMME 305 :
STRATEGIE ECONOMIQUE ET FISCALE
MINISTRE CONCERNE AU TITRE DE L'EXERCICE 2013 : PIERRE MOSCOVICI, MINISTRE DE L’ECONOMIE ET
DES FINANCES
TABLE DES MATIERES
Bilan stratégique du rapport annuel de performances 2
Objectifs et indicateurs de performance 5
Présentation des crédits et des dépenses fiscales 12
Justification au premier euro 19
Analyse des coûts du programme et des actions 36

2
PLR 2013
Stratégie économique et fiscale
Programme n° 305
RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES
BILAN STRATEGIQUE DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES
Ramon FERNANDEZ
Directeur général du Trésor
Responsable du programme n° 305 : Stratégie économique et
fiscale
La finalité du programme « Stratégie économique et fiscale » est d’éclairer le mieux possible les choix du
Gouvernement en lui apportant une aide à la conception et à la mise en œuvre des politiques économiques,
financières et fiscales, afin d’assurer une croissance durable et équilibrée de l’économie française.
Le programme permet la mise en synergie des interventions des différents acteurs concourant à l’action du
Gouvernement en matière de pilotage de l’économie française dans le cadre national, européen et international, de
compétitivité des entreprises et de politique fiscale. La définition et la mise en œuvre de ces politiques nécessitent,
entre autres, de pouvoir s’appuyer sur des prévisions et des analyses économiques de qualité pour lesquelles la
dimension internationale prend une importance croissante, de disposer d’un corpus juridique clair et accessible
encadrant l’activité économique, et d’opérer une transposition rapide des directives européennes. De même, le
programme permet de s’assurer des capacités de la Banque de France à réaliser un traitement efficace du
surendettement et de l’Agence France Trésor à gérer la trésorerie et la dette de l’Etat de façon optimale.
L’année 2013 a été marquée par :
- la poursuite de l’effort de retour à l’équilibre des finances publiques, avec l’entrée en vigueur du traité européen sur
la stabilité, la coordination et la gouvernance ;
- la mise en place du Haut Conseil des finances publiques ;
- la mise en œuvre d’importantes mesures visant à améliorer la compétitivité des entreprises afin de permettre un
retour à l’emploi, tel le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) applicable à compte r du
1er janvier 2013 ;
- la création de Bpifrance, pour laquelle a été défini un cadre réglementaire et des règles de gouvernance.
La direction générale du Trésor (DG Trésor) a piloté ou participé à la conduite d’importantes réformes survenues en
2013. La loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 qui a posé les bases d’une
réforme structurelle des banques françaises, a aussi mis en place les outils permettant de faire face aux difficultés
rencontrées par un établissement de crédit, renforcé la supervision et encadré les pratiques commerciales des
banques. Par ailleurs, la réforme de l’assurance-vie permet de davantage mobiliser l’épargne des ménages au service
du financement de l’économie et de la croissance avec la création de nouveaux produits.
Durant l’année, la DG Trésor a poursuivi une importante activité de diagnostic économique et de conseil pour la France
et l’international, en fournissant un grand nombre d’analyses aux ministres, notamment sur l’impact de la con solidation
budgétaire sur la croissance, l’évolution des coûts salariaux, l’inflation en zone euro et l’impact des politiques
publiques. Elle a également contribué à assurer la promotion de la stratégie économique du Gouvernement et des
réformes structurelles engagées auprès des partenaires de la France.
Elle a transmis des prévisions, analyses et préconisations aux ministres et a été fortement mobilisée par les différents
sommets internationaux (G8, G20, sommets européens) afin de contribuer à la mise en place de réponses
internationales coordonnées aux déséquilibres économiques et budgétaires. Plus largement, la DG Trésor a contribué
à ce que la France soit une véritable force de proposition à l’international.

PLR 2013
3
Stratégie économique et fiscale
RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES
Programme n° 305
L’accent mis par le Gouvernement sur la diplomatie économique a conduit les services économiques de la DG Trésor à
l’étranger à accroître leur mobilisation au service de l’appui à l’internationalisation de l’économie et de l’attractivité de
la France. Le rôle de pilote des acteurs économiques locaux, confié au chef de service dans son pays de résidence, a
ainsi été renforcé. En parallèle, la cartographie des implantations s’adapte progressivement à l’évolution des enjeux
économiques mondiaux par redéploiement des effectifs, géographiquement, vers les pays émergents et,
fonctionnellement, sur les missions d’appui aux entreprises articulées notamment autour des quatre familles de
produits et de services identifiées par la stratégie pour le commerce extérieur (« mieux se nourrir », « mieux vivre en
ville », « mieux communiquer » et « mieux se soigner »).
L’actualité fiscale en 2013 a très fortement mobilisé la direction de la législation fiscale (DLF).
Le redressement des comptes publics s’est traduit par l’engagement d’une réduction importante des dépe nses
publiques et par la mise en œuvre d’une fiscalité en faveur du soutien du pouvoir d’achat des ménages, axée sur
l’accompagnement du financement de la branche famille et de la réforme des retraites. Notamment, un nouvel
abaissement de l’avantage maximal procuré par le quotient familial et la suppression de l’exonération d’impôt sur le
revenu des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille procèdent de cette démarche, tout en
préservant les ménages les plus modestes grâce à la revalorisation exceptionnelle de la décote à 5 % et la
réindexation des trois premières tranches du barème de l’impôt sur le revenu.
La fiscalité a également été mobilisée au service de l’objectif d’améliorer l’accès au logement avec l’abaissement à
5,5 % du taux de TVA dans le secteur de la construction et la rénovation de logements sociaux et l’introduction du taux
réduit de TVA à 10 % sur le logement intermédiaire. La réforme du régime d’imposition des plus -values immobilières
permet également de fluidifier le marché grâce à la mise en place d’un abattement linéaire pour les biens immobiliers
autres que les terrains à bâtir.
Parallèlement, la transition écologique a été amorcée avec, d’une part, l’introduction d’une composante carbone dans
la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TIPCE) et l’extension de la taxe générale sur les
activités polluantes (TGAP) Air à de nouvelles substances et, d’autre part, le recentrage du crédit d’impôt à l’impôt sur
le revenu en faveur du développement durable sur les rénovations lourdes, afin de favoriser la rénovation thermique
des habitations principales.
La réforme de l’assurance-vie permet de mieux orienter l’épargne des ménages vers des placements au service du
financement de la prise de risques entrepreneuriaux. Elle se décline par la création de deux nouveaux contrats, les
contrats euro-croissance et les contrats vie-génération, ces derniers étant ciblés sur certains secteurs d’activité
aujourd’hui déficitaires en termes d’investissements (PME, logement intermédiaire, économie sociale et solidaire). La
création d’un PEA-PME permet, quant à elle, de faciliter le financement des PME et des ETI.
La finalisation de la réforme du régime d’imposition des plus-values mobilières et de droits sociaux avec la mise en
place d’un régime général et d’un régime incitatif, chacun s’appuyant sur un abattement progressif pour durée de
détention, a permis d’unifier et de simplifier les dispositifs existants conformément aux orientations arrêtées par le
Gouvernement à la suite des Assises de l’Entrepreneuriat. Par ailleurs, les aménagements apportés à certains
dispositifs avantageux comme la prorogation du statut de jeune entreprise innovante (JEI), la simplification du crédit
d’impôt recherche, et la création d’un statut de société coopérative de production (SCOP) d’amorçage pour faciliter la
reprise d’entreprises saines sources d’emplois, constituent également des leviers pour agir en faveur de la
compétitivité des entreprises. Des mesures de simplification permettront également de faciliter au quotidien la vie des
entreprises.
Enfin, la mise en place de conférences fiscales avec les responsables de programmes a permis à la DLF d’améliorer la
gouvernance fiscale et notamment celle des dépenses fiscales.

4
PLR 2013
Stratégie économique et fiscale
Programme n° 305
RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES
RECAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
OBJECTIF 1
Assurer la qualité de l’analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de
finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes
fiscales
INDICATEUR 1.1
Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans
le RESF et de celles des instituts de conjoncture
INDICATEUR 1.2
Fiabilité des prévisions de recettes fiscales
OBJECTIF 2
Contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale et accélérer la production
des textes d’application de la législation fiscale
INDICATEUR 2.1
Délais de codification et de production des textes d’application
OBJECTIF 3
Assurer la transposition des directives européennes dans les délais
INDICATEUR 3.1
Performance des services pour la transposition des directives sous la responsabilité de la
Direction générale du Trésor
OBJECTIF 4
Assurer l’efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor
INDICATEUR 4.1
Taux de satisfaction sur les demandes de veilles sectorielles et d’analyses comparatives
internationales
OBJECTIF 5
Assurer un traitement efficace du surendettement
INDICATEUR 5.1
Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de
surendettement
INDICATEUR 5.2
Proportion des mesures permettant l’apurement total et définitif de la situation de
surendettement
INDICATEUR 5.3
Coût complet du traitement d’un dossier de surendettement

PLR 2013
5
Stratégie économique et fiscale
OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
Programme n° 305
OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
OBJECTIF n° 1 : Assurer la qualité de l’analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de
finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales
INDICATEUR 1.1 : Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées
dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture
(du point de vue du citoyen)
Unité
2011
Réalisation
2012
Réalisation
2013
Prévision
PAP 2013
2013
Prévision
actualisée
PAP 2014
2013
Réalisation
2015**
Cible
PAP 2013
Croissance du PIB
Réalisation
%
1,7
0,0
INSEE
05/2014
0,3 (INSEE,
14/02/2014)
0,3
ND
Prévision de croissance du Gouvernement
%
2,0 (RESF
2011,
10/2010)
1,75 (RESF
2012,
10/2011)
RESF 2013
0,1
(Programme
de stabilité
04/2013)
0,8 (RESF
2013,
10/2012)
ND
Ecart prévision de croissance du
Gouvernement / réalisation
Points
0,3
1,75
ND
-0,2
0,5
ND
Prévision de croissance des instituts de
conjoncture
%
1,5 (RESF
2011,
10/2010)
1,2 (RESF
2012,
10/2011)
RESF 2013
ND
0,4 (RESF
2013,
10/2012)
ND
Ecart prévisions de croissance des instituts
de conjoncture / réalisation
Points
-0,2
1,2
ND
Sans objet
0,1
ND
Inflation
Réalisation
%
2,1
2,0
INSEE
01/2014
0,9 (INSEE
14/01/2014)
0,9
ND
Prévision d’inflation du Gouvernement
%
1,5 (RESF
2011,
10/2010)
1,7 (RESF
2012,
10/2011)
RESF 2013
1,3
(Programme
de stabilité
04/2013)
1,8 (RESF
2013,
10/2012)
ND
Ecart prévision d’inflation du
Gouvernement / réalisation
Points
-0,6
-0,3
ND
0,4
0,9
ND
Prévision d’inflation des instituts de
conjoncture
%
1,5 (RESF
2011,
10/2010)
1,6 (RESF
2012,
10/2011)
RESF 2013
ND
1,7 (RESF
2013,
10/2012)
ND
Ecart prévisions d’inflation des instituts de
conjoncture / réalisation
Points
-0,6
-0,4
ND
Sans objet
0,8
ND
Commentaires techniques
Source des données : DG Trésor et Insee
L’indicateur repose sur les prévisions de croissance et d’inflation du Gouvernement et des instituts de conjoncture telles qu ’elles figuraient dans le
rapport économique, social et financier (RESF) annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Dans les cas où la prévision de croissance
du Gouvernement est une fourchette, le chiffre retenu est celui qui sert de base à la construction du projet de loi de finances. Le tableau fait apparaître
les écarts (en points de pourcentage) entre les prévisions de croissance du PIB et d’inflation effectuées, par le Gouvernement d’une part, par les
instituts de conjoncture d’autre part, et la réalisation constatée. Pour les années 2011 et 2012, l’évolution du PIB constatée est celle qui figure dans les
comptes annuels publiés par l’Insee en mai 2012. Pour l’année 2013, le chiffre retenu est celui cohérent avec les comptes tri mestriels publiés par
l’Insee le 14 février 2014.
Les instituts de conjonctures dont le consensus des prévisions est retenu, en tant que membres de la Commission économique de la Nation, pour la
comparaison avec les chiffres du Gouvernement, étaient les suivants en 2013 : Bank of America Merrill-Lynch, La Banque Postale, Barclays, BIPE,
BNP-Paribas, Caisse des Dépôts, Citi, COE-Rexecode, Deutsche Bank, Euler Hermes, Exane, GAMA, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley,
Natixis, OFCE, Société Générale et UBS.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
1
/
40
100%