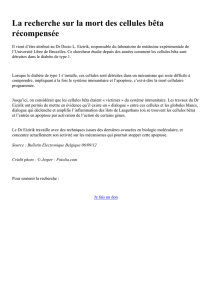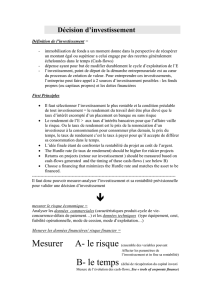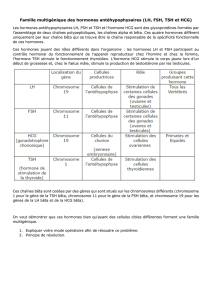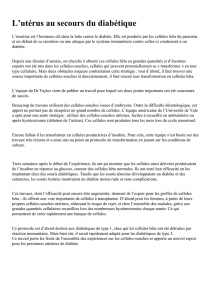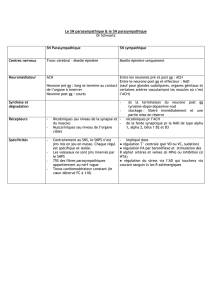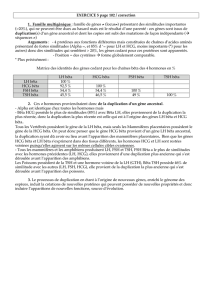Prime de risque - Ajouter ce blog dans vos Favoris

Prime de risque
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche à compléter concernant la Finance, vous pouvez partager vos connaissances en
le modifiant.
Les investisseurs et même les parieurs, ont habituellement une certaine aversion au risque. Ils préfèrent un
gain relativement sûr à un gain bien plus important mais aléatoire (mieux vaut recevoir 100 euros qu'avoir une
chance sur dix d'en recevoir 1000), selon l'adage « un tiens vaut mieux que deux tu l'auras ».
Ainsi, il y a une demande moins forte pour les choses risquées que pour les choses non risquées.
De ce fait, les investisseurs exigent en général pour investir dans une entreprise (par l'achat d'actions ou de tout
titre financier émis par des entreprises) que le rendement attendu soit supérieur à celui d'un placement non
risqué, c'est-à-dire celui des emprunts d'État.
Cette différence de taux, ce revenu supplémentaire espéré exigé, est la prime de risque.
Le taux correspondant, qui est la somme du taux non risqué et de la prime de risque est le taux risqué
On constate cependant qu'en période de grande euphorie (bulle spéculative), la prime de risque s'annule
(neutralité au risque) voire devient négative (recherche du risque).
L'aversion au risque, qui a conduit aux concepts d'utilité et de prime de risque, est l'une des toutes premières
notions ayant été découvertes en économie par Daniel Bernoulli, il y a 300 ans. Toutefois, la pertinence de ces
concepts fait l'objet de diverses controverses de nos jours, sous l'effet de travaux de recherche liés à la finance
comportementale.
La prime de risque globale d'un titre donné peut souvent être décomposée afin de rendre compte du fait que
certains facteurs de risque affectent toutes les entreprises d'une même catégorie alors que certains autre
éléments n'influenceront qu'une entreprise particulière. La prime de risque globale d'une entreprise A sera donc
la somme d'une prime de risque de marché (applicable aux autres entreprises) et d'une prime de risque
intrinsèque (reflétant uniquement le risque de l'entreprise A).
] Exemples
Diverses sociétés de crédit proposent des prêts où il n'est pas nécessaire de justifier de l'utilisation de
l'argent mis à disposition. Le taux pratiqué TEG est alors souvent élevé et atteint parfois 20% ! Ces
sociétés font en effet une marge très importante sur chaque crédit mais prennent le risque de ne pas être
remboursé (surendettement par exemple). Par conséquent, le surprofit gagné grâce aux personnes qui
remboursent leur crédit sert à financer les pertes liés aux non-remboursements (rappelons que ces
organismes ne créent pas de la monnaie, ils l'achètent à la BCE à un certain taux et la revendent à un
taux plus élevé à leurs clients).
Les créateurs de Meetic ont pris énormément de risques, la réussite actuelle n'étant pas du tout
prévisible. La prise de risque a été bien rémunérée (par le profit et l'augmentation de valeur de
l'entreprise). S'ils avaient échoués, ils auraient eu une rémunération de - 100 % (c'est à dire la perte de
tout le capital investit).

Nous pouvons faire le calcul de l'espérance mathématiques du gain suivant, où représente le capital investit,
300% le gain assuré si le pari est gagné, la probabilité que Meetic marche et la probabilité que le projet
échoue.
L'entreprise prend un risque, elle a donc une prime de risque qui est ici de 300%.
Pour les puristes, nous notons bien évidamment que , car soit le projet réussi, soit il échoue (cf.
Bernoulli) ; pour simplifier la chose, nous n'envisageons pas de solution intermédiaire (comme un "petit
succès"). Pour concrétiser la chose, nous pouvons supposer que (30% de chance que le projet
aboutisse sur un succès). Ainsi, l'espérance du gain est de , soit
un gain espéré de 20% (donc mathématiquement, il faut prendre ce risque puisqu'il est très supérieur au taux
non risqué).
[Voir aussi :évaluation d'entreprise, risque, théorie des jeux.
Dans VERNIMMEN /
Prime de risque : La prime de risque d'un marché financier mesure l'écart de rentabilité attendue entre le marché dans
sa totalité et l'actif sans risque (l'obligation d'Etat). Dans la zone Euro, elle oscille entre 3 et 6 %. Pour déterminer la prime
de risque propre à chaque titre, il suffit ensuite de multiplier la prime de risque du marché par le coefficient bêta du titre
en question.
Prime de risque (pour plus de détail voir page 446)
La prime de risque d'un marché financier mesure l'écart de rentabilité attendue entre le marché
dans sa totalité et l'actif sans risque (l'obligation d'Etat). Dans la zone Euro, elle oscille entre 3 et 6 %.
Pour déterminer la prime de risque propre à chaque titre, il suffit ensuite de multiplier la prime de
risque du marché par le coefficient bêta du titre en question.
Equivalent anglais : Market risk premium, Risk premium
COMPETENCES / L'ART DE LA FINANCE - LES ECHOS
L'utilisation du CAPM
Trois informations sont nécessaires pour calculer le taux de rendement exigé en utilisant le CAPM :
- le taux d'intérêt des titres d'Etat, considéré comme le taux d'intérêt de référence d'un placement sans risque ;
- le bêta du projet (1) ;
- la prime de risque du marché actions, qui s'est historiquement située autour de 8 % en moyenne.
En retenant un taux d'intérêt réel de 3 % et un projet ayant un bêta de 0,6, le taux de rentabilité exigé serait de
7,8 % (soit 3 + 0,6 x 8 %). Si le bêta était de 1,0, le taux de rentabilité exigé serait de 11 % (soit 3 + 1,0 x 8 %).
La plupart des projets comportent un niveau de risque qui est différent du bêta des actions de l'entreprise. Cela
s'explique notamment par le fait que les entreprises ont généralement recours aux emprunts pour assurer une
partie de leurs besoins de financement, ce qui augmente le niveau de risque associé à leurs actions. Afin
d'évaluer le niveau de risque associé à un projet d'investissement, il est donc nécessaire de recalculer le bêta
des actions de l'entreprise en éliminant l'impact de l'endettement. Le bêta de l'activité de l'entreprise correspond
à la moyenne pondérée du bêta des actions et du bêta de l'endettement, chaque bêta étant pondéré en fonction
de la quote-part de fonds propres et de dette au sein des capitaux permanents.

Si l'on retient comme hypothèse que le niveau de risque attaché aux dettes de l'entreprise est extrêmement
faible, se traduisant par un bêta proche de zéro, le bêta de l'activité est égal au bêta des actions multiplié par la
quote-part de fonds propres (exprimé en valeur de marché) au sein des capitaux permanents. Prenons
l'exemple d'une entreprise dont les actions ont un bêta de 0,6 et dont les capitaux permanents sont composés à
hauteur de 83 % de fonds propres et à hauteur de 17 % de dettes. Le bêta de l'activité sera égal au bêta des
actions multiplié par le pourcentage de fonds propres sur le total des capitaux permanents, soit 0,5 (0,6 x 0,83).
Ce bêta de 0,5 est appelé « bêta des actifs ». Pour estimer le coût des fonds propres de l'entreprise, il convient
d'utiliser le bêta des actions, mais pour évaluer le coût du capital de l'activité sous-jacente, le bêta des actifs
doit être retenu.
Pour les projets sans risque, donc, les flux de trésorerie devraient être actualisés en retenant le taux d'intérêt
des placements sans risque. Si l'on considère que la prime de risque exigée à l'avenir sera similaire à la prime
moyenne observée par le passé pour les projets dont le niveau de risque est équivalent à celui d'un placement
en actions, le taux d'actualisation appliqué aux flux de trésorerie devrait être égal au taux d'intérêt sans risque
majoré de 8 points (par exemple). Selon la même logique, pour les projets comportant un niveau de risque
intermédiaire, un taux d'actualisation intermédiaire doit être utilisé.
Modèle de valorisation
Afin de mettre en oeuvre cette approche, il est nécessaire de convenir de la méthode à utiliser pour évaluer le
niveau de risque représenté par un investissement. Cela aurait été difficile avant les années 60, décennie au
cours de laquelle la théorie financière a considérablement progressé.
En effet, au début des années 60, en se basant sur les travaux de Harry Markowitz et James Tobin, Bill Sharpe
a mis au point le Capital Asset Pricing Model (CAPM), un modèle simple mais performant permettant d'établir
une corrélation entre le rendement attendu d'un actif et le risque correspondant, tout en définissant de façon
précise à quoi correspond le risque.
Le CAPM repose sur un principe fondamental, à savoir que les investisseurs peuvent s'attendre à être
rémunérés pour la part du risque associé au portefeuille qu'ils doivent assumer en contrepartie de leur
placement. En revanche, ils ne peuvent pas espérer une telle rémunération, au titre de leur exposition aux
risques, si celle-ci a été atténuée au moyen d'une diversification des valeurs détenues dans le portefeuille.
Ainsi, le taux de rendement exigé sera plus élevé pour les placements comportant une part plus importante de
risques non susceptibles d'être diversifiés.
Deux types de risques
Un portefeuille composé de titres d'un seul émetteur sera nettement plus volatil qu'un portefeuille diversifié. La
détention d'un nombre important de titres diversifiés permettra donc aux investisseurs d'éliminer les risques
spécifiques à une entreprise. Cependant, la diversification connaît des limites en tant que technique de maîtrise
des risques. En supposant que l'investisseur détienne des titres de toutes les entreprises cotées en Bourse, le
portefeuille continuera néanmoins de comporter un niveau de risque assez élevé. Ainsi, la diversification permet
d'éliminer les risques spécifiques à une entreprise mais non le risque de marché actions.
Le cours d'une action fluctue sous l'influence de deux facteurs de risque. Le premier est le risque de marché
actions, qui est dû au fait que le cours d'une action a tendance à suivre le mouvement général observé sur le
marché. Le second est le risque spécifique, correspondant à l'ensemble des événements qui sont propres à
une entreprise donnée et sans lien avec les facteurs ayant un impact sur le marché boursier dans son
ensemble.
Les investisseurs n'aiment pas prendre de risque et n'en prendront pas à moins d'être rémunérés en
conséquence. Devant l'impossibilité d'éliminer le risque de marché en diversifiant leur portefeuille, ils exigent
donc un taux de rendement plus élevé sur leurs placements en actions. Dans le CAPM, le risque de marché
actions est représenté par le bêta.
Le cours d'une action ayant un bêta de 1,0 a tendance à suivre les fluctuations du marché. Pour une action
ayant un bêta de 1,5, le cours augmentera ou baissera de 1,5 point à chaque fluctuation d'un point observée
sur le marché dans son ensemble.
La figure 3 présente les bêtas déterminés récemment pour un échantillon d'entreprises très connues. Certaines
de ces entreprises ont un bêta de 1,5 voire plus et constituent des placements boursiers offensifs. Si le marché
est en hausse, les cours de ces actions augmenteront encore plus vite et si le marché baisse, ils enregistreront

une chute encore plus forte. D'autres entreprises ont un bêta de 0,5 voire moins et constituent des placements
défensifs. Leurs cours devraient bien se comporter dans un marché baissier, mais dans un marché en hausse
leur potentiel haussier sera moins important. La plupart des entreprises de l'échantillon ont toutefois un bêta
proche de la moyenne, soit 1,0.
Taux de rendement exigé
Pour estimer le taux de rentabilité exigé d'un investissement, il est nécessaire de déterminer le bêta du projet.
La tâche sera plus facile si le projet correspond à la création d'une activité globalement identique à celle menée
déjà par l'entreprise, mais à une plus petite échelle. Elle sera également plus aisée si le projet est du même
type que ceux réalisés dans le secteur d'activité concerné et pour lesquels des bêtas sont déjà disponibles.
Un projet d'investissement ayant un bêta de 0 ne comporterait pas de risque et les flux de trésorerie devraient
donc être actualisés en fonction du taux d'intérêt des placements sans risque. Un placement dans un fonds
composé d'instruments ayant pour actif sous-jacent des indices boursiers comporterait le même risque qu'un
placement direct en Bourse, soit un bêta de 1,0.
Le taux de rendement exigé d'un tel placement serait égal au taux d'intérêt des placements sans risque majoré
de la prime de marché actions attendue.
Prenons le cas d'un projet de construction d'une centrale électrique dont le bêta est estimé à 0,6. Ce dernier est
égal au bêta d'un portefeuille placé à hauteur de 40 % dans des bons du Trésor et à hauteur de 60 % dans des
actions.
Selon le CAPM, le taux de rentabilité exigé devrait donc être égal au taux de rendement des bons du Trésor
auquel s'ajoutent 60 % de la prime de marché actions.
En règle générale, selon le CAPM, le taux de rentabilité exigé d'un investissement est égal au taux d'intérêt d'un
placement sans risque majoré d'une prime de risque. La prime de risque est égale au bêta multiplié par la prime
de marché actions.
La plupart des projets comportent un niveau de risque qui est différent du bêta des actions de l'entreprise. En
conséquence, l'utilisation du même taux d'actualisation pour tous les projets réalisés par l'entreprise peut
conduire à des décisions d'investissement inappropriées.
La corrélation entre le taux de rendement exigé et le bêta est reproduite dans la figure 4 (page précédente) par
la courbe intitulée « Coût du capital ajusté d'un facteur de risque ». La figure permet de constater que le taux de
rendement exigé augmente au fur et à mesure de l'augmentation du bêta (lire en page VIII « L'utilisation du
CAPM »).
Risque lié au projet
Certaines entreprises utilisent le même taux d'actualisation pour tous les projets, malgré le fait qu'elles
excercent des activités qui présentent des risques très différents. Une telle pratique peut conduire à des
décisions d'investissement inappropriées.
La figure 4 explique pourquoi. La courbe montante, exprimant le coût du capital ajusté d'un facteur de risque,
représente la relation entre le taux de rendement exigé et les différents niveaux de bêta qui peuvent être
attribués à un projet. Les projets dont le taux de rendement attendu se situe au-dessus de cette courbe
devraient être autorisés et ceux dont le taux est placé en dessous de la courbe devraient être abandonnés.
Un projet à haut risque, tel que le Projet A, serait autorisé à tort par une entreprise qui utilise un seul taux
d'actualisation quel que soit le projet. En effet, si son taux de rendement attendu était ajusté pour tenir compte
des risques, il serait rejeté. De même, un projet à faible risque, tel que le Projet B, serait rejeté à tort si sa
rentabilité était évaluée en fonction du coût global du capital de l'entreprise, alors qu'il aurait été autorisé si sa
rentabilité attendue avait été corrigée pour tenir compte des risques.
Il existe d'autres méthodes d'évaluation du « coût du capital ajusté d'un facteur de risque », mais le CAPM
continue d'être très largement utilisé dans le cadre de l'évaluation des entreprises et des projets, ainsi qu'à des
fins réglementaires.
Ainsi, le coût du capital peut être évalué en appliquant le modèle de valorisation des opérations d'arbitrage, le
modèle de valorisation des options ou celui fondé sur la croissance des dividendes. Mais l'approche basée sur

le CAPM est celle qui est la plus couramment employée. *
(1) Le bêta du projet peut être déterminé en fonction d'informations fournies, par exemple, par le service
d'évaluation des risques de la London Business School.
Les chimères de l'allocation d'actifs
Les données historiques montrent que les actions constituent un véhicule d'investissement plus intéressant que
les obligations. En outre, elles ne seraient pas sensiblement plus risquées. Pourtant ces arguments se trouvent
aujourd'hui contestés par plusieurs analystes.
Rien qu'aux Etats-Unis, les fonds de pension gèrent plus de 4.000 milliards de dollars de produits de retraite.
Principale préoccupation de ces investisseurs à long terme : la répartition optimale des capitaux entre les
différentes classes d'actifs, par exemple entre les actions et les obligations d'Etat. Cet article expose la position
de la théorie financière sur l'allocation d'actifs à long terme et les raisons pour lesquelles la pratique se
démarque souvent de ces recommandations théoriques.
Un bon point pour les actions
Afin de comparer les différentes opportunités d'investissement, il convient avant tout d'étudier le couple
risque/rendement.
Pour évaluer les avantages découlant de la détention de tel ou tel type de valeur mobilière, il suffit de calculer
son rendement annuel moyen. Si tout le monde, ou presque, sait que les actions se sont toujours révélées plus
avantageuses que les obligations, peu de personnes savent jusqu'à quel point.
Ainsi, sur la période 1926-1993, le rendement annuel réel (c'est-à-dire corrigé de l'inflation) du marché actions
américain était de 6,6 %, soit beaucoup plus que le rendement annuel moyen des obligations d'Etat à long terme
(à peine 1,7 %). La différence de 4,9 points de pourcentage entre les deux s'appelle « la prime de risque ». Le
marché américain n'est pas le seul dans ce cas ; le rendement annuel du marché actions britannique
s'établissait à 5,7 % sur la même période contre 1,1 % pour les obligations, soit un écart de 4,6 points !
Ces résultats alléchants ne signifient pas, bien sûr, qu'il faille mettre tous ses oeufs dans le même panier et
investir la totalité de son capital en actions.
En effet, il est probable que la supériorité de performance des actions sur celle des obligations intervienne en
compensation du risque plus élevé qu'elles présentent. En d'autres termes, si les actions affichent une meilleure
performance en moyenne, elles peuvent très bien, sur une année donnée, nettement sous-performer les
obligations. Puisque les actions offrent un rendement nettement supérieur à celui des obligations, elles
devraient, selon toute logique, être également beaucoup plus risquées. Or, sur une longue période, les chiffres
tendent à prouver le contraire.
Jeremy Siegel, de la Wharton School de l'université de Pennsylvanie, a étudié les rendements des obligations et
actions américaines depuis 1802 (lire L'Art de la Finance n^o1). Ses conclusions sur le profil de risque des
actions sont pour le moins surprenantes.
Entre 1802 et 1992, le meilleur rendement réel offert sur une année était de 66 % pour les actions et de 35 %
pour les obligations, le plus faible de - 39 % pour les actions et de - 21 % pour les obligations. Jusque-là, rien de
nouveau. Ces chiffres ne font que confirmer que les actions sont un investissement plus risqué : le spread des
actions est plus important que celui des obligations.
Toutefois, pour l'investisseur à long terme, ce calcul n'est peut-être pas le plus pertinent. Il préférera étudier le
rendement sur 20 ans plutôt que sur une année. Or le rendement réel le plus élevé sur 20 ans est de 12 % sur
12 mois pour les actions et de 9 % pour les obligations, et le plus faible de 1 % pour les actions contre - 3 %
pour les obligations.
En d'autres termes, sur 20 ans, les actions ont toujours offert un rendement réel positif, ce qui n'est pas le cas
pour les obligations. Qui plus est, l'écart entre le rendement le plus élevé et le rendement le plus faible est
moindre pour les actions que pour les obligations. Contre toute attente, les actions semblent donc moins
risquées à longue échéance que les obligations.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%