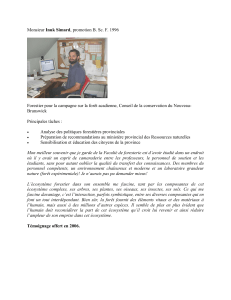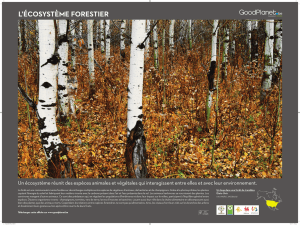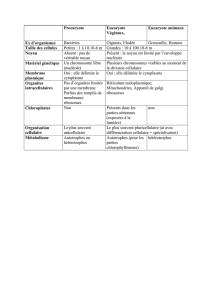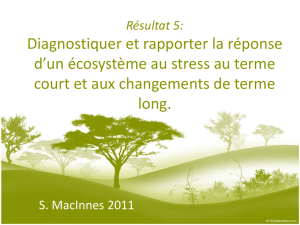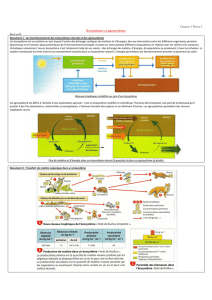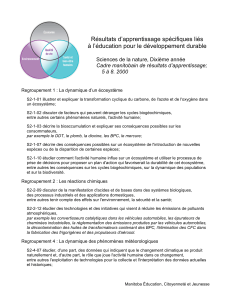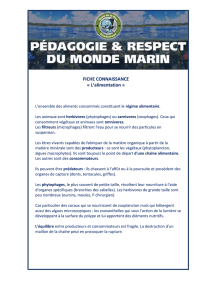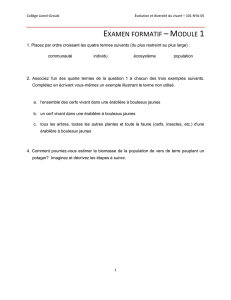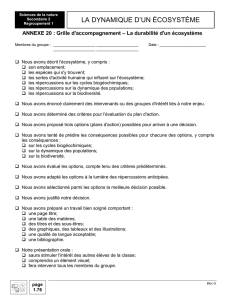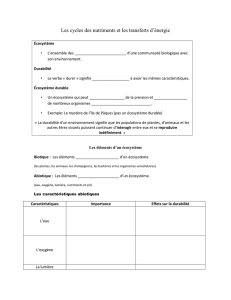OCR Document

Organisation fonctionnelle d’un écosystème
Tout écosystème comporte un ensemble d'espèces vivantes qui peuvent êtres répartis en trois groupes,
selon les modalités de leur nutrition. Les plantes chlorophylliennes, capables de réaliser la photosynthèse,
qui se satisfont d'éléments minéraux pour synthétiser les substances biochimiques indispensables à leur
croissance et à leur reproduction, sont de ce fait dénommées autotrophes (étymologiquement: qui se
nourrit lui-même). L'ensemble des végétaux autotrophes d'une communauté (ou du phytoplancton dans les
biotopes aquatiques) représente les producteurs de l'écosystème, terme d'ailleurs impropre
. car leur fonction consiste avant tout en une transformation d'énergie lumineuse en énergie _ chimique.
! Par ailleurs, un écosystème renferme toujours un ensemble d'organismes hétérotrophes, _ lesquels
exigent pour leurs besoins trophiques la présence de matières organiques. Ces derniers présentent une
activité métabolique largement complémentaire de celle des autotrophes.
'! On distingue deux catégories d' hétérotrophes. Celle des consommateurs correspond _ aux animaux. Ces
derniers possèdent un régime alimentaire macrophage: ils ingèrent _ des aliments figurés, soit végétaux
(herbivores) soit animaux (carnivores). L'autre caté_ gorie est constituée par les décomposeurs. Ce sont
des micro-organismes ou des végétaux i_ pluricellulaires de petite taille: bactéries et champignons. Les
décomposeurs sécrètent _ des substances enzymatiques qui dissolvent les matières organiques mortes, les
excréta des animaux et d'autres détritus (digestion extracellulaire) et absorbent les lysats qui résultent de
l'action de leurs exoenzymes. Comme ils présentent en outre une activité physiologique intense,
caractérisée par un métabolisme beaucoup plus rapide que celui des autres hétérotrophes, ils réalisent une
prompte minéralisation des déchets organiques, lesquels sont ainsi recyclés et réutilisés par les
producteurs.
Un lac (figure 1.38) constitue un exemple fort illustratif d'écosystème:
- le biotope lacustre est la résultante de sa localisation géographique, des conditions
climatiques propres à ce dernier, de la nature géologique de son substrat, enfin des
caractéristiques physico-chimiques de ses eaux;
- la biocœnose lacustre correspond à l'ensemble de la communauté vivante aquatiques: plantes macrophytes
(Roseaux, Nénuphars, par exemple), algues microscopiques du phytoplancton; microcrustacés (Daphnies,
Copépodes, par exemple) et Rotifères du zooplancton, poissons herbivores et carnivores, bactéries
hétérotrophes et champignons saprophytes des eaux et des sédiments.
Le seul flux d'énergie entrant est constitué par le rayonnement solaire qui est converti
en matière vivante et donc en énergie biochimique par le phytoplancton et les macrophytes aquatiques
grâce aux sels minéraux dissous dans l'eau. Cette matière vivante et l'énergie qu'elle renferme sont ensuite
incorporées dans les «chaînes alimentaires» de consommateurs : plancton, poissons herbivores et
prédateurs. Enfin, les micro-organismes (bactéries et champignons) contenus dans les eaux et les couches
superficielles des sédiments décomposent et minéralisent la matière organique après la mort des végétaux
et des animaux aquatiques.
Il résulte de ces liens trophiques dans un écosystème que les relations énergétiques entre ces trois
catégories sont toujours univoques, et vont toujours dans le sens:
autotrophes --hétérotrophes
ou de façon plus complète:
autotrophes -consommateurs -décomposeurs
de sorte que le schéma d'écoulement de l'énergie dans un écosystème correspond toujours à un modèle
thermodynamiquement ouvert (figure 1.39).
Les trois catégories précédentes d'organismes se rencontrent dans tous les écosystèmes. Elles

constituent, sur le plan écologique, les trois «règnes» fonctionnels de la nature, caractérisés chacun par un
type de nutrition et le recours à une source d'énergie particulière. L'un des domaines les plus originaux de
l'écologie, par rapport aux autres sciences biologiques, est celui de l'étude des relations obligatoires,
qu'elles soient causales ou d'interdépendance, entre les trois catégories d'êtres vivants que renferme
chaque biocœnose.
L'écosystème constitue en définitive l'unité structurale de base de la biosphère. Chacun couvre une
surface terrestre ou océanique dans laquelle règnent les conditions homogènes, quelle que soit son
étendue. Ses dimensions peuvent se chiffrer en ares ou en milliers de kilomètres carrés, - en épaisseur, ils
peuvent occuper quelques centimètres (sols désertiques), des dizaines de mètres (forêts ombrophiles
tropicales), voire des kilomètres (milieu océanique).

1
/
3
100%