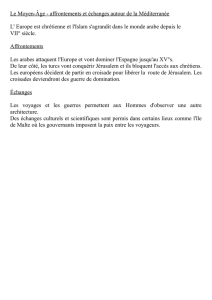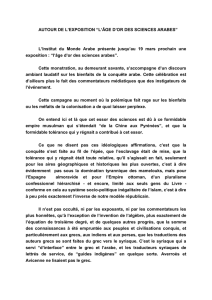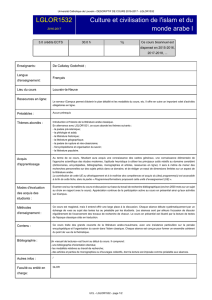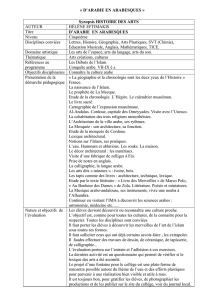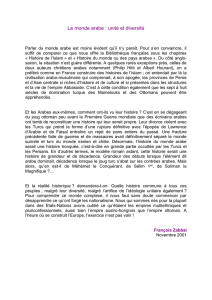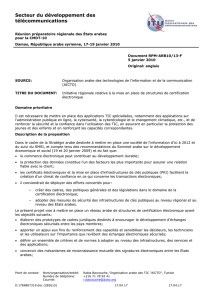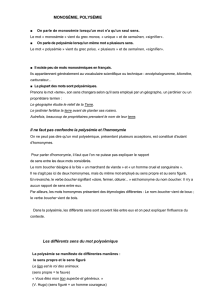formulerons des esquisses de comparaison avec les concepts

Regards croisés des linguistes autour de la polysémie :
exemple de l’arabe et du français
La question des représentations du sens occupe une place centrale dans une langue arabe
auscultée par linguistes, grammairiens et théologiens depuis de nombreux siècles. Nous
voudrions réinterroger ces représentations en adoptant une double position : comparative et
diachronique. La dimension comparative permet de mettre en regard les méthodes des
linguistes français et celles des linguistes arabes sur la place des sens dans la langue.
L’approche diachronique des sens amène parallèlement à restituer à la langue arabe une
polysémie souvent occultée et à montrer comment le phénomène de l’anachronisme,
massivement utilisé au cours de l’histoire et jusqu’à nos jours, est source de conflits.
La comparaison avec la façon d’aborder la polysémie chez certains spécialistes de la langue
française nous donne des pistes de réflexion intéressantes et jusqu’à maintenant très peu
exploitées pour la langue arabe. Le fait que la construction nouvelle de sens ne rejette pas
l’ancien, mais puisse le cumuler est une option qui n’a pas encore fait débat pour la langue
arabe. Les approches arabes sont en effet restées segmentées et pèchent par une vision
tronçonnée. La globalité du concept de polysémie n’a jamais été abordée dans une perspective
globale d’évolution de la langue et n’a jamais été replacée dans la vision dynamique et
cumulative de la langue telle qu’elle est conçue par certains linguistes français.
Il est donc délicat actuellement de proposer différents sens à un moment où le courant
dominant est d’imposer des conceptions standard du sens. Les traductions, elles-mêmes, sont
la plupart du temps, influencées par des compréhensions figées et amènent à des impasses.
Nous aimerions le mettre en évidence et montrer comment il est possible de restituer une
polysémie (actuellement désactivée) à travers quelques exemples de vocables qui nous
serviront de laboratoire.
Le mot ra est particulièrement emblématique de cette situation. La soi-disant interdiction
de la photo dans l’islam provient justement de l’amalgame entre le mot ra, dans son sens
moderne qui signifie la « photo » ou l’« image » et le même mot ra, mais dans son sens
ancien qui désignait les « tatouages ». C’était une façon pour l’islam de construire une
cohésion plus forte au sein de la communauté musulmane aux dépens de l’appartenance
tribale. Les femmes de chaque tribu étaient, à l’époque, reconnaissables à leur tatouage. S’il y
a interdiction dans l’islam, elle porte sur l’affichage des signes d’appartenance tribale
(tatouages) et non pas sur l’image. Nous pourrons aussi nous appuyer sur d’autres vocables,
tels que isl m ou encore siy a.
Une des conséquences de ce phénomène de désactivation des mots polysémiques est que la
compréhension globale des textes anciens se fait par le biais de mots compris dans leur sens
actuel sans lien avec leurs perceptions plus anciennes. Ce décalage crée un anachronisme qui,
certes, permet une utilisation de mots dans leur conception moderne et permet un
« rajeunissement sémantique » des textes de référence anciens, mais consacre en même temps
une perte polysémique, du fait qu’ils sont utilisés avec leur seul sens moderne. La non-prise
en compte de l’historicité qui a fait évoluer les sens favorise donc les amalgames.
La restitution de la pluralité des sens s’avère être actuellement essentielle, non seulement à la
sauvegarde de la richesse de la langue arabe et de la pluralité de la pensée arabo-musulmane,
mais aussi à la qualité de leur traduction en français.

Bibliographie
An s, Ibr h m
1965, Al-laha t al- arabiyya (« Les dialectes arabes »), éd., Maktabat al-an l
al-ma riyya, Le Caire, 349 p.
Berque, Jacques
1990, rééd. 1995, 2ème édition, Le Coran, éd., Albin Michel, Paris, 835 p.
Kleiber, Georges
1999, Problèmes de sémantique, éd., Presses Universitaires du Septentrion, Nancy
220 p.
Ribhi, Kamal
1975, L’homonymie des opposés en arabe à la lumière des langues sémitiques
(« At-ta d d f hw’i al-lu t al-s miyya »), éd., D r al- arabiyya, Beyrouth, 156 p.
Victorri, B. & Fuchs, C.
1996, La polysémie, construction dynamique du sens, éd., Hermès, Paris, 220 p.
1
/
2
100%