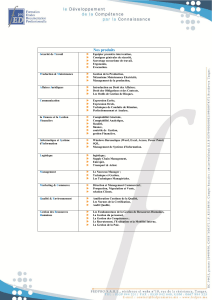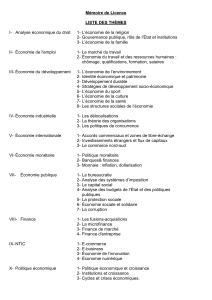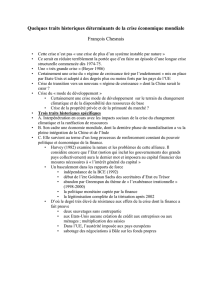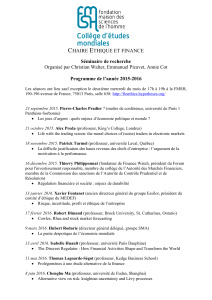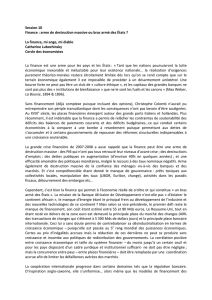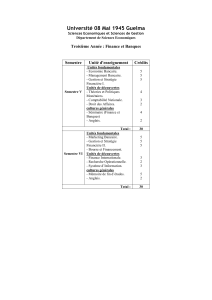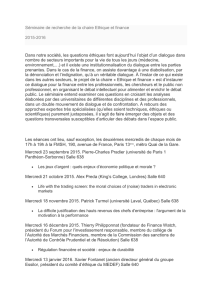imedia 9330

Spéculation immobilière, ralentissement économique
Quand la finance prend le monde en otage
Par Frédéric Lordon Le Monde diplomatique Septembre 2007
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/09/LORDON/15074
« La tourmente que traversent actuellement les marchés
financiers va peser sur la croissance mondiale », estime le
directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI),
M. John Lipsky. Plus soucieux que lui de rassurer l’opinion (et les
investisseurs), les gouvernants des Etats-Unis, d’Europe et du
Japon prétendent que les fluctuations boursières ne
constitueraient qu’un simple accident de parcours dans un ciel
dégagé. L’agitation a été enclenchée par la faillite aux Etats-Unis
d’un marché de l’immobilier gorgé de crédits distribués sans
discernement : pour le seul segment des prêts les plus risqués,
dits « subprime », les créances hypothécaires en circulation
atteindraient 1 300 milliards de dollars ; de un à trois millions
d’Américains pourraient devoir vendre leur habitation. Propageant
le risque à l’ensemble de l’économie mondiale, une innovation
financière débridée a, tour à tour, favorisé la bulle immobilière, la
crise du logement et la spéculation. Un nouveau relâchement du
crédit contiendrait peut-être (ou différerait) certains des dégâts.
Mais il encouragerait à la récidive les « mathématiciens fous de
Wall Street ». La prochaine crise est-elle donc déjà annoncée ?
Hegel, il y a deux siècles, déplorait l’incapacité chronique des
Etats à tirer les leçons des expériences de l’histoire. Les
gouvernements ne sont pas les seules puissances incapables
d’apprentissage. Le capital – tout particulièrement financier –
semble lui aussi condamné à la persévérance dans l’erreur, à
l’aberration récurrente et à l’éternel retour de la crise financière.
Quoique portant sur des « objets » nouveaux, la crise actuelle
des marchés de crédit donne à voir une fois de plus les
ingrédients chimiquement purs du désastre, offrant à qui voudra
bien s’en saisir une occasion de plus de méditer sur les «
bienfaits » de la libéralisation des marchés de capitaux.
C’est qu’il faut tout de même avoir la foi chevillée au corps pour
continuer de chanter, contre toute évidence, les vertus de la
financiarisation qui répand la prospérité générale, contribue à la
stabilité économique et au progrès du genre humain. Mais la
croyance financière ne désarme pas facilement et, elle qui se
targue d’être le principe de réalité incarné, elle qui soumet les
entreprises à la seule « validation par les faits », sous les critères
du reporting (livraison trimestrielle des comptes) et du track
record (« historique » des performances), demeure bêtement
ignorante de ce que l’histoire récente – sa propre histoire – lui
livre, de manière pourtant accablante. C’est qu’en effet le track
record de la libéralisation financière n’est pas bien fameux... Il
faut tout de même rappeler que, depuis qu’elle sévit, il aura été
difficile de passer plus de trois ans d’affilée sans un accident
majeur, presque chaque fois appelé à entrer dans les livres
d’histoire économique : 1987, krach mémorable des marchés
d’actions ; 1990, krach des « junk bonds » (« obligations pourries
») et crise des Savings and Loans (caisses d’épargne
américaines) ; 1994, krach obligataire américain ; 1997, première
tranche de crise financière internationale (Thaïlande, Corée,
Hongkong) ; 1998, deuxième tranche (Russie, Brésil) ; 2001-
2003, éclatement de la bulle Internet...
Et nous voici en 2007. Lecture des dévots : « Une mondialisation
heureuse mais heurtée (1)»... Dans Le Monde, Pierre-Antoine
Delhommais se gargarise de la résilience de la bête face à tant
de secousses majeures, dont on s'est chaque fois demandé si
elles n'allaient pas la tuer, et qui, chaque fois, non seulement se
relève mais repart de plus belle. Le fait est qu'on ne peut pas ne
pas être étonné avec lui. A ceci près que le journaliste oublie ce
qu'il en a coûté à chaque fois aux salariés de régler les ardoises
de l’ébriété financière. Car, invariablement, la dégringolade des
marchés frappe les banques, donc le crédit, plus l'investissement,
la croissance... et l'emploi.
Aussi faudra-t-il sans doute une reprise de son journal par un
fonds d'investissement un peu brutal pour que, faisant
l'expérience concrète du « downsizing » («dégraissage»),
Delhommais soit plus incité à faire le compte du cumul de points
de croissance perdus et d'emplois détruits du fait des pratiques
de la finance et (plus encore) de ses crises, et que les « heurts »
de la mondialisation lui deviennent personnellement pénibles
pour cesser de la trouver « heureuse ».
La crise des marchés du crédit qui frappe l'économie américaine
offre pourtant un panorama presque idéal des enchaînements
fatals de la spéculation libérée. Comme à la parade défilent à
nouveau les toxines générales de la finance, toujours les mêmes
et identiquement ordonnancées : 1. les tendances « Ponzi » de la
spéculation ; 2. le laxisme de l'évaluation des risques dans la
phase haussière du cycle financier; 3. la vulnérabilité structurelle
à une petite modification d'environnement et l'effet catalytique
d'une défaillance locale qui précipite le retournement ; 4. la
révision en catastrophe des évaluations ; 5. la contagion latérale
des doutes à d'autres compartiments du marché ; 6. le choc sur
les banques trop exposées ; 7. la menace d'un accident
systémique, c'est-à-dire d'un effondrement global, puis d'une
récession généralisée par strangulation du crédit... et l'appel au
secours adressé aux banques centrales par tous ces grands
fanatiques de la libre initiative privée...
1. Les tendances « Ponzi » des marchés
Nul probablement mieux que Hyman Minsky n'a mis en évidence
cet enchaînement de la finance des marchés, résumé par lui
sous l'appellation parlante d'« aveuglement face au désastre »
(2). Or Minsky prête une particulière attention aux déboires de
Charles Ponzi, spéculateur des années 1920, qui avait écrémé
l'épargne de gogos alléchés par des promesses de rendements
extraordinaires. Faute de tout actif réel capable de livrer les
performances annoncées, Ponzi servait ses premiers clients non
pas avec d'inexistants dividendes... mais avec le capital apporté
par les derniers arrivés, la « soutenabilité » de l'ensemble
supposant donc de maintenir impérativement un flux de
nouveaux entrants !
A l'escroquerie près, c'est sur un mécanisme assez semblable
que reposent toutes les bulles, qui nécessitent un afflux constant
de liquidités investies pour maintenir un marché haussier et
l'illusion que tout le monde y gagne. L'enrôlement spéculatif, voilà
le secret de la bulle, et, bien sûr, passé l'engagement des
premiers initiés, ce sont des agents de plus en plus ordinaires,
donc de moins en moins avertis - mais de plus en plus nombreux
- qui sont invités à former le gros des bataillons.
Pour que se prolonge, si possible ad aeternam, la croissance du
marché immobilier américain, il fallait donc que des cohortes
toujours plus importantes de ménages soient poussées vers le
marché de l'emprunt hypothécaire. Il n'a pas été trop difficile, rêve
américain de la propriété aidant, de les y convaincre au départ, et
cela d'autant plus qu'échaudés par la débâcle des actions de la
bulle Internet les ménages étaient à la recherche d'autres
formules d'investissement. Mais le contingent des emprunteurs «
sains » étant vite épuisé, et le marché devant impérativement
être soutenu, les courtiers de prêts immobiliers sont allés de plus
en plus loin chercher de nouvelles recrues... Pieds plats ?
asthmatiques ? décalcifiés ? P4 ? Pas de problème, bons pour le
service ! Et comment la guerre ne serait-elle pas fraîche et
joyeuse ? Les acquéreurs entrent en rangs serrés sur le marché
et les prix s'envolent.
Même si on ne peut pas rembourser, se disent uniment ménages
et courtiers, on revendra la maison avec plus-value pour les uns
et commission pour les autres. Et puisque, sur la foi de la
croissance indéfinie du marché, tout le monde finit par être
déclaré apte, les robinets du crédit sont maintenant grands
ouverts, et la hausse spéculative ainsi nourrie semble donner
raison à tous. Voilà comment émerge la catégorie, appelée à
passer à la postérité, des « subprime mortgages », ces prêts
immobiliers dont les attributaires, inconnus des établissements de
crédit, sont d'une solvabilité plus que douteuse. Et puisque
l'euphorie est à son comble, toutes les limites s'offrent à être
franchies : en la matière, on fera difficilement mieux que les prêts

dits « Ninja », pour « no incarne, no job or asset », soit « pas de
revenu, pas d'emploi ni d'actif (à mettre en garantie) », et le
Champagne en prime sans doute...
2. Le laxisme dans l'évaluation des risques
Mais la finance a de la ressource, ne se dit-elle pas d'ailleurs
experte en traitement des risques ? Le fait est en tout cas qu'elle
ne manque pas d'inventivité. Sa botte secrète ? Les « produits
dérivés ». Le problème d'un crédit, à plus forte raison quand il est
risqué, c'est qu'il reste dans les livres du prêteur jusqu'à
conclusion - bonne... ou mauvaise. La grande trouvaille, qui
remonte au début des années 1990, consiste à « fondre »
ensemble un certain nombre de crédits pour en faire une ligne de
titres obligataires négociables. Le grand avantage de cette
opération, adéquatement nommée « titrisation », tient au fait que
les titres ainsi « manufacturés » peuvent être vendus sur les
marchés par petits paquets aux divers investisseurs
(institutionnels) qui voudront bien les acheter. Voilà donc les
crédits douteux sortis du bilan de la banque - dont on comprend
maintenant qu'elle les accorde avec d'autant plus de légèreté
qu'elle sait pouvoir s'en débarrasser sitôt titrisés !
Mais pourquoi des investisseurs voudraient-ils acheter ce dont la
banque désire se défaire ? D'abord parce qu'ils les prennent par
plus petites quantités, et surtout parce que ces titres sont
négociables, c'est-à-dire susceptibles d'être à nouveau cédés.
Ensuite parce que la ligne de titres dérivée du groupe initial de
crédits est en fait découpée en différentes tranches de risques
homogènes. Selon son propre profil et son aversion pour le
risque, chaque investisseur institutionnel piochera dans la
tranche qui lui convient, sachant qu'il s'en trouvera toujours -
notamment les hedge funds (fonds d'investissement spéculatifs) -
pour vouloir de la tranche la plus risquée... puisqu'elle est aussi la
plus rémunératrice - tant que tout va bien.
Evidemment, tous les droits (flux financiers) et risques (de défaut)
attachés aux crédits initiaux sont transférés aux porteurs de ces
titres dits « RMBS » (residential mortgage backed securities, soit
« titres adossés à des crédits immobiliers »), mais ces porteurs
sont tellement nombreux - et changeants - qu'il en résulte une
formidable dispersion du risque global. Là où la banque
génératrice faisait face seule au défaut (de paiement) d'un de ses
prêts, non seulement elle en est maintenant totalement
débarrassée, mais les conséquences en sont fragmentées entre
une myriade d'investisseurs dont chacun n'assume qu'une part
tout à fait minime, qui plus est diluée dans l'ensemble de son
propre portefeuille.
(2. bis) Risques dilués... ou surmultipliés ?
Mais alors, dira-t-on, pourquoi s'alarmer si, avec la panacée de la
titrisation, la finance a résolu la quadrature du cercle ? Et ceci
d'autant plus que l'opération de titrisation va être réitérée à partir
des RMBS, dont les plus vilaines tranches demandent un
retraitement spécial pour être plus facilement écoulées. A partir
de leurs RMBS, certains investisseurs vont ainsi émettre une
nouvelle sorte de titres négociables, les CDO (collateralised debt
obligations). L'émission de CDO, titres dérivés de titres,
réarrange la fraction concernée du portefeuille de RMBS en
différentes tranches. La tranche supérieure, dite « investment
grade », soustrait ses porteurs aux premiers 20 ou 30 % de
défauts sur les crédits immobiliers initiaux. Suit une tranche
intermédiaire, dite « mezzanine », puis enfin une tranche basse
qui, elle, prendra le choc des premières défaillances.
On nomme pudiquement cette tranche « equity », mais le
langage des marchés dit les choses plus carrément : « toxic
waste », soit « déchets toxiques », voilà le nom réservé à ces
produits qui élèvent en quelque sorte le risque au carré puisqu'ils
représentent la tranche la plus risquée (des CDO) dérivée de la
tranche la plus risquée (des RMBS) tirée du portefeuille de
crédits initial... Mais tant que le marché immobilier monte et que
les ménages continuent de rembourser, il y aura toujours
preneur, puisque, la toxicité n'étant pas encore matérialisée, ne
restent que les formidables rémunérations.
Les hedge funds, qui peuvent lever des fonds à des taux plutôt
bas, investissent dans des titres à haut risque -qu'on croit pouvoir
revendre ad libitum tant que le marché est supposé liquide -et qui
rapportent en conséquence -c'est-à-dire beaucoup. Les marges
sont énormes, on prend les « déchets toxiques » pour de l'or et
les golden boys font la fête. Les profits faramineux masquent les
risques objectifs, que personne ne veut voir pour laisser vivre le
plus longtemps possible la vache à lait, et, pendant ce temps, les
courtiers immobiliers continuent de recruter à la pelle.
3. De la vulnérabilité structurelle à la défaillance qui frappe
les esprits
La dispersion des risques par les opérations de titrisation
empilées a fini par faire croire qu'ils n'existaient plus. C'est une
illusion. D'autant plus que cette douce ivresse a logiquement
induit, à la base, des comportements de plus en plus aventureux.
Puisque je me défais de mes crédits même les plus mauvais, se
dit le prêteur immobilier, autant y aller franchement ; et tant que le
marché des dérivés est liquide, se dit à l'autre bout le fonds
spéculatif, pourquoi ne pas prendre les CDO les plus défaillants
puisqu'ils sont aussi les plus juteux ? Les risques sont certes
dilués, mais la dilution même a poussé à la croissance totalement
incontrôlée de leur volume global, et la situation, pour finir,
devient de plus en plus critique.
La fragilité structurelle de l'édifice est maintenant telle qu'il
devient vulnérable à des modifications d'environnement a priori
insignifiantes. Les quarts de point supplémentaire de relèvement
de taux d'intérêt par la Réserve fédérale semblent infimes. Sauf
qu'à l'autre bout de la courbe des risques, le crédit immobilier de
Mrs Brimmage est passé de 6,3 % en 2005 à 11,25 %, et ses
mensualités de 414 à 691 dollars (3)... C'est plus qu'il ne lui en
faut pour aller à la cessation de paiement. Comme elle, 14 % des
emprunteurs « subprime » sont défaillants au premier trimestre
2007.
Pour être modestes, les hausses de taux d'intérêt de la banque
centrale ont un double effet de cisaillement. D'une part, il y a
moins de nouveaux entrants sur le marché immobilier et les prix
commencent à baisser; d'autre part, ceux qui y sont déjà voient
leurs mensualités devenir insupportables et la « sortie »
compromise. De fait, la réalisation de leur actif non seulement se
solde par une moins-value pour eux-mêmes, mais accentue la
pression baissière pour tout le monde.
Comme toujours dans les crises financières, un organisme
spécialisé boit le bouillon et c'est sa déconfiture qui, frappant les
esprits, donne le signal du grand retournement. En l'espèce, deux
défaillances - aux deux extrémités de la chaîne - viennent
dégriser les marchés. C'est d'abord la banque d'investissement
Bear Stearns qui doit fermer deux de ses fonds « dynamiques »,
sans doute un peu trop, et en fait dopés aux CDO. Mais c'est
aussi American Home Mort-gage Investment (AHMI), courtier
immobilier, qui doit carrément se mettre sous la protection du
chapitre XI de la loi sur les faillites (4). Cette mésaventure-là est
plus inquiétante que la précédente. Car AHMI n'est pas
spécialement engagé dans le compartiment des subprimes -
qu'est-ce que ça doit être ailleurs ?...
4. La révision en catastrophe de l'évaluation des risques
Cette fois, un léger vent de panique s'est levé. Les déchets
toxiques sentent déjà bien mauvais et l'on commence aussi à se
dire que les triples ou doubles A (5) des tranches « investment
grade » de CDO sont peut-être passablement frelatés. Mais
comment a-t-on pu en arriver à des erreurs d'évaluation aussi
monumentales ? Certes, la complexité objective de l'évaluation
des produits dérivés n'y est pas pour rien. Certes, c'est par
centaines que les agences de notation évaluent les tranches de
CDO et de RMBS. Pour autant, elles ne sont pas que ces bonnes
ouvrières ployant quelque peu sous l'ampleur de la tâche. Leur
chiffre d'affaires même leur vient des institutions financières,
émettrices en folie de ces titres à évaluer - 40 % des revenus
2006 de Moody's ont été réalisés avec les évaluations de
produits structurés... Or, pour qu'il y en ait de nouveaux à traiter,
il est sans doute préférable que les précédents soient déclarés
bien portants...
A quoi s'ajoute une démonstration supplémentaire que les
agences de notation n'ont jamais vraiment su être indépendantes
des engouements du marché, qu'il leur reviendrait de tempérer,
alors que, de fait, elles les ont la plupart du temps aimablement

accompagnés. C'est qu'il est difficile, quand on est si proche de la
finance, et qu'accessoirement on vit à son crochet, de crier «
casse-cou » quand tout le monde s'en met plein les poches...
Catastrophiquement procycliques là où elles devraient être
contraclyliques, les agences laissent faire à la hausse... et se
mettent, paniquées, à réviser dès que le retournement s'amorce,
contribuant ainsi à le changer en effondrement.
Et la crise n'en est probablement qu'à ses commencements.
C'est que les défaillances immobilières à venir des ménages
s'accumulent silencieusement dans l’antichambre des teasing
rates, ces taux d'appel très attrayants à l'aide desquels les
courtiers appâtent les chalands selon la règle dite des « 2 + 28 »
- les deux premières années au taux sympathique, les vingt-huit
suivantes au taux plein qui fait mal. On n'a donc pas encore vu
débouler la promotion 2006, et à peine celle de 2005, celles du
plus fort de la bulle immobilière, et qui vont sans doute faire des
étincelles. Tout comme les admirables fonds spéculatifs gavés de
leurs produits dérivés.
Et comme la mondialisation mondialise la finance, et avec elle la
bêtise financière, rien de tout cela ne se limite aux frontières
américaines. Certes, c'est bien là-bas que le marché
hypothécaire délire, mais la titrisation dérivée s'offre
magnifiquement à tous les fonds spéculatifs de la planète ! Les
Allemands, longtemps réputés ternes et ennuyeux, accrochés à
leurs banques de détail grisâtres, ont, au tournant du siècle,
décidé de devenir « modernes », et de s'orienter plus
franchement vers les activités de marché. Résultat des courses :
après le grand frisson de 1998 (risque russe), les raclées de
l'Internet (2001), voici qu'une banque, IKB, se trouve au bord de
la faillite pour cause de surexposition aux subprimes...
5. Contagion de la suspicion
Tout s'enchaîne maintenant d'un bout à l'autre du globe et des
marchés. Le fragile équilibre des produits dérivés résistait tant
que... personne ne le sollicitait, c'est-à-dire tant que tout le
monde feignait de croire liquide le marché où ils s'échangent.
Mais sitôt qu'un des acteurs souffre exagérément et commence à
vouloir se dégager en vendant ses CDO, la crainte latente se
cristallise et tous les acheteurs disparaissent. La liquidité
évaporée, les actifs, formellement négociables, cessent
pratiquement de l'être, et deviennent même inévaluables puisque
leurs prix peuvent virtuellement tomber à zéro.
Hilarant - avant qu'on en pleure -, le communiqué de BNP
Paribas qui, le 9 août, ferme trois de ses fonds -« dynamiques »
eux aussi : « La disparition sur certains segments du marché de
la titrisation aux Etats-Unis conduit à une absence de prix de
référence et à une illiquidité quasi totale des actifs [des fonds],
quelle que soit leur qualité ou leur rating (6). » Ce qui n'avait pas
empêché un instant M. Baudoin Prot, patron de la banque,
d'affirmer catégoriquement une semaine auparavant que la
liquidité des trois fonds était assurée. C'est dire surtout que
l'inquiétude dépasse largement le périmètre des produits les plus
risqués et contamine les tranches réputées les plus sûres.
Or la contagion ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Non
seulement elle gagne toutes les classes de risque dans le
compartiment des RMBS et dérivés, mais elle s'étend à d'autres
compartiments de marché, qui n'ont rien à voir avec celui-là. Sauf
de s'être adonnés, eux aussi, à l'orgie de crédits indiscriminés.
C'est tout particulièrement le cas du secteur de la private equity,
ces fonds d'investissement, vedettes de la finance de ces
dernières années, qui rachètent intégralement des entreprises
jugées prometteuses, les font sortir de la Bourse, les
restructurent au knout pour les revendre deux à quatre années
plus tard avec force plus-values.
Or ces fonds n'engagent que très peu de leurs capitaux propres
et « carburent » massivement à la dette - dont ils font d'ailleurs
payer le service par l'entreprise rachetée ! Les bénéfices qui en
résultent sont tout simplement exceptionnels. Ceux-ci ont atteint
de tels niveaux que les banques se sont littéralement précipitées
pour financer ces opérations. Dans un état de quasi-mystification
et persuadées qu'à tous les coups on gagne, elles ont consenti à
ces fonds des conditions d'emprunt proprement ahurissantes.
Ainsi celles des prêts dits « covenant-lite », c'est-à-dire allégés
de toutes les clauses respectant les ratios financiers
élémentaires, auxquelles sont normalement soumis les
emprunteurs - « faites n'importe quoi, nous vous suivons ! »...
Mieux encore, les prêts dits «PIK» (payment in kind), ou encore «
IOY» (I owe you), dont les intérêts et le principal sont remboursés
non pas en cash, mais en supplément de dette ajouté à la dette
initiale ! Les encours de crédit dirigés vers les fonds de private
equity ont ainsi atteint des volumes faramineux. O^ les opérations
de ce type sont particulièrement vulnérables au moment de leur
« débouclage » puisqu'il s'agit de ; revendre des actifs
notoirement « illiquides » : non pas des blocs d'actions mais des
entreprises tout entières ! Que vienne le premier accident de
débouclage" - revente impossible, différée, ou avec moins-value -
et tout le secteur de la private equity connaîtra à son tour son
moment de stupéfaction.
Des opérations de levée de fonds récemment lancées s'achèvent
plutôt laborieusement, par rapport à l'aisance triomphante des
mois précédents. C'est que les banques, de complices laxistes^
deviennent soudainement réticentes. Car, par un effet
d'amalgame typique des crises financières, la soudaine révélation
des risques dans un secteur suscite des interrogations dans
d'autres où l'euphorie a, à peu près, autant dégénéré. De même
que les déboires du Mexique en 1994 avaient induit le doute sur
la Thaïlande -pourtant pas la porte à côté !- par pur effet
d'amalgame avec la catégorie « marchés émergents », de même
ici l'immobilier produit des effets sur la private equity, qui n'a rien
à voir avec lui... sinon qu'il s'y est commis des excès à peu près
aussi pendables.
6. Choc sur les banques
Si elles ont réussi dans l'ensemble à se défaire de leurs
portefeuilles de crédits immobiliers par le jeu de la titrisation, les
banques encaissent tout de même le retour de manivelle, et par
de multiples voies. D'abord, elles ont laissé leurs fonds de
gestion se charger des produits dérivés, et le risque
hypothécaire, chassé par la porte, est revenu par la fenêtre. Mais
c'est aussi la contagion latérale qui les menace, et notamment via
la private equity, où elles sont, là, directement exposées.
Or la régulation prudentielle du secteur bancaire ne plaisante pas
: les banques sont priées de maintenir soigneusement des ratios
dits « de solvabilité » entre leurs capitaux propres et leurs
engagements. Si des moins-values, même latentes, se
manifestent - et les voici qui s'annoncent d'autant plus fortes que
les agences de notation sont en train de se réveiller et de revoir
toutes les évaluations à la baisse -, les banques doivent passer
dans leurs comptes les provisions correspondantes, et, pour
maintenir leurs ratios, il leur faudra réduire le dénominateur (les
crédits accordés) en proportion de la contraction du numérateur
(les capitaux propres entamés par les provisions).
Au total, et comme toujours, ce sont les agents de l'économie
réelle, entreprises et salariés, éloignés de toutes les turpitudes de
la spéculation, qui se retrouveront face à des robinets à crédit
fermés sans même comprendre ce qu'ils ont pu faire pour mériter
ça. Car, pour restaurer les bilans des banques, la contraction du
crédit sera générale, tous emprunteurs confondus.
7. Les banques centrales sont appelées à la rescousse
Ils ont maintenant fière allure les héros de la finance. Modernes
et arrogants quand les marchés étaient haussiers, les voilà, tel le
juge de Brassens face au gorille, « criant maman, pleurant
beaucoup », et se jetant dans le giron de la « mamma étatique »
qu'ils vomissent quand la fortune leur fait lâcher toutes les
vannes de la régurgitation idéologique. Certes, la banque
centrale, priée de venir les tirer de la déconfiture en baissant ses
taux pour restaurer la liquidité générale, n'est pas l'Etat lui-même,
mais elle est le pôle public, le « hors-marché », abhorré quand
les profits coulent à flots, supplié quand il fait mauvais temps.
Jim Cramer, qui tient sur la chaîne boursière CNBC une émission
de conseil financier tout en hurlements et en chemisette à
manches courtes, sur fond de hard rock saturé, de buzzers et de
bulls (7) en surimpression, pique une crise de nerfs (8), vitupérant
M. Ben Bernanke, le président de la Réserve fédérale, aux cris
de « eut ! eut ! (9) ». Et comme M. Bernanke semble prendre son

temps, M. Cramer lui décoche l'insulte suprême : il ne comprend
rien, car c'est un «universitaire» (académie) (10)...
Mieux habillés et moins ostensiblement vulgaires, les autres
gestionnaires de fonds interrogés sur la même chaîne sont tout à
fait d'accord. Ah ! que de regrets pour M. Alan Greenspan, qui «
coupait » les taux sans rechigner. Un vrai praticien, lui, pas
encombré d'inutiles études, et à qui il suffisait de tâter le cul de la
bête pour savoir qu'il fallait lâcher du lest.
Les moins dingues commencent pourtant à se dire que cette
longue tolérance monétaire aux excès de la finance n'a pas été
complètement étrangère à la formation et à l'accumulation des
risques qui crèvent aujourd'hui telles des bulles. Quant à M.
Bernanke, il semble pour l'heure plutôt d'avis de laisser les
opérateurs les plus imprudents supporter les conséquences de
leur inconséquence. Mais il ne faut pas s'y tromper. Cette
position du banquier central n'est tenable que si les défaillances
demeurent localisées. Qu'elles « coagulent » et précipitent un «
risque de système » - c'est-à-dire, par effet domino,
d'effondrement général -, et il n'aura pas d'autre choix que
d'intervenir, et massivement.
C'est bien là d'ailleurs le plus insupportable dans les méfaits de la
finance, toujours encouragée à aller trop loin, c'est-à-dire au-delà
du seuil où les autorités ne peuvent plus se désintéresser de ses
infortunes et doivent plonger pour lui sauver la mise - la parfaite
prise d'otages.
FRÉDÉRIC LORDON
Cet article est mis en débat sur notre site Internet, avec des
propositions de l'auteur : http://blog.mondediplo.net/-En-Debat-
Notes :
(1) Pierre-Antoine. Delhommais, Le Mande du 9 aoûi 2007
(2) Hyman P. Minsky, Stabilizing an Unstable Economy, Yale
University Press, New Haven, 1986.
(3) Gretchen Morgenson, « Mortgage maze may increase
foreclosures », The New York Times, 6 août 2007.
(4) Cette disposition permet aux entreprises de à pas sombrer en
les protégeant de créanciers trop impatients (moratoire des
dettes sociales). Elle déliç aussi l'employeur de ses engagements
et permet de renégocier les accords salariaux.
(5) La notation financière désigne par AAA et AA les titres les
plus sûrs.
(6) Communiqué BNP Paribas, 9 août 2007.
(7) Le taureau (bull) est l'animal représentatif de la hausse
boursière.
(8) CNBC, 3 août 2007; www.youtube.com/
watch?v=GKZgfrs!tmw
(9) C'est-à-dire « baisse ! baisse ! » (les taux d'intérêt).
(10) M. Ben Bernanke a un long passé d'économiste universitaire

Spéculation immobilière, ralentissement économique
Comment protéger l’économie réelle
Par Frédéric Lordon Le Monde diplomatique Septembre 2007
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/09/LORDON/15165
En complément de son article publié dans Le Monde
diplomatique de septembre, et qui analyse la crise financière
partie cet été du marché américain du crédit immobilier (lire «
Quand la finance prend le monde en otage »), Frédéric Lordon
livre, dans cet article exclusif pour notre site Internet, ses pistes
de réflexion sur la finance... et les moyens de limiter sa
suprématie.
Cet ensemble d’articles fait l’objet d’un débat sur notre site
http://blog.mondediplo.net/-En-debat- .
Il se pourrait qu’il y ait du vrai dans l’adage populaire voulant qu’«
à quelque chose malheur [soit] bon » — mais encore faut-il aller
débusquer ce « quelque chose » là où il se cache… De la crise
des marchés de crédit à laquelle assistent médusés les salariés,
pressentant confusément, mais pertinemment, qu’en bout de
course ce sont eux qui pourraient bien en faire les frais, on peut
au moins dire qu’elle offre une occasion, à ne louper sous aucun
prétexte, de prendre la mesure de ce qu’il en coûte de tout
accorder à la finance et de se décider enfin à lui briser les reins.
Or, seul le sidérant spectacle du tumulte des marchés, les
images des traders hystériques, des gestionnaires de fonds suant
l’angoisse et des banquiers centraux blafards d’insomnie
peuvent, à chaud, frapper suffisamment les esprits pour soutenir
une demande politique d’action contre la spéculation. La fenêtre
« spectaculaire » est hélas à peu près d’aussi courte durée que
les effets réels de la crise financière peuvent être longs (et
pénibles) à digérer. En témoignent la force des effets d’oubli et
l’incapacité à établir dans la conscience collective la connexion
entre les recrudescences successives de chômage et les
accidents financiers qui les ont précédées, et dont un décalage
de six mois suffit à faire perdre de vue qu’ils en ont été la cause.
Il y a lieu de croire que la libéralisation financière aurait passé un
sale quart d’heure si le corps politique avait clairement perçu le
lien de cause à effet entre la crise spéculative immobilière de la
fin des années 1980 — celle-là même qui a failli emporter le
Crédit Lyonnais — et le violent retournement conjoncturel du
début des années 90, entre les monumentales crises monétaires
qui ont manqué volatiliser le SME (Système Monétaire Européen)
en 1992-1993 et le pic assassin de chômage des années 1993-
1996, entre l’éclatement de la bulle internet en 2000 et la rupture
de croissance des années 2001-2004… Si donc la crise
financière de 2007 peut être d’une quelconque « utilité »
politique, et en attendant les dégâts qu’elle pourrait diffuser dans
l’épaisseur de l’économie réelle, c’est comme opportunité d’une
prise de conscience, préalable à une frappe politique.
1. Transparence » et « régulation », ou politique du « cause
toujours »
Du train où vont les choses, on n’en prend pourtant pas le chemin
— mais comment s’en étonner : pour ne pas être le plus grand
nombre, les ennemis de cette aperception demeurent sans aucun
doute les plus puissants. Il suffit pour s’en rendre compte de
considérer les dérisoires mesures que le président français
Nicolas Sarkozy met en regard de ses martiales déclarations
d’arraisonnement de la finance — c’est « Verdun, on ne passe
pas ! », mais armé d’un pistolet à bouchon… Le bouchon en
question est d’ailleurs passablement émietté pour avoir déjà trop
servi, puisqu’il s’agit de l’increvable appel à la « transparence ».
Argument de troisième zone, délibérément ignorant des
mécanismes fondamentaux des marchés, tels qu’ils expriment les
caractéristiques les plus profondes des structures actuelles de la
finance, la « transparence » — ou plutôt le « déficit de
transparence » — fait typiquement partie de ces peccadilles
qu’on lâche d’autant plus facilement qu’elles permettent de
sauver l’essentiel. La crise financière internationale de 1997-
1998, qui avait failli emporter la totalité du système financier,
avait déjà été mise sur le compte de « l’opacité », et avec
d’autant meilleure conscience, quoique mêlée de relents douteux,
qu’il s’agissait des « marchés émergents » — comprendre d’une
partie du monde « pas tout-à-fait développée », et à qui il reste
encore « des progrès à faire » pour se mettre aux normes
occidentales… Le problème du diagnostic d’arriération, c’est qu’il
s’effondre sitôt que le « monde avancé », en 2000, connaît à son
tour la panique financière et ceci en fait parce qu’il est victime des
mêmes causes — génériquement celle de la finance libéralisée.
On aurait pu au moins croire que cette pantalonnade désarmerait
le topos de la « transparence », réservé aux « sauvages ». Pas
un instant ! Sous des formes à peine différentes, c’est l’opacité
des Enron et autres Worldcom, ripoux opportunément poussés
sur le devant de la scène, qui a porté tous les péchés du monde
pour mieux faire oublier ce que la crise devait aux structures
déréglementées des marchés de capitaux. Quelques années plus
tard, faute de n’avoir rien appris, ou plutôt de n’avoir rien voulu
apprendre, les mêmes causes, laissées invariantes, produisent
les mêmes effets… et c’est le même brouet de la transparence
qui nous est servi à nouveau comme purgation de mauvaises
humeurs qu’on espère passagères.
Si la transparence comme arme de stabilisation de la finance
n’était pas une illusion parfaite (1), il y aurait au moins une bonne
raison de ne pas s’attendre à la voir mise en œuvre : il est
impératif que l’opacité demeure aussi longtemps que possible le
candidat récurrent à l’explication de la crise. Or, plus d’opacité,
plus de dérivatif ! Tout le temps où elle dure, au moins les élites
gouvernementales et financières peuvent-elles prendre des
poses avantageuses en faisant résonner de vibrants appels à « la
régulation ». Aussi l’éternel retour de la crise financière est-il
également l’éternel retour des déclarations vides et des propos
sans suite, de la cécité volontaire et des analyses qui regardent
ailleurs, éternel retour d’une séquence-type dont on voit déjà se
dérouler, impeccablement ordonnées, toutes les étapes : 1)
exhortations politiques solennelles « à la régulation », 2)
protestation du capital financier qui déclare absolument nuisible
toute intervention législative, 3) proposition alternative par ses
soins d’une « auto-régulation », moyennant la création d’un «
groupe de travail » rendant rapport et faisant du vent, le tout
piloté selon un calendrier qui, le temps passant et l’oubli gagnant,
aidera toute l’affaire à mieux finir dans les sables.
A l’expérience, et contre toutes les idées reçues ordinairement
véhiculées par les experts stipendiés ou les amis du système, il
apparaît que les Etats-Unis sont passablement moins libéraux
que les Européens. Au moins l’éclatement de la bulle internet y a-
t-il donné lieu à une vraie loi — cris d’horreur étouffés de justesse
en France et vraiment parce que ce sont eux, les Américains, les
seuls qui peuvent se permettre de légiférer dans le capitalisme
puisque, par ailleurs, leurs créances libérales sont
insoupçonnables. La loi Sarbanes-Oxley (2002) aura ainsi
drastiquement durci les dispositifs de contrôle des comptes — les
chefs d’entreprise s’en plaignent assez d’ailleurs, sans qu’on
sache véritablement faire la part de la gêne réelle et de la
propension à geindre à tout propos. Mais cette loi reposait
entièrement sur l’hypothèse « ripoux », et ne pouvait en aucun
cas prétendre s’attaquer aux véritables causes de l’instabilité
financière. Et la France pendant ce temps ? A l’époque sous
gouvernement « socialiste », puis à la période Jean-Pierre
Raffarin, et très attachée à l’idée de faire passer
comparativement les américains pour stalinoïdes, elle… n’a rien
fait. Les hurlements patronaux au totalitarisme de la loi y ont
immédiatement rencontré un écho compréhensif et l’on a laissé le
Mouvement des entreprises de France (Medef) piloter lui-même
groupes de travail et rédaction de rapports qui, tel le rapport de
M. Daniel Bouton (2)], n’avaient pas d’autre finalité que de
prouver la supériorité de la régulation du capital par le capital,
équivalent dans son ordre d’un appel à la chasteté par la vertu de
réfrènement dans un bordel militaire de campagne.
2. La spéculation comme art de la prise d’otages
Il faut rappeler tous ces faits si l’on veut éviter la reproduction de
la séquence maintes fois parcourue et déjà prête à resservir «
Régulation / Auto-régulation / Rien »… et nouvelle crise dans
quatre ans. Et il le faut d’autant plus qu’une nouvelle fois la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%