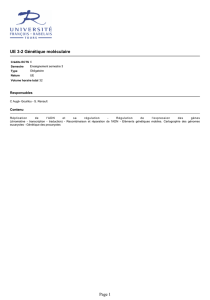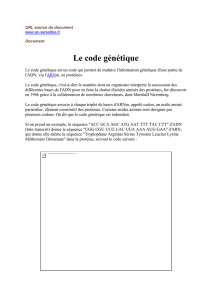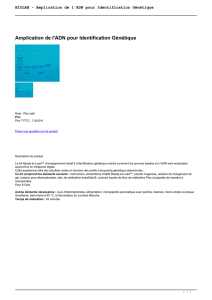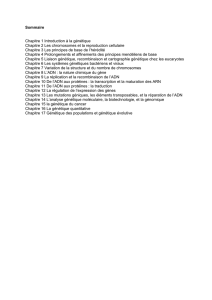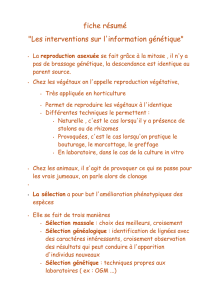G--n--tique et Ethique

Génétique et Ethique
I.Introduction
Le but est d'essayer de poser des question de nature éthique soulevées par l'exercice du conseil
génétique de manière très simple.
---> Quels sont les problèmes concrets rencontrés par le généticien dans la pratique de sa discipline ?
-Pour y répondre sur quelles bases scientifiques, juridiques ou déontologique peut-on essayer de
s'appuyer ?
II. Le conseil génétique
Définissons tout d'abord ce qu'est le conseil génétique :
On peut définir le conseil génétique comme l'acte médical qui consiste à évaluer la probabilité pour qu'une
maladie réputée héréditaire qui est déjà survenue chez un ou plusieurs membres d'une famille ne se
manifeste à nouveau chez un autre membre de cette même famille .
Le terme de récurrence a été consacré pour désigner cette récidive, on parle de risque de récurrence et le
conseil génétique a pour but de préciser ce risque pour une famille et lorsque cela est possible, et c'est de
deuxième objectif, essayer de prévenir cette récurrence, d'en assurer la prévention.
III. Qui vient consulter, et pourquoi ?
On peut dire, d'une manière très générale que les consultants sont des personnes qui sont confrontées au
risque de transmission d'une affection certainement ou potentiellement génétique :
Bien sûr dans les cas de maladies héréditaires connues (ex : mucoviscidose, hémophilie ...)
Mais également dans un bon nombre d'autres affections qui peuvent être héréditaires (ex : certaines
malformations, certains handicaps : moteur, sensoriel ou psychique)
1. Les parents ayant eu un enfant malade
Souvent, il s'agit de couples, de parents qui sont eux-mêmes en bonne santé, mais qui ont eu un enfant
atteint d’une maladie génétique et qui se posent des questions sur l'origine, le mode de transmission et la
récidive possible (récurrence) de cette maladie pour d'autres enfants qu'ils envisagent d'avoir. « d’où ça
vient ? Est-ce que ça peut se reproduire ?»
2. Futurs parents, malades
Il peut s'agir également de personnes, d'individus eux-mêmes atteints de maladie génétique et qui se
posent des questions sur l'éventualité, la possibilité de la transmission de leur propre affection à leur
descendance : <<quel est le risque pour que mes enfants déjà nés, ou que j'envisage d'avoir soient eux-
mêmes atteints par cette maladie?>>
3. Personne ayant des liens de parenté avec un individu malade
La troisième possibilité est qu'il peut s'agir, et c'est de plus en plus fréquent, de personnes, d'individus qui
ont un ou plusieurs apparentés de degré variable, des parents plus ou moins éloignés atteints d'une
affection réputée héréditaire et qui sont inquiets soit pour eux-mêmes, soit pour leurs propres enfants leur
descendance.
C'est fréquemment la descendance future plus que pour eux-mêmes, pour leurs enfants que pour les

consultants qui viennent en génétique, et souvent pour une descendance future.
Et la finalité du conseil génétique, c'est souvent d'aider les consultants à prendre leurs décisions d'avoir et
avec quel risque ou de ne pas avoir les enfants qu'ils désirent.
IV. Démarche suivie lors du conseil génétique
Dans ce chapitre, on va voir qu'elle est la démarche suivie lors du conseil génétique, cette démarche se
passe, se déroule en trois temps, qui correspondent à trois questions particulières.
1. Quelle est précisément la maladie de l'enfant, du consultant ?
Il faut tout d'abord, et c'est un impératif absolu, incontournable caractériser de manière parfaite et précise
l'affection dont est atteint l'individu ou les individus qui motive(nt) la consultation.
Il faut établir un diagnostic précis de la maladie en cause.
Il est impossible de faire un quelconque conseil génétique sans le diagnostic le plus précis possible de la
maladie en cause.
Schématiquement, le généticien se trouve confronté à deux situations :
-Cas le plus fréquent : l'individu est facilement accessible, on peut le rencontrer, avoir de ses nouvelles,
l'examiner, il faut alors toujours essayer d'examiner soi-même le patient, demander la communication de
tout son dossier médical.
Il faut faire exécuter les examens qui pourraient manquer au dossier (très fréquent) et qui viennent
confirmer le diagnostic de la maladie.
-Mais il arrive souvent que le ou les individu(s) malade(s) ne soi(en)t pas accessible(s) parce qu'ils sont
décédés, trop éloignés ou parce que les liens familiaux se sont distendus, il faut alors reconstituer, avec
les médecins ayant eu en charge le patient, le dossier médical pour aboutir au diagnostic le plus exact
possible et il peut persister un doute diagnostic, et le conseil génétique ne doit être alors donné que sous
réserve d'une possible erreur.
Le diagnostic va permettre de donner un mode de transmission à la maladie, et c'était le but de ce
premier temps.
2. Quel est le lien entre le consultant et le malade ?
Dans un deuxième temps, il faut établir l'arbre généalogique de la famille du consultant afin d'établir le lien
familial entre ce consultant et le, ou les malades.
Au terme de ces deux premiers temps, on a le mode de transmission et le lien. Un premier risque peut-
être donné au consultant qui va tenir compte des deux paramètres dont on vient de parler, le mode de
transmission et le lien familial, c'est ce que l'on appelle le risque "à priori" qui est un risque chiffré qui se
donne en pourcentage.
Ex : Des parents qui ont eu un enfant atteint d'une maladie autosomique récessive ont un risque a priori
de 25% d'en avoir un second,
Un individu atteint d'une maladie autosomique dominante a un risque à priori de 50% de transmettre
sa maladie.
Ce risque chiffré résumait il y a encore quelques années l'essentiel du conseil génétique, la difficulté pour
les consultants tenait au fait que leur décision devait être prise en fonction d'un risque qui est un concept
relativement abstrait, qui est difficile à appréhender de manière objective.
On distinguait les situations à risque faibles où la récurrence était de 5 à 10% et les situations à risque
élevé où la récurrence était de 25-50%, et il y avait des situations qui étaient loin d'être rares où aucun
conseil génétique chiffré ne pouvait être donné (ex : cas isolé d'hémophilie: un couple avait eu un garçon
hémophile sans antécédent : il était impossible de savoir si la mère était ou non conductrice.

3. L'affection en cause dont est atteint ou sont atteints le ou les individus
malades est-elle accessible aux nouvelles investigations de la biologie
moléculaire ?
A l'heure actuelle, il existe depuis une quinzaine d'années un troisième temps en rapport avec les progrès
de la biologie moléculaire, il est maintenant possible d'aller au delà d'un conseil génétique purement
chiffré, grâce à l’apport des techniques de la biologie moléculaire en répondant à la question "L'affection
en cause dont est atteint ou sont atteints le ou les individus malades est-elle accessible aux nouvelles
investigations de la biologie moléculaire ?", ou en termes simples : "le gène de la maladie est-il connu, et
s'il l'est, se prête-t-il facilement à l'analyse moléculaire?" (il existe en effet des gènes difficiles à analyser)
dans cette éventualité, la stratégie est simple, mais il faut bien la suivre, il faut tout d'abord rechercher
chez le ou les sujets atteints de la famille l'anomalie génétique responsable de cette maladie, c'est-à-dire
caractériser chez ce ou ces malades la ou les mutations responsables de la maladie. Une fois (toujours
commencer par le malade) identifiée, caractérisée la mutation, celle-ci peut être recherchée chez le
consultant lui-même, ce qui permet de définir son propre statut vis-à-vis de la maladie.
Et là, on arrive à un risque positif ou négatif, qui n'est plus en pourcentages : la présence ou l'absence de
ma mutation permet alors de donner un conseil génétique non plus sous forme de probabilité, mais sous
forme de certitude : on passe de l'expression d'un risque à une réponse oui ou non.
On reprend l'exemple de l'hémophilie :
On identifie la mutation chez l'enfant, et on va la rechercher chez sa mère : elle est conductrice : risque =
100%, elle ne l'est pas, risque = 0%.
V. Les diagnostics
On va définir un certain nombre de termes, de qualificatifs importants :
1. diagnostic pré symptomatique :
Ce diagnostic concerne essentiellement des maladies génétiques ou héréditaires à révélation tardive
(voire même 30 ou 40ans), faire un diagnostic pré symptomatique, c'est faire le diagnostic de la maladie
avant que celle-ci ne se manifeste chez cet individus.
Ce diagnostic pré symptomatique répond à la question toute simple que se pose pour lui-même un sujet
apparenté à un malade : "quel est le risque que je développe moi-même la maladie dont tel ou tel parent
est atteint ?" .
Autrefois (il y a 15-20 ans), on répondait en pourcentages (le plus souvent c’était 50% pour une maladie
dominante), la réponse est aujourd'hui apportée par l'analyse moléculaire de manière simple et non-
ambigüe :
-si la mutation identifiée chez le malade est absente chez le consultant, il a toutes les chances de ne pas
développer la maladie.
-si elle est présente, il a tous les risques pour que cette maladie apparaisse, mais sans qu'il soit possible
le plus souvent d'en préciser ni la date ni la gravité.
Il y a un grand intérêt quand il existe des moyens de prévention de la maladie
2. Le diagnostic prénatal
Il permet lui aussi une certaine prévention de la maladie.
Faire le diagnostic prénatal, c'est faire le diagnostic avant la naissance de l'individu qui est atteint lorsque
l'enfant attendu par un couple qui a un risque important d'être atteint par une maladie génétique grave,
incurable, et pour laquelle les mutations sont parfaitement identifiées, il est possible de rechercher ces
mutations chez l'enfant attendu par un prélèvement foetal, le plus précocement possible, la réponse est
non-ambigüe :
-l'enfant attendu a la ou les mutations et bien il est atteint. Les parents peuvent décider d'interrompre la
grossesse.
-la ou les mutations sont absentes, on peut rassurer le couple sur l'intégrité de leur enfant. L’enfant est

indemne.
3. Le diagnostic préimplantatoire
Le diagnostic préimplantatoire représente un progrès par rapport au diagnostic prénatal, ce diagnostic est
(sera, prévu pour un avenir très proche) non plus sur le foetus mais sur l'oeuf fécondé à ses premiers
stades (8 cellules) avant son implantation, sa nidation
De manière concrète, une fécondation in-vitro est faite à partir des gamètes parentaux.
Plusieurs embryons sont obtenus.
Une ou deux cellules de ces embryons sont prélevées puis analysées à la recherche des mutations et
bien sûr seuls sont réimplantés dans l'utérus maternel des embryons indemnes de la maladie.
L'avantage est bien sûr d'éviter un avortement une interruption de grossesse en cas d'atteinte.
Mais elle a un pourcentage de réussite qui reste faible.
Le désagrément est qu'il faut avoir recours à une fécondation artificielle ce que certains couples ont du
mal à accepter.
VI. Problèmes de nature éthique
On va voir maintenant les problèmes de nature éthique qui se posent au généticien dans l’exercice de sa
spécialité . On peut regrouper les problèmes en trois rubriques :
-liés à la nature du matériel biologique étudié
-liés au caractère familial des investigations menées
-liés à la nature prédictive des examens effectués
1. Problèmes liés à la nature de l'ADN
a) L'ADN d'une cellule contient toute l'information génétique d'un individu
Tout d'abord, l'ADN de n'importe qu'elle cellule contient toute l'information génétique d'un individu. Par
exemple, une cellule de fois contient tous les gènes de l'individu, mais s'y expriment seulement ceux qui
ont une fonction hépatique. Donc, à partir de n'importe quelle cellule, on peut avoir accès au gène du
caractère héréditaire, mais aussi à tous les gènes qui commandent le caractère distinctif d'un individu, on
parle d'empreinte génétique, c'est un très bon système d'identification.
Cet ADN peut avoir d’autres utilités, notamment en guise d’expertise judiciaire, on peut identifier un
individu dans des affaires pénales, criminelles, mais aussi civiles et notamment les affaires de filiation.
b) Matériel biologique facilement accessible
Deuxième caractéristique : l'ADN est un matériel biologique facilement accessible, une simple prise de
sang suffit pour étudier tout l'ADN le génome d’un individu, même un cheveux, la salive ... peuvent être
utilisés.
c) Molécule relativement stable
L'ADN, de plus est une molécule relativement stable qui se dégrade peu. Les prélèvements, mêmes
sanguins peuvent voyager, certains prélèvements qui n'étaient pas initialement destiné à l'analyse
génétique peuvent être étudiés (pièce opératoire, bloc d'histologie ...). Certains tissus peuvent se prêter à
l'analyse même après la mort du sujet.
d) Possibilité d'amplification
L'ADN peut être amplifié, séquence par séquence, grâce à la technique dite de PCR qui permet donc
d'obtenir à partir d'un tout petit prélèvement on peut avoir de grandes quantités d'ADN ce qui augmente la
puissance des analyses.

e) Possibilité de stockage
L'ADN peut être stocké après extraction pour une très longue période, il résiste parfaitement se prête
facilement à la congélation et peut être utilisé des années des décennies après.
f) Possibilité d'immortalisation
L'ADN peut être immortalisé sous une forme active, vivante, fonctionnelle dans des cellules particulières
qui sont des cellules transformées qui ont un pouvoir de se diviser à l'infini. C’est une lignée
lymphoblastoïde . Ces cellules peuvent être à leur tour congelées, stockées, à la décongélation, ces
cellules redeviennent vivantes, se divisent et forment donc une source inépuisable d'ADN.
---> Toutes ces caractéristiques imposent un certain nombre de règles aux généticiens vis-à-vis de leurs
consultants, il faut à chaque fois qu'un prélèvement génétique est effectué, informer le patient de ces
caractéristiques de l'ADN et permettre à ce patient de garder un certain contrôle de son ADN, des
opérations.
La pratique de toute analyse génétique impose (de manière judiciaire) d'avoir recueillit préalablement et
par écrit le consentement libre et éclairé du patient.
Le formulaire de consentement doit être lu avec le patient, lui être expliqué et bien sûr être signé.
Dans ce document, il est dit que l'étude génétique portera uniquement sur l'étude du gène de la maladie
en cause et que si des études ultérieures s'averraient nécessaires, l'accord du patient lui sera demandé,
que le prélèvement ne peut pas servir dans un cadre non médical, en particulier judiciaire, il est précisé
aussi que les informations qui accompagnent le prélèvement ne peuvent être transmises à d'autres
médecins qu'avec l'accord du généticien, et que ces informations doivent rester accessibles au patient.
Enfin que le patient reste propriétaire de son ADN, qu'il peut en exiger la restitution, voire la destruction.
Voilà pour les problèmes liés à la nature de l'ADN.
2. Problèmes liés au caractère familial des explorations menées
La deuxième série de problèmes concerne le caractère familial des explorations menées.
Quatre types de problèmes peuvent se poser.
a) Nécessité d'avoir accès à des parents plus ou moins éloignés
Premier type : ce sont tous les problèmes posés par la nécessité d'avoir accès à des apparentés plus ou
moins éloignés pour avoir des informations médicales, pour les examiner, pour les prélever, mais il s'agit
d'individus qui n'ont formulé aucune demande particulière pour eux-mêmes et qui ne sont pas toujours
disposé à apporter leur nécessaire coopération, il arrive que l'on soit même confronté à de véritables refus
se situant dans le cadre de conflit familiaux : jusqu'où faut-il insister lorsque tout un diagnostic est
suspendu à l'examen ou au prélèvement de ces apparentés, faut-il légiférer dans ce domaine : pour
l'instant non. On touche là à la frontière entre le respect de la vie privée et la nécessité d'assister une
personne en danger.
b) Identification d'un parent à risque potentiel
A l'inverse, on peut être amené à repérer, à identifier dans une famille des apparentés à risque potentiel,
à qui il faudrait un conseil génétique, à qui il faudrait faire des investigations, mais qui, là encore, n'a fait
aucune demande particulière. Cette information qui peut revêtir un caractère indispensable ne peut être
véhiculée jusqu'à ces personnes que par des consultants, il faut qu'ils en parlent à leur famille. Il ne peut
pas y avoir de la part du médecin de rapport direct avec des personnes qui ne lui ont rien demandé. Il faut
dire aux consultants d'alerter les parents concernés, ou le plus simple, de conseiller de venir rencontrer le
médecin, le généticien.
c) Respect du caractère confidentiel et personnel des résultats des examens pratiqués.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%