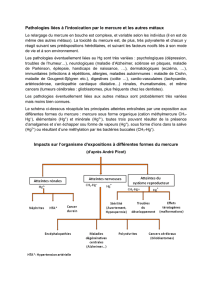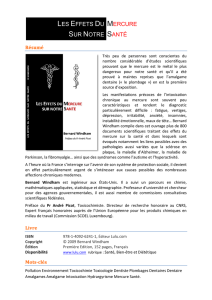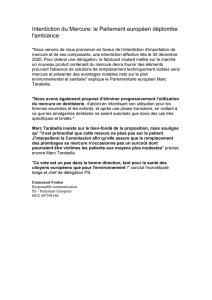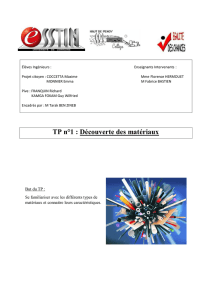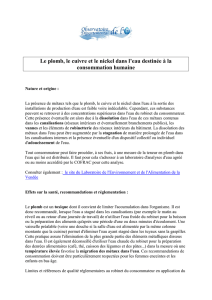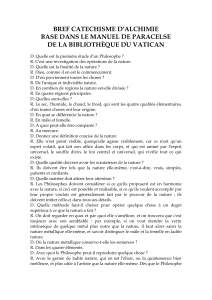ISLAM - Regards sur sciences

ISLAM - Les mathématiques et les autres sciences
L’alchimie
Il conviendrait de parler ici d’autres branches connexes qui ont également bénéficié de l’apport des
savants musulmans : l’hygiène et la diététique, l’odontologie, l’ophtalmologie, la toxicologie, la
physiognomonie, ainsi que la zoologie (cf. les ouvrages de Djahiz, de Damiri, de Qazwini), l’agriculture
(cf. L’Agriculture nabatéenne d’Ibn Wahshiyya, le Kitab al-filaha d’Ibn al-‘Awwam), la botanique,
l’horticulture, l’art vétérinaire, l’hippiatrie, la fauconnerie, etc. Mais on se bornera à signaler l’influence
décisive qu’auront les savants sur l’alchimie, science dont l’importance fut considérable au Moyen Âge.
D’après le Fihrist d’Ibn al-Nadim, c’est le prince ‘umayyade Khalid ben Yazid (m. en 704) qui fut le
premier à s’en occuper chez les Arabes. Il se serait initié à cette discipline à Alexandrie, sous la direction
d’un certain Marianos qui aurait écrit un traité alchimique en 2 315 vers, le Paradis de la sagesse . Mais
c’est avec Djabir ben Hayyan, le Geber des Latins, que l’alchimie prit réellement son essor. Né à Tus en
Iran vers 721, il s’établit comme alchimiste à la cour de Harun al-Rashid et devint l’ami personnel du
sixième imam shi‘ite Dja‘far al-Sadiq (m. en 768), qu’il considéra comme son maître. Il avait à Koufa
(Kufa) un laboratoire qui fut retrouvé deux siècles après sa mort dans le quartier de la porte de Damas, et
où l’on découvrit un mortier en or pesant deux livres et demie. Il existe un immense corpus djabirien,
dont une grande partie, selon l’étude minutieuse qu’en a faite Paul Kraus, aurait été écrite plus tard par
un groupe d’ismaéliens. Il est donc difficile de distinguer ce qui appartient en propre à Djabir. Les
groupes les plus importants de ces traités sont les suivants : les CXII Livres , dédiés aux Barmécides et
fondés sur la Table d’émeraude (Tabula smaragdina ) ; les Dix Livres de rectification , qui décrivent
les progrès faits par les alchimistes ; les LXX Livres , dont une grande partie fut traduite en latin ; les
Livres des balances (Kutub al-mawazin ), où il expose sa théorie alchimique.
La théorie de Djabir, qui s’inspire de la doctrine aristotélicienne de la matière mais en la développant
dans une ligne différente, pourrait se résumer de la manière suivante. Le substrat général de tout
l’univers sensible est la « matière première », sujet de toutes les transformations, qui n’existe que revêtu
d’une « forme ».
À partir de cette matière première naissent en effet les « quatre éléments » : le feu et l’eau, la terre et
l’air ; ces éléments sont « formés » par l’union de la matière première et de la forme substantielle
correspondante.
Outre cette forme substantielle, il existe des « propriétés naturelles », appelées également « natures » :
le chaud et le froid, le sec et l’humide. Ces « propriétés » qualifient les quatre éléments : le feu est sec et
chaud ; l’air est chaud et humide ; l’eau est humide et froide ; la terre est froide et sèche.
Les quatre éléments peuvent se transformer les uns en les autres, mais selon un ordre donné : il faut
qu’entre les deux éléments il y ait une propriété commune ; les transformations se font ainsi selon les
directions suivantes : terre ? feu, feu ? air, air ? eau, eau ? terre, mais jamais entre feu et eau ni entre
terre et air. Il peut y avoir un cycle entier, mais par intermédiaire.
Les métaux ont quatre natures, deux externes et deux internes. Par exemple, le plomb est froid et sec
extérieurement, chaud et humide intérieurement. L’or est chaud et humide extérieurement, froid et sec
intérieurement.
Les sources de ces natures sont le soufre et le mercure ; non pas le soufre et le mercure ordinaires,
mais des substances hypothétiques dont le soufre et le mercure représentent la forme la plus proche. Le
soufre fournit les natures chaud et sec ; le mercure, les natures froid et humide. Sous l’influence des
planètes, les métaux sont formés au sein de la Terre par l’union du soufre et du mercure. Cette théorie
sera communément admise jusqu’à l’apparition de la théorie du phlogistique au XVIIe siècle.
Quand le soufre et le mercure sont absolument purs et qu’ils se mélangent dans un rapport idéal, ils
donnent le plus parfait des métaux, l’or. Lorsque interviennent des défauts quelconques, surtout dans les
proportions, on obtient d’autres métaux : argent, plomb, étain, fer, cuivre. Mais, les éléments étant les

mêmes, on peut chercher à remédier à cette impureté et à retrouver l’équilibre qui caractérise l’or et
l’argent. On y arrive au moyen d’élixirs. Toutefois, au lieu de perdre beaucoup de temps à faire des
essais empiriques, Djabir élabore sa théorie de l’équilibre ou de la « balance », fondée sur le fait que tout
dans la nature comporte poids de dimension ; il s’agira non d’établir une égalité de masse ou de poids,
mais un équilibre des « natures ». D’après cet alchimiste, à côté des divers élixirs permettant d’obtenir
des transformations spécifiques, il existe un élixir majeur capable d’effectuer toutes les transformations.
Djabir donna par ailleurs des indications très claires pour la préparation de certains produits. Il divise les
minéraux en trois groupes : les esprits, qui se volatilisent quand on les chauffe (soufre, arsenic ou
réalgar, mercure, camphre, sel ammoniac) ; les métaux, qui sont des substances fusibles, malléables,
sonores, douées d’un certain éclat (or, argent, plomb, étain, cuivre, fer et kharsini ) ; les substances non
malléables, qui peuvent être réduites en poudre et qui se subdivisent en huit familles.
Dans son Kitab sunduq al-hikma (Coffre de la sagesse ), Djabir fait mention de l’acide nitrique. En
d’autres écrits, il signale que le cuivre colore la flamme en vert ; il indique les procédés pour préparer
l’acier, pour raffiner les autres métaux, pour teindre les habits et le cuir, pour fabriquer des vernis
rendant imperméables les vêtements, pour préserver le fer de la rouille, pour mordancer les tissus avec
de l’alun, pour fabriquer à partir de la marcassite « dorée » une encre phosphorescente, remplaçant celle,
trop coûteuse, qu’on obtenait avec de l’or. Il mentionne le bioxyde de manganèse dans la fabrication du
verre et sait concentrer l’acide acétique en distillant le vinaigre. Il décrit avec exactitude des opérations
comme la calcination, la cristallisation, la dissolution, la sublimation et la réduction.
Razi donna à l’alchimie un aspect plus scientifique, et à la description des appareils et des opérations
plus de précision. Comme Djabir, il admet les quatre éléments comme substrat de toutes les substances,
mais sans recourir à la théorie compliquée de la « balance ». Pour lui, l’alchimie enseigne d’une part à
transformer les métaux non précieux en argent ou en or et, d’autre part, à convertir du quartz ou même
du simple verre en pierre précieuse (émeraude, saphir, rubis, etc.) ; ces transformations s’effectuent au
moyen d’élixirs appropriés, auxquels pourtant Razi ne donne jamais le nom de « pierre philosophale ». Il
admet par ailleurs la théorie de Djabir selon laquelle les métaux sont composés de soufre et de mercure ;
à ceux-ci il joint parfois une troisième substance de nature saline.
L’intérêt de Razi apparaît surtout dans la chimie appliquée. Son Sirr al-asrar (Secretum secretorum )
donne pour la première fois une division claire des corps chimiques : aux élucubrations théoriques, il
préfère le travail positif du laboratoire. Par sa description des appareils (foyer, soufflet, creuset, appareil
distallatoire, alambic, aludel, bain-marie, fioles diverses, tamis, filtres, etc.), des multiples opérations
chimiques (distillation, calcination, évaporation, cristallisation, sublimation, filtration, amalgamation,
cération, etc.) et par sa classification systématique des produits des trois règnes qui sont employés dans
le laboratoire de l’alchimiste, déjà Razi apparaît comme le témoin de l’avènement de la chimie
proprement dite.
Il divise les substances minérales en six sections : les esprits (mercure, sel ammoniac, sulfure
d’arsenic [orpiment et réalgar], soufre) ; les corps (or, argent, cuivre, fer, plomb, étain, kharsini ) ; les
pierres (pyrites, oxyde de fer, oxyde de zinc, azurite, malachite, turquoise, hématite, oxyde d’arsenic,
sulfure de plomb, mica et abseste, gypse, verre) ; les vitriols (noir, blanc, vert, jaune, rouge ; aluns) ; les
borax ; les sels. À ces substances « naturelles », Razi ajoute un certain nombre de substances obtenues
artificiellement : la litharge, l’oxyde de plomb, le vert-de-gris, l’oxyde de cuivre, l’oxyde de zinc, le
cinabre, la soude caustique, les polysulfures de calcium et divers alliages.
Le grand mérite de Razi aura été de rejeter les pratiques astrologiques et magiques pour s’attacher à ce
que l’expérience peut prouver. Son insistance en vue de promouvoir ces recherches de laboratoire ne
manqua pas de porter ses fruits en pharmacologie. C’est ainsi que le Persan Abul-Mansur Muwaffaq, au
Xe siècle, apporte au sujet de certains médicaments des détails qui témoignent d’un véritable progrès en
ce domaine.
Les recherches des musulmans dans les diverses sciences s’accompagnent évidemment de

perfectionnements intéressants dans le domaine des techniques, des métiers, de l’industrie : tissus,
étoffes, tapis, teintures, émaux, céramiques, fabrication de divers papiers et de parfums, préparation des
cuirs, trempe de l’acier, extraction des métaux, joaillerie, damasquinerie, autant de secteurs où
l’ingéniosité des artisans met à profit les expériences et les découvertes des savants.
Mais le magnifique essor scientifique qui a marqué le Moyen Âge musulman s’est arrêté pratiquement
au XVe siècle. Les raisons de ce que George Sarton aimait à appeler « le miracle de la culture arabe »
puis celles de la décadence sont fort complexes. On peut affirmer du moins que la question de race ou de
nationalité ne joue pas dans cet essor un rôle essentiel. À Bagdad, au Caire, à Cordoue ou à Samarkand,
l’effort scientifique a mobilisé le Persan et l’Arabe, le Turc et l’Andalou, le Berbère et le Sabéen. La vie
culturelle se développe ou s’étiole et meurt selon qu’elle trouve un terrain propice ou un milieu
destructeur.
D’autre part, il faut dire que l’islam ne constituait pas un obstacle véritable à la recherche scientifique,
mais qu’il en stimula, au contraire, certaines branches. En l’absence d’une institution spécifique destinée
à préserver l’interprétation orthodoxe de la parole divine (le Coran) et de la tradition religieuse (les
hadith ), l’interprétation du donné religieux restait assez large pour permettre aux différentes doctrines
théologiques et philosophiques de coexister et de s’affronter. Cette possibilité a garanti la liberté
nécessaire au développement des recherches intellectuelles et scientifiques.
Les savants de l’Islam médiéval ont été sans conteste à la pointe du progrès. Le silence de plusieurs
siècles qui a suivi cette suprématie de la culture arabe a commencé à faire place, à partir du milieu du
XIXe siècle, à la renaissance (nahda ) qui aujourd’hui porte ses fruits dans tous les pays musulmans. Des
universités modernes et des instituts de recherche ont été fondés dans les grandes capitales du monde
islamique : Alger, Rabat, Tunis, Le Caire, Bagdad, Beyrouth, Téhéran, Karachi. Et une élite
intellectuelle, ouverte aux nouvelles méthodes scientifiques, collabore avec les savants du monde entier.
___________________________________
© 1995 Encyclopædia Universalis France S.A.Tous droits de propriété intellectuelle et industrielle réservés.

1
/
4
100%