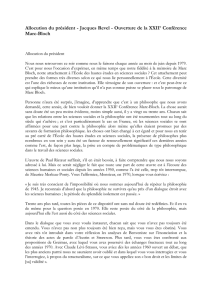Dans cette présente étude, il s`agit de questionner les conditions de

1
CAMILLE VASSEUR OCTOBRE 2003
UNIVERSITE CHARLES-DE-GAULLE-LILLE-III
UFR DE PHILOSOPHIE
Y A-t-il un âge pour philosopher ?
QUELQUES REMARQUES SUR LES QUESTIONS
DE L’EDUCATION DU JUGEMENT CHEZ L’ENFANT
ET D’UNE PROPEDEUTIQUE A L’ENSEIGNEMENT
PHILOSOPHIQUE
MEMOIRE DE DEA SOUS LA DIRECTION DE
MONSIEUR BERNARD JOLY, PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE.

2
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier sincèrement Monsieur Bernard Joly pour la qualité de sa présence
au long de mes études universitaires. En tant que directeur de recherches pour mon DEA
d’une part, il a soutenu et validé mon projet d’échange interuniversitaire franco-québécois.
C’est grâce à lui que j’ai pu effectuer la première partie de mes recherches de DEA à
l’Université Laval à Québec. De plus, son écoute, sa rigueur et ses conseils ont été nécessaires
pour que ce travail aboutisse. En tant que directeur de l’UFR et professeur de philosophie
d’autre part, il a assuré, avec Mesdames Sylvie Solère-Queval, Mireille Depadt et Joëlle
Delattre, une collaboration de quatre années entre les UFR de philosophie et de sciences de
l’éducation. Sans cette collaboration, je n’aurais pas pu travailler sur la pratique de la
philosophie avec les enfants au sein de l’université de Lille 3.
Je suis aussi reconnaissante à Madame Sylvie Solère-Queval de m’avoir permis,
depuis le début de ma maîtrise en philosophie et sciences de l’éducation, de progresser dans la
compréhension des relations entre la philosophie et l’enseignement en classe primaire. Je lui
dois notamment la possibilité d’élaborer et de présenter avec elle, en licence de sciences de
l’éducation à Lille 3, une unité d’analyse de pratiques autour de l’apprentissage de la
philosophie à l’école élémentaire.
Je remercie également Monsieur Frédéric Worms pour le temps et l’attention qu’il
accordera à l’examen de ce mémoire.
De plus, je tiens à remercier Monsieur Michel Sasseville pour la richesse de la
formation dispensée à Québec et à Genève sur la pratique de la philosophie en communauté
de recherche.
Par ailleurs, certaines personnes ont joué un rôle considérable dans la poursuite de mes
études en philosophie avec les enfants grâce à leur appui, leur écoute, leurs conseils et leur
dynamisme. Je pense ici à :
- Nicole Bliez, Thierry Bour, Michel Tozzi, Alexandre Herriger, Véronique Delille.
- Toutes les personnes rencontrées à Québec et Genève lors de mes stages et
formations autour de la pratique de la philosophie en communauté de recherche: Madeleine
Pineault, l’école active de Malagnou, l’association Pro-Philo et l’Institut ODEF , et plus
particulièrement Paule, Elisabeth, Jane, Muriel, Françoise, Thierry, Sylvie, Martine, Ilona.
- Mes parents, mes frères et sœur, Séverine, Dominique, Jacqueline.
- Sabine, Frédérique, Cécile, Laure, Béatrice, Alvaro, Marina, Mathilde, Gaëtan.

3
SOMMAIRE
REMERCIEMENTS ............................................................................................................................................. 2
SOMMAIRE .......................................................................................................................................................... 3
INTRODUCTION ............................................................................................................................................... 4
I- QUELLE CONCEPTION DE L’ENSEIGNEMENT PHILOSOPHIQUE ? .................................... 11
II- QU’EST-CE QU’EDUQUER LE JUGEMENT ? .......................................................................... 47
III- COMMENT EDUQUER LE JUGEMENT DANS LE CADRE DU SYSTEME SCOLAIRE
FRANÇAIS ? ..................................................................................................................................................... 64
CONCLUSION ................................................................................................................................................... 96
BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................................................................. 98
TABLE DES MATIERES ............................................................................................................................... 102

4
INTRODUCTION
Depuis quelques années, en France, des pratiques dites « à visée philosophique » se
développent au sein de certaines classes de l’école primaire et du collège. Ce sont souvent les
enseignants eux-mêmes qui mettent en place ce type d’initiatives et leur pratique questionne
nécessairement les objectifs et les moyens que se donne l’école. Entre autres, ces pratiques
émergentes induisent une remise en question de la forme actuelle de l’enseignement
philosophique en tant que celui-ci est dispensé seulement en terminale. Elles interrogent
notamment la légitimité et les conditions de possibilité d’une propédeutique à l’enseignement
philosophique dispensé en classe terminale. C’est ce questionnement que nous nous
proposons d’examiner dans ce mémoire. Sachant que l’objectif de l’enseignement de la
philosophie est de contribuer à l’éducation du « jugement libre et indépendant que requiert
notre société démocratique
1
», comment est-il possible de favoriser davantage cet objectif en
amont de la scolarité en France ?
Pour mener à bien notre réflexion, il nous faut préalablement comprendre pourquoi et
comment la philosophie a acquis le statut d’un enseignement terminal.
Si aujourd’hui la philosophie a sa place uniquement en dernière année d’études
secondaires, c’est que cet enseignement est voulu depuis Victor Cousin, c’est-à-dire depuis
1840, comme une fin et une synthèse d’un parcours complet de la culture. « On ne philosophe
pas pour savoir mais parce que l’on sait déjà
2
», disait Jacques Muglioni. La philosophie dans
le système scolaire français est conçue comme une discipline qui vient couronner la fin des
études secondaires, non seulement parce qu’elle est voulue comme une synthèse réflexive
mais aussi parce qu’aux yeux des personnes qui ont mis en place cet enseignement et aux
yeux de celles qui le cautionnent sous cette forme, l’accès à la philosophie nécessite un savoir
préalablement acquis. D’une certaine manière, on pourrait donc penser que dans les
programmes actuels, la propédeutique à l’enseignement philosophique consiste en
l’assimilation des savoirs dispensés en primaire, collège et lycée.
Mais actuellement, le cursus scolaire suffit-il à préparer l’apprentissage du philosopher
en Terminale ? Ce n’est pas l’avis de ceux qui veulent conserver la place terminale de
l’enseignement philosophique. En effet, ceux-ci déplorent le fait qu’aujourd’hui l’instruction
est dévalorisée et régresse, qu’elle n’est plus une priorité de l’école : de nombreux élèves
1
« Instructions du 2 septembre 1925 du ministre Anatole de Monzie », circulaire toujours en vigueur et que les
derniers programmes et orientations ont confirmée, .in GRATELOUP Léon-Louis, Notice pédagogique à l’usage
du professeur de philosophie, Hachette, 1986, Paris, p. 7.
2
MUGLIONI Jacques, L’école ou le loisir de penser, Paris, CNDP, 1993, p. 117.

5
aujourd’hui, parvenus au baccalauréat, « non seulement ignorent le sens des mots les plus
simples, mais encore ne savent même pas délimiter la proposition dans la phrase, reconnaître
sa fonction, ses éléments constituants, sujet, verbe, attribut ou complément
3
». Cette
dévalorisation de l’instruction ne permet plus d’enseigner correctement la philosophie. Il n’y
aurait donc plus à proprement parler de propédeutique satisfaisante à l’enseignement
philosophique.
Mais en quoi consistait cette propédeutique avant de disparaître ? Cette propédeutique
était en elle-même non philosophique. « De l’Antiquité au début du siècle la classe de
philosophie fut toujours précédée par les classes de grammaire et de rhétorique
4
», rappelle
Muglioni. Hegel précise également que la grammaire est la philosophie élémentaire. Ces
classes de grammaire et de rhétorique ont été modifiées progressivement et n’ont plus
véritablement d’existence aujourd’hui.
En résumé, la place terminale de l’enseignement philosophique semble être
pleinement justifiée mais il n’existe plus rien qui puisse être considéré comme une préparation
facilitant l’accès à cet enseignement. La restauration des enseignements de grammaire et de
rhétorique serait-elle alors à la fois possible et souhaitable ?
Pour répondre à cette question, il faut tenir compte du fait que les conditions
d’enseignement ont évolué et que les programmes scolaires antérieurs semblent ne plus
convenir. En effet, avant la mise en place du collège unique, l’enseignement secondaire était
réservé à une élite. Aujourd’hui, au contraire, on cherche à démocratiser l’enseignement, de
telle sorte qu’un nombre croissant d’élèves accède au baccalauréat. La question est donc de
savoir si, compte tenu de la situation scolaire actuelle et des objectifs que poursuit
l’enseignement philosophique, les moyens requis pour enseigner la philosophie peuvent rester
sensiblement les mêmes qu’auparavant.
Comment comprendre que la philosophie ait pris cette forme terminale de
l’enseignement secondaire ? Selon quels présupposés cet enseignement a-t-il été institué et
pourquoi est-il toujours en vigueur ? Autrement dit, selon quelle(s) école(s) philosophique(s)
3
. MUGLIONI Jacques, « Quelle école pour l’enseignement philosophique ? » in Philosophie école même
combat, colloque philosophique de Sèvres -1984, PUF, 1984, Paris, p. 20.
4
Ibid. p. 20.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
1
/
104
100%