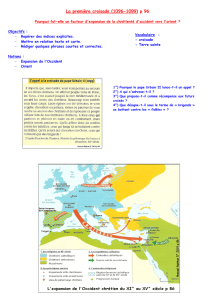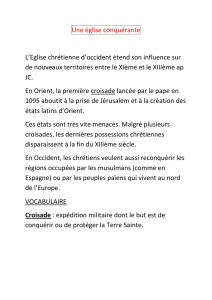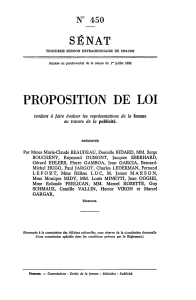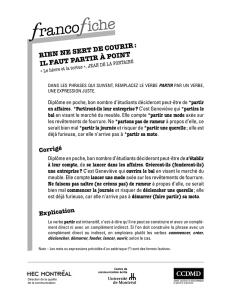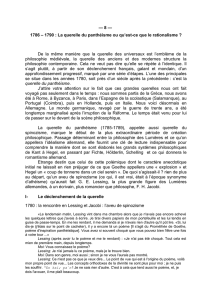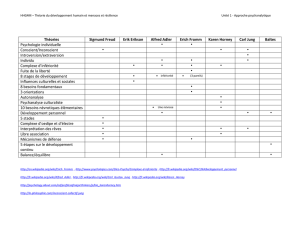La Querelle du Nouveau Monde

Conjonctures N° 14
105
La Querelle
du Nouveau Monde
Lettre ouverte à une amie
par Robert Laliberté
Bruxelles, 10 janvier 1991.
La jeunesse de l'Amérique est sa
plus ancienne tradition. Ça fait
maintenant trois cents ans qu'ils
en parlent.
Oscar Wilde
Chère Amie,
Je ne sais pas si je t'ai déjà raconté cette
histoire : un de mes amis, prof d'info à l'UQAM,
participait à un échange avec la France et allait
enseigner pendant un an à Montpellier. Un des
premiers matins de son installation, il descend à la
boulangerie près de chez lui. À entendre son accent,
la boulangère lui demande s'il vient de Montréal, il
répond que oui, elle lui dit qu'elle aussi. En fait,
c'était une Française qui avait passé une vingtaine
d'années à Montréal, puis était retournée dans sa
ville natale, maintenant qu'elle et son mari avaient
accumulé suffisamment d'argent pour s'acheter un
petit commerce. Elle vante à mon ami les charmes
de Montpellier, lui dit qu'il va sûrement s'y plaire et
ajoute sur le ton de la confidence : « Vous verrez,
ici, les gens sont plus intelligents ». Évidemment,

106
mon ami s'est bien amusé de la remarque;
seulement, à l'usage, il a eu l'impression que, dans
sa candeur, la boulangère avait exprimé un
sentiment très répandu chez les Français qu'il allait
côtoyer et, particulièrement, bien sûr, chez ses
collègues universitaires. On pense encore à Giscard
qui déclarait : « La France n'a pas de pétrole, mais
elle a des idées ». Tout cela pour te dire que je ne
suis pas entièrement d'accord avec la position que tu
m'exprimais, une fois que l'on parlait de la Querelle
du Nouveau Monde. Si je résume bien ta pensée,
l'idée de l'infériorité de l'Amérique te semblait
surtout une idée américaine, un complexe
d'infériorité qui ne renverrait en contre-partie à
aucun complexe de supériorité marqué chez les
Européens. Voilà ce dont j'aimerais discuter un peu,
après avoir exposé sommairement cette controverse.
C'est Robert Hébert, avec son livre sur
l'Amérique française devant l'opinion étrangère,
paru à l'Hexagone, qui m'a fait connaître la Querelle
du Nouveau Monde, et je dois l'en remercier. Dans
les notes de sa présentation, il explique que son
anthologie se trouve à compléter l'ouvrage classique
d'Antonello Gerbi sur ladite Querelle, un gros
volume qui couvre de long en large l'histoire des
perceptions réciproques de l'Amérique latine et
« américaine », et de l'Europe, mais qui ne touche
pas du tout au cas de l'Amérique française (en
l'occurrence, principalement, ce qu'on appelle
aujourd'hui le Québec). J'ai donc été consulter le
livre de Gerbi, dans sa version anglaise (University
of Pittsburg Press, 1973); l'original de 1955 est en
italien et il existe aussi une version en espagnol;
Hébert se demande pourquoi ce livre n'a pas encore

Conjonctures N° 14
107
été traduit en français et je m'interroge, pour ma
part, sur le fait qu'il ne se trouve dans la
bibliothèque d'aucune université de langue française
à Montréal.
Le Pérou, c'est pas le Pérou !
Une remarque, d'abord, sur la généalogie de
l'ouvrage. En 1938, Gerbi quitte l'Italie et se trouve
un poste universitaire au Pérou (fuyait-il le
fascisme ? il ne le dit pas). Très vite, il se rend
compte qu'une idée revient sans cesse dans les
conversations qu'il a avec des Péruviens, l'idée de
l'infériorité intellectuelle, culturelle et même
physiologique des habitants du Nouveau Monde,
comparés à ceux de l'Ancien Monde (en
l'occurrence, essentiellement, l'Europe). Si la chose
ne l'a frappé qu'une fois rendu en Amérique, c'est
donc que Gerbi avait à peu près la même impression
que toi : il croyait que cette idée reçue l'était surtout
des Américains… Et il entreprend d'en faire
l'histoire.
Il résume ainsi la teneur de cette longue
Querelle : « Essentiellement, le thème fondamental
de tant de diatribes était, tout simplement, la notion
de l'infériorité présumée de la nature en Amérique
et, principalement, de sa faune, y compris l'homme,
en comparaison avec celles de l'Ancien Monde, et,
subsidiairement, l'idée de la décadence inévitable et
de la corruption auxquelles tout l'hémisphère

108
occidental se trouvait condamné »
1
. Deux idées en
une donc : primo, la supériorité de l'Ancien Monde
sur le Nouveau; secundo, l'inévitable décadence de
l'Occident (j'y reviendrai). Passons maintenant à
l'histoire de cette Querelle.
Contrairement à ce que disait Oscar Wilde que
j'ai cité en exergue, l'idée de l'Amérique comme
d'un Nouveau Monde, même s'il s'agit d'une vieille
lune, ne date pas de Christophe Colomb; elle
n'aurait même pas trois cents ans. Pendant que je
lisais Gerbi, je suis tombé sur un article d'André
Belleau, repris dans Notre Rabelais, où il démontre
que les récits des explorateurs de l'Amérique
comme Cartier n'ont pas eu en leur temps le
retentissement qu'on serait porté à leur accorder
après coup. Bien sûr, la découverte d'un continent
inconnu a été quelque chose d'énorme, elle a
transformé l'image de la terre de la même façon que
la révolution copernicienne a modifié l'image du
ciel. Mais il faut voir aussi que la découverte des
Amériques s'inscrivait dans un mouvement
beaucoup plus large d'exploration du monde par les
Européens et qu'à cet égard, les tribus
amérindiennes ne jouissaient pas, si l'on peut dire,
d'un privilège de primitivisme sur celles d'Afrique
ou d'Indonésie (comme on peut le voir chez
Camoens). Pour l'homme du XVIe siècle, les empires
aztèque et inca ne semblaient pas plus bizarres que
ceux de la Chine ou du Japon. Et le contour des
continents a mis un long moment à se dégager
clairement.
1
p. IX, ma traduction, comme pour toutes les citations tirées de la
même source.

Conjonctures N° 14
109
J'ai d'abord trouvé étonnant que l'idée soit si
récente, j'aurais cru qu'elle eût servi bien plus tôt,
pour justifier, par exemple, l'infériorité politique des
Créoles dans l'empire espagnol et, en général, la
tutelle coloniale des métropoles européennes. Selon
Gerbi, ce serait plutôt les velléités autonomistes,
puis l'obtention de l'indépendance de ses anciennes
colonies, qui auraient, par dépit, mené l'Europe à
dénigrer l'Amérique. Hébert en fournit d'ailleurs le
contre-exemple, avec le cas du Québec qui a pu
parfois échapper à un tel dénigrement de la part de
penseurs réactionnaires qui y ont vanté la
survivance admirable des vertus de l'Ancien
Régime.
East is East, and West is West…
Fatima, qui a beaucoup étudié, comme tu le sais, le
concept d'Orient (et il y a bien des parallèles à faire
entre ce concept et celui du Nouveau Monde),
disait, si je me rappelle bien, que c'est chez Bodin
qu'elle avait trouvé la première formulation de
l'opposition Orient/Occident. Eh bien ! s'il n'a pas
lancé la Querelle du Nouveau Monde, le même
Bodin en a du moins, selon Gerbi, posé les
fondements. À deux titres : d'abord, en donnant la
première formulation de cette idée, devenue depuis
le cliché par excellence, à savoir que les habitants
de l'Amérique n'avaient pas d'« histoire », qu'ils
n'avaient qu'une « géographie » (en passant, pour
Bodin, c'était aussi le cas des peuples slaves et
africains); ensuite, en réactualisant les théories des
climats, qu'il avait trouvées chez les auteurs de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%