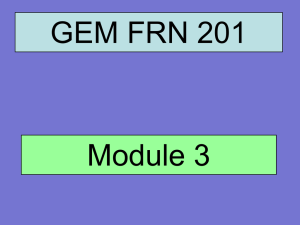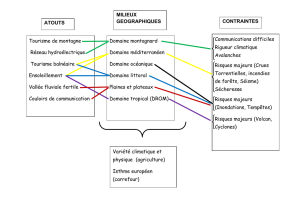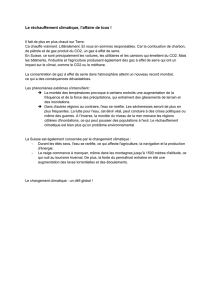L`expérimentation d`un modèle socio-constructiviste

L’expérimentation d’un modèle socio-constructiviste …
__________________________________________________________________________________
1
L’expérimentation d’un modèle socio-constructiviste
d’éducation au changement climatique
Diane Pruneau, Hélène Gravel, Wendy Bourque
et Joanne Langis, Université de Moncton
Le projet de recherche présenté dans cet article fait suite à une étude menée auprès de
190 personnes pour connaître leurs idées au sujet du changement climatique. Ces personnes
avaient exprimé leurs connaissances, leurs croyances et leurs impressions au sujet de la nature
du phénomène, de ses causes, de ses signes, de ses conséquences possibles et des gestes à poser
pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. L’étude menée en 2000, à Montréal et à
Moncton, au Canada, et auprès d’adultes, d’adolescents et d’enfants (Pruneau, Liboiron et
coll., 2001), avait permis d’identifier, chez de nombreux répondants, la présence des idées
suivantes :
- le changement climatique est un réchauffement général du climat, causé par des facteurs
inconnus ou par l’amincissement de la couche d’ozone;
- les signes du changement climatique sont encore peu visibles dans mon milieu;
- le changement climatique est peu préoccupant car celui-ci n’aura probablement pas de
conséquences dans ma propre vie (surtout si j’habite en ville);
- une température plus chaude peut être agréable;
- les humains ne peuvent pas vraiment influencer le climat;
- la population en général n’acceptera pas de modifier ses comportements par souci de
protéger l’équilibre climatique.

L’expérimentation d’un modèle socio-constructiviste …
__________________________________________________________________________________
2
Suite à ces résultats, un modèle d’éducation au changement climatique a été élaboré.
Dans cet article, nous expliquons ce modèle et nous le justifions au plan conceptuel. Nous
racontons ensuite le projet Jeunes visionnaires
1
durant lequel le modèle pédagogique a été
expérimenté avec 39 adolescents de 13-14 ans dans deux communautés côtières canadiennes.
La méthode de recherche employée est enfin décrite ainsi que les résultats de l’expérimentation
du modèle sur les idées des jeunes au sujet du changement climatique. Nous terminons
l’article en effectuant une analyse critique du modèle afin de proposer des interventions
pédagogiques plus efficaces.
Cadre théorique
Le changement climatique est un phénomène global, encore méconnu dans ses
particularités locales, et dont on entend souvent parler par les médias. Les notions de
climatologie expliquant la situation sont complexes et les points de vue des scientifiques
diffèrent lorsque ceux-ci tentent d’identifier les causes et les conséquences du changement
climatique. De même, le jeune âge des adolescents implique que ceux-ci n’ont généralement
pas été témoins d’un climat différent de celui d’aujourd’hui. Pour toutes ces raisons, il est
normal que le changement climatique apparaisse comme un événement qui risque d’être
catastrophique dans un futur lointain. Il devient alors difficile d’inciter les personnes à
modifier les comportements quotidiens, bien ancrés dans le mode de vie nord-américain, tels
que conduire son automobile et consommer une importante quantité de ressources.
1
Le projet Jeunes visionnaires a été subventionné par le fond d’action pour le changement climatique du Canada
et par le Fond en fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick. Les auteures remercient ces organismes
pour leur confiance et leur contribution financière.

L’expérimentation d’un modèle socio-constructiviste …
__________________________________________________________________________________
3
Pour faire comprendre un problème environnemental complexe, méconnu et peu facile
à saisir dans ses dimensions spatiales (locales) et temporelles, quelles sont les stratégies
pédagogiques qui peuvent être mises à profit? L’enquête précédente effectuée à Montréal et à
Moncton démontre bien que le changement climatique est encore peu connu et suscite pour
l’instant peu de préoccupations réelles. Le modèle pédagogique que nous proposons représente
un premier essai dans la recherche de méthodes d’enseignement adaptées à ce problème
environnemental et qui assureraient une prise de conscience et une connaissance du
phénomène, ainsi qu’un désir de modification de comportements.
Le modèle élaboré et expérimenté sur la côte est du Canada se composait des
interventions pédagogiques suivantes :
- inviter les adolescents à effectuer une étude locale du changement climatique : observer ses
signes tangibles, ses causes dans le milieu, et prédire ses conséquences possibles;
- à la façon des scientifiques, leur permettre de se construire une opinion personnelle sur le
changement climatique;
- leur présenter des représentations graphiques simples de l’effet de serre;
- leur fournir l’occasion d’accomplir une action de groupe pour protéger l’équilibre climatique;
- les mettre en situation d’apprécier les éléments naturels de leur milieu (afin de les aider à
vouloir conserver ces éléments au lieu d’envier les composantes d’un climat plus chaud);
- leur permettre de communiquer leurs nouvelles connaissances sur le changement climatique.
Au plan théorique, le modèle conçu est socio-constructiviste, expérientiel et vise la
prise de conscience tangible du changement climatique grâce à des observations locales.
L’usage de représentations graphiques simples pour illustrer l’effet de serre s’inspire d’Hyerle

L’expérimentation d’un modèle socio-constructiviste …
__________________________________________________________________________________
4
(1996) qui suggère cette stratégie pour enseigner des concepts scientifiques complexes. On
vise ici à aider les élèves à bien distinguer l’effet de serre de l’amincissement de la couche
d’ozone. Le modèle comporte également une dimension éducation au futur (Hicks, 1996;
Ziegler, 1991) dans laquelle on invite les adolescents à visualiser les éléments possibles qui
pourraient composer leur vie dans l’avenir et à réfléchir aux effets de ces éléments.
L’éducation au futur exerce un rôle d’empowerment : les apprenants réalisent qu’ils détiennent
le pouvoir de modifier leur avenir. Suite à l’observation des signes locaux et des sources
d’émissions, les élèves ont été invités à prédire ce qui pourrait arriver quand ces signes et ces
émissions seront devenus plus abondants. Le modèle met également à profit des techniques
courantes d’éducation relative à l’environnement : les visites sensorielles sur le terrain et
l’accomplissement d’une action environnementale. Les visites sensorielles favorisent
l’appréciation et la relation avec le milieu naturel alors que la réalisation d’une première action
environnementale encourage l’exécution d’actions ultérieures (Pruneau, Chouinard, Arsenault
et Breau, 1999). Les apprenants éprouvent souvent de la fierté en accomplissant une action
environnementale et ils deviennent conscients de leur capacité de réaliser ce type d’action
(Pruneau, Gravel et Ouattara, sous presse).
Le changement conceptuel
L’aspect socioconstructiviste du modèle pédagogique est inspiré des théories sur le
changement conceptuel. Le changement conceptuel se définit comme « un processus de
développement conceptuel des idées initiales des élèves vers des conceptions plus
scientifiques » (Duit, 1999, p. 265). Durant ce « processus graduel, les structures conceptuelles
initiales basées sur les interprétations enfantines des expériences quotidiennes sont

L’expérimentation d’un modèle socio-constructiviste …
__________________________________________________________________________________
5
continuellement enrichies et restructurées » (Vosniadow et Ioannides, 1998, p. 28). Le
processus cyclique est caractérisé par plusieurs phases de travail inductif et déductif (Hewson,
Beeth et Thorley, 1998). C’est ainsi que le changement conceptuel suppose une modification
importante des idées initiales des élèves au sujet d’un phénomène, vers des conceptions plus
semblables à celles des scientifiques. Cette modification des idées initiales peut être :
- complète : l’ancienne conception est totalement remplacée par une nouvelle conception
(Hallden, 1999);
ou
- périphérique : l’idée initiale persiste et est incluse dans la nouvelle conception (Duit, 1999).
De façon plus spécifique, plusieurs transformations peuvent s’opérer dans les idées initiales des
élèves suite à un changement conceptuel : des concepts
2
peuvent être additionnés ou soustraits
(Nersessian, 1991), des liens entre les concepts peuvent également être ajoutés ou enlevés ou la
structure des idées initiales peut être radicalement modifiée (di Sessa et Sherin, 1998).
En apprentissage des sciences, la constatation d’un changement conceptuel chez les
élèves constitue une preuve tangible qu’il y a eu apprentissage. L’objectif du changement
conceptuel n’est toutefois pas facile à atteindre. Les élèves débutent une leçon ou un thème de
sciences avec des croyances solides et bien ancrées au sujet d’un phénomène scientifique et de
ses relations avec d’autres phénomènes (Thouin, 1997). Plusieurs situations peuvent se
produire et limiter le changement conceptuel :
- la compréhension du phénomène peut s’avérer trop difficile (Garrison et Bentley, 1990);
2
Legendre (1988) définit un concept comme « une représentation mentale et générale des traits stables et
communs à une classe d’objets directement observables, et qui sont généralisables à tous les objets présentant les
mêmes caractéristiques » (p. 11)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
1
/
34
100%