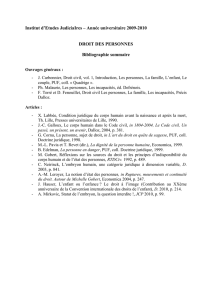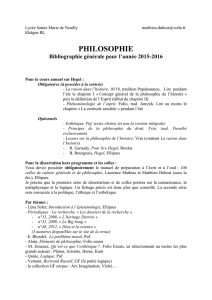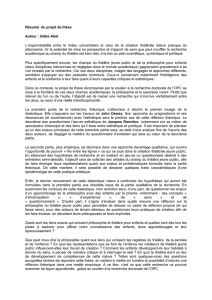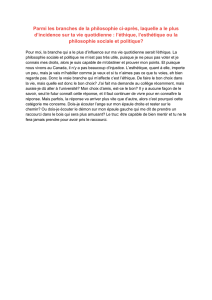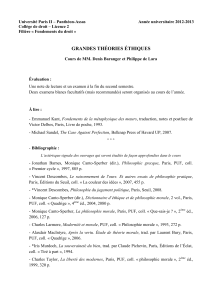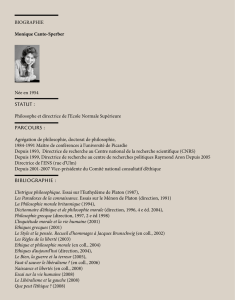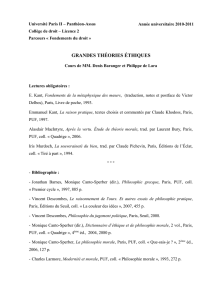II. La critique de l`œuvre d`art : pré-texte ou connaissance

- I -
THESE DE PHILOSOPHIE – ÉPISTEMOLOGIE :
«
«
L
LE
E
S
SA
AV
VO
OI
IR
R
A
A
L
L’
’Œ
ŒU
UV
VR
RE
E
»
»
Mots-clefs :
Activité, compétence, connaissance, critique d’art, critique des sciences, critique,
discours, entreprise, épistémologie, ergologie, habileté, humain, langage, objectivité,
œuvre d’art, œuvre, philosophie, savoir, savoir-être, savoir-faire, science, subjectivité,
technique, travail artistique, travail, vie.
Auteur :
M. HULIN THIBAUD
(Titulaire d’une Bourse d’Allocation de Recherche)
ADR. : 5, AV. M. BLONDEL
13100 AIX-EN-PROVENCE
TEL. : 06.07.86.09.43
04.42.93.27.01
MAIL : THIBAUD.HULIN@LIBERTYSURF.FR
Directeurs de la thèse (co-tutelle) :
M. SCHWARTZ YVES (PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE, MEMBRE DE L’INSTITUT
UNIVERSITAIRE DE FRANCE, DIRECTEUR DU DEPARTEMENT APST-ERGOLOGIE,
UNIVERSITE DE PROVENCE)
M. COMETTI JEAN-PIERRE (MAITRE DE CONFERENCES HABILITE, UNIVERSITE DE
PROVENCE)

- II -
PLAN
Introduction……………………..…………………………………………………………III
I. La connaissance au travail : Savoir, Savoir-faire, Savoir-être et Compétence ... IV
A) L’approche traditionnelle ................................................................................ IV
B) Les mutations de l’évaluation des compétences ............................................... V
C) Approches philosophique de la compétence ................................................... VI
II. La critique de l’œuvre d’art : pré-texte ou connaissance ? ............................... VIII
A) La science de l’art......................................................................................... VIII
B) Echecs de la tentative de réification de l’art .................................................... IX
C) Le critique d’art ................................................................................................ X
III. Sur l’objectivité du discours scientifique - vers une épistémologie des activités
humaines .................................................................................................................................. XI
A) La science objective ........................................................................................ XI
B) Incertitudes scientifiques ................................................................................ XII
C) Pour une épistémologie des activités humaines ........................................... XIII
Conclusion…………………………………………………………………………...……XIV
Bibliographie………………………………………………………………………………XV
I. Histoire de la Philosophie ................................................................................……XV
II. Travail .................................................................................................................... XVI
III. Esthétique ........................................................................................................... XVII
IV.Epistémologie…………………………..……………………………………..XVIII
*
* *

- III -
INTRODUCTION
Nous voudrions partir d'un mot de Salvador Dali, cité par B. Jarrosson (p. 179) : "ce
que je connais le mieux, ce sont les côtelettes, parce que je les mange".
Sous son apparence anecdotique, le peintre évoque un problème considérable pour la
philosophie de la connaissance. En effet, la séparation entre sujet et objet semble être à la fois
la condition sine qua non et l'obstacle fondamental à l'activité de connaissance. La fusion de
l'objet et du sujet, ou l'assimilation de l'un par l'autre semble être la seule réponse possible à la
volonté de savoir. Ainsi, l'analyse des activités humaines qui investissent l'action dans un
objet offre un terrain privilégié pour l'épistémologue, relativement à la question du processus
réel du connaître. En effet, le savoir, lorsqu'il n'est pas pure contemplation de son objet de
connaissance, guide l'action : il peut-être alors l'occasion d'une immersion dans un pro-jet ou
dans une œuvre. Comment le savoir, de contenu immatériel, en vient-il à remplir un objet
matériel ? Et surtout, quel est son statut ? En effet, le savoir à l'œuvre est de nature très
opaque, il ne se transmet pas aisément, il est souvent rétif à la mise en mot. Deux exemples
nous en convaincront.
D'une part, les productions industrielles sont l'objet de savoir-faire, qui constituent un
capital dont on redécouvre actuellement toute la valeur. Cependant, l'attention récente
accordée à ce type de savoir n'est pas sans soulevé de nombreux problèmes. Notamment, il
pose la question de la reconnaissance de ceux qui en sont les possesseurs, ce qui entraîne un
ébranlement des grilles traditionnelles de classification des emplois et d'évaluation des
salaires. En somme, si l'artisan, l'ouvrier, etc., possède un savoir propre, celui-ci rivalise en
quelque sorte avec le savoir de l'ingénieur ou du chef d'entreprise, dont sa position sociale
dépendait de sa formation scientifique.
D'autre part, les œuvres d'art apparaissent comme un cas particulier des produits
artefactuels. Le travail de l'artiste qui lui a présidé est davantage individualisé, personnalisé. Il
ne requiert cependant pas moins la maîtrise de certaines techniques propres à son art, qu'il a
parfois puisé chez des maîtres du passé. Si l'attention aux œuvres d'art a pu se définir comme
un mode particulier de connaissance, c'est bien que le faire artistique requière déjà un savoir
préalable qui s'investit dans un objet ou dans une action dite artistique. Ce savoir, en outre, est
l'occasion d'interrogations profondes de la part du spectateur ou de l'amateur, qui souvent est
en quête de connaissances censées éclaircir l'expérience esthétique à laquelle il se confronte.
Il est à noter que la séparation des activités artistiques et des activités industrieuses ne
date que de deux siècles seulement ; en outre, elle n'est pas une distinction naturelle, mais un
fait social caractéristique de la société du début du 19ième siècle. Pourtant, il existe bien une
professionnalisation de l'artiste qui a suivi une formation relative à son art. Et la sublimation
du phénomène artistique au désavantage du métier manuel ne peut-être qu'un choix
axiologique qui dépend de la culture : il y a du gestuel dans l'art, et du savoir dans le métier.
Plus fondamentalement, nous voudrions attirer l'attention sur les problèmes similaires
que rencontrent ceux qui se confrontent à la réalité de ces pratiques. En effet, la pensée
positiviste a pu propager l'idée que l'étude de l'art pouvait donner lieu à l'usage de méthodes
scientifiques. De l'autre côté, le taylorisme s'est imposé dans sa tentative de décrire de façon
"rationnelle" le travail humain. Or, il faut ici s'étonner de ce que ces volontés se sont avérées

- IV -
tout à fait insuffisantes pour cerner le processus réel de l'activité de l'homme à l’œuvre, cédant
ainsi en faveur de méthodes beaucoup plus souples et cependant bien plus adaptées.
*
* *
I. La connaissance au travail : Savoir, Savoir-faire, Savoir-être et
Compétence
A) L’approche traditionnelle
Le problème de l’évaluation des compétences s’est posé récemment, il fait suite au
constat d’une crise de l’évaluation traditionnelle. Ce que nous désignons donc par ce terme
correspond à la conception tayloriste du travail qui s’est imposée au milieu du XXième siècle
comme la véritable approche rigoureuse de ce concept. En effet, la séparation
conception/exécution telle qu’elle fut pratiquée par l’Organisation Scientifique du Travail ne
suggère qu’une seule voie pour l’évaluation des compétences : la fidélité aux normes prescites
par autrui, et la performance réalisée, en fonction d’un étalon de mesure définit à nouveau par
les mêmes prescipteurs. The one best way suppose par conséquent la définition d’une
perspective unique du travail bien fait, laquelle répond à une définition qualitative qui répond
par-là aux outils dénommés « scientifiques » par l’Organisation citée. D’autre part,
l’attribution d’une seule tâche à un même individu permet ici encore de « cloisonner »
l’activité de travail, épurant ainsi l’activité de tout élément hétérogène, non essentiel à
l’exécution du travail prescrit.
Les limites de ces définitions n’ont cessé de s’imposer aux acteurs du processus de
travail ainsi conçu. Cette volonté de simplification du travail humain, le refus de prendre en
considération la spécificité de l’activité réelle a plutôt contribué à l’obscurcir qu’a le penser
plus clairement. Nombre d’ergonomes n’ont cessé de signaler les écarts du travail réel par
rapport au travail conçu. Ainsi l’observation des performances effectives d’un ouvrier
spécialisé, censée fournir les normes du travail en terme de performance, mesurable
quantitativement, s’est avéré insuffisante pour circonscrire la tâche d’un ouvrier spécialisé.
C’est que la dynamique des normes de vie, inhérentes à l’être humain au minimum, ne peut se
soustraire à la définition d’une norme unique (the one best way), quand bien même elle est
tirée d’une moyenne supposée. La construction d’un modèle unique ou général de l’activité de
travail n’a donc cessé, à la suite des principes de F. W. Taylor, puis du fordisme, de multiplier
les mesures et les observations de tâches. On peut dire que cette volonté de diviser le temps
d’une activité selon l’espace, et l’espace de travail à partir d’une quantification des gestes
corporels, est un échec. Celui-ci trouve sa source à la fois dans un contexte économique qui
requiert une main d’œuvre massive, que dans une méconnaissance de l’activité de travail,
dans la confiance excessive envers des méthodes dites scientifiques (susceptibles de

- V -
quantifications diverses), et peut-être aussi dans un certain mépris de la main d’œuvre
concernée
1
, laquelle va sans doute de paire avec cette ignorance.
Dans les années 1960-70, les critiques des principes du taylorisme se sont multipliées,
et l’on a commencé à mesurer les pertes désastreuses que la prééminence de cette conception
a engendré, notamment en terme de capital de travail. La dénonciation du travail "préconçu",
qui devait s’accompagner de la réduction spectaculaire du nombre des ouvriers, n’a cependant
pas conduit à envisager le travail manuel différemment. On peut donc parler d’un véritable
paradigme du travail dominant une grande part du XXième siècle, lequel ne cesse de subir les
coups de boutoir de ceux qui étudient l’activité singulière et concrète depuis une trentaine
d’années.
B) Les mutations de l’évaluation des compétences
On peut dire que les tentatives pour sauvegarder les principes de la conception
taylorisée du travail ont conduit à un « taylorisme flexibilisé », en tant qu’il conserve sa
méconnaissance du travail concret, mais en prêtant davantage oreille aux dynamiques
nouvelles des organisations. A une logique de technique et de rendement, il fallut bien céder à
une logique cognitive, de spécialisation des firmes et des agents. L’automatisation cède place
progressivement à l’autonomie du travailleur, et on assiste, ici et là, à des initiatives originales
qui préfèrent une gestion multiple du travail à une coordination supposée prévisionnelle ;
l’idée d’une main d’œuvre qualifiée a donc enfin été retrouvé après un silence de près de deux
siècles.
L’idée de qualification professionnelle s’est donc imposée, en France, à la suite d’une
volonté de faire disparaître les grilles de salaires minimums en dessous du SMIC dans les
années 80, en même temps qu’une création croissante des formations qui les valident. De son
côté, la politique de professionnalisation des entreprises a favorisé un système de postes plus
ouvert, propice à la progression du salarié selon ses capacités propres. Les grilles de
qualification sont ainsi solidaires de systèmes de rémunération. Cependant, la classification
des emplois, qui regroupent désormais postes et fonctions, admet une variabilité relative au
type de l’entreprise et à son mode de production. A cette armature socio-économique se
joignent des dispositifs juridiques, qui légifèrent des contrats de qualification, associant temps
de travail et temps de formation.
Pourtant, le déplacement progressif de l’idée de qualification professionnelle vers celle
de compétence n’est pas sans évoquer de nouveaux enjeux au travail. L’usage de tests,
d’entretiens et d’autres évaluations initiales sans rapport est aujourd’hui systématique, et
décident prioritairement de l’embauche. Au-delà d’un départage nécessaire des candidats, ces
procédures visent à explorer les capacités et motivations profondes du futur salarié, à
apprécier ses connaissances concrètes et son comportement futur. S’il est vrai que la
personnalité du salarié n’a pas, théoriquement, à être confondue avec l’aptitude à exécuter une
tâche donnée ou à accomplir une fonction, cependant le bon fonctionnement de l’entreprise
1
Cf. l’idée de « flânerie systématique », idée maîtresse de Shop Managment de F. W. Taylor (1903).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%